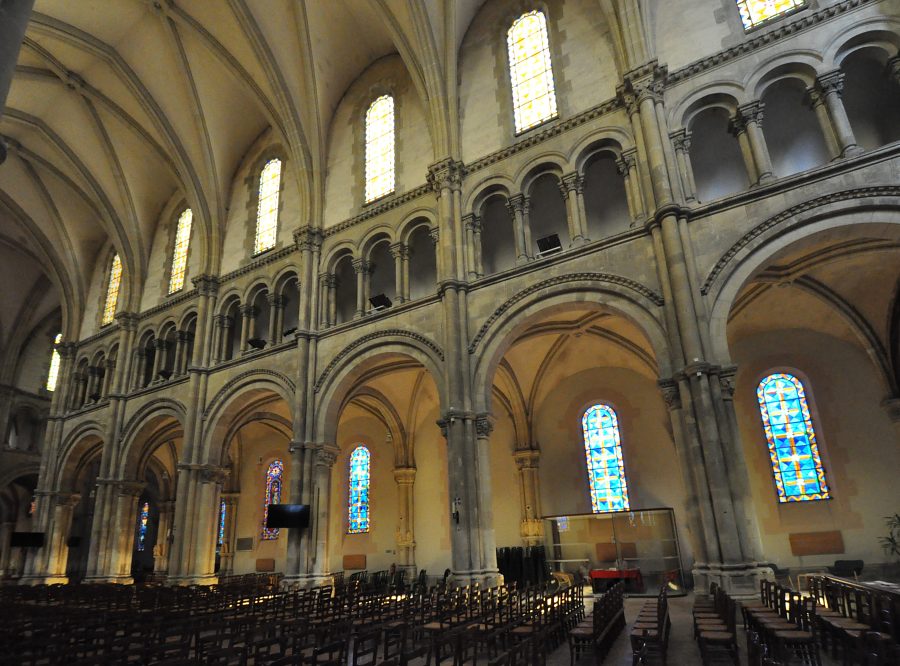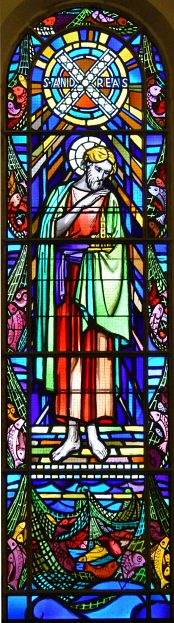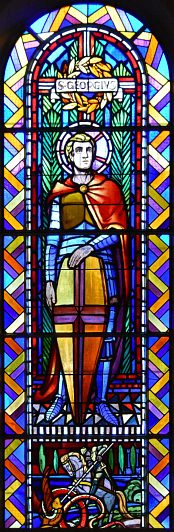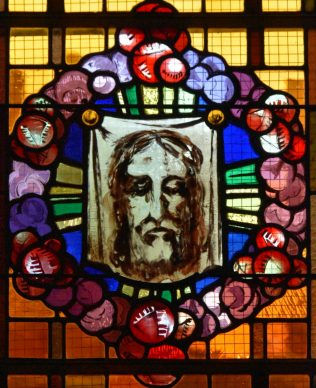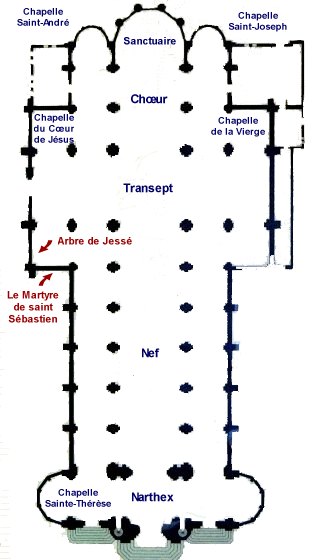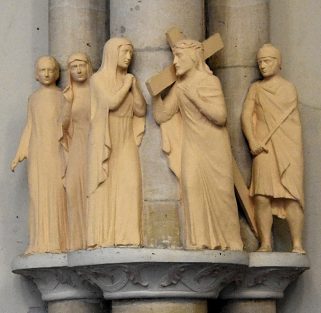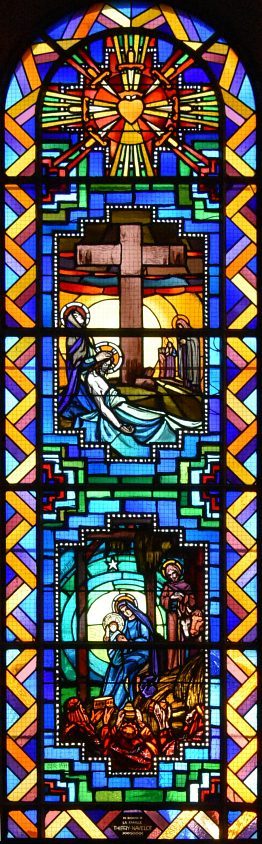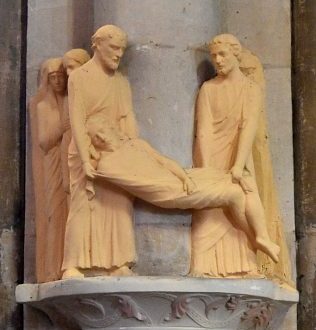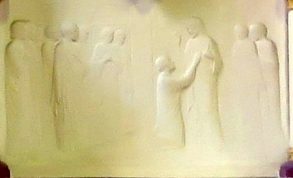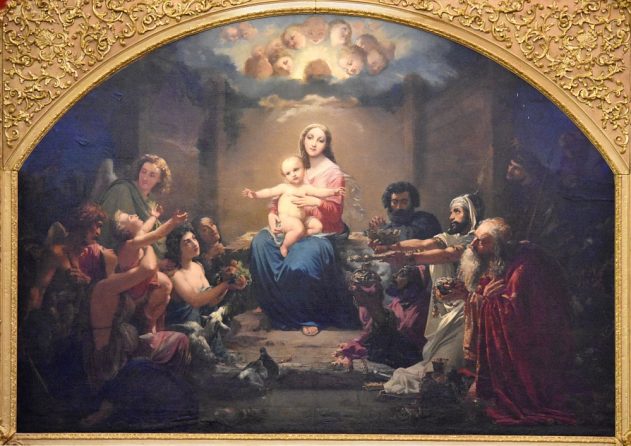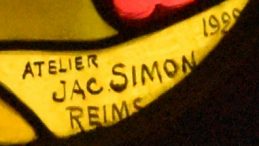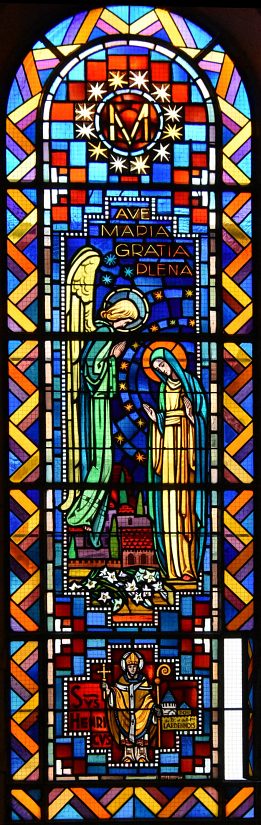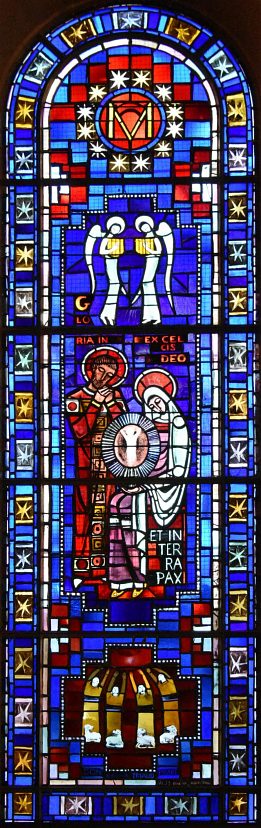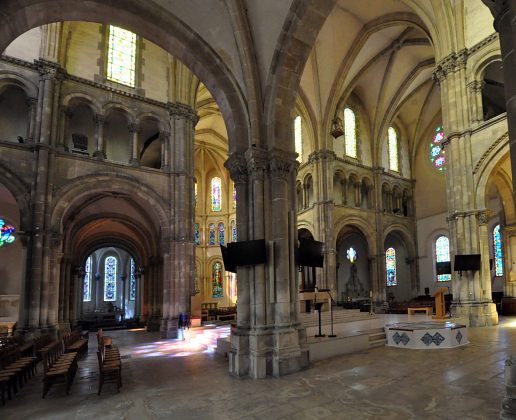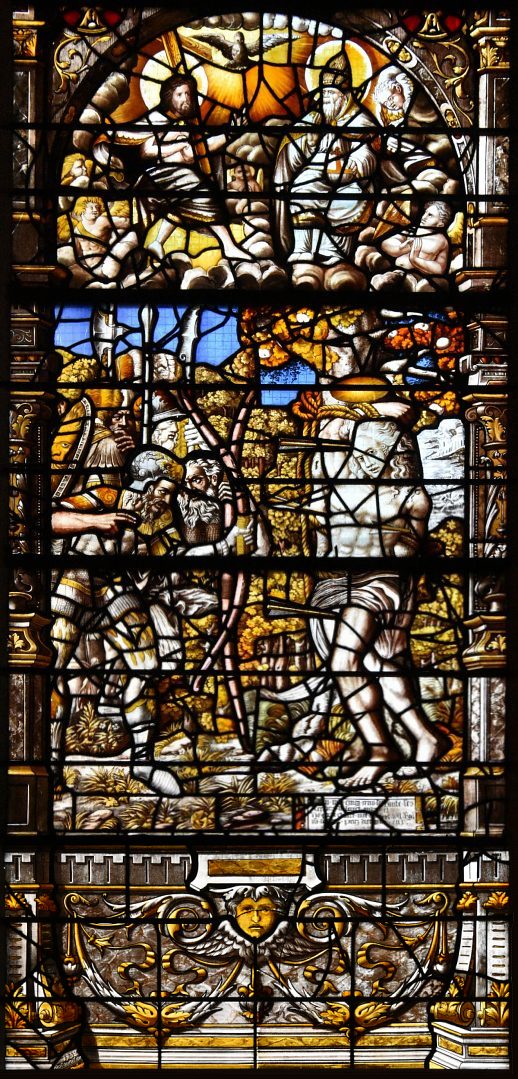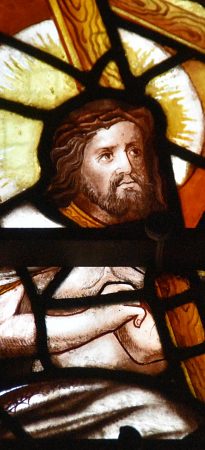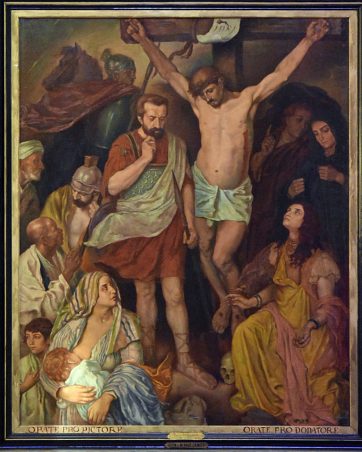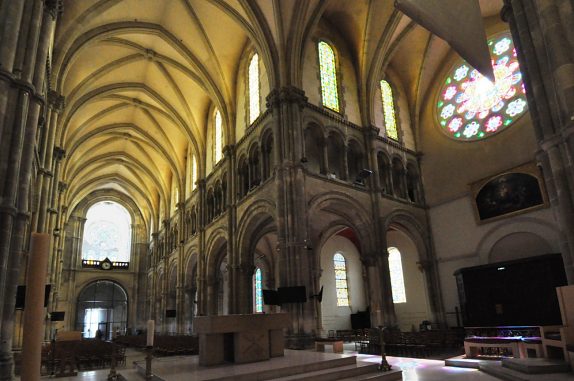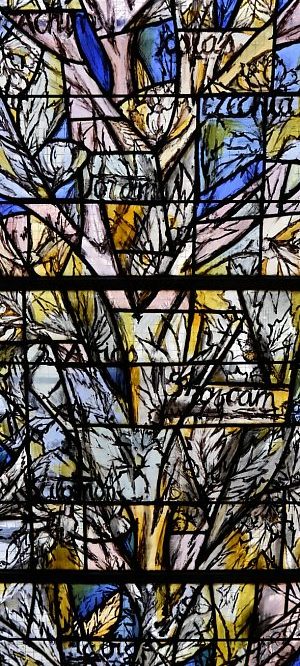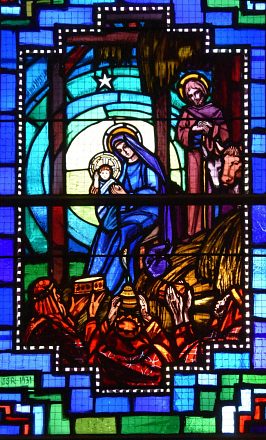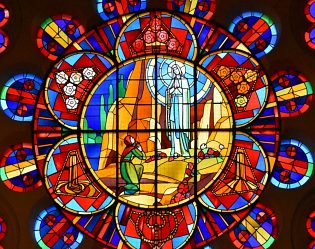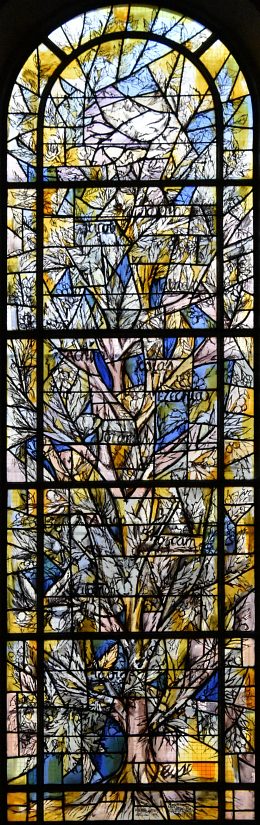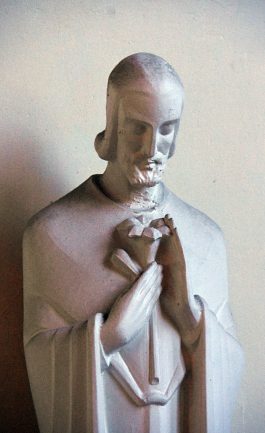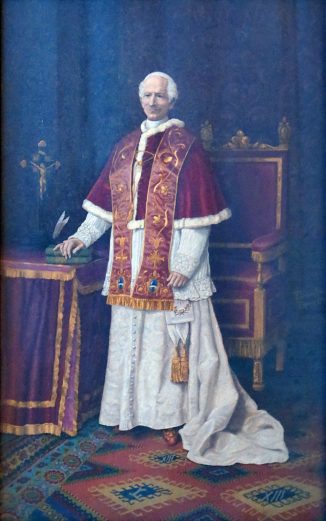|
|
 |
 |
Au Moyen Âge, le quartier où
se trouve l'église Saint-André actuelle se situait
au niveau de la Porte de Chacre, en dehors des remparts de la ville.
La première mention connue d'un édifice cultuel rémois
dédié à saint André se trouve dans une
bulle du pape Innocent IV, datée de 1251. Celui-ci promet
des indulgences à ceux qui visiteront l'oratoire aux jours
de la Saint-André et de la Sainte-Catherine. Cet édifice
a été détruit pendant la guerre de Cent Ans
alors que le roi Édouard III faisait le siège de Reims
(décembre 1358 - mars 1360), le but du souverain anglais
étant de prendre la ville pour s'y faire sacrer roi de France.
Devant l'âpreté des défenseurs, il dut renoncer
à son projet.
En fait, l'église a été détruite par
les soldats français du capitaine Gaucher de Châtillon,
chargé de la défense de Reims.
L'édifice s'élevant trop près des remparts,
Gaucher estima qu'il pouvait servir de point d'appui à l'assiégeant.
D'autres bâtiments, eux aussi à l'extérieur
des remparts, subirent le même sort.
Les historiens de la ville supposent que l'édifice a été
reconstruit rapidement, puis à nouveau détruit en
1475 quand Reims
fut menacée d'une nouvelle attaque anglaise. En effet, le
roi York Édouard IV, reprenant à son compte la volonté
de son aïeul, fit débarquer son armée à
Calais et l'engagea dans une chevauchée en Picardie et en
Champagne. Cela ne mena pas loin : le roi Louis XI versa des subsides
à l'ennemi pour lui faire quitter la France.
En 1529, les habitants du faubourg, qui dépendaient de la
paroisse Saint-Symphorien, demandèrent l'autorisation au
chapitre de bâtir une chapelle (toujours dédiée
à saint André). Aussitôt élevée,
ils s'adressèrent au cardinal de Lorraine pour qu'elle fût
reconnue succursale de Saint-Symphorien, une façon pour elle
d'acquérir de nouveaux droits et de gagner son indépendance.
En 1560, ils obtinrent gain de cause : un prêtre y résidera
désormais en permanence et la chapelle sera agrandie et dotée
de fonts baptismaux.
Pendant les guerres de Religion, les maisons du faubourg Saint-André
sont rasées. L'église subsiste. Les habitants se réfugient
à l'intérieur des remparts. Quand la paix revient,
il faut reconstruire les maisons, mais l'église est en ruine.
Les faibles moyens disponibles iront d'abord aux habitations ; l'édifice
cultuel se contentera des restes.
En 1686, l'église devient une cure indépendante et
peut donc toucher des revenus. On peut ainsi la remettre à
neuf.
En 1793, sous la Terreur, elle est transformée en grange.
Après la Révolution, elle est réaffectée
au culte, et désormais rattachée à la cathédrale
Notre-Dame.
Au XIXe siècle, le renouveau du catholicisme aidant, l'édifice
est bientôt jugé rudimentaire et d'une capacité
insuffisante pour une population qui s'accroît. Aussi une
nouvelle église est-elle construite de 1859 à 1865, à
côté de la première, par l’architecte diocésain
Narcisse Brunette (1808-1895). L'ancien édifice est ensuite
rasé.
En septembre 1914, les Allemands tirent au canon sur Saint-André
(comme sur la cathédrale) qu'ils soupçonnent de servir d’observatoire
d’artillerie. En 1917, l’église est incendiée par de nouveaux bombardements
allemands.
La reconstruction, engagée en 1929, ne copiera pas l'original.
Le clocher sera rebâti plus haut. Il culmine à présent
à 88 mètres, ce qui en fait le plus haut édifice religieux
de Reims.
Saint-André ne suit pas la règle de l'orientation
habituelle : la façade est en effet dirigée quasiment
au sud. Dans cette page, ce sont donc les directions liturgiques
qui sont employées (avec un chœur
supposé être à l'est).
En 1914, tous les vitraux
du XIXe siècle ont été brisés. Ils seront
remplacés dans les années 1930 par des créations
de l'atelier rémois Jacques Simon. Néanmoins,
l'église possède un grand vitrail Renaissance (mis
à l'abri en 1914-18) illustrant le Martyre
de saint Sébastien.
|
 |

L'église Saint-André vue depuis le narthex.
Dans une élévation à trois niveaux, l'église présente un composé néo-roman
et néogothique parfaitement homogène. |

Après les fouilles archéologiques achevées
en 2024,
l'entrée méridionale donne maintenant sur une
petite esplanade. |
|
Architecture
extérieure.
Le clocher culmine à 88 mètres.
Saint-André est ainsi le plus édifice
religieux de Reims.
Si la façade et son élévation relèvent
clairement du style néo-roman, les arcs-boutants
et les contreforts sur les côtés ont de
quoi étonner. Sont-ils là pour une raison structurelle
ou est-ce simplement une fantaisie stylistique voulue
par l'architecte ? Quoi qu'il en soit, ils impriment
une touche nettement néogothique au profil de l'église
qui en devient ainsi un édifice au style hybride.
L'église date de 1865 et ce mélange des
genres n'était pas rare sous le Second Empire.
Quant au chevet (photo plus haut), les absidioles et
les fenêtres en plein cintre lui donnent aussi
un goût néo-roman, mais la large taille
des fenêtres, laissant moins de place à
la maçonnerie, trahit aussi une structure néogothique.
|
|

Portail latéral néo-roman de l'église. |
|
|
|
|

Le narthex est séparé de la nef par de grandes
baies vitrées. |
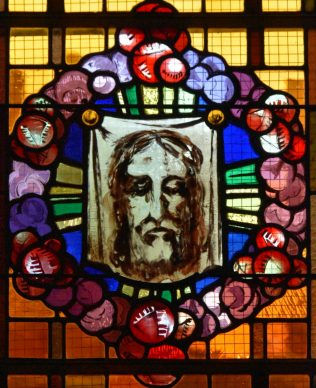
La Sainte Face orne un vitrail de la chapelle Sainte-Thérèse,
1930-32. |

Sainte Thérèse de Lisieux
par Gabriel Paulin-Paris, XIXe siècle. |
|

Chapiteaux néo-romans dans le narthex. |

Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus
dans le narthex. |
|
| ARCHITECTURE INTÉRIEURE
: LA NEF ET LES BAS-CÔTÉS |
|
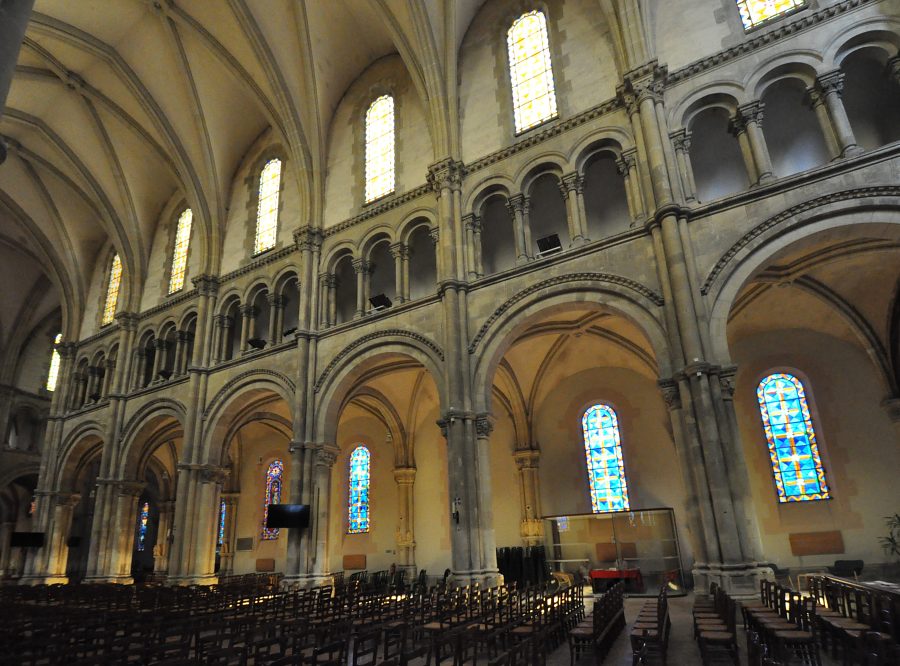
Dans toute l'église, les élévations sont sur trois niveaux.
Ici l'élévation sud.
Les arcs en plein-cintre rappellent le néo-roman ; les voûtes
d'ogives
et la taille des grandes fenêtres au troisième niveau
font penser au néogothique. |
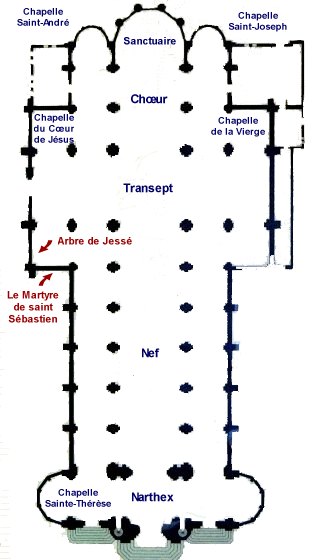
Plan de l'église Saint-André.

L'église Saint-André mesure 75 mètres de long
pour une largeur au transept de 36 mètres.
Ses voûtes s'élèvent à 22 mètres. |

La croix de la Mission de 1821 est devenue le Grand Calvaire.
|

Le Monument aux Morts, place de la République.
Il a pris la place de la grande croix de la Mission érigée
en 1821. |
|
Le
chemin de croix.
C'est une création, dans les années 1930,
du sculpteur rémois Gabriel Paulin-Paris.
Sur le plan esthétique, il est dommage que la
teinte du matériau utilisé (bois, pierre,
moulage ?) se confonde presque avec celle des
colonnettes en arrière-plan. Une petite couche
de peinture foncée sur ces colonnettes accentuerait
le contraste, donnant ainsi plus de cachet à
l'œuvre de Paulin-Paris.
Pour le constater, passez la souris sur l'image ci-dessous.
|
|
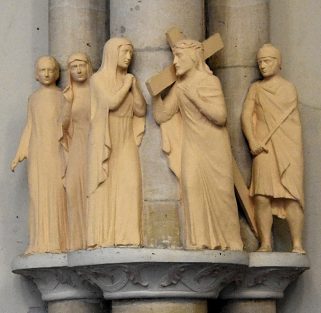
Chemin de croix, station IV : Jésus rencontre sa mère.
Gabriel Paulin-Paris, années 1930. |
Passez la souris
sur l'image pour assombrir l'arrière-plan
et donner un peu de cachet à la sculpture. |
|
|
La
Vierge de la Piéta ---»»
Dans cette scène traditionnelle de la Piéta
(quand Marie reçoit son fils descendu de la croix),
Jacques Simon a peint la Vierge debout, pressant contre
elle le corps du Christ mort.
Le visage de Marie est un peu étonnant. On a
l'habitude de voir la Mère de Dieu (Mater
Dolorosa) diriger vers le Ciel un visage éploré,
acceptant - les yeux ouverts - la volonté divine.
Jacques Simon l'a peinte les yeux fermés. Marie
semble ainsi ajouter à sa douleur une sorte de
profonde méditation. Ce qui renforce l’impression
de souffrance intérieure.
Au Moyen Âge et à Renaissance, quelques artistes ont
représenté Marie de la sorte, mais ce choix reste rare.
|
|
|
|
Architecture
intérieure.
Une fois passé le grand narthex,
le visiteur se retrouve dans un environnement
de couleur ocre, à l'architecture très
homogène : l'élévation, sur
trois niveaux, se prolonge de manière identique
jusqu'à l'abside du chœur.
L'édifice est-il en style néogothique
ou en style néo-roman ?
Les panneaux d'information dans le narthex
parlent d'une église terminée en
1865 en style néogothique par l'architecte
Narcisse Brunette. Le Corpus Vitrearum,
dans le tome consacré aux vitraux de Champagne-Ardenne,
parle, de son côté, de style néo-roman.
En fait, le style emprunte aux deux époques
médiévales et, à ce titre,
on peut le qualifier d'hybride. Il respecte surtout
la tendance stylistique de la seconde moitié
du XIXe siècle, profondément marquée
par les idées d'Eugène Viollet-le-Duc
et de ses élèves. Narcisse Brunette
n'a fait que suivre la vague.
Le profil général des élévations
fait penser au néo-roman, notamment par
ses arcades en plein-cintre, mais le plein-cintre
faisait partie intégrante des principes
de la nouvelle «école» qui
portait le gothique aux nues... Même chose
pour le triforium et ses ouvertures à trois
fenêtres par travée : rien ne s'oppose
à les rencontrer dans une église
romane du XIe siècle. Mais le choix des
trois colonnettes montantes jusqu'à la
retombée des voûtes (photo ci-contre)
se rattache plus à l'époque gothique.
Quant au troisième niveau de l'élévation,
il laisse trop de place à la fenêtre
pour être qualifié de néo-roman.
Des ouvertures de cette taille ne permettraient
pas à un mur roman, de plus forte épaisseur,
de contrebuter efficacement une voûte en
berceau. En cela, il se rapproche du style gothique
qui, lui, aurait carrément inséré
une ouverture plus imposante...
Les voûtes d'ogives au-dessus du vaisseau
central et des bas-côtés, par leur
cachet typiquement néogothique, achèvent
de donner à l'église son côté
hybride, typique de l'époque de sa construction.
|
|

Trois colonnettes accompagnent la retombée
des ogives jusqu'au sol. |
|

Les stations du Chemin de croix s'élèvent le long des piliers
qui ferment les bas-côtés.
Ici : le bas-côté nord (direction prise au sens liturgique). |
|
La
croix de la Mission est devenue le Grand Calvaire.
La Révolution une fois passée, le christianisme
en France connaît une ère de renouveau.
C'est vrai dans la Marne. Les communautés religieuses
se réinstallent ; les curés et les vicaires
nommés sont des ecclésiastiques modérés.
Mais, depuis 1789, le territoire de l'archevêché
de Reims
s'est modifié.
Selon l'Atlas historique des diocèses de France
(Éditions Archives et Culture, 2020),
en 1801, le Concordat réunit le département
de la Marne au diocèse de Meaux. Durant vingt
ans il n'y a plus d'archevêché à
Reims.
L'évêché de Châlons-en-Champagne
disparaît lui aussi. Il faut attendre 1822 pour
que l'archevêché renaisse, amputé
de la partie sud de la Marne, mais élargi à
l'ensemble du département des Ardennes. Les évêques
de Châlons, Soissons, Beauvais
et Amiens
sont alors suffragants de l'archevêque de Reims.
Néanmoins, Monseigneur Jean-Charles de Coucy
sera archevêque de Reims
de 1817 à 1824. À sa mort (1824), il sera
remplacé par Jean-Baptiste de Latil.
La piété populaire s'était tue
à l'ère révolutionnaire. Dès
le début de la Restauration, elle se réveille.
Processions et plantations de croix se multiplient ;
pouvoir politique et pouvoir religieux s'accordent.
Ainsi est organisée à Reims
la grande Mission de 1821 qui culmine le 23 février
par l'érection d'une croix d'une vingtaine de
mètres de haut dans le square de la Mission,
près de l'actuelle place de la République. L'endroit
est maintenant occupé par le monument aux Morts
(photo ci-contre).
Après les Trois Glorieuses de juillet 1830, des esprits
échauffés, violemment opposés au cléricalisme, abattent
la croix en août suivant et la traînent dans la ville
sous les quolibets. Elle peut néanmoins être récupérée.
Cachée à Vervins dans l'Aisne, ce n'est qu'en 1880 que
l'archevêque de Reims,
Monseigneur Langénieux, décide de la dresser dans l'église
Saint-André, avec un bras vertical fortement amputé.
Sa hauteur initiale était en effet de 17 mètres. Les
statues de la Vierge et de saint Jean, disposées de
part et d'autre, l'ont transformée en une croix du Calvaire.
|
|

Le Calvaire, détail : le Christ. |

Chemin de croix, station III :
Jésus tombe sous le poids de la croix.
Gabriel Paulin-Paris, années 1930. |

La Vierge de la Piéta a les yeux fermés : une expression
assez rare. |
|
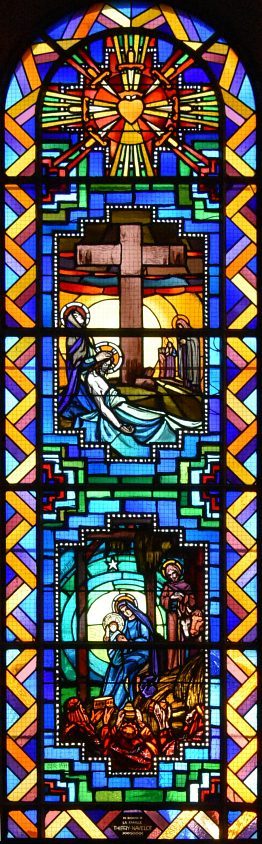
Piéta et Adoration des mages.
Atelier Jacques Simon,
1930-32. |
|

Le Couronnement de la Vierge.
Atelier Jacques Simon, 1930-32. |
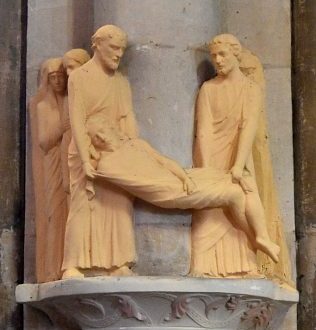
Chemin de croix, station XIV : Jésus est mis dans le sépulcre.
Gabriel Paulin-Paris, années 1930. |
|
Les
vitraux de l'église Saint-André.
Tous les vitraux de l'église sont du XXe siècle,
à l'exception du Martyre
de saint André, daté de 1560,
mais très restauré au XIXe. C'est le seul
vestige de l'importante vitrerie Renaissance qui ornait
l'ancienne église du XVIe siècle, démolie
en 1865.
Cette vitrerie Renaissance est bien documentée.
Le Corpus Vitrearum en donne un résumé.
On y trouvait des thèmes traditionnels : la Visitation,
la Vierge du Calvaire, le Père céleste
entouré d'angelots, la Charité de saint
Martin, ainsi qu'une suite de saints. Certains d'entre
eux présentaient le donateur du vitrail (vraisemblablement
à la Vierge ou au Sacré-Cœur). C'était
le cas du seigneur Lucquy et de sa femme. Plusieurs
de ces verrières portaient la date de 1560.
En 1865, il fallut orner les baies de la nouvelle église
néo-romane. Comme seules deux des verrières
Renaissance furent jugées réutilisables,
on décida de faire recréer une série
de vitraux. Des ateliers de peintres verriers connus
au niveau national furent sollicités, comme Maréchal
de Metz, mais aussi des ateliers locaux : Bourgeois,
Bulteau, Vermonet ou Marquant.
Les obus allemands de la première guerre mondiale
ont malheureusement détruit toute cette production.
De 1929 à 1932, c'est l'atelier rémois
de Jacques Simon qui fut chargé de recréer
la vitrerie de l'église, privilégiant
là encore des thèmes traditionnels. Ce
sont ces verrières qui sont visibles aujourd'hui.
À noter qu'il n'y a pas de vitrail rappelant
le bombardement ou les combats de 1914-18.
En 1959, Brigitte Simon, dans le cadre de l'atelier
de son père, créa un vitrail original
sur le thème de l'Arbre
de Jessé, vitrail que l'on peut voir dans
le bras gauche du transept.
C'est l'atelier Jacques Simon qui fut chargé
de la restauration du vitrail du Martyre
de saint André en 1932. Cette œuvre
du XVIe siècle avait été mise à
l'abri à l'ancien archevêché de
Reims
dès le début du premier conflit mondial.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Champagne-Ardenne,
1992.
|
|
|

La Crucifixion et la Cène.
Atelier Jacques Simon, 1930-32. |

Chapiteau néogothique dans la nef. |

La Vierge du Calvaire, détail. |

Chapiteau néogothique dans la nef. |
| LE TRANSEPT, SES
AUTELS ET SES VITRAUX |
|

Le transept et la nef vus depuis le bras nord (au sens liturgique)
du transept. |
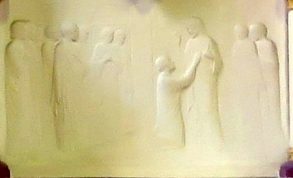
L'Incrédulité de saint Thomas.
Bas-relief de l'autel du Cœur de Jésus. |
 |
|

Chapelle du Cœur de Jésus.
Bras nord du transept.
«««---
Marie-Madeleine devant le Christ ressuscité.
Atelier Jacques Simon, 1930-32 |
|
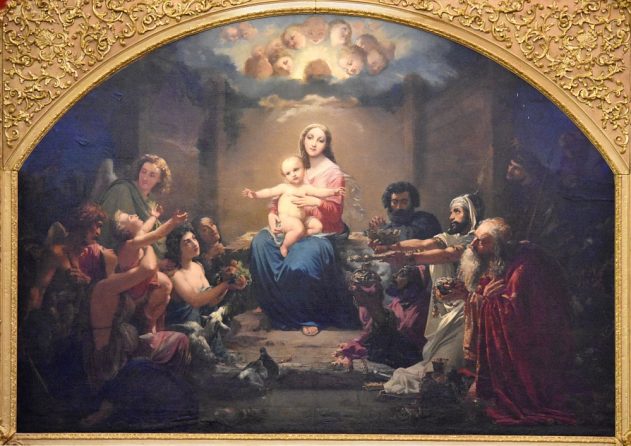
Adoration des bergers et des mages.
Toile d'Henri Lehmann (1814-1882) |

Baie 19 : le Martyre de saint Sébastien.
Vitrail daté de l'année 1560.
Voir plus bas la scène
du Martyre en gros plan. |
|
|
|

La Vierge et l'Enfant.
Atelier Jacques Simon, 1929. |
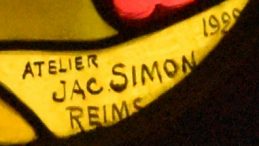
Signature du vitrail ci-dessus : Jac SIMON REIMS 1929. |
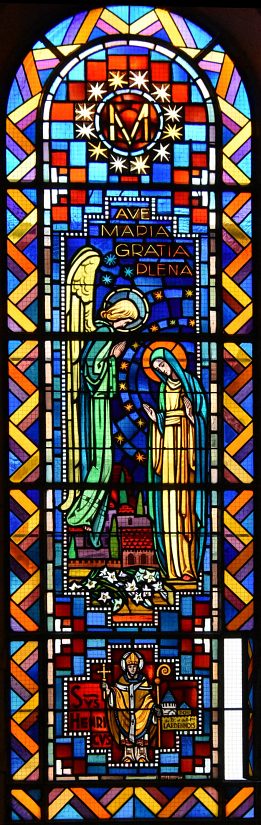
L'Annonciation
Atelier Jacques Simon, 1930-32. |
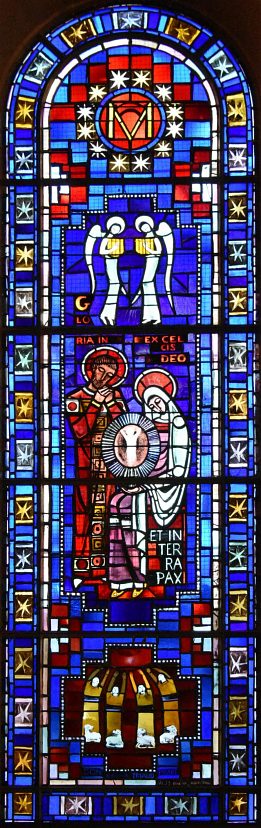
La Nativité.
Atelier Jacques Simon, 1930-32. |

Annonciation et Visitation.
Bas-reliefs de l'autel de la Vierge. |
|
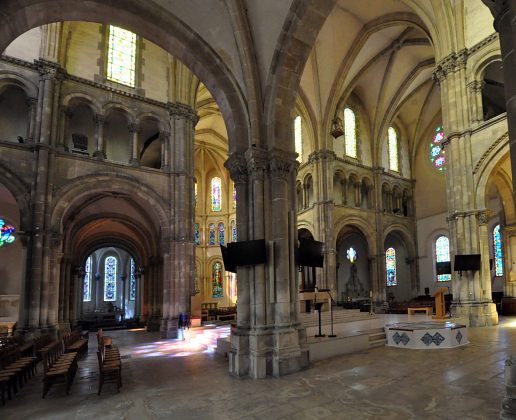
Transept vu depuis le bas-côté nord (pris au sens liturgique).
À l'arrière-plan : le chœur. |
|
Le
Martyre de saint Sébastien, vitrail de 1560 (2/3).
---»» Henri Jadart, conservateur de la Bibliothèque
et du Musée de Reims,
parle en effet, dans son rapport, de trois vitraux d'époque
Renaissance qui se trouvent dans l'église en 1911.
Il y a d'abord une verrière de saint Philippe et saint
Jacques, encadrée par une vitrerie moderne, qui se trouve
dans la sacristie.
Henri Jadart parle ensuite d'une fenêtre dans le croisillon
gauche du transept qui rassemble deux scènes : d'abord,
le Baptême du Christ ; puis, au-dessous, saint Paul
qui bêche la terre, tandis que son disciple Apollos
passe derrière lui pour arroser. C'est évidemment
une allégorie d'un propos de saint Paul dans sa Première
lettre aux Corinthiens : «Moi j’ai planté, Apollos
a arrosé, mais c’est Dieu qui donnait la croissance.»
Selon Henri Jadart, ce vitrail - disparu - comprenait,
en son milieu, l'inscription de quatre lignes donnée
plus haut.
---»» Suite 3/3
plus bas.
|
|
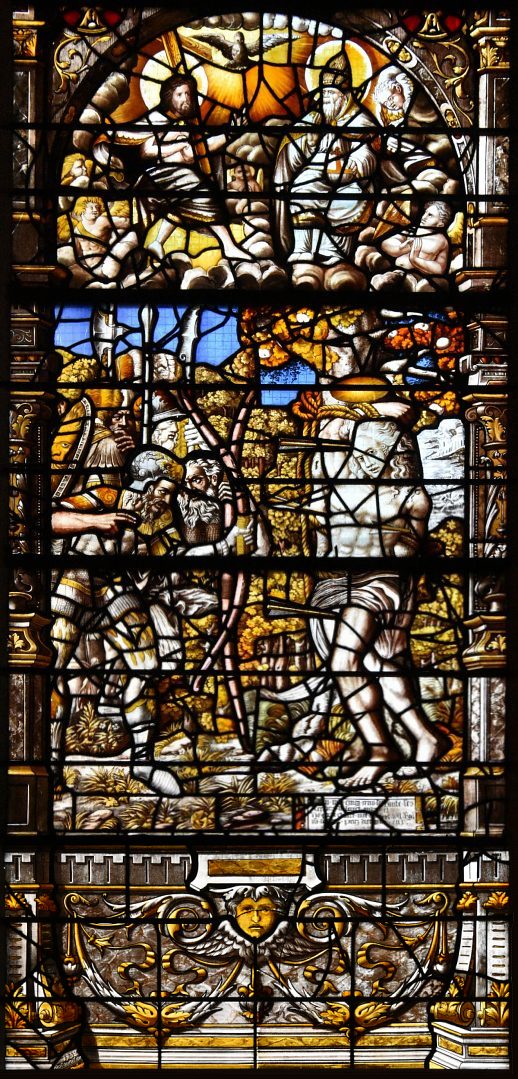
Baie 19, détail : le Martyre de saint Sébastien.
Année 1560. |
|

Entrée de la Vierge au Temple et Éducation de la Vierge.
Bas-reliefs de l'autel de la Vierge. |
|
Les
bas-reliefs de l'autel de la Vierge.
Ces bas-reliefs sont donnés dans les deux photos
ci-dessus. On y voit, d'une part, une Annonciation
et une Visitation ; et, d'autre part, une Présentation
de Marie au Temple accolée à une Éducation
de la Vierge (qui se passe d'ailleurs sous l'œil
attentif de Joachim).
La taille des personnages est clairement surdimensionnée.
Le sculpteur leur a donné la taille de la hauteur
de la niche, voire davantage, forçant ainsi certains
des personnages à pencher la tête. C'est
notamment le cas de sainte Anne et du grand-prêtre
qui accueille Marie au Temple. Ce grand prêtre
est souvent identifié à Zacharie, époux
d'Élisabeth, ce qui ferait de lui un parent par
alliance de la Vierge. Il est d'ailleurs regardé
comme un saint de la Bible.
Bien que cette disproportion soit un peu choquante,
la sculpture néogothique du XIXe siècle
n'en était pas avare. Elle visait à attirer
l'attention sur les personnages, sans considération
de l'échelle induite par la hauteur des niches.
|
|

Baie 19, détail : En 1560, les archers de Saint-André
ont offert cette verrière. |

Baie 19, détail : saint Sébastien.
Année 1560. |

Baie 19, détail : le Père céleste.
Année 1560. |
|
Le
Martyre de saint Sébastien, vitrail de 1560 (3/3).
---»» Le troisième et dernier vitrail se trouvait dans
une fenêtre du croisillon droit du transept. C'est le
Martyre de saint Sébastien. Il insérait une légende
et une date en deux lignes :

Lan mil V LX henry Warnier et pierre failles, Thomas
colbert, guillaume becault, Jehan bouqueton,
Maturin chevalier, tous demourant au bourg portecheque
de Reims, m'ont faict faire.

De ces incohérences, que peut-on conclure ?
Il est vraisemblable qu'Henri Jadart, en rédigeant,
a inversé les deux inscriptions tant il est logique
de voir une corporation d'archers offrir un vitrail
illustrant le martyre de saint Sébastien.
L'autre inscription s'appliquerait donc au vitrail de
Paul bêchant, offert par des habitants du bourg
portecheque à Reims.
De cette verrière restaurée, selon le Corpus Vitrearum,
en 1864, il ne reste rien.
|
|
|

Baie 19, détail : deux archers.
Année 1560. |

Baie 19, détail : paysage en camaïeu derrière saint Sébastien.
Année 1560. |
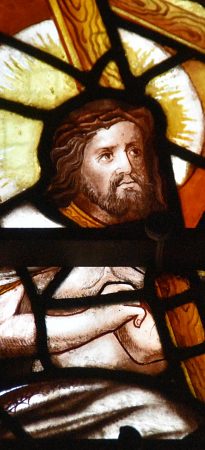
Baie 19, détail : Jésus et sa croix.
Année 1560. |
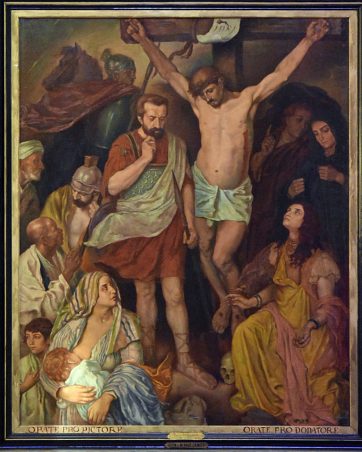
«La Conversion de saint Longin», 1898.
Émile Bernard (1868-1941). |
|
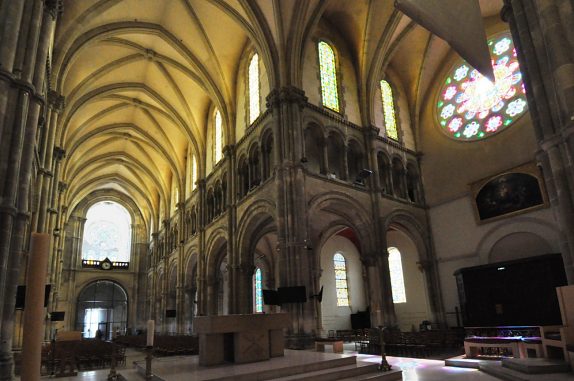
La nef et le bras nord (pris au sens liturgique) du transept
vus depuis la croisée.
Le triforium s'interrompt au niveau des façades du transept. |
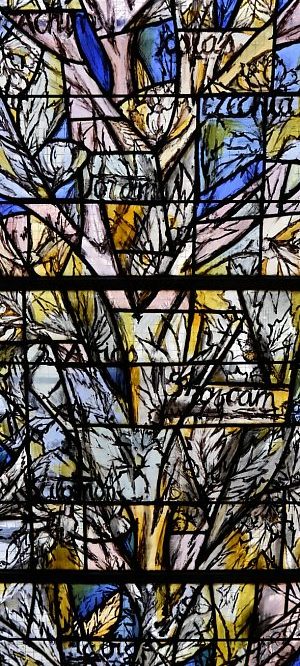
Baie 17, détail : Arbre de Jessé et ses
rois.
Brigitte Simon, 1959. |
|
L'Arbre
de Jessé de Brigitte Simon, 1959.
Ce vitrail prend la notion d'Arbre au pied
de la lettre. En peignant le feuillage d'un chêne
lors d'un mois d'automne, Brigitte Simon donne
toute sa place à la nature arboricole.
Bien qu'elle ne représente les rois que
par leurs noms, son œuvre ne manque pas d'allure.
C'est un agréable mariage de quatre couleurs
où les traits qui strient le vitrail sur
toute sa surface dessinent avec énergie
le tronc, les branches, les brindilles et les
feuilles. Sans doute l'artiste a-t-elle voulu
ainsi rivaliser avec l'intense réseau de
plombs du vitrail de 1560 dans la baie voisine.
Dans l'extrait en gros plan donné ci-contre,
on reconnaît de bas en haut : David, Salomon,
Roboam, Asa, Joram, Ézéchias, Josias,
etc.
|
|
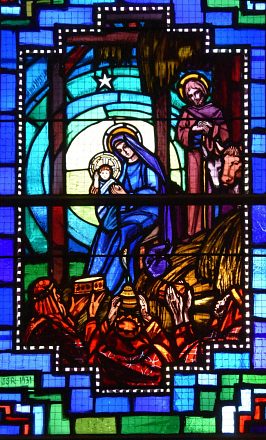 |
|
|

Vierge à l'Enfant, détail.
XIXe siècle
Autel de la Vierge dans le bras sud du transept. |
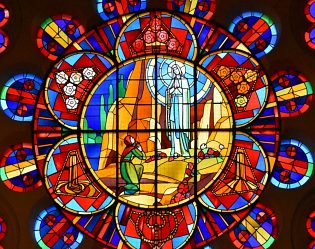
Sainte Bernadette devant la Vierge
Partie centrale d'une rose dans le transept.
Atelier Jacques Simon, années 1930. |
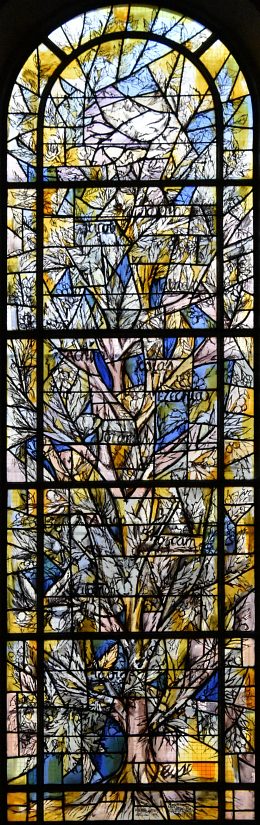
Baie 17 : Arbre de Jessé
Brigitte Simon, 1959.
Le nom de Jessé apparaît tout en bas. |
«««---
L'Adoration des mages, signé : JSR - 1931.
Atelier Jacques Simon, Reims, 1931. |
|
|
|
|

Chapelle Saint-André dans l'abside nord. |

Statue de saint Sébastien
datée du XVe siècle. |
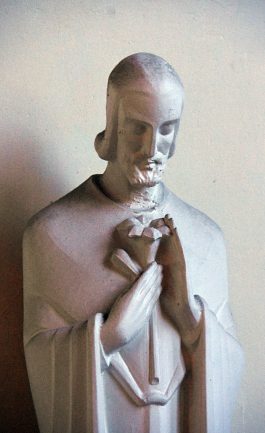
Saint Joseph, détail.
Belgique, Milieu du XIXe siècle. |

Ecce Homo dans une absidiole |
|
|
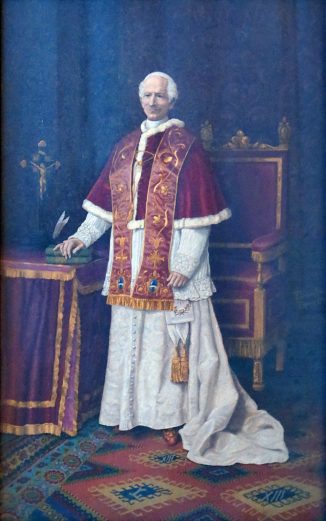
Tableau du pape Léon XIII. |

Statue de saint André dans la chapelle absidiale éponyme. |
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-ANDRÉ |
|

Comme la nef et le transept, le chœur de l'église s'élève sur trois
niveaux et respecte l'homogénéité du style.
En revanche, l'architecture de l'abside est simplifiée.
On y remarque la suppression du triforium comme dans les façades
du transept. |
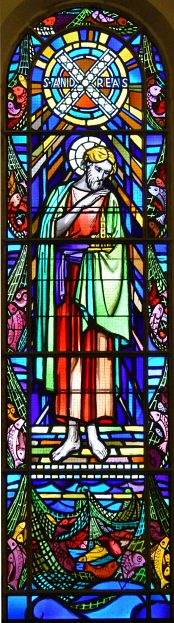
Saint André. |

Saint Jacques le Majeur. |

Saint Paul.
|

Saint Pierre.
|
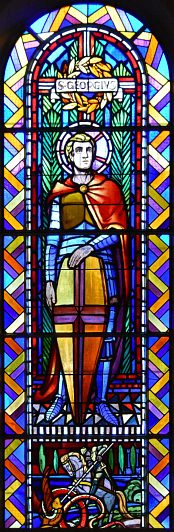
Saint Georges.
Vitraux de l'atelier
Jacques Simon.
1930-1932. |
|

Les fenêtres hautes de l'abside reçoivent des vitraux de symboles
ou de grands personnages
qui sont des créations de l'atelier Jacques Simon à Reims (années 1930-1932). |

La nef vue depuis l'arrière de l'autel de messe à la croisée
du transept.
L'Arbre de Jessé de 1560 se trouve, au premier niveau, dans le vitrail
de droite. |
Documentation : Panneaux d'information dans
le narthex
+ «Les vitraux de Champagne-Ardenne», Corpus Vitrearum, 1992
+ «Congrès archéologique de France, session LXXVIIIe tenue à Reims
en 1911», article d'Henri Jadart
+ «Reims», Éditions Bonneton, 1990. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|