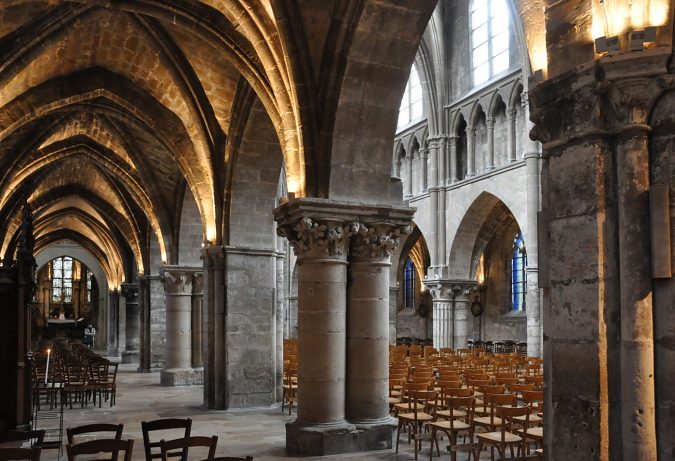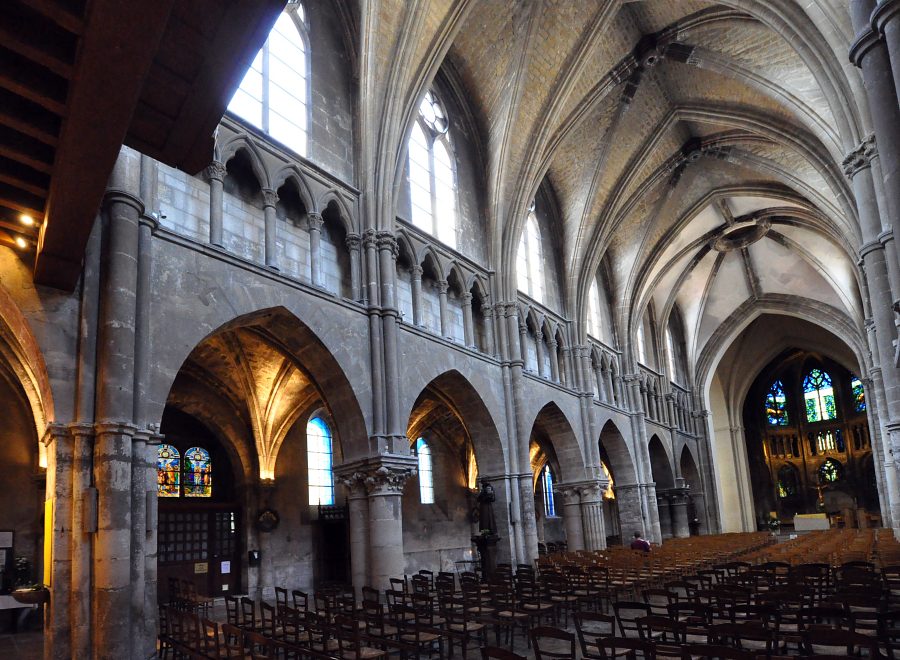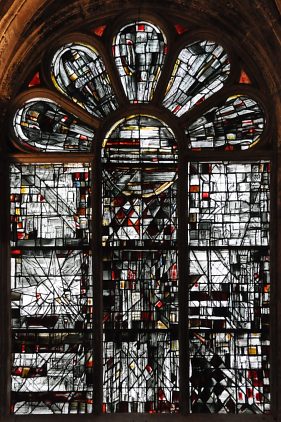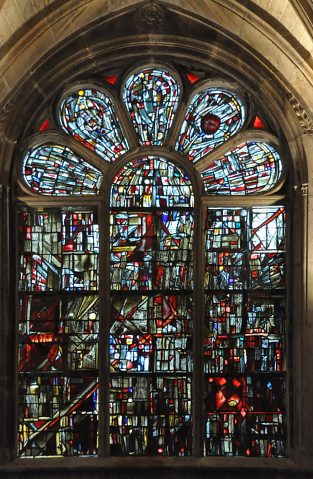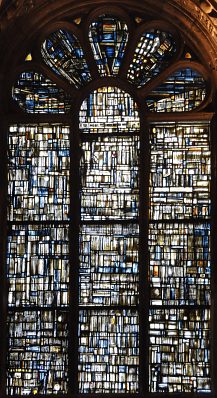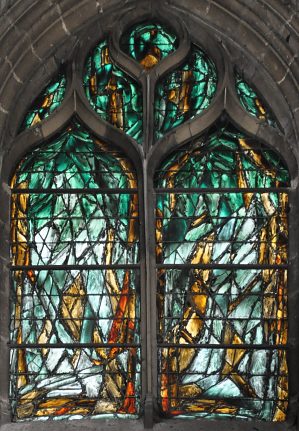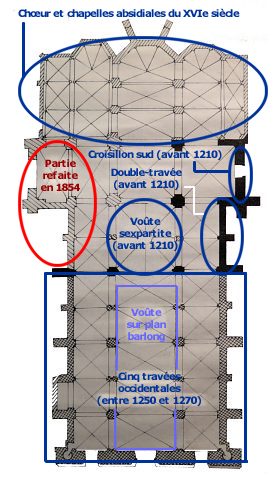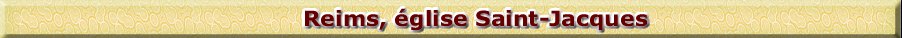 |
 |
Avec la cathédrale
et la basilique Saint-Rémi,
l'église Saint-Jacques est la seule église médiévale de Reims
qui soit parvenue jusqu'à nous (avant la Révolution, on en comptait
plus d'une trentaine). Son origine est assez bien connue. Le quartier
de la Couture, où elle se trouve, fut concédé aux Rémois par l'archevêque
Guillaume de Champagne en 1182 pour y construire des échoppes
et des maisons. Située hors les murs, cette zone se présentait en
fait comme une extension de la ville. Auparavant, c'était un terrain
cultivé sur lequel l'abbaye de Saint-Denis percevait des dîmes.
Pour compenser la perte de revenus, l'archevêque Guillaume accorda
à l'abbaye une rente annuelle de douze livres.
Saint-Jacques fut évidemment bâtie pour subvenir aux besoins spirituels
de la nouvelle communauté. On sait qu'elle était déjà en travaux
en 1190. On construisit d'abord le chœur,
puis le transept et les deux premières travées de la nef (appelées
«double-travée»).
Le tout fut terminé vers 1200. Enfin vint le reste de la nef jusqu'à
la façade. Selon l'historien Peter Kurmann, cette partie fut construite
en deux temps. Le rez-de-chaussée fut achevé avant 1235. Après un
arrêt des travaux assez long, la construction reprit vers 1250-1260.
Tout porte à penser que l'édifice était achevé en 1270.
Le style de l'édifice est homogène. On note un aspect roman évident
au premier niveau de la nef (arcades, piliers, chapiteaux), niveau
qui est surmonté par un triforium en gothique rayonnant (style en
vogue au moment de la suite des travaux, vers 1250-1260). Au XVIe
siècle, tout le chœur fut détruit (sans doute pour être agrandi).
Les architectes choisirent le style gothique pour respecter l'harmonie
de l'ensemble quand on le regarde depuis l'avant-nef, mais bâtirent
les chapelles
latérales du chœur
en style Renaissance. Leur beauté est aujourd'hui bien mise en lumière
par les vitraux modernes de l'artiste Maria Elena Vieira Da Silva.
En 1854, l'architecte Narcisse Brunette se livra à des réparations
et des reconstructions fort importantes - et dont l'ampleur paraît
aujourd'hui injustifiée. Ainsi, tout le croisillon
nord du transept fut reconstruit en l'agrandissant, la croisée,
refaite et la double-travée adjacente, altérée. D'autres éléments
voisins furent reconstruits à l'identique. Au cours du premier conflit
mondial, l'église eut beaucoup à souffrir. En 1920, l'architecte
Henri Deneux y mit au point sa technique de couvrement de la nef
en éléments de ciment armé. Cette technique fut ensuite utilisée
à grande échelle à la cathédrale.
|
 |

Vue d'ensemble de la nef de l'église Saint-Jacques.
Le premier niveau date du tout début du XIIIe siècle. Les niveaux
supérieurs sont de la seconde moitié de ce même siècle. |
| ARCHITECTURE EXTÉRIEURE
DE L'ÉGLISE |
|

La façade occidentale de l'église.
Pour l'historien Peter Kurmann, avec son immense pan de mur
terminé
par trois pignons, elle est unique dans la France septentrionale. |

Sculptures florales au-dessus d'un pilier du portail nord (XIIIe
siècle). |
 |
|

La partie centrale de la façade illustre un thème typiquement
rémois :
deux niches situées entre les trois portails (aménagement reproduit
à Saint-Rémi).
En 1827, on a placé les trois statues que l'on voit dans les
niches :
saint Jacques est entouré de saint Jean l'Évangéliste et de
saint Pierre. |

Saint Jean l'Évangéliste et son aigle dans une niche de
la façade.
Statue installée en 1827. |

Saint Jacques dans la niche
centrale de la façade.
Statue installée en 1827. |
«««--- Le portail
nord date
du XIIIe siècle. |
|
|

Sculptures florales au-dessus d'un pilier du portail nord
(premier tiers du XIIIe siècle). |

Le chevet de Saint-Jacques a été entièrement reconstruit
au XVIe siècle. |
|
|
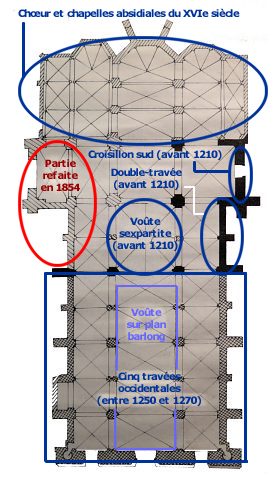
Plan de l'église Saint-Jacques. |
|
Les
chapiteaux de Saint-Jacques.
Les chapiteaux du premier niveau de la nef, comme celui
donné ci-contre en (1), méritent un commentaire. Il
faut d'ailleurs leur ajouter ceux de la façade occidentale
vus plus haut.
Si l'on suit la terminologie de l'historienne Denise
Jalabert, cette famille de chapiteaux appartient au
type de la «flore généralisée» de la première
moitié du XIIIe siècle.
L'historien Peter Kurmann précise dans son article sur
Saint-Jacques dans la revue du Congrès archéologique
tenu en Champagne en 1977 : «La plupart d'entre eux
sont décorés de feuilles à larges tiges s'enroulant
en des crochets en grande majorité épanouis. D'autres
feuilles plus petites se collent sur les larges tiges
dans une rangée qui prend naissance au-dessus de l'astragale.»
(L'astragale est la moulure qui sépare le chapiteau
et le fût du pilier).
Le chapiteau donné dans la photo ci-contre en (2) appartient
aussi à cette catégorie bien qu'on y voie des fleurs
sculptées sans ordonnancement particulier et avec des
pétales qui ressortent nettement. Notons que cet aspect
reflète d'ailleurs très bien le côté sauvage de la nature.
La thèse de Denise Jalabert, exposée dans son ouvrage
La Flore sculptée des monuments du Moyen Âge
en France, paru en 1965, a suscité maintes critiques.
Il semble en effet hors de portée des historiens d'ordonner
les sculptures de chapiteaux médiévaux selon un système
chronologique ou de les classer par école. Il y a trop
d'inconnus dans les noms des sculpteurs et les dates.
Seul un rangement par famille de fleurs et de feuilles
peut être tenté.
|
|
|

Le clocher est surmonté d'un lanternon construit pour remplacer
la flèche abattue par un ouragan en déc. 1711.
Il a été à nouveau détruit en 1918 et rebâti. |

Le Baptême de Clovis.
Vitrail historié datant de 1933.
Atelier Jacques Simon, Reims. |

Statue moderne
de la Vierge à l'Enfant. |

1 : Chapiteau à thème floral sur les colonnes jumelles
de la nef.
Son type artistique a été appelé «flore généralisée». |

Clé de voûte du XIIIe siècle
dans un collatéral. |

2 : Chapiteau à thème floral sur les colonnes jumelles
de la nef. |

Clé de voûte du XIIIe siècle dans un collatéral. |
|
|
| LA NEF ET LA DOUBLE-TRAVÉE |
|

Élévations sud de la nef (XIIIe siècle).
La double-travée correspond aux deux arcades de gauche.
Elles sont séparées par la seule pile faible de l'édifice. |
|
L'élévation
sud de la nef.
Les deux travées les plus à gauche sont appelées
«double-travée». Elles auraient été achevées vers 1210. La
pile qui divise en deux cette double-travée est la seule pile
faible de l'église (la partie en vis-à-vis, qui est au nord,
a été entièrement refaite et transformée en 1854 par l'architecte
Narcisse Brunette). Les cinq autres travées (la cinquième
à droite sort du cadre de la photo) ont été construites entre
1210 et 1230.
|
L'alternance pile forte - pile
«faible» n'a plus qu'un intérêt artistique puisque la voûte
au-dessus de ces travées est quadripartite. L'alternance vise
en quelque sorte à répéter le schéma artistique de la double-travée,
notamment en adoptant un dessin différent pour les colonnettes
selon qu'elles sont fixées sur une pile faible ou une pile
forte.
|
|

Chapiteau du triforium
Vers 1250-1270. |

Chapiteau du triforium
Vers 1250-1270. |
|
L'histoire
de la nef médiévale (1/2).
Les cinq travées occidentales de Saint-Jacques
ont donné lieu à des interprétations contradictoires.
Elles ont été construites en deux fois : d'abord le
rez-de-chaussée, qui possède un indéniable cachet roman,
puis le triforium, en gothique rayonnant et la voûte.
On constate, sur la photo ci-dessus de l'élévation sud,
une alternance de piles fortes et de piles «faibles»
(les colonnes doubles jouant le rôle des piles faibles,
mais n'en sont pas). De prime abord, on en déduit que
le plan prévoyait une voûte sexpartite. On sait pourtant
que la voûte construite dans la deuxième moitié du XIIIe
siècle était quadripartite (dite «à plans barlongs»),
rendant inutile l'alternance fort-faible. Que s'est-il
donc passé ?
Une première interprétation nous est donnée par l'architecte
Louis Demaison dans son article sur l'église
Saint-Jacques rédigé à l'occasion du Congrès archéologique
tenu à Reims en 1911. Celui-ci écrit : «Vers le début
du XIVe siècle eut lieu une reconstruction partielle
; on refit l'étage supérieur du portail, les murs, les
fenêtres, le triforium et les voûtes des cinq premières
travées de la nef.» Ce qui signifie, ni plus ni moins
- et l'historien Peter Kurmann le souligne - que toute
la nef aurait été achevée au début du XIIIe siècle,
voûte sexpartite comprise.
Mais alors, on ne voit pas pourquoi la fabrique de l'église
aurait dissipé ses fonds dans le simple plaisir de changer
partiellement l'architecture. Aucun ouragan destructeur
n'étant signalé dans les relations, il n'y avait pas
de réparations importantes à apporter. Et le procédé
visant à modifier une large partie de l'édifice pour
le plaisir, après un laps de temps aussi court, ne s'est
jamais rencontré.
Dans son article sur Saint-Jacques, écrit lors du Congrès
archéologique tenu en Champagne en 1977, l'historien
Peter Kurmann contredit son collègue avec diplomatie
: ---»» Suite 2/2.
|
|
|
|
L'histoire
de la nef médiévale (2/2).
---»» «Je crois que les choses se passèrent différemment,
écrit-il. Pour quelles raisons les parties élevées à plus
de deux tiers de la nef auraient-elle été démolies?» Kurmann
rappelle qu'il n'y a pas de trace de «soudure» architecturale
dans la liaison entre la cinquième et la «sixième» travée,
c'est-à-dire là où l'on pourrait s'attendre à voir une rupture
de la construction. Il opte donc pour un arrêt des travaux
- ce qui est hautement probable compte tenu des difficultés
habituelles de financement.
Les étapes s'échelonnent alors de manière logique. Une fois
terminée la double-travée (travées 6 et 7 près du transept),
sous l'influence des avancées architecturales, on change les
plans pour adopter une voûte à plans barlongs (quadripartite).
Puis on élève «les grandes arcades et les collatéraux sur
toute la longueur de la nef, probablement de l'est à l'ouest,
y compris le rez-de-chaussée de la façade» (Kurmann). Cette
construction a dû se terminer vers 1235 au plus tard.
Notons que les piles faibles doivent impérativement être remplacées
par des piles quasi fortes afin de soutenir la nouvelle forme
de voûte prévue - d'où la présence de colonnes doubles alternant
avec les grosses piles rectangulaires. On remarquera que l'alternance
fort-faible a été appliquée dans le dessin des colonnettes,
selon le schéma de la double-travée (départ du sol ou départ
du chapiteau), ceci afin d'assurer l'homogénéité de la nef
et son harmonie.
Relevant les particularités artistiques du deuxième niveau,
Kurmann écrit que les niveaux supérieurs n'ont pas pu être
élevés avant 1250-1260. Ainsi, une fois bâtis les arcades
et les collatéraux, l'activité du chantier aurait cessé pendant
vingt à trente ans. (Pour que le culte pût avoir lieu, il
suffisait de couvrir les travées occidentales d'une toiture
provisoire.)
L'intervalle 1250-1260, donné par Kurmann pour la reprise
des travaux, se trouve confirmé par les formes du triforium
et le décor végétal des chapiteaux. Le style roman imprègne
le premier niveau, mais, au-dessus, c'est un gothique rayonnant
arrivé à maturité qui est à l'honneur. Le triforium est ainsi
une succession de baies à quatre arceaux trilobés. Quant au
style floral des chapiteaux, il a lui aussi évolué.
|
Peter Kurmann écrit à ce sujet
: «Les tailloirs polygonaux et reculés par rapport au feuillage,
leurs feuilles en grande partie serrées et aux surfaces souvent
boursouflées les font comparer aux chapiteaux des quatre travées
occidentales de la cathédrale
de Reims qui doivent être datées de la seconde moitié
du XIIIe siècle». On peut voir ci-dessus deux exemples de
ces chapiteaux en gothique rayonnant.
Conséquence : compte tenu de la reprise au XIXe siècle de
la double-travée nord par Narcisse Brunette, la seule pile
faible (et réellement faible) visible dans l'église Saint-Jacques
est la colonne centrale de la double-travée méridionale, donnée
ci-contre à droite.
Récapitulons à présent les différentes étapes de la construction
médiévale et Renaissance de l'église :
••vers 1183 - avant
1200 : construction du chœur et du transept sur le terrain
de la Couture concédé par l'archevêque Guillaume de Champagne
;
••1200-1210
: construction de la double-travée adjacente au transept (en
quelque sorte les 6e et 7e travées) ;
••changement de
projet pour la voûte des cinq travées restantes qui sera
quadripartite et non pas sexpartite ;
••1210 - avant 1235
: construction du rez-de-chaussée de la nef (c'est-à-dire.
les cinq travées restantes) avec reprise, pour les colonnettes
engagées, du schéma adopté dans la double-travée (afin de
respecter l'harmonie de l'ensemble) ;
••arrêt des travaux
(1235 - après 1250) ;
••après 1250 jusqu'à
1270 : construction des étages supérieurs des cinq travées
de la nef et de leur voûte quadripartite ;
••XVIe siècle (jusqu'à
1548) : destruction du chœur, puis construction d'un nouveau
chœur gothique
avec ajout de chapelles absidiales de style Renaissance.
Sources : 1) Congrès archéologique
de France, 78e session, Reims, 1911, article de Louis
Demaison ; 2) Congrès archéologique de France, 185e
session, Champagne, 1977, article de Peter Kurmann.
|
|

Pile faible dans la double-travée méridionale.
C'est la seule pile réellement faible qui subsiste
dans l'église actuelle après la décision
de passer à une voûte quadripartite au-dessus
des cinq travées ouest qu'il restait à construire (décision prise
après 1210).
Le style est du XVIe siècle : la pile a donc été reprise en sous-œuvre
à cette époque. |

Quatre illustrations du baptême : baptême moderne ; baptême
Clovis ; baptême d'un catéchumène des premiers siècles ; baptême du
Christ dans le Jourdain).
Vitraux de l'atelier rémois Jacques Simon datés de 1933.
On peut les voir au-dessus d'un local attenant à la nef. |
|
Les vitraux
de l'église Saint-Jacques.
Les vitraux actuels de l'église forment trois groupes distincts :
- ceux de 1933 (donnés ci-dessus) réalisés par l'atelier rémois
Jacques Simon, auxquels il faut rajouter le vitrail
de Jésus
prêchant donné plus bas ;
- ceux réalisés par le peintre tchèque Joseph Sima,
puis par Maria Elena Vieira Da Silva dans les années
1960 et 1970 ; ils ornent l'abside et les chapelles latérales
du chœur ;
- les vitraux (très dépouillés) de la nef réalisés par Benoît
Marq au début du XXIe siècle.
Tous ces artistes ont œuvré au sein de l'atelier Simon à Reims.
L'un des clous de la vitrerie de l'église, c'est sans aucun
doute la création de Maria Elena Vieira da Silva dans les
chapelles qui encadrent le chœur. De grandes
photos de ces chapelles sont données dans cette page.
Les verrières semblent reproduire la structure des vieilles
pierres. Elles s'intègrent à merveille dans l'ensemble
et accroissent d'ailleurs l'atmosphère de méditation de l'endroit.
Mais, étant assez sombres, on se doute qu'elles laissent
passer peu de lumière. Il n'est guère possible de s'en rendre
compte car des projecteurs éclairent les chapelles presque
en permanence (voir les différentes photos proposées).
On sait que l'église Saint-Jacques a beaucoup souffert de
la première guerre mondiale. Mais qu'en était-il des vitraux
avant 1914 ?
Dans son article sur Saint-Jacques paru dans la revue du Congrès
archéologique tenu à Reims en 1911, l'historien Louis
Demaison rapporte qu'il y avait des vitraux anciens épars
dans les diverses fenêtres de l'église.
|
Néanmoins, seules les trois fenêtres
hautes de l'abside avaient conservé leurs vitraux complets
du XVIe siècle. Il en donne la description.
Dans la fenêtre centrale (là où Joseph Sima a créé une grande
croix blanche à cheval sur les deux panneaux), le panneau
de gauche illustrait la fontaine de vie : «le Christ en croix,
dont le sang est recueilli dans une vasque placée à ses pieds»
[Demaison]. De part et d'autre se tenaient Marie-Égyptienne
et Marie-Madeleine. La première portait trois pains
; la seconde tenait un vase de parfums.
Le panneau de droite accueillait une Résurrection avec des
gardes vêtus d'une armure du XVIe siècle.
Les deux panneaux de la fenêtre de droite illustraient des
sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament : Moïse sur le
Sinaï, le Serpent d'airain, Jésus au milieu des docteurs et
la Multiplication des pains.
Dans la fenêtre gauche était représenté le martyre d'un saint
que Louis Demaison n'est pas parvenu à identifier. Il précise
qu'on y trouvait ce qu'on peut regarder comme des éléments
traditionnels de l'iconographie du martyre : un chevalet,
les pieds du supplicié chargés de meules, le bourreau,
le prince qui préside à l'exécution, son sceptre à la main.
Dans une autre scène, le saint est décapité.
On trouvait ensuite le donateur, sa femme et ses trois filles,
accompagnés de leurs saints patrons. Enfin, au pied du chef
de famille, on pouvait voir un blason appartenant à la famille
de Thumery.
Source : Congrès
archéologique de France,
78e session, Reims, 1911, article de Louis Demaison sur l'église
Saint-Jacques.
|
|
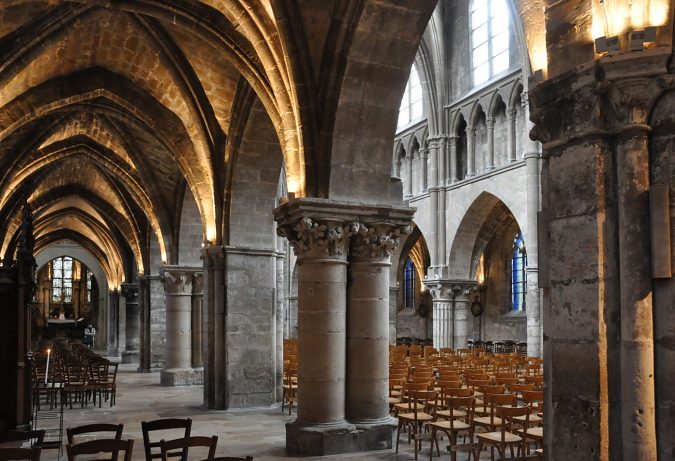
Le collatéral nord vu de l'entrée.
On observe l'alternance des piles fortes (rectangulaires) et des piles
«faibles» (colonnes gémellés).

| Clé de voûte du XIIIe siècle
dans un collatéral. ---»»» |
|

Chemin de croix moderne
Station 1 : Jésus est condamné. |
 |

Voûte des cinq travées occidentales.
Leur dessin à plan barlong date de la deuxième moitié du
XIIIe siècle, après le changement de plan intervenu vers 1210.
|

Collatéral sud érigé au début du XIIIe siècle.
Il est éclairé par les vitraux modernes de Benoît Marq créés vers
2010. |

Jésus prêchant à ses disciples
Vitrail de l'atelier rémois Joseph Simon, 1933. |

Élévations de la double travée méridionale (avant 1210).
L'histoire de cette double-travée est développée dans l'encadré
ci-contre. |

Chapiteaux à thème floral.
Ce style correspond à la deuxième moitié du XIIIe siècle. |
|

Triforium à quatre baies en tiers-points dans la double-travée
méridionale (avant 1210). |
|
Une
curiosité architecturale de l'église : la double-travée
méridionale.
Même si le visiteur ne s'en doute pas quand il rentre
dans l'église, il y a une partie de l'architecture qui
mérite son attention : c'est la double-travée au
sud (elle tient en fait la place des travées 6 et
7 si l'on compte en partant de l'avant-nef).
Avec le transept sud, la double-travée (donnée ci-contre
à gauche) est la partie la plus ancienne de l'édifice.
Pour l'historien Peter Kurmann, elle a dû être érigée
avant 1210.
La double-travée est surmontée d'une voûte sexpartite,
datée de la même époque, qui n'a été que peu retouchée
en 1854 par l'architecte de la ville de Reims,
Narcisse Brunette. La partie la plus intéressante de
cette double-travée est son triforium. Une photo
en est proposée ci-dessus, tandis qu'une photo du triforium
des autres travées, construites après 1250, est donnée
ci-dessous.
Le triforium de la double-travée est constitué de quatre
arcades par travée. On s'aperçoit que les deux arcades
du milieu sont en retrait par rapport aux arcades latérales
- alors que, dans le triforium qui sera construit après
1250, les arcades sont alignées. Les deux arcades du
milieu constituent une sorte de «panneau reculé» [Kurmann]
qui correspond, en largeur et en profondeur, à l'embrasure
de la fenêtre haute. Il est clair que les baies de la
double-travée sont plus belles que celles qui suivront
après 1250. C'est pourquoi des considérations esthétiques
s'imposent.
Le pourtour de la fenêtre haute est mis en exergue par
un élégant arc qui naît au niveau de la corniche surplombant
le triforium. Cet arc est inexistant ailleurs, ce qui
appauvrit l'aspect des fenêtres hautes dans les cinq
travées post-1250. Au niveau des deux arcades centrales
de la double-travée, l'architecte n'a pas lésiné sur
les moyens pour embellir ce qui aurait dû être le schéma
général de l'harmonie de l'église. En effet, une petite
pile avec chapiteau sépare, de chaque côté, le «panneau
reculé» des arcades latérales. On a ainsi
deux piles, de diamètre différent et avec chapiteau,
qui sont juxtaposées. Tous les chapiteaux sont au même
niveau, y compris ceux qui reçoivent les retombées des
voûtes. Pour ce faire, ces retombées plongent littéralement
sur le triforium. L'effet esthétique global ainsi créé
est tout à fait séduisant.
À l'opposé, le triforium des cinq travées post-1250
(ci-dessous) paraît sortir d'un catalogue de prêt-à-construire.
Ses quatre arceaux en tiers-point à redents trilobés
et ses chapiteaux à feuilles resserrées paraissent bien
standardisés en face de la maîtrise architecturale du
concepteur du triforium à «panneau reculé».
L'historien Peter Kurmann nous apprend que c'est à l'église
Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne que fut construite
pour la première fois toute une nef avec ce fameux «panneau
reculé». Dans un article de 1966 sur cette même église,
l'historienne Anne Prache défend l'idée selon laquelle
les travaux dans cette dernière église se situeraient
bien avant 1183. À Saint-Jacques, un détail sur les
moulures du triforium pousse Peter Kurmann à penser
que l'architecte connaissait Notre-Dame-en-Vaux.
A priori, rien n'empêchait les maîtres d'œuvre, après
1250, de réutiliser ce schéma esthétique de «panneau
reculé» pour le triforium des cinq travées suivantes.
S'ils ne l'ont pas fait, c'est probablement pour une
question de coût.
Source : Congrès archéologique
de France, 185e session,
Champagne, 1977, article de Peter Kurmann.
|
|

Triforium à quatre arceaux et à redents trilobés dans la nef.
Style gothique rayonnant. |
|
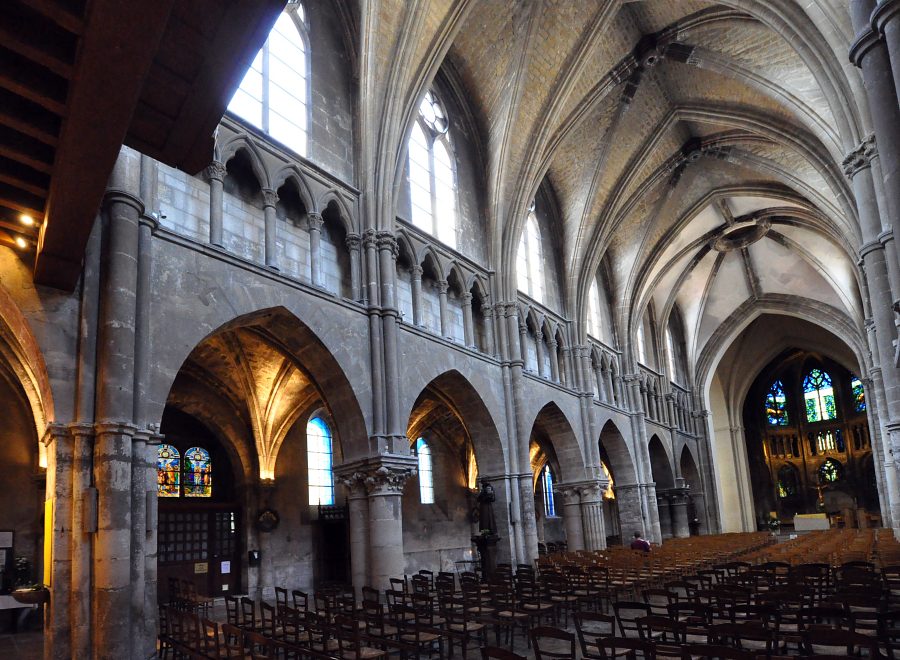
Élévations nord de la nef (XIIIe siècle).
À droite, la double-travée est couverte d'une voûte
sexpartite. |

Le transept et son grand oculus qui reçoit un vitrail moderne.
Le croisillon nord a été intégralement rebâti en 1854. |

La nef vue depuis le chœur. |
| LE CHŒUR CONSTRUIT
EN GOTHIQUE RAYONNANT À L'ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE |
|

Le chœur de Saint-Jacques a été construit en style gothique au début
du XVIe siècle.
Ce style, dépassé à l'époque, permettait de s'aligner sur le style
gothique de la nef.
Les vitraux des fenêtres hautes sont de Joseph Sima (XXe siècle).
|

Baptistère de style contemporain au sein d'une architecture
gothique. |

Arcades en gothique flamboyant dans le chœur.
(Début du XVIe siècle).
Au XVIe siècle, le style Renaissance a été rejeté pour l'abside afin
qu'il ne vienne pas
heurter l'aspect architectural en gothique rayonnant de la nef. |

Le chœur de l'église Saint-Jacques a été édifié au XVIe siècle. |
|
Par souci d'harmonie de l'ensemble
vu depuis la nef,
les constructeurs du XVIe siècle ont opté pour le style
gothique flamboyant, bien que le triforium du chœur soit plus
proche du gothique rayonnant.
L'architecte s'est néanmoins permis quelques libertés sur
les intrados (qu'on ne voit pas depuis la nef) en y sculptant
une structure en caissons typique de la Renaissance.
|
|

Élévations nord du chœur. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Le Christ en croix dans le chœur.
Œuvre moderne. |

Arceaux trilobés dans le triforium du chœur (gothique rayonnant). |

Chapiteaux dans le triforium du chœur (construit au XVIe siècle). |

Le chœur et sa voûte datent du XVIe siècle.
Tous les vitraux sont modernes. |
| LA CHAPELLE ABSIDIALE
SUD DE STYLE RENAISSANCE (XVIe SIÈCLE) |
|

Vue d'ensemble de l'absidiole sud (XVIe siècle).
L'aspect féerique de l'endroit n'échappera à personne. |

La chapelle absidiale sud et le chœur.
Les arcades en plein cintre qui font communiquer la chapelle et le
chœur sont garnies, à leur intrados,
de caissons sculptés en relief, décorés de fleurons et de pointes
de diamant. |
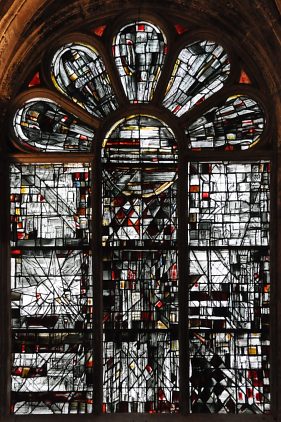
Vitrail moderne dans la chapelle absidiale sud
créé par Maria Elena Vieira Da Silva,
Atelier Simon à Reims, années 1970. |

Chapelle absidiale sud. |
|
Les voûtes retombent sur des colonnes
corinthiennes qui reprennent le parti des piles faibles de
la nef (colonnes jumelles).
Les vitraux de Maria Elena Vieira Da Silva (années 1970) s'insèrent
fort bien dans les vieilles pierres, mais sont assez opaques.
Que donnerait la photo sans l'éclairage artificiel ?
|
|

Arcature à coquilles Renaissance dans la chapelle absidiale
sud. |
 |
«««--- Sculpture Renaissance
d'un angelot
sur un pilier séparant
le chœur et la chapelle. |
|
|
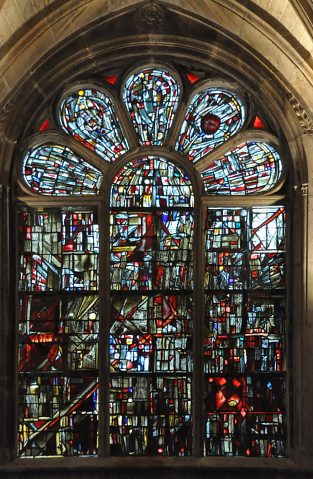
Vitrail moderne de Maria Elena Vieira Da Silva,
Atelier Simon à Reims. |
| LA CHAPELLE ABSIDIALE
NORD DE STYLE RENAISSANCE (XVIe SIÈCLE) |
|

Vue d'ensemble de l'absidiole nord.
À droite, vue sur le chœur
et l'absidiole sud. |

La chapelle absidiale nord.
L'ornementation des fenêtres est plus raffinée que dans la chapelle
sud.
Le millésime « 1548» est gravé sur la deuxième arcade qui sépare la
chapelle du chœur. |

Clé pendante avec tête de chérubin
dans la chapelle absidiale nord.
Milieu du XVIe siècle. |

Coquille Renaissance dans une arcade de la chapelle absidiale nord. |

La chapelle absidiale nord vue depuis l'autel annexe.
Cette chapelle bénéficie d'une ornementation plus élaborée que la
chapelle sud. |

Coquille Renaissance avec tête de chérubin
dans une arcade de la chapelle absidiale nord. |

Statue moderne de saint Joseph
au sein d'un ancien autel Renaissance.
Chapelle absidiale nord. |
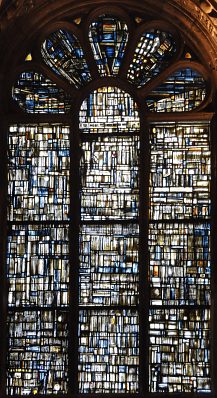
Vitrail moderne dans la chapelle absidiale nord
créé par Maria Elena Vieira Da Silva,
Atelier Simon à Reims. |

Ornementation Renaissance
dans l'intrados d'une fenêtre
Chapelle absidiale nord. |

Statue de la Vierge à l'Enfant dans la chapelle absidiale nord. |

Saint Joseph dans l'autel Renaissance. |
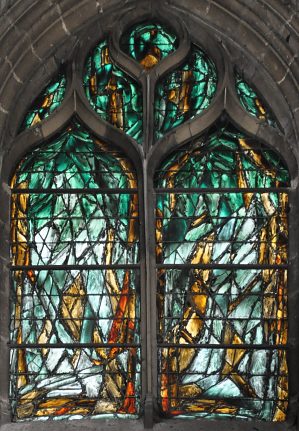
Vitrail moderne dans le chœur. |
|
«««--- Cette statue moderne de
la Vierge à l'Enfant paraît bien commune, mais il faut reconnaître
que, placée devant un vitrail de Maria Elena Vieira Da Silva,
elle acquiert un cachet certain.
|
|
| LA CHAPELLE ANNEXE
OU SACRISTIE |
|

Vue d'ensemble de la sacristie avec sa pièce maîtresse : le
Christ en croix de Pierre Jacques de Reims (†1596). |

L'orgue de tribune est moderne. |
|

Le Christ en croix
Œuvre en bois attribuée au sculpteur Pierre Jacques de Reims
(†1596). |

Le visage du Christ mort dans l'œuvre de Pierre Jacques de Reims.
|
|

Vue de la nef et de l'orgue de tribune depuis le chœur. |
Documentation : Dictionnaire des églises de
France, éditions Robert Laffont, 1966
+ Congrès archéologique de France, 78e session, Reims, 1911, article
de L. Demaison
+ Congrès archéologique de France, 185e session, Champagne, 1977,
article de Peter Kurmann. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |