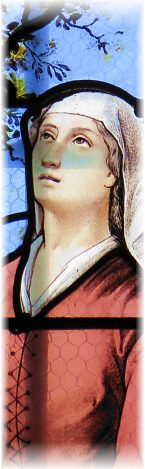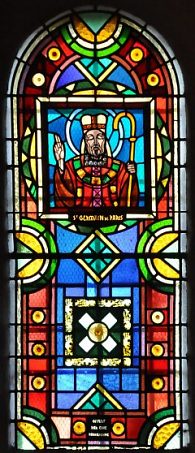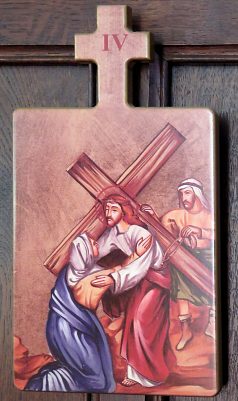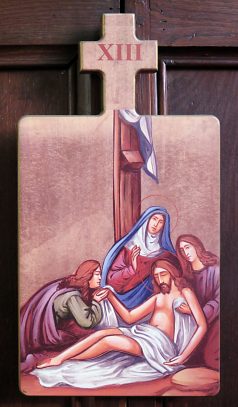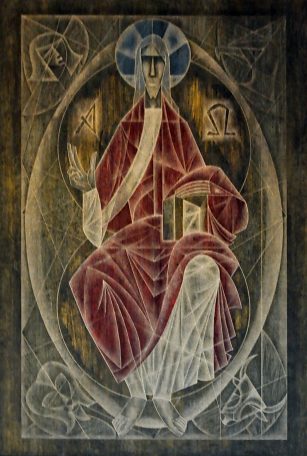|
|
 |
 |
L'histoire de l'église Saint-Germain
commence avec l'arrivée de moines bénédictins
à Fontenay-le-Fleury, dans l'actuel département des
Yvelines, pour mettre en valeur les terres. Un oratoire est édifié.
Selon un schéma de développement bien connu au Moyen
Âge, l'activité besogneuse des moines attire les paysans
; un petit bourg se forme ; une paroisse se crée. Du XIIe
au XVe siècle, l'oratoire s'agrandit et devient le chœur
sur lequel débouche une petite nef. L'église, dédiée
à saint Germain, est alors un édifice attenant au
prieuré bénédictin. À la fin du XVe,
il est détruit par un incendie.
Faute de population, il faut attendre la décennie 1540 pour
lancer la reconstruction. La fabrique opte alors pour une sorte
d'église-halle. En effet, la nef se double, au sud, d'un
large bas-côté de style assez éclectique : voûtes
sur croisée d'ogives, issues de l'art gothique, avec des
clés de voûte illustrant la salamandre
de François Ier et le taureau
; baies en plein cintre, à la mode romane, perçant
un mur scandé de contreforts ; à la retombée
des ogives, des consoles
d'un style presque Renaissance. Le mur gouttereau, qui fermait la
précédente nef, est remplacé par une suite
de quatre arcades. L'église-halle est ainsi séparée
en deux vaisseaux. La présence, du côté de la
nef, de départs d'ogives rompues laisse penser à une
modification dans le choix du voûtement. La voûte en
berceau surbaissé a été préférée
aux croisées d'ogives (voir plus
bas).
Le clocher, de style roman, ne possède qu'une seule cloche
dont les Fontenaysiens semblent très fiers. Nommée
Germaine, elle a été installée en 1529 et classée
monument historique en 1995.
En 1793, l’église devient temple de la Raison. En fait, elle va
servir de salle de réunion à une municipalité sans mairie. De 1801
à 1844, Saint-Germain, revenue au culte catholique, est une
annexe de l'église de Saint-Cyr.
Elle devient enfin église paroissiale en 1856. Par chance,
le propriétaire du château de Fontenay, Félix Barthe, qui
est aussi ministre de la Justice et des Cultes, est un ami de l'empereur
Napoléon III. Celui-ci accorde plusieurs subsides, pris vraisemblablement
sur sa liste civile, pour restaurer l’église.
Saint-Germain, de petite taille, possède un intérieur
très sobre. Une dalle
mortuaire du XVIe siècle est accrochée au mur, sur la
façade de l'entrée. Elle porte les armes de la famille
des Gondi, seigneurs de Villepreux. Au XIXe siècle, l'édifice
avait été orné de vitraux d'époque.
Malheureusement, lors du bombardement massif de la R.A.F sur Saint-Cyr-l'École
fin juillet 1944, Fontenay-le-Fleury, tout proche, n'a pas été
épargné. Les vitraux ont tous été détruits
sauf celui qui illustre sainte
Jeanne d'Arc (resté entier). Des résidus ont été
rassemblés, dans le désordre, au sein d'un petit
vitrail consacré à sainte Marguerite, dans le
bas-côté sud. Les autres ont été remplacés
par des créations de l'atelier versaillais d'André Ripeau
en 1947. Ils sont tous donnés dans cette page.
À titre d'anecdote, notons que François Ier est venu à
l'église Saint-Germain en février 1547. C'était à
l'occasion de l'une de ses visites à sa favorite, Anne de
Pisseleu, duchesse d'Étampes, en son château des Clayes.
Cependant, l'ouvrage Le Patrimoine des Communes des Yvelines
(éditions Flohic, 2000) indique simplement que François
Ier, se rendant à Villepreux chez le seigneur La Ballue,
serait, selon la tradition, passé à Fontenay-le-Fleury.
Notons aussi que le comédien et dramaturge Sacha Guitry a
épousé à Saint-Germain sa quatrième
femme, Geneviève de Séreville, le 5 juillet 1939.
C'était son premier mariage religieux.
|
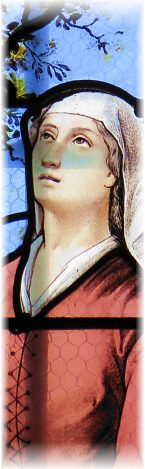 |

La nef de l'église Saint-Germain à Fontenay-le-Fleury. |

Vue extérieure et façade de l'église Saint-Germain. |
 |
|

Le bas-côté sud, de style roman, et ses toits couvrant
des voûtes d'ogives. |
| «««---
Le chevet de l'église est plat. Sur la gauche :
l'extrémité du bas-côté sud. |
|
|
La
cloche. L'église Saint-Germain ne
possède qu'une cloche, dénommée
Germaine.
Elle est en bronze, pèse environ 600 kilos et
date de l'année 1529.
C'est la plus ancienne cloche du département
des Yvelines. Elle est classée monument historique
depuis 1995.
|
|
|
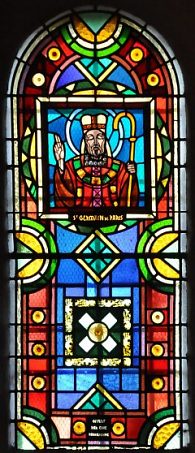
«Saint Germain de Paris»
Vitrail de l'atelier André Ripeau
Versailles, 1947. |

«Saint Jean-Baptiste»
Vitrail de l'atelier André Ripeau
Versailles, 1947. |
|

Les arcades centrales entre la nef et le bas-côté
sud. |
|
Architecture
intérieure. Le visiteur attentif constatera,
sur les piles centrales de l'église, côté
nef, la présence de départs d'ogives interrompues.
Ils sont bien visibles dans la photo ci-dessus. Sur
le bas-côté sud, les ogives sont complètes
et montent jusqu'à la clé (ci-contre).
Peut-on en déduire une succession possible d'étapes
dans la reconstruction de l'église vers 1543
?
La photo ci-dessous des départs d'ogives côté
nef et côté sud montre que les courbures
ne sont pas exactement les mêmes. Elle paraît
moins accentuée côté nef. On peut
en conclure que le maître maçon du XVIe
siècle prévoyait de bâtir un édifice
qui se rapprochait de l'église-halle : deux vaisseaux
voûtés d'ogives, la voûte de la nef
étant un peu plus haute que celle du bas-côté.
Il est probable que le bas-côté sud a d'abord
été construit selon les normes du gothique,
mais avec déjà une influence Renaissance
: les piles centrales sont monocylindriques ; les chapiteaux
sont courts, couverts d'un entablement assez plat. Les
consoles (l'une est donnée ci-dessous) où
viennent buter les retombées d'ogives délaissent
l'art gothique pour emprunter les façons du style
nouveau qui se répand au XVIe siècle.
Que s'est-il passé ensuite ? La fabrique a-t-elle
décidé de changer le voûtement de
la nef pour une forme en berceau plus conforme à
l'art Renaissance (et plus conforme sans doute
à l'ancienne voûte romane) ? Y a-t-il eu
une interruption des travaux autorisant cette décision
et la possibilité de la concrétiser ?
Un nouveau maître-maçon a-t-il pris le
relais du précédent ? On ne sait
pas. Toujours est-il que la nef, voûtée
en berceau surbaissé, est plus haute que ce que
prévoyaient les départs d'ogives. Sans
doute fallait-il bien souligner que le vaisseau au sud
n'était qu'un bas-côté.
Le commentaire indiqué dans Le Patrimoine
des Communes des Yvelines aux éditions Flohic
(an 2000) reste dans le flou. On y lit : «Chronologiquement
antérieure à la travée et donc
à la croisée d'ogive, la voûte en
berceau est construite après l'incendie du XVIe
siècle. Mais les départs de croisées
d'ogives semblent indiquer une origine ogivale.»
On ne saurait mieux dire...
Notons, pour terminer, la présence de tirants
métalliques en travers du bas-côté
pour consolider la structure (photo ci-contre). Les
contreforts
sud devaient sembler insuffisants pour contrebuter
à eux seuls le poids des voûtes et de leur
couvrement.
|
|

Le bas-côté sud et ses voûtes ogivales.
La clé-de-voûte porte la salamandre de François
Ier. |
|

«Purification» et «La Vierge au pied de la
croix»
Vitrail de l'atelier André Ripeau
Versailles, 1947. |

«Assomption» et «Couronnement de la Vierge»
Vitrail de l'atelier André Ripeau
Versailles, 1947. |
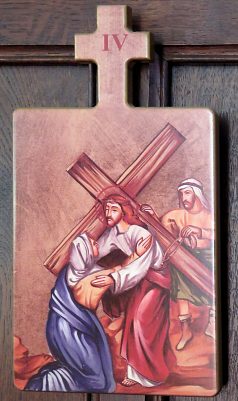
Chemin de croix
Station IV : Jésus rencontre sa mère. |
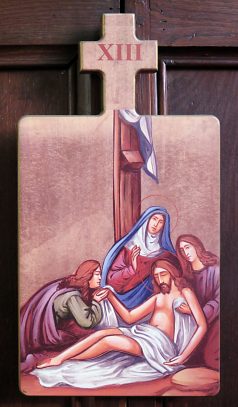
Chemin de croix
Station XIII : Jésus est descendu
de la croix et remis à sa mère. |
|

Statue du Bon Pasteur, détail. |

Départs d'ogive vers la nef et vers le bas-côté
sud. |

Console Renaissance à la retombée d'ogive
dans le bas-côté sud. |
|

Clé de voûte
dans le bas-côté sud
à l'emblème du taureau. |

La salamandre de François Ier
dans une clé de voûte
du bas-côté sud |
 |
| Vitrail moderne
à la façade de l'église ---»»» |
|
|

La chaire à prêcher est en bois de noyer.
Selon les sources, elle est datée du XVIIIe ou
du XIXe siècle. |
Vitrail «Annonciation»
et «Nativité» ---»»»
Atelier André Ripeau, Versailles, 1947. |
|
|
 |

La nef vue depuis le bas-côté sud. |
|
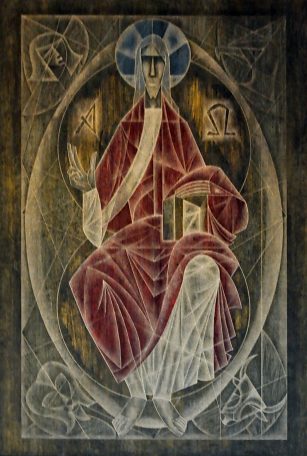
Composition moderne du Christ «Alpha et Omega».
Cet ornement figurait dans le chœur il y a quelques années. |

Notre-Dame de Fontenay, détail.
Plâtre doré, XVIIIe siècle. |

Résidu des vitraux du XIXe siècle, détail. |

Tabernacle en bois doré, détail. |
|

Dalle mortuaire du XVIe siècle.
Elle porte les armes de la famille des Gondi. |

Vitrail «Jeanne d'Arc»
Atelier inconnu, XIXe siècle. |
|
|
|

Dalle mortuaire du XIVe siècle, détail.
On y voit un prélat tenant un calice dans sa main
droite. |

Résidu d'un vitrail relatif à sainte Marguerite.
Atelier inconnu, XIXe siècle.
Avec le vitrail de Jeanne d'Arc, ces quatre panneaux sont
les seuls rescapés
du bombardement de juillet 1944 sur Saint-Cyr-l'École.
Les panneaux du registre supérieur sont à
intervertir. |
 |
|
| |

«Vie de sainte Marguerite», détail.
LES DEUX PANNEAUX
SUPÉRIEURS
DU VITRAIL DU XIXe SIÈCLE
RANGÉS DANS LE BON ORDRE :
Le préfet Olybrius fait jeter Marguerite
en prison. |
|

«Vie de sainte Marguerite», détail. |
|
|

Vitrail «Jeanne d'Arc», détail.
Atelier inconnu, XIXe siècle. |

La nef de l'église Saint-Germain vue depuis le bas-côté
sud. |
Documentation : site de la paroisse Saint-Germain
+ dépliant sur l'église disponible dans la nef.
+ «Les Miscellanées de Fontenay-le-Fleury», éditions
TerraMare, 2013
+ «Dictionnaire des monuments d'Île-de-France»,
éditions Hervas, 2001
+ «Le Patrimoine des Communes des Yvelines», éditions
Flohic, 2000. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|