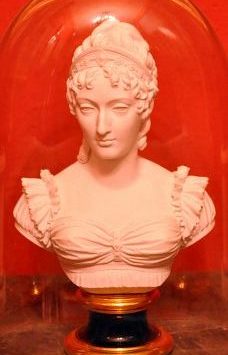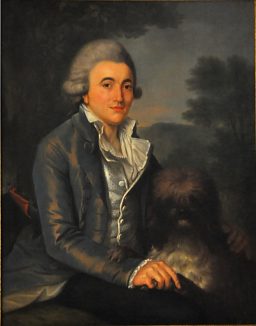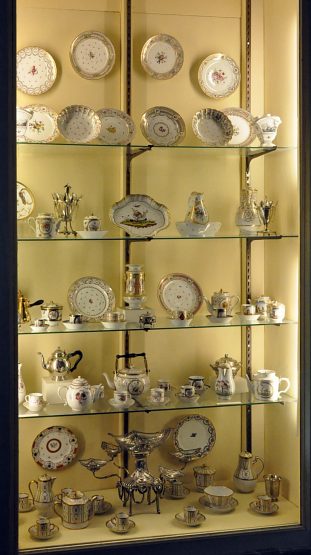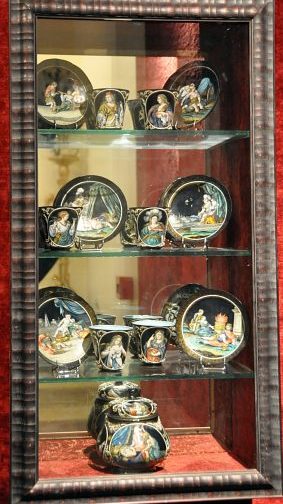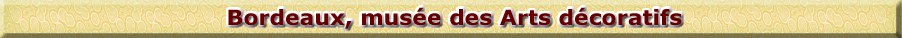 |
 |
Le musée des Arts décoratifs
de Bordeaux
est logé dans l'hôtel de Lalande, un ancien hôtel
particulier. Le visiteur est ainsi convié à déambuler,
sur plusieurs niveaux, dans des salles aménagées.
Le but est de rappeler l'atmosphère d'une vaste maison bourgeoise
bordelaise au XVIIIe siècle. Le musée
Lambinet à Versailles
suit la même optique.
Antichambres, salons divers et chambres se succèdent dans
des pièces aux lambris peints et aux parquets parfois luxueux.
Meubles, instruments de musique, tableaux, bustes de porcelaine,
vases et potiches voisinent avec des armoires où s'accumulent
les céramiques et les souvenirs issus de nombreux legs et
d'hôtels particuliers bordelais.
Le descriptif des objets est rassemblé, par pièce,
dans un seul panneau si bien qu'il n'est pas toujours facile de
trouver l'information que l'on cherche. Cette lacune sera-t-elle
corrigée à l'avenir ?
Historique de l'hôtel. Dans les années 1770,
après autorisation royale, le cardinal de Rohan, archevêque
de Bordeaux,
vend une partie de ses vastes terrains pour financer la construction
de sa nouvelle demeure : le futur palais Rohan, actuellement Hôtel
de ville.
Pierre de Raymond de Lalande, membre de la noblesse de robe
bordelaise, se porte acquéreur en 1775 d'une parcelle de
ces terrains pour y bâtir une grande maison. Bâtie entre
cour et jardin, elle sera isolée des bruits de la ville.
La construction est achevée en 1779, mais la famille en profitera
peu : de Lalande meurt en 1787 et son fils et héritier est
guillotiné sous la Terreur. L'hôtel est alors déserté.
Sous le Consulat, il est loué à la ville. En 1808,
les services de l'octroi s'y installent. Puis, à la suite
de successions et de ventes, il se retrouve, de 1842 à 1848,
propriété du maire de Bordeaux,
Duffour-Dubergier. Cependant, loué depuis longtemps à
l'armée, l'hôtel ne sert plus de demeure familiale.
La municipalité l'achète en 1880 et va y installer
des services de police. Une prison sera même construite en
1885 dans le jardin de l'hôtel. En 1923, la ville change l'affectation
du bâtiment et y crée le musée d'Art ancien,
tandis que la prison devient dépôt des œuvres
non exposées.
Au cours de la dernière guerre, le musée est fermé.
Il rouvre en 1955 sous l'appellation Arts décoratifs.
Cette page présente des vues des pièces comme le visiteur
ne les verra plus : une modernisation est en cours jusqu'à
la fin 2025. Les bibelots des vitrines font une large place à
la faïence et à la porcelaine. Le salon
du duc de Bordeaux et celui
de la duchesse de Berry exposent des souvenirs de la famille
des Bourbons au XIXe siècle.
|
 |
 |
-- AVERTISSEMENT --
LE MUSÉE EST FERMÉ DEPUIS 2023 ET NE ROUVRIRA
QU'EN 2026 APRÈS UN RÉAMÉNAGEMENT COMPLET
COMPRENANT L'INTÉGRATION DE L'ANCIENNE PRISON DANS LE
PARCOURS DU MUSÉE.
LES PHOTOS DE CETTE PAGE CONCERNENT L'ANCIENNE DISPOSITION,
VISIBLE JUSQU'EN AVRIL 2023. |
|

Salon Cruse-Guestier. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'HÔTEL DE LALANDE |
|

Une vaste cour en ovale sépare l'hôtel de la rue. |

L'hôtel de Lalande accueille le musée des Arts décoratifs
depuis 1955. |
|
|

L'escalier d'honneur et son garde-corps à balustres. |
 |
|
|
Le
vestibule.
L'entrée de la demeure n'est pas centrale. Elle
se fait sur la droite, dans le pavillon latéral,
laissant ainsi le rez-de-chaussée de la façade
à une grande salle
à manger prolongée d'un salon
de compagnie.
L'escalier d'honneur est orné d'une magnifique
rampe à balustres, vrai chef-d'œuvre de
la ferronnerie bordelaise (photo ci-contre). Détail
rare : les balustres sont réunis par une guirlande
de glands et de feuilles de chêne.
Une grande tapisserie bruxelloise est suspendue dans
l'escalier. Elle rappelle les liens étroits de
Bordeaux
avec les ports de la mer du Nord.
|
|

«Triomphe d'un empereur romain»
Tapisserie bruxelloise, début XVIIe siècle. |
| «««---
Commode française, 1ère moitié du XVIIe siècle |
|
|
|
|

Première antichambre : plâtres des statues du Grand Théâtre
de Bordeaux d'après Pierre-François Berruer, 1777. |
|
|
|

LE SALON CRUSE-GUESTIER |
|
Le
salon Cruse-Guestier.
Les pièces de ce salon viennent du legs Cruse-Guestier
de 1936. Ce couple de grands bourgeois protestants,
issu du monde du négoce bordelais, lègue
au musée d'Art ancien tous les objets du grand
salon de son hôtel particulier, l'hôtel
Poissac. Le legs inclut une condition : les objets doivent
être exposés dans une même salle
du musée.
|
|

Tasse en faïence «Pauline». |
|

LA SALLE À MANGER |

LE SALON DE COMPAGNIE |
|
|
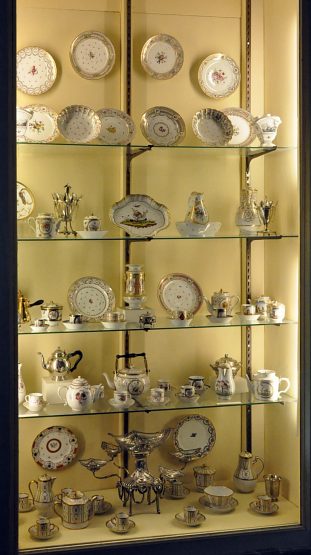
Vitrine de porcelaines.
La plupart des pièces de céramique sont issues
de legs au musée. |

Pot de porcelaine, XIXe siècle.. |
|
«««--- Vitrine
de porcelaines.
|
|
|

Le SALON DE LA DUCHESSE DE BERRY (vue partielle). |
|
La
duchesse de Berry.
Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry,
est la mère de l'«enfant du miracle».
Louis XVIII, sur le trône, est sans postérité.
Il regarde donc du côté des deux fils de
son frère, le futur Charles X. L'aîné,
le duc d'Angoulême, est lui aussi sans enfant.
Le second, le duc de Berry, épouse en 1816 Marie-Caroline
de Bourbon-Siciles. En 1819, ils ont une fille, Louise
d'Artois. Mais, en 1820, le duc de Berry est assassiné
par Louvel au motif qu'il veut en finir avec la dynastie
des Bourbons.
Quelques mois plus tard, la duchesse de Berry met au
monde un fils, Henri, l'«enfant du miracle».
C'est lui qui, en 1873, refusera le trône de France
parce qu'il ne veut pas du drapeau tricolore.
La duchesse de Berry eut une vie agitée. Voulant
ravir le pouvoir à Louis-Philippe et aux Orléans,
elle fut à l'origine des insurrections vendéennes
de 1832.
|
|
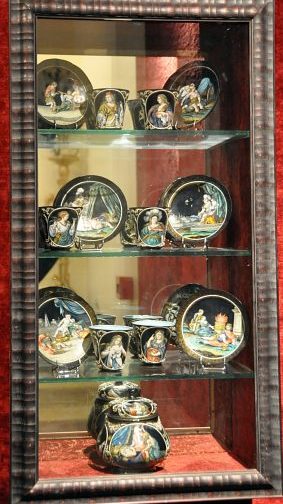 |
|

Loth et ses filles.
Assiette en faïence. |

Pendule du XIXe siècle. |
|
«««--- Armoire
avec assiettes, tasses et pots en faïence.
|
|
|

La dictée d'un sage à son secrétaire
Assiette en faïence. |

«La duchesse de Berry partant pour l'exil en 1830»
Tableau anonyme du XIXe siècle. |
|

Une marine dans le salon de la duchesse de Berry.
|

La duchesse de Berry
Tableau anonyme, XIXe siècle.
|
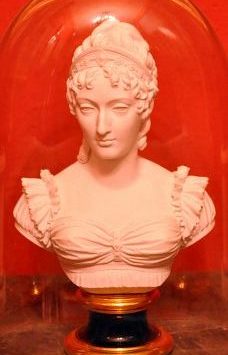
La duchesse de Berry en buste de porcelaine. |
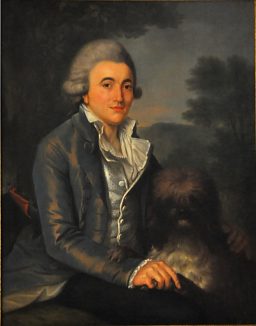
Portrait d'un homme avec son chien. |

Commode du XVIIe siècle. |
|
|

La PREMIÈRE ANTICHAMBRE du premier étage
et ses collections de faïences. |

Jeune homme au panier, plâtre.
|

Surtout de table du maître-orfèvre Pierre-Auguste
Forestier (1755-1838).
Premières années du XIXe siècle. |
|

Plat en faïence de Rouen. |

Vase à anses (Rouen ou Bordeaux). |
|

Assiettes en faïence, XIXe siècle.
| Service de table (argent
ou étain de Bordeaux). ---»»» |
|

|

LA PREMIÈRE ANTICHAMBRE du premier étage de l'hôtel.
Les vitrines de cette pièce présentent les faïences
du nord de la France
au XVIIe et XVIIIe siècle : Rouen, Lille, Saint-Omer, Nevers
et Sinceny. |
|
|

Vitrine de faïences du nord de la France.
| «««---
Marines avec volcan en éruption (l'Etna ?). |
|

LA CHAMBRE GARANCE
Les boiseries Louis XV et la cheminée en pierre proviennent
d'un hôtel particulier bordelais. |

Une mère et sa fille.
Tableau anonyme dans la chambre Garance. |

La chambre garance, détail.
Le lit dit «à la duchesse» ou «à l'ange»
est couvert d'une indienne à camaïeu rouge garance reproduisant
le thème de «l'Art d'aimer». |

LA CHAMBRE JONQUILLE
(Ancienne chambre de Mme de Lalande)

Les boiseries et la cheminée viennent de l'hôtel de Louis-Hyacinthe
Dudevant, négociant à Bordeaux.
Le lit à la polonaise vient d'un don au musée des Amis
de l'hôtel de Lalande en 2003. |

La cheminée de la chambre Jonquille. |

LE SALON BORDELAIS

Pièce centrale du premier étage, ce salon évoque
le riche intérieur d'un bourgeois bordelais au début
du XIXe siècle.
Il est évidemment meublé de pièces du XVIIIe.
Au premier plan, un pianoforte des années 1790 en acajou massif
avec des filets de bois d'ébène. |

«Céphale et l'Aurore»,
Tableau de l'École française, XVIIIe siècle. |

Le Salon bordelais : cheminée et pianoforte.
La cheminée date du tout début du XIXe siècle. Ses bas-reliefs décoratifs
sont de style néoclassique. |
 |

L'indiscrète ou une servante écoutant derrière la porte.
Tableau anonyme du XIXe siècle.
«««---
Cabaret avec samovar et porcelaines de Bordeaux
dans le salon bordelais. |
|

L'indiscrète ou une servante écoutant derrière la porte, détail. |

Madame John Mac-Carthy par A. Wertmüller, 1788. |

Une autre vue du SALON BORDELAIS. |

LE SALON VERT ou SALON DE GASCQ
Les boiseries de ce salon viennent de l'hôtel de Gascq à
Bordeaux. Leur style rocaille était rare dans les décors
privés bordelais. |

Cartel Régence, signé Duhard à Bordeaux.,
1776 |

«Scriban» de l'époque Régence dans le Salon
Vert. |
Documentation : «Musée des Arts décoratifs
de Bordeaux», Somogy Éditions d'Art, 2012
+ panneaux d'information dans le musée. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |