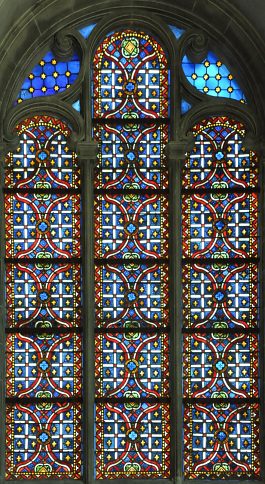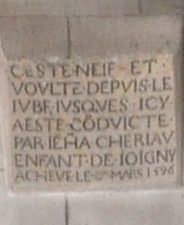|
 |
En 1080, Geoffroy, comte de Joigny, donna
une église dédiée à saint Jean aux moines
venus de la Charité-sur-Loire pour fonder un prieuré
(ce qui signifiait à l'époque un pôle de développement
économique). Il ne reste rien de cet édifice.
Les parties les plus anciennes de l'église actuelle (quelques
faisceaux de colonnes dans les travées du chœur) remontent
au XIIIe siècle. Peut-être faut-il y voir les vestiges
d'une chapelle primitive incluse dans l'enceinte du château
féodal. On sait néanmoins qu'une église fut
bâtie avec l'aide de Rome puisque l'antipape Clément
VII (1378-1394) accorda des indulgences à ceux qui donneraient
pour la construction. Elle fut longue : sa dédicace n'eut
lieu qu'en 1504, vraisemblablement sans que l'édifice ne
soit terminé. Il est vraisemblable aussi que Saint-Jean a
énormément souffert de l'incendie de 1530, davantage
encore que Saint-Thibault.
Aussi, vers le milieu du XVIe siècle, construisit-on une
nouvelle église sur ce qu'il restait du sinistre, à
savoir quelques contreforts de grès dans les bas-côtés,
quelques travées dans le chœur et dans les deux collatéraux,
et enfin la souche du clocher. Ces vestiges étaient de style
gothique flamboyant. La reconstruction, entreprise de 1548 à
1596 par Jean Chéreau père et fils, fut de
style Renaissance. Sans preuve formelle que le fils ait hérité
du travail du père, seule cette hypothèse, pour les
historiens et les archéologues, permet d'expliquer la très
longue durée des travaux (une cinquantaine d'années)
et surtout la remarquable unité de style de la voûte
de la nef.
Dans la décennie 1570, Saint-Jean faillit disparaître.
Jean Chéreau fut chargé par Louis de Saint-Maure de
la reconstruction du château, voisin de l'église, et
surtout de son extension. Le tout à l'imitation du château
d'Ancy-le-Franc, élevé par l'italien Serlio. Mais
Louis de Saint-Maure s'éteignit en 1572, et le décès
rapide des propriétaires successifs du château annula
le projet. Cet épisode explique sûrement la très
longue durée de la reconstruction.
Saint-Jean, comme l'église qui l'avait précédée,
n'eut pas de transept, mais on y dressa un jubé, disparu
depuis. En 1759, la foudre frappa la flèche du clocher-porche,
qui datait de 1609. Celle-ci fut remplacée par un clocheton
surmonté d'un dôme, tel qu'on le voit aujourd'hui.
Sous la Révolution, l'église n'eut pas trop à
souffrir : elle fut utilisée pour les cérémonies
officielles et le culte de la déesse Raison. En 1856, on
ajouta une chapelle d'axe.
L'église Saint-Jean offre aux visiteurs deux belles œuvres
d'art : le tombeau
d'Adélaïs, du XIIIe siècle, et un Sépulcre
du XVIe. Quant aux vitraux, ils sont dans leur très grande
majorité en verre blanc, ce qui assure une grande luminosité
à l'édifice. On trouve néanmoins quelques tympans
avec des vitraux
Renaissance. Les verrières ajoutées au XIXe siècle
ont toutes été brisées lors du bombardement
de juin 1940.
|
 |

La nef et le chœur de l'église Saint-Jean de Joigny. |

L'église Saint-Jean et, en face, le seul bâtiment qui
reste du château des Gondi.
La face sud du château, que l'on voit ici, est d'un aspect fort
simple. Elle date
de 1613, quand le cardinal Pierre de Gondi détenait le comté
de Joigny.
Pour avoir une vision panoramique de la ville depuis l'Yonne,
reportez à la page de l'église Saint-Thibault. |

La façade de l'église Saint-Jean n'accueille
plus qu'un portail délabré. |

La porte Saint-Jean et le clocher de l'église.
C'est une porte sans pont-levis qui daterait des reconstructions entreprises
au début du XIe siècle. |

Le portail gothique de la façade est à l'état
de ruine.
Les sculptures des voussures ont disparu
sous l'effet de la Révolution et du temps. |

La porte ouest du château des Gondi
et son très beau style Renaissance. |
|
Le
château des Gondi a été
bâti de 1569 à 1613. Sa construction a
été longue, chaotique, marquée
par une succession de sept propriétaires, et
jamais achevée.
À l'origine, il comprenait deux corps de bâtiments.
L'ensemble a vraisemblablement été érigé
sur les plans de Jean Chéreau, qui s'est
lui-même inspiré de l'œuvre de l'italien
Serlio. Vers 1820, il fut mis en vente. L'aile nord
de la partie est fut démolie. À part un
rez-de-chaussée à l'est, il subsiste ---»»»
|
|
|
|
|

Façade nord du château des Gondi en face de l'église
Saint-Jean.
C'est la réplique de la façade (sur la cour intérieure)
du château d'Ancy-le-Franc. Dans
les années 1570, le projet des comtes était d'étendre
le château et donc de détruire l'église. |
|
Le
château des Gondi (suite)
--- un très élégant
corps de logis. La façade nord du corps de logis,
donnée ci-contre à droite, est la plus
intéressante. Elle reçoit deux ordres
architecturaux : ionique en bas, corinthien à
l'étage. En bas, les pilastres plats encadrent
des niches. Les portes est et ouest sont dessinées
avec arc en plein cintre. Cette façade est une
réplique de l'élévation du château
d'Ancy-le-Franc qui donne sur la cour intérieure.
La façade sud, plus simple, sans ordre et visible
dans la photo
plus haut, a été
commencée en 1600, une fois la façade
nord terminée.
En 1616, le château passe entre les mains de Philippe-Emmanuel
de Gondi et de son épouse Françoise-Marguerite
de Silly. Ce couple, très pieux, est lié
à Vincent de Paul. Selon la brochure de l'association
culturelle de Joigny, il est compréhensible que
le château n'ait jamais été terminé
: les Gondi ont préféré utiliser
leurs ressources pour soulager les miséreux.
Sources : 1) Congrès
archéologique de France, 1958, Auxerre, Joigny
par Jean Vallery-Radot ; 2) À la découverte
de Joigny éditée par l'Association
culturelle et d'Études de Joigny.
|
|
|

Élévations sud dans la nef de l'église. |

Saint Jean dans sa niche. |
|
Architecture.
On voit, sur la photo ci-dessus, la spécificité
de la nef de l'église Saint-Jean : architecture
gothique et arcades en tiers-point au premier niveau,
style Renaissance au second. Les deux niveaux sont séparés
par une moulure ornée de petits animaux réels
ou fantastiques que l'on retrouve jusque dans le chœur.
Cette moulure supporte une arcature aveugle, sorte de
faux triforium, qui est une succession de groupes de
trois fenêtres dont une seule reste ouverte pour
l'aération des combles des bas-côtés.
Une série de douze niches à consoles et
à dais assure la transition entre les deux styles
d'architecture. Quatre de ces niches sont d'époque.
|
|
|

Saint Thomas dans sa niche (moderne). |

Saint Philippe dans sa niche. |
|
| LE SÉPULCRE DE L'ÉGLISE SAINT-JEAN,
avant 1520 |
|

Le Sépulcre de l'église Saint-Jean (avant 1520). |
|
Le
sépulcre de l'église Saint-Jean.
Cette œuvre de marbre blanc, datée d'avant
1520, est assez fade et sans relief. L'artiste, qui
pour l'historien Jean Vallery-Radot serait Mathieu
Laignel, a suivi les conventions d'usage pour la
réalisation de ce genre de sculpture, mais il
n'a pas su insuffler d'émotion dans les personnages,
pas plus que dans leur gestuelle. Les visages des femmes
(la Vierge et les trois Marie) se ressemblent. À
la tête et aux pieds du Christ mort, Joseph d'Arimathie
et Nicodème sont statiques et ne soutiennent
pas le linceul. Joseph, qui tient la couronne d'épines
et les clous, est même un peu grotesque : la partie
inférieure de son personnage, sans aucune recherche
artistique - contrairement à celle de Nicodème
qui dégage surplis et jambe -, semble sortir
d'un moule industriel. Pour voir une Mise au tombeau
de meilleure facture, on pourra se reporter à
celle, du XVIe siècle également, en bois
polychrome de la collégiale Saint-Denis
à Amboise.
Si les personnages sont de facture française,
le sarcophage, où gît le corps du Christ,
est de facture typiquement italienne. Au centre du soubassement,
deux angelots tiennent un petit bouclier (une targe)
contenant les instruments de la Passion. Les médaillons
des côtés reçoivent le visage vu
de profil de Raoul de Lannoy et de son épouse,
ancêtres de la mère de Pierre de Gondi.
Initialement, le Sépulcre était exposé
à la chapelle funéraire des Lannoy, au
château de Folleville, dans la Somme. En 1604,
Philippe-Emmanuel de Gondi épouse Françoise-Marguerite
de Silly, héritière du château des
Lannoy et de la chapelle seigneuriale abritant le sépulcre.
Leur fils, Pierre de Gondi (1602-166) vend le domaine
de Folleville en 1634, à l'exception du sépulcre
et de petits angelots de marbre qui portent les blasons
d'ascendants de sa mère. Le sépulcre ira
rejoindre le château de Joigny et sera donné,
peu avant 1723, à l'église Saint-Jean.
Sources : 1) Congrès
archéologique de France, 1958, Auxerre, Joigny
par Jean Vallery-Radot ; 2) À la découverte
de Joigny éditée par l'Association
culturelle et d'Études de Joigny.
|
|
|

Bénitier de marbre blanc de style
Renaissance dans l'entrée de l'église. |

Jésus dans le Sépulcre. |
|

La Vierge et saint Jean, accompagnés d'une sainte femme dans
le Sépulcre (avant 1520). |
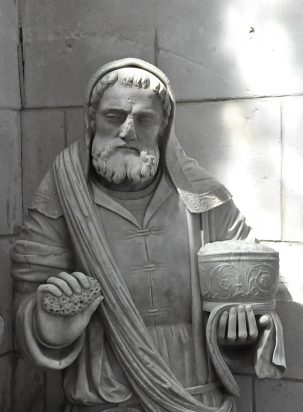
Nicodème dans le Sépulcre (avant 1520). |

Joseph d'Arimathie dans le Sépulcre (avant 1520). |
| LE BANC D'ŒUVRE, XVIIIe SIÈCLE |
|
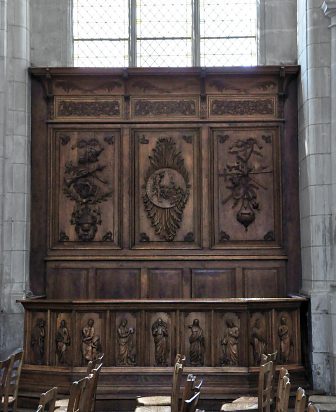
Le banc d'œuvre du XVIIIe siècle. |

La Décollation de saint Jean-Baptiste dans le banc d'œuvre. |
|
Le banc
d'œuvre de l'église Saint-Jean a été
classé monument historique au titre d'objet en 1992.
C'est une œuvre du XVIIIe siècle qui brille par le très
haut niveau artistique de ces bas-reliefs. Le détail
en est donné en gros plan ici : décollation
de Jean-Baptiste et symboles liturgiques sur le panneau d'arrière-plan
; le Christ et les apôtres sur le devant.
|
|

Décollation de saint Jean-Baptiste et symboles liturgiques
sur le dossier du banc d'œuvre (XVIIIe siècle). |

Le Christ et les apôtres dans le banc d'œuvre (XVIIIe
siècle).. |
|

Niches de saint Pierre et de saint Paul
dans la nef (moderne) |
|
| LE TOMBEAU D'ADÉLAÏS, COMTESSE DE
JOIGNY |
|

Le tombeau d'Adélaïs, comtesse de Joigny (†1187). |

Le tombeau d'Adélaïs, détail du soubassement :
deux des enfants de la comtesse. |

Le tombeau d'Adélaïs de Champagne, détail.
La gisante est vêtue d'une coiffe à mentonnière.
Milieu du XIIIe siècle. |

Saint Simon dans sa niche.
Nef de l'église Saint-Jean. |
|
|
Le
tombeau d'Adélaïs de Champagne,
comtesse de Joigny date du milieu du XIIIe siècle.
Adélaïs est une comtesse de la première
famille des comtes de Joigny, morte en 1187. Les comtes
et comtesses de cette famille étaient enterrés
au prieuré Notre-Dame de Joigny ou encore à
l'église Notre-Dame de l'abbaye des Prémontrés
de Dilo. C'est à l'abbaye de Dilo qu'avait été
déposée cette magnifique œuvre médiévale.
L'abbaye étant démolie en 1843, le tombeau
fut transporté d'abord à la mairie de
Joigny, puis à l'église Saint-Jean - sans
aucune casse pour les sculptures, nous disent les historiens.
La comtesse est représentée avec la tête
vêtue d'une coiffe à mentonnière.
Elle porte une longue robe. Un chien veille à
ses pieds. Sur la face antérieure, sous des arcs
trilobés, quatre personnages sont sculptés
en bas-relief : ce sont les enfants de la gisante. Sur
la photo ci-dessus à droite, on voit une jeune
femme, coiffée comme sa mère, qui doit
être Agnès ; à sa gauche, son frère
Guillaume porte un faucon son son poing. Une allégorie
représentant l'insouciance est sculptée
à la tête du sarcophage (bas-relief non
donné dans cette page). Sources : 1)
Congrès archéologique de France, 1958,
Auxerre, Joigny par Jean Vallery-Radot ; 2) À
la découverte de Joigny éditée
par l'Association culturelle et d'Études de Joigny.
|
|
| LA VOÛTE DE JEAN CHÉREAU
(2e moitié du XVIe siècle) |
|

La remarquable voûte de Jean Chéreau dans
la nef. |
|

Trois sculptures sur la moulure qui sépare
le niveau gothique du niveau Renaissance
dans la nef et le chœur. |

|

|
|
|
|
La voûte
de Jean Chéreau. Saint-Jean est une église
où il faut lever la tête, autant dans la nef
que dans les bas-côtés. Dans la nef, la voûte
est en berceau surbaissé avec pénétrations
pour les baies. «Elle est ornée à l'intrados
d'un compartimentage en très faible relief, dont le
dessin général rappelle celui d'un parterre
de broderies dans un jardin», écrit Jean Vallery-Radot.
Jean Chéreau, son concepteur, la désignait sous
le terme de «voûte en parquets». Comme pour
la façade du château des Gondi, Chéreau
s'est inspiré des livres de l'italien Sebastiano Serlio.
On voit, ci-contre, le détail de l'intrados d'une voûte
en berceau des pénétrations : un octogone, abritant
une tête d'angelot ou de diablotin, est entouré
de deux carrés à large bord remplis d'une fleur
à nombreux pétales. Dans l'image ci-dessous,
le gros plan sur la voûte montre une quantité
impressionnante de têtes de petits personnages (dont
certains rayonnent comme des soleils) et de motifs floraux
dans un ordonnancement qui pourrait rappeler un jardin à
la française.
La voûte a été réalisée
entre 1557 et 1596, c'est-à-dire à une époque
où la voûte ogivale bénéficiait
encore d'une large préséance dans la région.
On la retrouvera d'ailleurs au siècle suivant à
Auxerre, Villeneuve-sur-Yonne,
Avallon, etc.
On se doute que cette voûte en pierre pèse lourd.
Sa stabilité est assurée, à l'extérieur,
par de minces arcs-boutants (voir photo plus
haut) dont les culées, renforcées de vases
et de guirlandes, prennent appui sur les vieux contreforts
de grès de l'ancienne église.
Source : Congrès archéologique
de France, 1958, Auxerre.
Article Joigny par Jean Vallery-Radot.
|
|

Le décor de Jean Chéreau dans l'intrados d'une voûte
en pénétration. |

«Le parterre de broderie dans un jardin» : la voûte
Renaissance de Jean Chéreau. |

Décor Renaissance entre deux intrados de petites voûtes
en pénétration.
Nef de l'église Saint-Jean.
|

Le bas-côté sud vu depuis le chœur.
La plupart des vitraux sont en verre blanc : l'église Saint-Jean
bénéficie d'une très grande luminosité. |

Saint Jacques le Majeur dans sa niche.
|
| LES VITRAUX RENAISSANCE DE L'ÉGLISE SAINT-JEAN |
|
|
Les
vitraux Renaissance. La première consécration
de l'église Saint-Jean date 1504. Elle sera suivie
du terrible incendie de 1530. Les vitraux qui ornaient
les baies de sa nef ont sans doute été
posés peu après 1504, car des fragments
portent la date de 1509. En 1910, un érudit note
la présence, dans la baie 13, d'anges musiciens
du XVIe siècle ainsi que d'une Vierge à
l'Enfant entourée de Jacob et de Joseph.
Le XIXe siècle a ajouté des vitraux figuratifs,
détruits lors des bombardements de 1940. En 1951,
l'atelier Louzier et Gimonet répara les
verrières et, en 1980, l'atelier Gaudin
ajouta des vitreries décoratives dans quelques
baies. Cette page donne la plupart des vitraux du XVIe
siècle visibles dans l'église, c'est-à-dire
les tympans des baies 9,
11 et 12.
Source : Corpus Vitrearum,
Les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté et
Rhône-Alpes, Éditions du CNRS 1986.
|
|
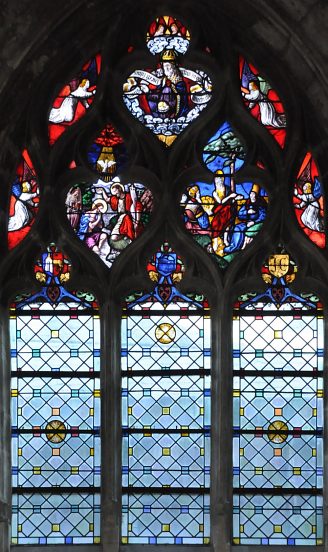 Vue d'ensemble de la baie 11.
Vue d'ensemble de la baie 11.
Le tympan et les têtes de lancettes (avec trois écus)
sont du XVIe siècle.
Les lancettes décoratives sont de l'atelier Gaudin (1980). |
|
| VITRAIL RENAISSANCE, BAIE 11 |
|

Dans le soufflet, le Père céleste bénissant. Dans
chacune des mouchettes, un ange sur fond rouge.
Détail du tympan de la baie 11, début du XVIe
siècle. |

Le Baptême de Jésus (restauré).
Soufflet du tympan de la baie 11.
Début du XVIe siècle. |

Prédication de saint Jean-Baptiste.
Soufflet du tympan de la baie 11.
Début du XVIe siècle. |
|
| LES VOÛTES D'OGIVES DES BAS-CÔTÉS |
|
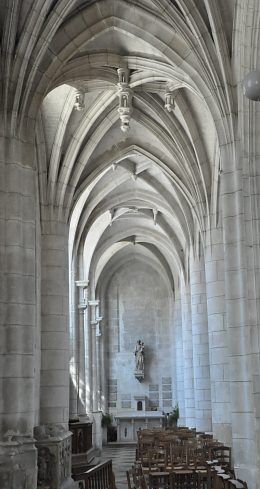
Le bas-côté sud vers la chapelle Saint-Joseph
à l'entrée de l'église.
Sur la suite des voûtes, on peut voir
l'une des rares clés pendantes de l'église. |

Un croix dessinée par les liernes et les tiercerons
dans une voûte d'ogives d'un bas-côté de
l'église Saint-Jean. |
|
Les
voûtes des bas-côtés.
Si la voûte de la nef est un chef-d'œuvre
à elle toute seule, on ne peut pas visiter l'église
Saint-Jean sans lever un œil émerveillé
vers les voûtes des bas-côtés. Jean
Chéreau, l'architecte de la reconstruction
après l'incendie de 1530, s'est efforcé
d'embellir ces deux suites de voûtes en multipliant
les tracés de liernes et de tiercerons. Les suites
nord et sud sont presque symétriques. On remarquera,
sur le plan de l'église donné plus haut,
que cet embellissement - et la beauté qui l'accompagne
- s'accroît à mesure que l'on se rapproche
du chœur.
|
|
|

Le Sacré-Cœur sur une clé de voûte
au centre de la croix donnée ci-contre. |

Fleur avec fruit et pétales sur une clé de voûte.
à une extrémité de la croix donnée
ci-contre. |
|

La voûte du bas-côté nord avec ses liernes
et tiercerons.
(Précision : la clarté à gauche vient des
fenêtres hautes de la nef) |
| VITRAIL RENAISSANCE, baie 12 |
|

Vitrail : tympan de la baie 12, XVIe siècle.
Les nombreuses étoiles sont montées en chef-d'œuvre
Les têtes de lancette, à gauche et à droite,
sont données en gros plan plus
bas. |
|

Une croix dessinée avec des liernes et des tiercerons
dans une voûte du bas-côté nord.
On voit à gauche une partie de la voûte de la nef
et de l'intrados de la voûte en berceau d'une pénétration. |

Saint Luc et saint Marc dans leur niche.
Nef de l'église Saint-Jean. |

Le bas-côté nord en direction de la chapelle Saint-Vincent.
|
| VITRAIL RENAISSANCE, baie 12 |
|

Détail du tympan de la baie 12 avec lune et soleil. Début
du XVIe siècle. |
|

Vitrail : Mouchettes de la baie 11.
Les anges au centre portent les instruments de la Passion.
On remarquera la présence de très nombreuses étoiles
montées en chef-d'œuvre.
Début du XVIe siècle. |

Tête de lancette dans la baie 12.
Moïse et les tables de la Loi. Début du XVIe siècle
(restauré). |

Tête de lancette dans la baie 12.
Marie-Madeleine et son pot d'aromates. Début du XVIe siècle. |

Saint André dans sa niche.
Nef de l'église Saint-Jean. |
| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-JEAN |
|

Le chœur de l'église Saint-Jean.
Le maître-autel est du XIXe siècle. L'autel de
messe et l'ambon sont contemporains. |

Ornementations du XIXe siècle sur le maître-autel
:
Le Baptême de Jésus et la Décollation de
saint Jean-Baptiste. |
|

Chapiteau Renaissance et animaux fantastiques sous la moulure
au-dessus du chœur (2e moitié du XVIe siècle). |

Animaux fantastiques sous la moulure au-dessus du chœur
(2e moitié du XVIe siècle). |

Le maître-autel du XIXe siècle. |
|

Saint Pierre et saint Paul abrités sous un
impressionnant dais de style Renaissance. |

La voûte du chœur, détail. |

Chapiteau Renaissance et animal fantastique
sous la corniche du chœur.
«««--- À GAUCHE
Le dessin très élaboré de Jean Chéreau
pour le «parquet de la voûte» au-dessus du chœur. |
|
|

Chapiteau et décoration Renaissance
dans le chœur, XVIe siècle. |

L'église du berceau de saint Vincent de Paul.
Mouchette du XIXe siècle. |

Le corps de saint Vincent de Paul dans une mouchette du XIXe siècle.
Les Gondi, seigneurs de Joigny, secondèrent l'action de «Monsieur
Vincent». |
| VITRAIL RENAISSANCE, baie 9 |
|

Tympan de la baie 9, début du XVIe siècle.
Les têtes des deux lancettes accueillent des putti gardant un
ciboire.
Dans le soufflet, des pèlerins se recueillent autour de la
châsse d'un saint. |
 |

|
|
À DROITE ---»»»
Soufflet de la baie 9 : des pèlerins se recueillent
autour de la châsse d'un saint. La colombe
du Saint-Esprit vole au-dessus d'eux.
Début du XVIe siècle.
|
«««---
À GAUCHE
Détail d'une tête de lancette dans la baie 9.
Début du XVIe siècle. |
|
| LA SEPTIÈME TRAVÉE OU LE «DÉAMBULATOIRE»
(XVIe SIÈCLE) |
|

Le mur du chœur vu depuis la chapelle axiale. |

«Marie-Madeleine au pied de la croix»
Tableau donné par l'Empereur en 1858. |

La 7e travée forme une sorte de petit déambulatoire.
On est ici devant la chapelle absidiale Saint-Vincent de Paul,
les vitraux sont de l'atelier Gaudin (1980). |
|
La 7e travée
forme une sorte de petit déambulatoire ouvert sur la
chapelle d'axe et sur deux chapelles absidiales très
peu saillantes. Les voûtes de cette travée et
l'intrados des absidioles sont remarquables.
|
|

Chapelle du Sacré-Cœur dans l'absidiole sud.
Le dessin de l'intrados n'est pas le même que celui de la chapelle
St-Vincent. |

L'autel XIXe siècle
de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul
dans l'absidiole nord. |
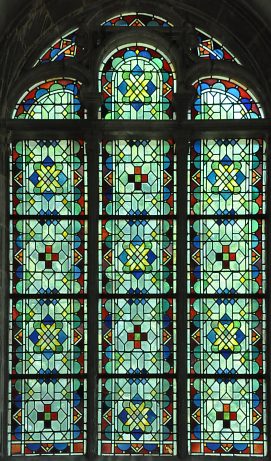
Un des vitraux à figures géométriques
de la chapelle d'axe
(XXe siècle). |
| LA CHAPELLE AXIALE DU XIXe SIÈCLE |
|

Vue d'ensemble de la chapelle d'axe. |
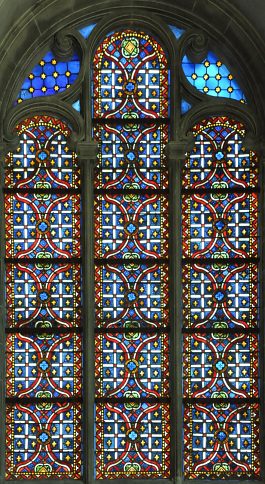
Vitrail à figures géométriques dans la
chapelle axiale. |

Le soubassement de l'autel de la chapelle axiale : Annonciation
et Visitation encadrent une Nativité. |
|

Ornementation XIXe siècle dans la chapelle axiale. |
|
La
chapelle d'axe a été construite
en 1856 et dédiée à Notre-Dame.
Cette construction avait peut-être pour but de
mettre l'église Saint-Jean en règle avec
le vœu de Louis XIII du 10 février 1638
qui consacrait le royaume de France à Notre-Dame.
À la suite de ce vœu, les églises
françaises qui n'étaient pas dédiées
à Notre-Dame prirent l'habitude d'avoir leur
chapelle principale (souvent la chapelle d'axe) dédiée
à la Vierge.
L'architecture de la chapelle d'axe rappelle celle du
reste de l'église. Quant à l'ornementation
de l'autel, elle est typique du XIXe siècle :
le tabernacle a même pris la forme d'une «maison
d'or» ou d'une «tour de David», deux
appellations de la Vierge dans les litanies.
Les vitraux du XXe siècle sont assez fortement
colorés.
|
|
|

L'orgue de tribune.
Le buffet central est d'époque Louis XIV (XVIIe siècle).
Le positif dorsal est du XVIIIe siècle.
Les jouées de part et d'autre du bloc central ont été
ajoutées au XIXe siècle
pour cacher une partie de la tuyauterie. |

Ornementations sur la partie supérieure de l'orgue de
tribune.
Les décorations sur les trois tourelles et les pots à
feu datent du XVIIe siècle. |
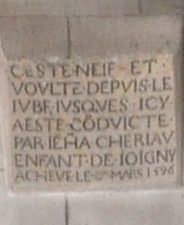
Plaque sur le revers du mur
du clocher-porche,
au-dessus de l'orgue de tribune. |
|
Les
datations. Saint-Jean regorge de dates d'achèvement
gravées dans les pierres ou les clés de
voûte lors de la reconstruction de 1548. Cette
profusion assez inhabituelle permet à l'historien
d'en suivre l'évolution à la trace, que
ce soit pour la nef, les bas-côtés ou les
voûtes.
Ainsi, Jean Vallery-Radot, dans son étude de
1958 pour le Congrès archéologique de
France, indique en notes ou dans le texte, au fil de
la rédaction : La date de 1548 est gravée
à l'intrados de l'une des deux petites baies
à voussure fuyante percées à la
base du mur, ou La date de 1548 est gravée
dans la voûte de cette travée ou encore
Au-dessus de la troisième baie de la nef,
côté nord, on lit : «Le 2 mai 1590»,
ou enfin On relève cette date [1556] gravée
autour d'un monogramme sur la clef de voûte de
la deuxième travée du collatéral
sud, etc. La plaque ci-contre est la marque de bon
achèvement ou de fin de travaux la plus complète
que l'on puisse trouver. Elle signe le travail de Jean
Chéreau : Cette nef et voûte depuis
le jubé jusqu'ici a été conduite
par Jean Chéreau, enfant de Joigny. Achevé
le 12 mars 1596.
Source : Congrès archéologique
de France, Auxerre, 1958.
|
|
|

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur. |
Documentation : Congrès archéologique
de France, 1958, Auxerre, Article Joigny par Jean Vallery-Radot
+ À la découverte de Joigny éditée
par l'Association culturelle et d'Études de Joigny
+ Dictionnaire des églises de France, éditions
Robert Laffont. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |










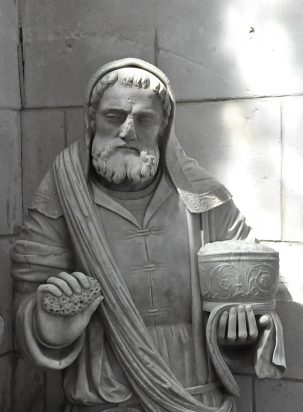

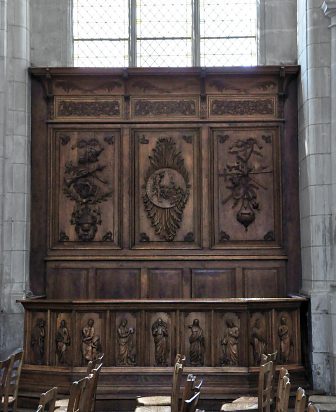








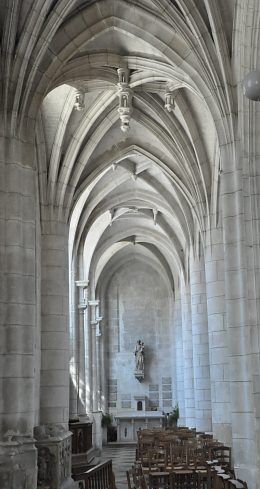


















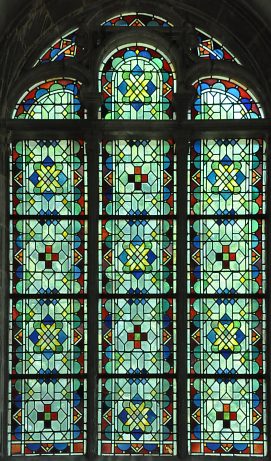




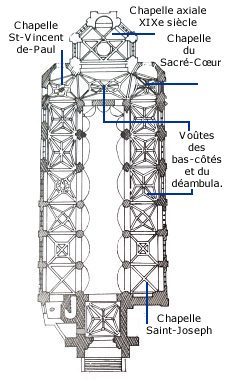



















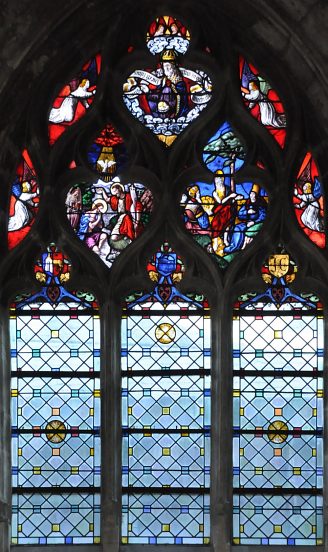 Vue d'ensemble de la baie 11.
Vue d'ensemble de la baie 11.