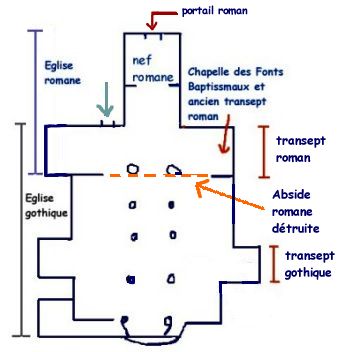|
|
 |
 |
L'église Saint-Étienne
d'Ars-en-Ré fait preuve d'originalité en présentant
une église romane et une église gothique imbriquées.
Au XIe siècle, une petite chapelle romane fut construite,
puis agrandie au XIIe et transformée en gothique au XVe.
Pour se défendre des attaques des pillards venus de la mer,
le village édifia très tôt, autour de son église,
une enceinte fortifiée à la manière d'un château
fort. Celle-ci fut démantelée au XVIIIe siècle.
Sous la Révolution, Saint-Étienne devint Temple de
la Réunion et de la Raison. C'est sous ses voûtes gothiques
que se tenaient les séances de la société populaire
des Amis de la Liberté et de l'Égalité. Elle
fut rendue au culte en 1802.
L'église Saint-Étienne d'Ars est connue par ses cartes
postales et son clocher de 40 mètres blanc et noir qui sert
d'amer aux marins, mais c'est aussi l'église d'une petite
commune classée parmi les plus beaux villages de France.
|
 |

Vue générale de l'église gothique.
Photo prise au niveau de la troisième travée sur les
quatre que compte la nef.
A gauche, la chaire à prêcher date du premier quart du
XVIIe siècle. |

Au premier plan, la partie romane de Saint-Étienne et son portail. |

Saint-Étienne d'Ars-en-Ré possède un portail
roman de très belle facture.
Malheureusement, il ne reste quasiment rien des sculptures sur les
voussures. |
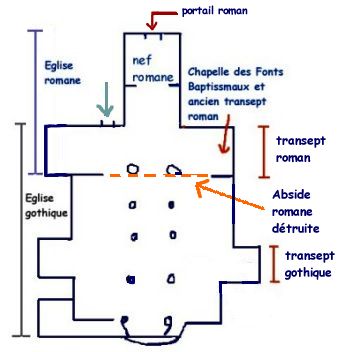
Plan de l'église Saint-Étienne d'Ars-en-Ré.

|
Plan.
L'imbrication de deux églises romane et gothique rend
un plan général indispensable. La partie romane
est en haut, la partie gothique en bas. On voit que le transept
roman a été réutilisé comme narthex
de l'église gothique tandis que l'abside de l'église
romane était détruite.
|
|

Vue générale de l'église Saint-Étienne
d'Ars-en-Ré avec son monument au morts.

|
Photo.
La partie romane des XIe et XIIe siècles est à
gauche et au centre de la photo (avec le bras sud du transept).
Toute la partie de droite (partiellement cachée par
le bras sud du transept) correspond à l'église
gothique du XVe siècle.
On aperçoit, sur la droite, le bras sud du transept
gothique. Ainsi Saint-Étienne d'Ars a deux transepts
!
|
|
| |

Nef romane du XIe siècle. |
|
La
nef romane possède deux travées
et n'est éclairée que par quatre petites
fenêtres. On remarquera la blancheur des murs
comme, d'ailleurs, partout dans l'église.
Cette blancheur omniprésente rappelle une règle
de l'Ile-de-Ré : les murs externes des habitations
doivent obligatoirement être de couleur blanche.
|
|
|

Chapelle des Fonts baptismaux fermée par une clôture
en chêne. C'est le bras gauche du transept roman. |
La clé de voûte de la croisée d'ogives de
la nef romane comporte une décoration pittoresque : un
visage de bonhomme souriant
ou grimaçant.
Dans la photo à gauche,
cette clé de voûte est masquée par le lampadaire
suspendu. |
 |
|
|
L'enceinte
de l'église Saint-Étienne d'Ars-en-Ré.
Au XIe siècle, l'église n'est qu'un édifice
rectangulaire (la nef romane actuelle). Au XIIe, l'abbaye
de Saint-Michel en l'Herm (en Vendée) reprend possession
de ses îles d'Ars et de Loix (dans l'actuelle Ile-de-Ré).
On peut penser qu'une première tranche de modifications
eut lieu à cette époque. Au XVe siècle,
sous la pression d'une population croissante, l'église
s'agrandit d'une partie gothique.
Cependant, comme l'abbaye des Châteliers
sur la commune de la Flotte-en-Ré, ces petits villages
insulaires demeuraient des proies tentantes pour les pillards
venus de la mer. C'est pourquoi les habitants d'Ars construisirent
une enceinte fortifiée autour de leur église.
De hautes murailles, percées de trois portes bien défendues,
s'appuyaient sur un mur intérieur épais. À
l'extérieur, une douve en faisait le tour. C'était
un véritable château fort dominé par une
tour carrée de treize mètres de haut, elle-même
coiffée d'un dôme aplati.
|
De là, il était facile
d'observer la mer et de repérer tous les navires. Entre
les murailles et l'édifice cultuel se trouvait un large
terrain à découvert où s'entraînaient
les hommes chargés de la défense. Il est d'ailleurs
possible que le nom d'Ars vienne du latin Arx qui signifie
«citadelle».
Le péril venu de la mer ne disparut vraiment qu'au
XVIIIe siècle. L'enceinte fut alors démantelée
petit à petit. Vers 1760, on utilisa des pierres du
mur pour paver des allées de l'église. Sous
la Terreur, en février 1794, l'ensemble de la muraille
fut démolie et l'on combla la douve qui en protégeait
l'accès. D'une manière générale,
le terrain fut remblayé et arasé pour faciliter
les exercices de la Garde Nationale.
C'est ainsi qu'on explique l'exhaussement du niveau de la
place de l'église et, par suite, l'enfouissement du
bâtiment cultuel. En effet, en étant sur la place
Carnot d'Ars, il faut descendre six marches, devant le portail
roman, pour accéder à l'église.
|
|

Vue d'ensemble du chœur et des autels.
La construction date du XVe siècle, les autels, du XVIIIe siècle.
Au premier plan, l'autel de messe. |

Chapelle latérale de la Vierge.
Le tableau illustre Notre-Dame du Rosaire. |

Chapelle latérale Saint-Nicolas.
Les voûtes gothiques blanches et très bombées
rappellent le style Plantagenêt. |

|

L'autel de messe, la nef et le bas-côté nord.
L'autel de messe est entouré de stalles.
«««---
Le maître-autel, dédié à saint Étienne, date du XVIIIe
siècle.
Le tableau illustre la lapidation du saint à Jérusalem. |
|

Sculpture en pierre d'un chérubin
dans l'abside centrale. |
 |
 |
La chaire à
prêcher de Saint-Étienne d'Ars est en noyer. La
base Palissy la date du 1er quart du XVIIe siècle.
Elle est supportée par une très belle tête
sculptée évoquant Samson (ci-dessus).
La partie inférieure de son abat-voix cache une colombe.
---»»» |
 |
|

Chapelle du Sacré-Cœur dans le bras sud du transept gothique.

|
Chapelle
du Sacré-Cœur. Elle a été
construite en 1654. À la Révolution elle est
devenue poudrière. Sa restauration date de 1824.
En, 1852, à la suite de deux naufrages en mer, elle
a été dédiée aux Marins.
Deux ex-voto en portent témoignage : une maquette,
«la Reine des Anges»
(brick ponté à deux mâts), réalisée
par un marin d'Ars en 1854 et une peinture à l'huile,
«la Lucile», où l'on voit un trois-mâts
goélette anglais porter secours à un chasse-marée
français bien secoué par la tempête.
|
|
 |
 |
|
|

Vue générale des trois autels de l'abside derrière
les imposants piliers cylindriques de la nef.
Il s'en dégage une beauté certaine comme se dégage
aussi, à l'extérieur, l'aspect pittoresque d'Ars-en-Ré
qui compte parmi les «plus beaux villages de France». |
Documentation : panneaux d'information exposés
dans l'église Saint-Étienne. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|