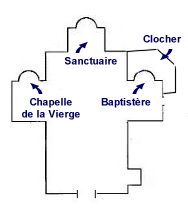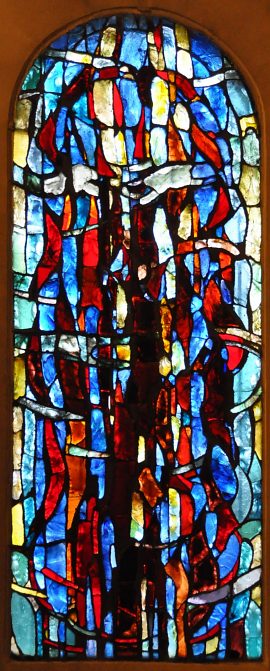|
|
 |
 |
L'église Notre-Dame de l'Assomption
se situe dans le quartier nord de Meudon,
un quartier appelé «Bellevue» d'après
le propre mot de Louis XV venu visiter le château que la marquise
de Pompadour, vers 1750, s'y était fait construire. Mais
Bellevue, c'est également un sinistre souvenir : c'est là
qu'un terrible accident de chemin de fer, en 1842, coûta la
vie à des dizaines de voyageurs, dont le marin et explorateur
français Jules Dumont d'Urville.
La Révolution ruine le château de Bellevue. Au XIXe siècle,
de coquettes maisons sont bâties dans le parc par la bourgeoisie
aisée parisienne. L'église Saint-Martin
étant assez loin, la municipalité de Meudon
autorise en 1844 la création d'une chapelle afin d'assurer
le culte localement. Un terrain est acheté à la société
des Chemins de Fer de la rive gauche (ce qui explique que l'église
soit tout à côté de la gare de Bellevue) et
une souscription est ouverte. La construction, placée sous
la direction de l'architecte E. Vigoureux, est terminée en 1846.
La chapelle ne possède ni clocher, ni chapelles latérales.
Par un décret de 1857, l'Empereur Napoléon III l'érige
en chapelle de secours : le culte y sera célébré
sous la direction du curé de Meudon
; la gestion sera assurée par la fabrique de l'église
Saint-Martin.
En 1860, les habitants de Bellevue demandent l'agrandissement de
leur chapelle, ce que refuse la municipalité (sans doute
sur pression du curé qui ne souhaite pas que la chapelle
devienne paroisse, échappant à ses prérogatives).
Après maints palabres, le bâtiment sera finalement
agrandi. Un transept avec deux chapelles latérales, puis
un clocher seront ajoutés. Le site Web de la paroisse donne
l'information suivante : la querelle est remontée au ministre
des Cultes et jusqu'à l’Empereur lui-même ; en mai
1861, ce dernier signe un décret autorisant l'extension. Les travaux
seront achevés en 1872. L'histoire raconte que le maire s'est
finalement réconcilié avec les habitants du quartier
Bellevue...
Notre-Dame de l'Assomption présente toujours son aspect du
XIXe siècle. C'est une petite église de style éclectique
avec une belle voûte lambrissée et un chemin
de croix dû à une artiste de l'Église réformée
de Meudon.
L'église pourra néanmoins intéresser les amateurs
de vitraux. Le chœur est en effet orné d'une petite
rose de 1846, créée par la Manufacture royale de Sèvres,
illustrant la Vierge
à l'Enfant. D'autre part, Job et Michel Guevel ont réalisé,
au début des années 1980, sept verrières originales
en dalle
de verre, un matériau très prisé à
cette époque.
|
 |

La nef et le chœur de l'église Notre-Dame de l'Assomption. |

La façade de l'église Notre-Dame. Les consoles portaient
deux statues, retirées en 1982. |
|

Le chœur de l'église et le côté sud. |

Le baptistère dans le côté sud.
La cuve baptismale, tirée d'un chêne de Meudon en 1993,
est l'œuvre d'A.D.Roppert, sculpteur meudonnais.
Derrière, la tapisserie, de 1992, est une création de
17 paroissiennes. Elle représente la foule
des baptisés qui émerge des eaux.
|

«Le Christ aux outrages»
Panneau peint attribué à Van Hemmessen (XVIe siècle). |

L'orgue de tribune est un Aristide Cavaillé-Coll de 1887.
Il a été restauré en 1975 et 1992. |
|
Le chemin
de croix de l'église date de l'année
2008. Il a été réalisé par une
artiste de l'Église réformée de Meudon
: Marie-Laure de la Rochefordière. Sa base est un cercle sur
une croix. Cinq exemples en sont donnés ci-dessous.
Le visage du Christ est représenté en forme
de mandorle. L'artiste écrit à son sujet : «Elle
signifie l’union de la terre et du ciel, des mondes inférieurs
et supérieurs. Elle convient, ainsi à l’encadrement des humains
sanctifiés. C’est pour ces raisons spirituelles et esthétiques
que je présente le visage du Christ dans une mandorle.»
Source : Présentation
du chemin de croix par Marie-Laure de la Rochefordière sur
le site de la paroisse.
|
|

Chemin de croix, station I :
Jésus est condamné à mort. |

Chemin de croix, station II :
Jésus est chargé de sa croix. |

Chemin de croix, station IV :
Jésus rencontre sa mère. |

Chemin de croix, station V :
Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. |

Chemin de croix, station XII :
Jésus meurt sur la croix.
Le chemin de croix a été créé en 2008
par
Marie-Laure de la Rochefordière
de l'Église réformée de Meudon. |

Le côté nord et ses vitraux en dalle de verre, dont un
oculus.
La chapelle de la Vierge dans le bras nord du transept. ---»» |
 |
| MOBILIER ET VITRAUX
DU CHŒUR |
|

L'ambon du chœur est orné du Tétramorphe. |

L'ornementation du maître-autel représente
la Trinité créatrice.
Œuvre de D. Kaeppelin. |
|

Vitrail de saint Adolphe, patron du donateur du vitrail.
Atelier Noël Lavergne, Paris 1887. |

Vitrail de la Vierge à l'Enfant, détail. |
|

Sainte Clotilde et saint Adolphe sont peints sur un semis
d'oiseaux en camaïeu de bleus.
Atelier Noël Lavergne, 1887. |

Vitrail de la Vierge à l'Enfant.
Manufacture royale de Sèvres,
1846. |
|
|
Le
vitrail «La Vierge à l'Enfant» de
la Manufacture de Sèvres.
En 2003, dans l'ouvrage Un patrimoine de lumière,
1830-2000, Nicole Blondel, alors conservateur général
honoraire du patrimoine, donne une information intéressante
sur les vitraux créés par la Manufacture
de Sèvres
au XIXe siècle.
Les cartons de Sèvres
étaient réalisés par des artistes
célèbres (comme Jean-Dominique Ingres
pour les verrières de Notre-Dame
de la Compassion à Paris, 17e) et la réalisation
des vitraux, mise au point par l'atelier sévrien,
était complexe. Le prix était donc élevé.
Alexandre Brongnart, directeur de la Manufacture, accepta
un procédé quasi industriel pour en diminuer
le coût : l'impression par transfert pour la réalisation
des bordures.
C'est ce qui a été fait pour la petite
rose du chœur de Notre-Dame de l'Assomption (la
Vierge à l'Enfant donnée ci-dessus) dont
la bordure a été dessinée par Hyacinthe
Régnier.
«Le procédé, écrit Nicole
Blondel, consistait à transférer les motifs
colorés à l'aide d'épreuves imprimées
à partir de plaques de cuivre gravées
au burin et enduites de couleurs vitrifiables.»
Elle ajoute que cette invention est due aux Anglais
«qui ornent leurs faïences fines de cette
façon standardisée à partir de
la fin du XVIIIe siècle.» La Manufacture
royale de Sèvres
utilisera pour la première fois ce procédé
vers 1806.
|
|
|

Le Tétramorphe décore l'ambon. |

Vitrail de sainte Clotilde, patronne de la donatrice.
Atelier Noël Lavergne, Paris 1887. |

Vitrail de la Vierge à l'Enfant, détail. |
|
| LES VITRAUX EN
DALLE DE VERRE DE JOB ET MICHEL GUEVEL |
|
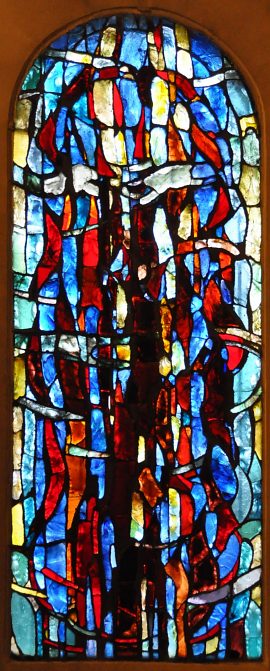
Vitrail en dalle de verre.

Ce matériau pose de gros problèmes
de conservation (voir le texte ci-contre). |

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail. |
| QUATRE VITRAUX EN
DALLE DE VERRE ---»»» |
|

Statue de saint Antoine de Padoue
avec l'Enfant-Jésus, détail. |
|
|
La
dalle de verre. Les sept vitraux non figuratifs
en dalle de verre des maîtres verriers Job et Michel
Guevel ont été posés de 1981 à 1983. Six sont installés
dans des fenêtres en plein cintre, le septième
est un grand
oculus dans le bras nord du transept. Leurs auteurs
les ont associés aux symboles chrétiens
que sont la Création et les sacrements.
Dans l'ouvrage Un patrimoine de lumière, 1830-2000,
l'historienne Laurence de Finance précise, à
propos des dalles de verre, que, dans l'architecture
religieuse des années 1960, celles-ci sont plutôt
utilisées pour les verrières monumentales,
notamment sur les façades, ouvrant ainsi l'église
sur le monde, conformément aux principes de Vatican
II. L'église Stella
Matutina à Saint-Cloud
(92) offre un exemple de cette ouverture sur le monde,
bien que la verrière de la façade ne soit
pas en dalle de verre.
L'avis du peintre Alfred Manessier (rapporté
par Laurence de Finance) est assez pertinent sur ce
matériau. Pour cet artiste, la dalle de verre
ne peut pas prendre place dans une fenêtre de
style gothique ou Renaissance car, par son aspect, elle
alourdit, alors que, dans ces deux styles d'architecture,
le vitrail doit alléger. La dalle de verre, reconnaît-il,
a pour elle des qualités d'insonorisation et
de solidité que n'a pas le vitrail traditionnel.
En revanche, ce dernier a un atout bien connu qui fait
tout son charme : il filtre la lumière en la
coloriant et diffuse ainsi un tapis de couleurs. Il
est clair que les exemples de dalles de verre présentés
à gauche et ci-dessous ne permettent de distribuer
qu'une lumière diffuse.
Les baies de l'église Notre-Dame de l'Assomption
sont de style néo-roman, creusées dans
de solides cloisons murales : elles échappent
ainsi au premier reproche d'Alfred Manessier. En revanche,
conformément à son propos, les dalles
de verre sont très solides. Elles sont d'ailleurs
en relief. Deux photos données à droite
présentent des plans rapprochés : on y
voit le doigt d'une main apposé contre le matériau
pour bien en montrer l'aspect en trois dimensions.
La dalle de verre a-t-elle
un avenir ? En 2018, dans l'ouvrage Les
défis du vitrail contemporain (SilvanaEditoriale),
Claudine Loisel, docteur en chimie et ingénieur
de recherche pour les Monuments historiques, se montre
perplexe sur les capacités de conservation de
ce matériau auquel elle prédit un avenir
assez sombre. Son poids et sa structure lui fermant
le débouché des édifices anciens
protégés au titre des Monuments historiques,
son usage se perpétue aujourd'hui à l'international.
Mais, reconnaît-elle, la dalle de verre n'a plus
la faveur du public, que ce soit pour l'esthétisme
ou la technique. «Beaucoup de problèmes
de conservation apparaissent, écrit-elle, liés
à la mise en œuvre du béton, des
armatures en fer qui rouillent et des dalles en verre,
mal recuites ou de composition chimique instable, qui
se feuillètent et perdent toute consistance.»
|
|
 |
 |

|

|
|

Vitrail en dalle de verre : le relief est bien visible. |

Vitrail en dalle de verre : le doigt indique le relief. |

Statue de la Vierge à l'Enfant (Art populaire). |

Vitrail en dalle de verre : le doigt indique le relief. |

Vitrail en dalle de verre : le relief est bien visible. |
|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur. |
Documentation : Site Internet de la paroisse
+ «Un patrimoine de lumière, 1830-2000», MONUM,
Éditions du patrimoline, 2003.
+ «Dictionnaire des monuments d'Ile-de-France», éditions
Hervas, 2001. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|