|
|
 |
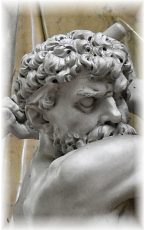 |
Cette troisième page consacrée
à la cathédrale Saint-Étienne de Sens termine
l'examen des grandes verrières de la Renaissance dans le
transept
: Les Saints Protecteurs (ci-dessous), les Saints
Archevêques de Sens et la Vie
de saint Nicolas. Puis elle aborde des thèmes architecturaux
avec le chœur
et ses deux chapelles
orientées (les plus anciennes chapelles de la cathédrale)
et le déambulatoire.
C'est dans le déambulatoire que le visiteur peut admirer
les grandes verrières du XIIIe siècle (Le
Bon Samaritain, le Fils
Prodigue, Thomas
Becket et saint
Eustache). Enfin, l'attention est portée sur les trois
chapelles rayonnantes. La chapelle
axiale, dédiée à saint Savinien, date de
la première période de construction (début
du XIIe siècle). Elle a été agrandie au XIIIe.
Quelques photographies sont proposées du très beau
marbre de 1772 illustrant le martyre
de Savinien par Joseph Hermand. La chapelle
du Sacré-Cœur remonte à la Renaissance, son
pendant, celle de Sainte-Colombe,
date du XVIIIe siècle. La chapelle Sainte-Colombe abrite
le mausolée
du Dauphin et de la Dauphine, œuvre de Guillaume Coustou
le Jeune (1777).
Ces deux dernières chapelles contiennent des vitraux dignes
d'intérêt, notamment une Sibylle
de Tibur (des années 1550) et un très rare vitrail
du XVIIIe siècle : une Crucifixion
datée de 1748.
Cette page revient abondamment sur le problème architectural
des retombées
de voûtes d'ogives, déjà exposé en
page
1 pour les bas-côtés. Ici, ce problème,
typique du gothique primitif, est explicité sur les voûtes
du déambulatoire, là où, selon les historiens,
le maître de Sens a montré quelques maladresses.
|
 |
| VERRIÈRE DES SAINTS PROTECTEURS DU DIOCÈSE
(Baie 123) - 1646 |
|
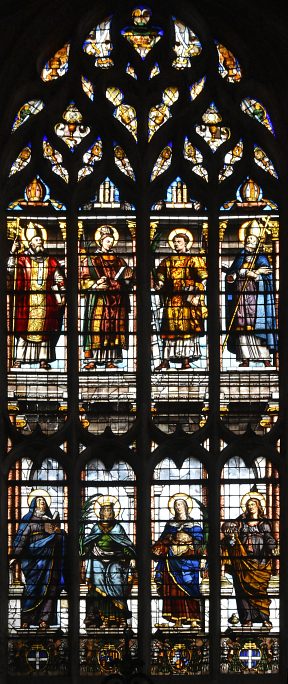
Baie 123, LES SAINTS PROTECTEURS DU DIOCÈSE DE SENS |
|
Verrière
des saints protecteurs du diocèse. Cette
grande verrière, qui se dresse dans le transept nord
et que l'on aperçoit quand on sort du déambulatoire,
date de 1646. Œuvre d'Antoine Soulignac,
elle remplace une verrière du XVIe siècle détruite
lors d'une forte tempête en 1644.
Deux séries de quatre grands personnages se dressent
sur un fond architectural en plein cintre. Les femmes sont
peintes sur un fond incolore, à peine bleuté
; les hommes sur un fond noir. On trouve, en bas, les saintes
Paule, Colombe, Béate et Madeleine
; en haut, les saints Savinien, Étienne,
Laurent et Potentien. Le soubassement abrite
les armoiries épiscopales. Dans le tympan : emblèmes
héraldiques, ciboires et encensoirs, sabres et glaives,
complétés par des pots-à-feu. Selon le
Corpus Vitrearum, la verrière est bien conservée.
Source : Corpus Vitrearum, les
vitraux de Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes,
éditions du CNRS.
|
|
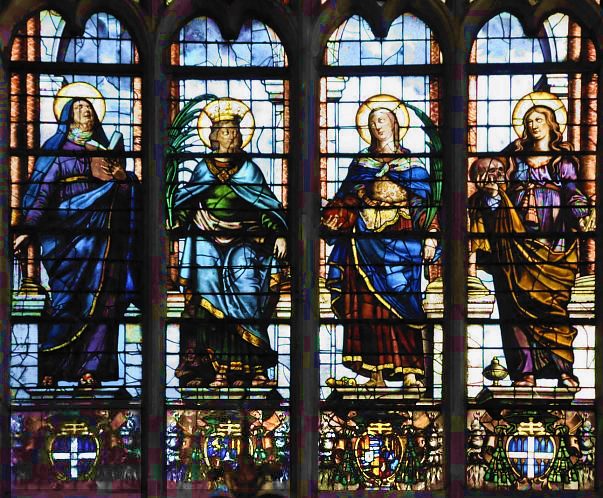
Sainte Paule, sainte Colombe, sainte Béate et sainte Madeleine
dans la baie 123.
Les Saints protecteurs du diocèse, œuvre d'Antoine Soulignac.
- Année 1646 - |

Saint Étienne |
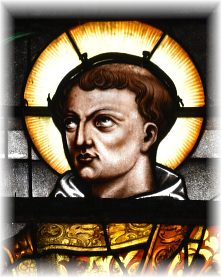
Saint Laurent |

Sainte Colombe |
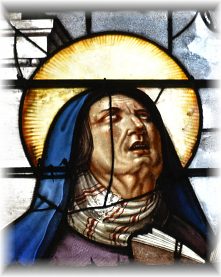
Sainte Paule |
|
| QUATRE SAINTS ET SAINTES
DANS LA VERRIÈRE DES SAINTS PROTECTEURS DU DIOCÈSE
DE SENS (Année 1646). |
|
| VERRIÈRE DES SAINTS ARCHEVÊQUES DE
SENS (Baie 115) - vers 1517 |
|
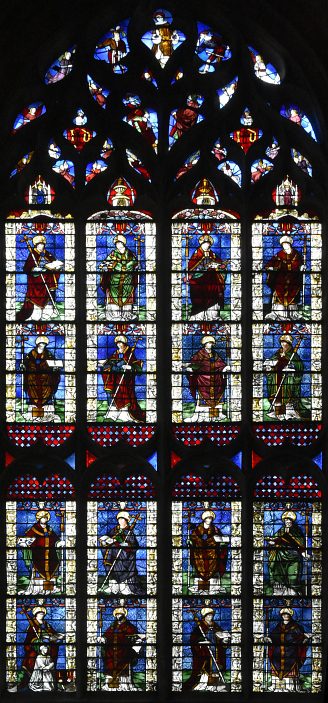
Baie 115, LES SAINTS ARCHEVÊQUES DE SENS. |
À DROITE ——»»»
1) Le chanoine Jean Debray (†1519), archidiacre d'Étampes,
donateur du vitrail des Saints Archevêques de Sens
(vers 1517)
2) Un archevêque de Sens dans le même vitrail. |
|
|

Deux archevêques et le donateur dans la baie 115. |
|
Verrière
des saints archevêques de Sens. Cette
grande verrière, de 12 mètres sur 4,8
mètres, illumine le transept nord quand on arrive
dans le chœur depuis le vaisseau central. Elle
a été offerte par le chanoine Jean
Debray (†1519), archidiacre d'Étampes.
Comme bien d'autres vitraux dans le transept de la cathédrale
, elle est l'œuvre de Jean Hympe et de son fils.
Elle est datée aux alentours de l'année
1517. Les deux paires de rangées d'archevêques
sont séparées par une zone de meneaux
transversaux vitrés par de la mosaïque colorée.
On ne peut pas dire que l'effet en soit très
heureux. Y a-t-il eu, par manque de fonds, une obligation
de simplifier la décoration de la séparation
centrale de la verrière?
Les deux points intéressants de ce vitrail sont,
d'une part, les fonds damassés, dominés
par des linteaux à motifs Renaissance (des têtes
de bélier dans l'exemple donné ci-dessus)
; d'autre part les bordures Renaissance en grisaille
et jaune d'argent qui encadrent à gauche et à
droite tous les personnages, comme on peut le voir ci-dessus.
À noter que le haut du tympan abrite une lapidation
de saint Étienne.
La verrière a été restaurée
en 1883 par l'atelier d'Émile Hirsch.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes,
éditions du CNRS
|
|
 |
 |
|
| VERRIÈRE DE SAINT NICOLAS (Baie 118) -
1502 |
|
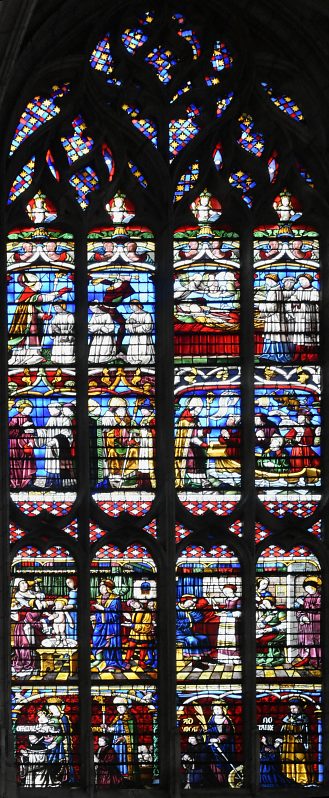
Baie 118, VERRIÈRE DE SAINT NICOLAS, 1502. |
|
Verrière
de saint Nicolas. Cette grande verrière,
installée à côté de celle de l'Arbre
de Jessé, est l'œuvre des maîtres verriers
troyens Liévin Varin, Jehan Verrat et
Balthazar Godon. Elle date de 1502 et a été
offerte par la confrérie de Saint-Nicolas qui regroupait
les gens de justice de l'archevêque. Celui-ci rendait
la justice au temporel et au spirituel. Il avait donc à
son service des ecclésiastiques (un official pour le
représenter, un promoteur et des juges assesseurs)
et le tribunal du bailli (qui était composé
de laïcs).
La verrière illustre les principaux épisodes
de la vie de ce saint qui fut évêque de Myre
en Anatolie, au début du IVe siècle : 1) le
miracle du premier jour de sa naissance où il tient
debout tout seul ; 2) la dot des trois pucelles sauvées
de la débauche par la générosité
de Nicolas ; 3) Nicolas est désigné évêque
de Myre ; 4) il apaise la tempête ; 5) il sauve trois
officiers condamnés à mort injustement ; 6)
la mort de saint Nicolas.
On remarquera la scène des trois officiers romains,
vêtus de robe blanche, prêts à se faire
décapiter et sauvés par le zèle de saint
Nicolas. Cette histoire est racontée dans La Légende
dorée de Jacques de Voragine (†1292), rédigée
à la fin du XIIIe siècle. Dans le cours du XIIe,
elle a été remplacée par celle des trois
enfants tués par un boucher et ressuscités par
le saint. Mais à l'époque où l'archevêque
de Gênes rédigeait sa Légende,
il ne la connaissait sûrement pas.
Il faut s'arrêter sur le registre des donateurs qui
est digne d'intérêt car on y voit les différents
acteurs de la justice épiscopale : à gauche,
un official représentant l'archevêque et agenouillé
devant une Vierge à l'Enfant ; un juge devant saint
Nicolas ; un avocat devant sainte Catherine d'Alexandrie ;
enfin, un notaire, présenté très certainement
par saint Yves, lui aussi patron des professions de robes.
La verrière a été restaurée par
Émile Hirsch en 1884, notamment la scène de
la Mort du saint. Elle est jugée comme «assez
bien conservée» par le Corpus Vitrearum.
Sources : 1) Les vitraux de
la cathédrale de Sens, éditions A˜PROPOS
; 2) Corpus Vitrearum, les Vitraux de Bourgogne, Franche-Comté
et Rhône-Alpes, éditions du CNRS.
|
|
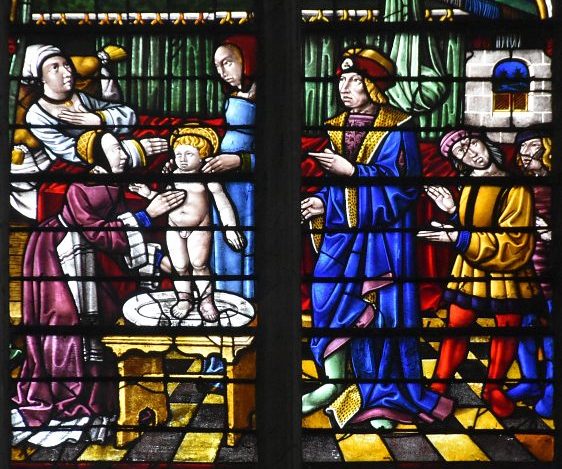
Le premier miracle de saint Nicolas : il se tient debout sur sa baignoire
le jour de sa naissance.
Détail de la verrière de saint Nicolas, baie 118, année
1502. |

Saint Nicolas sauve trois officiers injustement accusés.
Détail de la verrière de saint Nicolas, baie 118,
année 1502. |

Saint Nicolas, appelé par des marins, apaise la tempête.
Détail de la verrière de saint Nicolas, baie 118,
année 1502. |
|

Les donateurs de la verrière de la baie 118, année 1502.
De gauche à droite : l'official, qui représente l'archevêque
de Sens, un juge, un avocat et un notaire (désignations inscrites
sur chaque vitrail).
Ils sont présentés par une Vierge à l'Enfant,
saint Nicolas, sainte Catherine d'Alexandrie et saint Yves. |
| LES CHAPELLES ORIENTÉES DU TRANSEPT |
|

Chapelle Saint-Jean-Baptiste et baptistère (origine XIIe siècle). |

La chapelle de la Vierge (bras sud du transept) est en gothique rayonnant. |

Vierge à l'Enfant offerte par le chanoine
Manuel de Chaulnes en 1334 (chapelle de la Vierge). |
|
Les chapelles
du transept. Dès sa construction (vers 1130),
la cathédrale a été conçue avec
trois chapelles : une chapelle
axiale, actuellement dédiée à saint
Savinien, et deux chapelles au niveau du transept (qui n'existait
pas à l'époque). Ces chapelles possèdent
des autels dirigés vers l'orient. Ce sont donc des
chapelles orientées.
La chapelle orientée Saint-Jean-Baptiste est
la plus imprégnée de style roman : suite d'arcatures
aveugles en plein cintre et voûte en cul-de-four (photo
ci-dessus). Cependant le Bulletin monumental de 1982,
consacré à la cathédrale de Sens, se
montre perplexe. Il rappelle que rien ne permet d'affirmer
que la voûte en cul-de-four était le parti prévu
à l'origine. La chapelle a été très
restaurée dès avant le XIXe siècle et
la moulure qui court à la base de cette voûte
en cul-de-four est de style classique ! En conséquence,
même si les restaurations ont respecté le style
original, on ne peut rien conclure quant à un éventuel
signe d'antériorité de cette chapelle sur les
autres parties de la cathédrale. D'autre part - et
le Bulletin monumental le rappelle - les murs de l'absidiole
n'ont pu être montés qu'une fois construit le
mur du bas-côté nord.
Quant à la chapelle de la Vierge, les historiens
sont d'avis qu'elle possédait, à l'origine,
une architecture romane semblable à celle de la chapelle
Saint-Jean-Baptiste. Mais cette chapelle, disposée
au sud, a été réédifiée
dans la seconde moitié du XIIIe siècle selon
les règles du gothique rayonnant : fin réseau
de pierre ouvrant largement les murs au-dessus d'un soubassement
orné d'arcades. La chapelle Saint-Jean a des aspects
clairement romans (dans des parties peut-être reconstruites),
et la chapelle de la Vierge, telle qu'on peut la voir actuellement,
s'inscrit déjà dans l'ère d'un gothique
bien installé, celui du XIVe siècle.
De combien de travées droites disposaient ces deux
chapelles orientées? Une, deux ou trois? Rien ne permet
de le dire. Après les fouilles d'Adolphe Lance, le
plan proposé par Viollet-le-Duc leur attribue une seule
travée droite. Conclusion reprise par l'historien Charles
Porée pour le Congrès archéologique
d'Avallon en 1907 et par le chanoine Chartraire dans sa
Petite monographie de la cathédrale parue en
1928. Mais ce résultat a été mis en doute
par l'architecte L. Bégule, dans son ouvrage sur la
cathédrale paru en 1929, qui en voyait trois.
Terminons cet aperçu architectural en rappelant que
la construction du transept, à partir de 1490, a bien
sûr nécessité une adaptation de la partie
occidentale de ces chapelles. Claire Pernuit, dans l'ouvrage
Sens, première cathédrale gothique, écrit
que, lors de cette construction, l'une des travées
de la chapelle Saint-Jean-Baptiste a dû être détruite
- sans plus de précision. Le chanoine Chartraire écrit,
quant à lui : «En avril 1502, les maçons
abattent la première travée de la chapelle Saint-Jean,
l'architecte [Martin Chambiges] désirant remplacer
l'arc en plein cintre qui en forme l'entrée sur l'ancien
transept.» Et il ajoute que l'on n'a d'ailleurs aucune
preuve de l'existence de cet ancien transept... Comme quoi,
l'historique de l'architecture des grandes cathédrales,
en l'absence de documents précis, n'est jamais simple
et un même historien peut parfois se contredire en toute
bonne foi.
L'ornement principal de la chapelle de la Vierge est évidemment
la magnifique statue de la Vierge à l'Enfant, offerte
par le chanoine Manuel de Chaulnes en 1334.
Sources : 1) Bulletin monumental,
La cathédrale de Sens, 1982 ;
2) Sens, première cathédrale gothique,
éditions A˜PROPOS, 2014 ; 3) La cathédrale
de Sens d'Eugène Chartraire, Petite monographie
des grands édifices de la France, 1928.
|
|
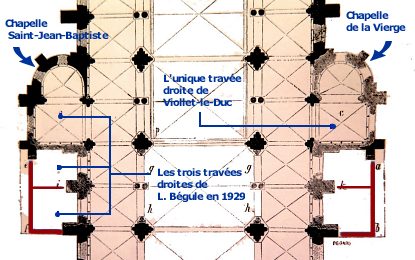
Le plan des chapelles orientées dans le transept. Pour
Viollet-le-Duc, une seule travée droite
(fin du XIXe siècle) ; pour L. Bégule en 1929,
trois travées droites. |

Couronnement de la Vierge, XIVe siècle, partiel.
Vitrail de la baie 18 dans la chapelle de la Vierge. |
|

La voûte en cul-de-four
et la voûte du début du XVIe siècle
de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. |
 |
 |
| CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE |
CI-DESSUS
Le Christ du Calvaire dit «de Cerisiers»,
détail.
Cette statue, dont les bras et les jambes sont modernes,
pourrait
provenir d'un calvaire placé sous abri et situé
au bord d'une route.
Date estimée : vers 1260. |
À DROITE ---»»»
Christ aux liens en pierre polychrome du XVe siècle.
Le personnage agenouillé doit être le commanditaire. |
|
|
| LE CHŒUR DE LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE |
|

L'entrée du chœur et l'autel de messe de la cathédrale
de Sens.
La magnifique grille centrale, dessinée par Michel-Ange Slodtz,
date de 1760. |
|
Le
chœur de la cathédrale Saint-Étienne
est entièrement fermé par des grilles
hautes. Il est impossible d'y pénétrer,
ce qui interdit d'apprécier le baldaquin
et le maître-autel de près. Ces deux ouvrages,
conçus par l'architecte Servandoni, ont
été sculptés par les frères
Slodtz dans les années 1740.
Comme on le voit sur la photo ci-dessus, l'entrée
du chœur est fermée par une magnifique grille.
Un premier projet, en 1726, eut pour dessein de remplacer
le jubé du XIIIe siècle, jugé vétuste.
Le maître serrurier parisien Jean de Brie
réalisa la nouvelle ferronnerie, qui fut mise
en place en 1732. Vers 1760, le cardinal de Luynes
lança un nouveau projet pour renouveler le jubé
(photo ci-contre). La porte centrale, œuvre de
Jean de Brie, fut déplacée à l'entrée
de la chapelle Saint-Savinien
(où elle se trouve toujours). À sa place,
on installa une grille bien plus prestigieuse, dessinée
par Michel-Ange Slodtz. Ses nombreux motifs à
la feuille d'or représentent des objets liturgiques.
Elle est l'œuvre de Guillaume Doré.
Le nouveau jubé fut presque entièrement
financé par le cardinal de Luynes.
Au XIXe siècle, de multiples voix s'élevèrent
pour détruire le jubé : on voulait libérer
la perspective pour mieux suivre le déroulement
de l'office. En 1868-1869, les autels latéraux
(photo ci-contre) furent donc détruits. Leurs
parties sculptées sont aujourd'hui exposées
au musée
de Sens. On peut y voir, disposées en deux
paires, les trois vertus théologales (Foi, Espérance
et Charité) associées à une vertu
cardinale, la Justice.
Les vitraux de l'abside de Saint-Étienne ne s'approchent
en rien de la vue féerique offerte par d'autres
cathédrales, comme par exemple Saint-Gatien
à Tours. À Sens, seule la verrière
d'axe et ses deux voisines reçoivent des vitraux
historiés (du XIIIe siècle). Ils illustrent
la Passion du Christ, des scènes de la vie de
la Vierge et des scènes de la vie de saint Étienne.
Quelques extraits en sont proposés ci-dessous.
Le reste du chœur est illuminé par des verrières
décoratives, surmontées de tympans trilobés
et ornés de petites scènes ou de personnages.
Ces trilobes ont néanmoins un intérêt
: ils sont du XIIIe ou du XIXe siècle. On donne
plus
bas quelques exemples de trilobes du XIIIe siècle.
Source : Sens, première
cathédrale gothique, éditions A˜PROPOS,
2014.
|
|

Les instruments du culte resplendissent au sein de la grille
centrale du chœur, posée en 1760.
Dessinée par Michel-Ange Slodtz, cette grille a été
réalisée par Guillaume Doré. |
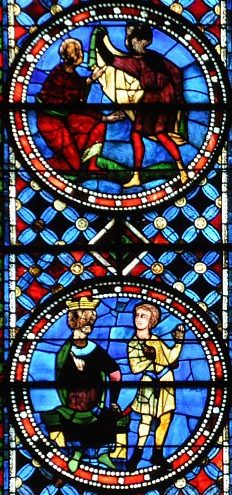 |
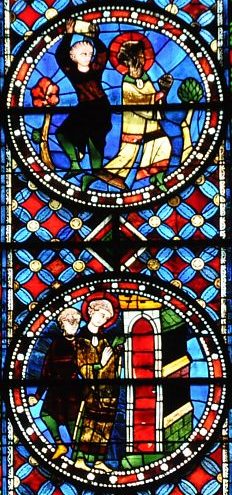 |
Vie de saint
Étienne, vers 1230-1240, détail.
Vitrail de la baie 102 dans l'abside. |

Le couronnement du baldaquin dessiné par Servandoni (vers
1740). |
|

Essai de reconstitution du jubé de 1762.
Maquette présentée au musée
de Sens par Marc Barbier, échelle 1/20e. |

La Foi et l'Espérance : sculpture de l'ancien jubé
de la cathédrale (vers 1762)
Ouvrage de Joseph Hermand. |

L'ange musicien du lutrin
dans le chœur.
|
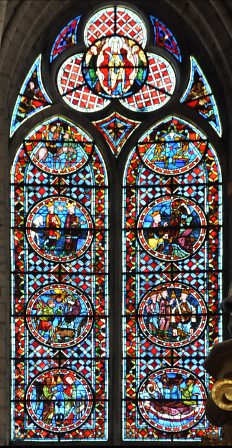
VIE DE LA VIERGE ET ENFANCE DU CHRIST
Baie 101, XIIIe siècle. |

Le baldaquin dans le chœur, dessiné par Servandoni
(vers 1740) |
|
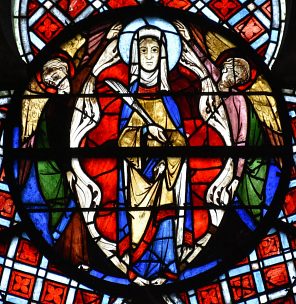
Tympan du vitrail de la Vie de la Vierge et de l'Enfance du
Christ
Baie 101 dans l'abside, XIIIe siècle.
|

Saint Pierre et saint Paul
Trilobe d'un vitrail du chœur, XIIIe siècle.
|

Le Christ montrant ses plaies
Trilobe d'un vitrail du chœur, XIIIe siècle. |
|
| Voir les trilobes de Moïse
et d'Abraham
(XIIIe siècle) à la page 1. |
|
| LE DÉAMBULATOIRE ET LES VERRIÈRES
DU XIIIe SIÈCLE |
|
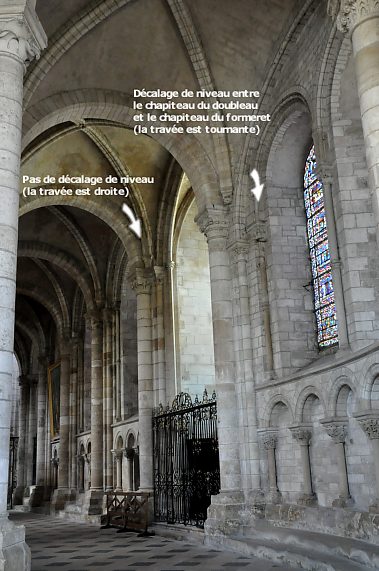
Le déambulatoire nord et son arcature romane du XIIe siècle.
La grille que l'on voit correspond à l'entrée de la
chapelle Saint-Thomas-Becket,
construite au XIVe siècle entre les contreforts du chœur.
Les chapiteaux de part et d'autre de cette chapelle montrent déjà
la difficulté des travées tournantes du déambulatoire.
Dans les chapiteaux à droite
de la chapelle (à gauche sur la photo), pas de décalage
de niveau entre le chapiteau
du doubleau et celui du formeret ; à gauche de la chapelle,
il y a décalage. |
|
Le déambulatoire
de la cathédrale de Sens est un endroit
où il faut lever les yeux : d'une part pour l'architecture
de la voûte, d'autre part pour les très beaux
vitraux du XIIIe siècle. Après beaucoup d'atermoiements,
les historiens ont obtenu la preuve que le premier maître
de Sens avait, dès l'origine, pourvu le déambulatoire
d'une chapelle d'axe de forme rectangulaire, la chapelle Saint-Savinien.
C'était un choix délibéré car
la structure architecturale d'un déambulatoire riche
de plusieurs chapelles rayonnantes était déjà
connue et répandue dans le monde roman.
Si la cathédrale du XIIe siècle brille par son
uniformité, elle n'en demeure pas moins un édifice
de transition. On le voit aisément dans le déambulatoire
nord. Celui-ci présente une série d'arcades
en plein cintre, enrichie de chapiteaux typiquement romans
: oiseaux et lions affrontés, taille
de la vigne (ce dernier est d'ailleurs le plus beau chapiteau
de tout l'édifice).
Le visiteur ne manquera pas de remarquer - en levant les yeux
- la maladresse des travées tournantes du déambulatoire.
Les voûtes tournantes que l'on observe sont bien sûr
en forme de trapèze, mais les formes n'en sont pas
régulières, pas plus que les croisées
d'ogives. Enfin, on retrouve ici le simple culot qui reçoit
la tombée d'ogive, profil déjà vu dans
les bas-côtés du vaisseau central. En fait, d'un
point de vue chronologique, c'est le cheminement inverse qui
est correct : le constructeur des bas-côtés,
vraisemblablement par fidélité au parti du premier
maître, a reproduit ce qui existait dans le déambulatoire.
On donne ci-après un exemple de cette retombée
atypique : le doubleau et le formeret retombent sur une colonnette,
mais pas la nervure d'ogive. Ce qui apparaît comme une
erreur puisque la grande tradition gothique veut que toute
nervure tombant d'une voûte doit être reçue
sur sa colonnette propre. Mais, comme indiqué dans
l'encadré sur les bas-côtés de la nef
(voir à la page
1), la cathédrale Saint-Étienne a été
érigée à une époque où
les éléments du style gothique n'étaient
pas encore figés en système.
Il y a encore mieux, dans le déambulatoire, pour illustrer
ce qu'on peut considérer comme des tâtonnements
du premier maître : dans les parties tournantes,
les chapiteaux des formerets sont placés nettement
au-dessous du chapiteau recevant le doubleau (voir photos
ci-dessous) alors que, dans les parties droites, ces deux
chapiteaux sont au même niveau. Dans le Bulletin
monumental de 1982 consacré à la cathédrale
de Sens, Jacques Henriet écrit à ce sujet :
«(...) pour construire les voûtes de travées
de plan trapézoïdal dont la base atteint plus
de 9 mètres et pour éviter un surbaissement
très exagéré des formerets, l'architecte
a prévu le départ de ceux-ci à un niveau
inférieur.» Mais ce départ est un repentir
car la bonne disposition n'avait pas été vue
à l'origine. Henriet ajoute en effet : «Cette
solution (...) n'a pas été immédiatement
perçue par le "Maître de Sens" qui
a implanté le mur extérieur et les piles du
chœur jusqu'au niveau des départs des voûtes
sans apprécier pleinement les difficultés que
lui causerait l'ampleur des travées tournantes. Lorsqu'il
a fallu monter les voûtes, le problème surgit
et l'architecte décida alors de procéder à
l'abaissement des chapiteaux des formerets.» Le lecteur
non initié aura compris que la conception des travées
tournantes d'un déambulatoire ne se fait pas à
la légère et que tout doit être anticipé.
De la sorte, le déambulatoire de la cathédrale
Saint-Étienne présente, dans ses irrégularités,
un véritable cas d'école, typique du gothique
primitif. Nous engageons le visiteur de la cathédrale
à passer un peu de temps dans cet endroit pour observer
ces ajustements. Ils font partie intégrante de l'histoire
de l'architecture.
Voir le complément de l'analyse des retombées
des voûtes à la page
1 dans l'encadré sur les bas-côtés.
Nous avons vu que, à l'origine, seule existait la chapelle
d'axe. Au XIVe siècle, on construisit trois chapelles
entre les contreforts du chœur : Sainte-Apolline, Saint-Martial
et Saint-Thomas-Becket. En 1556, une chapelle rayonnante sera
dressée au sud, la chapelle Notre-Dame-de-Lorette (devenue
depuis chapelle du Sacré-Cœur)
où l'on peut admirer le vitrail de la Sibylle
de Tibur. Puis, en 1703, son pendant au nord sera ouvert
à son tour : la chapelle Sainte-Colombe.
Ces chapelles rayonnantes sont données plus bas.
Sources : 1) Bulletin monumental,
La cathédrale de Sens, 1982 ;
2) Sens, première cathédrale gothique,
éditions A˜PROPOS, 2014.
|
|
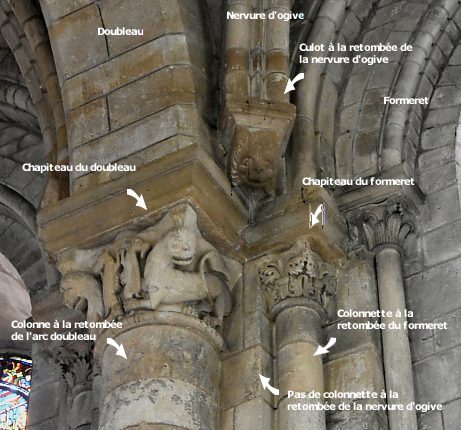
Travée droite : pas de décalage de niveau entre le chapiteau
du doubleau et le chapiteau du formeret.
La nervure d'ogive retombe sur un culot au-dessus des chapiteaux :
elle n'est pas reçue sur une colonnette. |
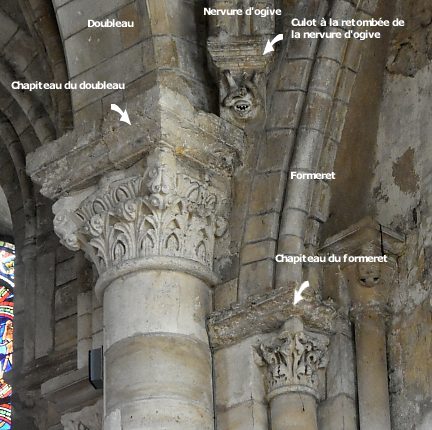
Travée tournante : décalage de niveau entre le chapiteau
du doubleau et le chapiteau du formeret.
La nervure d'ogive retombe sur un culot au-dessus des chapiteaux (absence
de colonnette). |
| LES IRRÉGULARITÉS DES RETOMBÉES
D'OGIVES SONT UNE PART DE L'HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE GOTHIQUE |
|

Vue partielle de la voûte du déambulatoire
et des trapèzes (qui ne sont pas très bien assurés). |
À DROITE ---»»»
Le déambulatoire sud dans sa partie romane.
La fenêtre à gauche est celle de la tribune
de l'archevêque :
il pouvait suivre l'office tout en restant dans ses appartements.
À droite, l'escalier mène à la salle
du Trésor. |
|
|

|

Lions adossés
Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150). |

Tête de grotesque crachant des lianes
Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150). |
|

Les méchants dans la gueule des démons.
Chapiteau roman dans le déambulatoire.
(Vers 1150) |

La taille de la vigne.
Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150) |
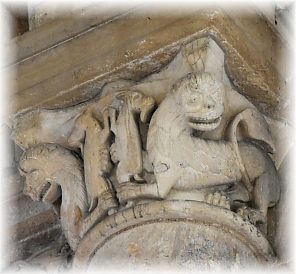
Animaux monstrueux.
Chapiteau roman dans le déambulatoire (vers 1150). |
|

Arcature aveugle de type roman dans le déambulatoire
nord
surmontée de deux vitraux du XIIIe siècle : le
Bon Samaritain et le Fils prodigue. |
|
Le
vitrail du bon Samaritain Cette magnifique
verrière (qui jouxte celle du Fils
prodigue) affiche cinq mètres de haut pour
deux mètres de large. Elle est datée aux
alentours de 1207-1215. C'est l'une des plus belles
verrières du XIIIe siècle que l'on puisse
contempler en France. L'histoire du Bon Samaritain est
trop connue pour que l'on s'y étende ici. Notons
simplement que les épisodes liés à
cette histoire figurent dans trois carrés posés
sur la pointe (l'homme agressé ; le prêtre
et le lévite qui passent leur chemin ; le Samaritain
qui conduit l'homme à l'auberge), chaque carré
étant enrichi de quatre lobes proposant l'interprétation
parabolique de l'image centrale.
Rappelons que la parabole du Bon Samaritain, qui ne
se trouve que dans l'évangile de Luc, est présentée
comme une allégorie de l'histoire du monde depuis
Adam (la Chute, Moïse, l'Incarnation du Christ,
sa Passion et sa Résurrection). Le Corpus
Vitrearum indique que le vitrail a été
restauré, sans donner plus de précisions.
Sources : 1) Les vitraux
de la cathédrale de Sens, éditions
A˜PROPOS ; 2) Corpus
Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, éditions du CNRS.
|
|

Au centre, le prêtre et le lévite passent leur
chemin.
Dans les lobes, épisodes de la vie de Moïse.
Baie 15, verrière du Bon Samaritain, vers 1207-1215. |
À DROITE ---»»»
Au centre, le Samaritain conduit l'homme blessé
dans une auberge
et paie l'aubergiste pour ses soins.
Dans les lobes, des scènes de la Passion.
Baie 15, verrière du Bon Samaritain, vers 1207-1215. |
|
|
| LA VERRIÈRE DU BON SAMARITAIN (Baie
15) - vers 1207-1215 |
|
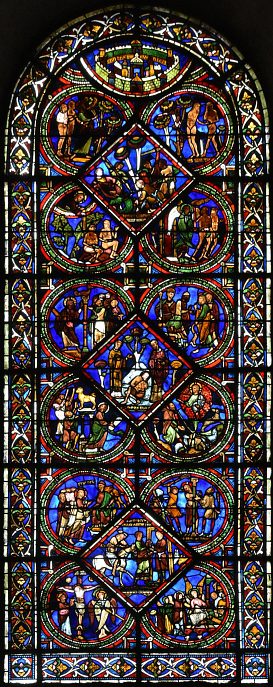
Baie 15, LA PARABOLE DU BON SAMARITAIN
Vers 1207-1215
L'un des plus beaux vitraux du XIIIe siècle
que l'on puisse voir en France. |
À DROITE
---»»»
«Thomas Becket et Alexandre III»
Huile sur toile
par Michel Honoré Bounieu (1740-1814). |
|
|
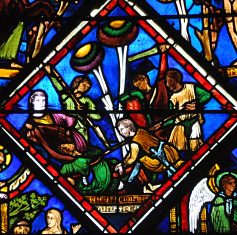
Cinq hommes armés attaquent un voyageur. |

Les Saintes Femmes devant le tombeau. |
 |
|
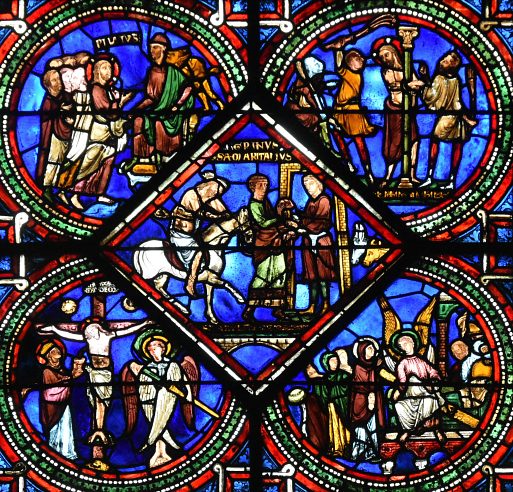 |
|

Déambulatoire nord avec vue sur la chapelle Sainte-Colombe.
Série d'arcades romanes sur la gauche. |
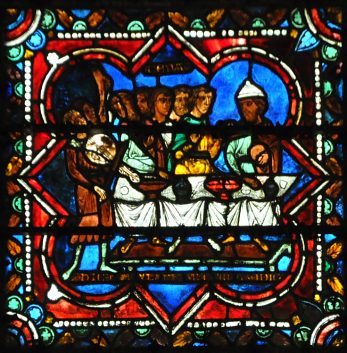
Un grand festin accueille le Fils prodigue.
Baie 17, verrière de la Parabole du Fils prodigue, vers
1207-1215. |
À DROITE ---»»»
À droite, le fils cadet réclame sa part
d'héritage ;
à gauche, le père partage son bien entre
ses deux fils.
Baie 17, verrière de la Parabole du Fils prodigue,
vers 1207-1215. |
|
|
| LA VERRIÈRE DU FILS PRODIGUE (Baie
17) - vers 1207-1215 |
|
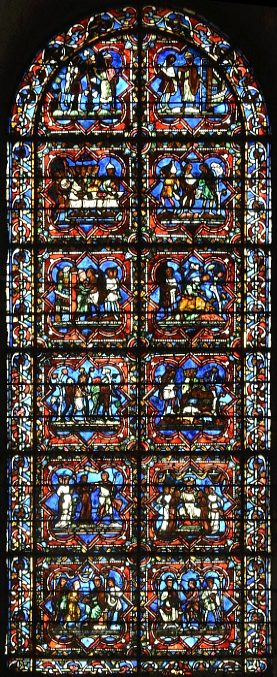
Baie 17, LA PARABOLE DU FILS PRODIGUE
Vers 1207-1215. |
|
Le
Fils prodigue. Aussi belle et de même
taille que celle du Bon
Samaritain, la verrière du Fils prodigue
est, là encore, datée des années
1207-1215. Tout le monde connaît l'histoire
de ce fils cadet, développée dans
l'évangile de Luc, qui réclame à
son père sa part d'héritage. Tandis
que son frère aîné, plus consciencieux,
s'en va travailler aux champs, le fils cadet s'en
va tout dépenser en réjouissances
chez des courtisanes. Un vitrail le montre allégoriquement
enchaîné par des démons. Ayant
tout perdu, il devient gardien de porcs pour assurer
sa subsistance, signe d'une déchéance
complète. Enfin, honteux, il revient chez
son père, qui lui pardonne. Son frère
rentre des champs et proteste contre tant de laxisme !
Une scène, qui ne figure pas dans la parabole
de Luc, vient conclure l'histoire sur une note
positive : le père parvient à
convaincre son fils aîné de pardonner
lui aussi.
Les douze scènes, à dominante bleue,
se détachent sur un fond à dominante
rouge. On pourra regretter le contraste un peu
vif entre le rouge et la gamme des bleus.
Comme pour la verrière du Bon
Samaritain, le Corpus Vitrearum indique
que le vitrail a été restauré,
sans donner plus de précisions.
Sources : 1) Les
vitraux de la cathédrale de Sens, éditions
A˜PROPOS ; 2) Corpus
Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, F-Comté,
Rhône-Alpes.
|
|

Le Fils prodigue est accueilli par son père.
Baie 17, La Parabole du Fils prodigue |
|
 |
|
| LA VERRIÈRE DE SAINT EUSTACHE (Baie 21),
vers 1207-1215 |
|
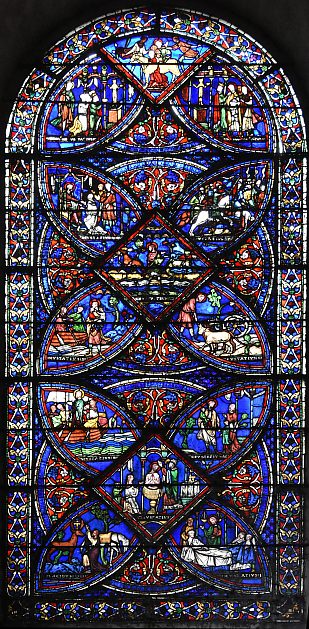
Baie 21, VIE DE SAINT EUSTACHE, vers 1207-1215. |
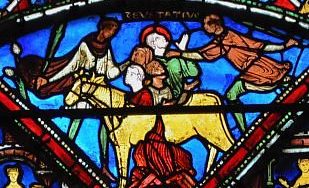
Eustache et sa famille sont martyrisés dans le
taureau d'airain. |
|
|
La
verrière de saint Eustache remonte
aux années 1207-1215. Elle fait partie des quatre
verrières du XIIIe siècle de la cathédrale
avec le Bon
Samaritain, le Fils
prodigue et la Vie
de Thomas Becket.
Comme on le voit à gauche, le dessin de la verrière
est complexe et original. Le même motif de carré
entouré de pétales, le tout inscrit dans
un cercle tangent à la bordure, se répète
deux fois et demi. Le décor est très riche
: palmettes, rinceaux s'entremêlent dans les cercles
et dans les bordures. Les blancs donnent du rythme au
dessin sur un fond d'un bleu puissant. Enfin, les personnages
élancés et les multiples plis de leurs
vêtements s'insèrent bien dans le style
des premières années du XIIIe siècle.
L'histoire de saint Eustache est une légende
qui va chercher ses origines dans les mondes romain
et celtique, ainsi qu'au Proche-Orient. Placide est
un général de l'empereur Trajan (98-117).
Au cours d'une chasse, la croix du Christ lui apparaît
entre les bois d'un cerf qu'il poursuit. Et le Christ
lui demande pourquoi il le poursuit ainsi. À
la suite de cette vision, il se convertit au christianisme
avec sa femme et ses deux fils. Il devient Eustache,
traduction grecque de Placide. Comme Job, une suite
de malheurs le frappe : ses esclaves meurent ; ses biens
sont pillés. Avec sa famille, il part en Égypte
refaire sa vie, mais le capitaine du navire retient
sa femme pour prix de la traversée. Traversant
une rivière à gué, un lion et un
loup s'emparent de ses fils. Il se vend ensuite comme
ouvrier agricole. Mais Trajan a besoin de lui. Il le
fait rechercher et lui confie le commandement de son
armée. Eustache remporte la victoire (vitrail
ci-contre à droite). Puis, une suite d'événements
heureux lui fait retrouver sa femme et ses fils.
Cependant l'empereur Hadrien succède à
Trajan et exige qu'Eustache sacrifie aux dieux. Ce qu'il
refuse (voir à droite). Lui et sa famille sont
alors placés dans un taureau d'airain chauffé
à blanc. On tirera leurs corps intacts de la
fournaise.
La verrière n'est pas un original du XIIIe
siècle. Seule la partie supérieure
(1,80m de haut) remonte à cette époque.
Le reste a été recréé par
un restaurateur de l'Yonne dans les années 1850,
peut-être en s'inspirant du vitrail de saint Eustache
de la cathédrale
de Chartres. Son pastiche est d'une qualité
remarquable.
Sources : 1) Les vitraux
de la cathédrale de Sens, éditions
A˜PROPOS ; 2) Corpus
Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, éditions du CNRS ; 3)
Le vitrail de saint Eustache, les cahiers de Culture
et Foi, publication du diocèse de Sens.
|
|
| TYMPAN DE LA VERRIÈRE DES QUATRE
SAINTS (baie 16), XIVe siècle |
|

Détail du tympan de la baie 16 : La résurrection
des morts, XIVe siècle
Chapelle Saint-Martial dans le déambulatoire sud. |
| LA VERRIÈRE DE SAINT THOMAS BECKET
(Baie 23), vers 1207-1215 |
|

Tentative de réconciliation entre Thomas Becket (à
gauche)
et le roi Henri II Plantagenêt (à droite)
en présence du roi de France, Louis VII, au centre.
Baie 23, Vie de saint Thomas Becket, vers 1207-1215. |
|
La
verrière de Thomas Becket illustre
des scènes de la dernière année
de la vie de l'archevêque de Canterbury, avant
son assassinat en 1170. Elle est datée des années
1207-1215 et possède la même taille que
les trois autres verrières du XIIIe siècle
(5m sur 2m). Son agencement est tout différent
: il est constitué de suites de médaillons
groupés par cinq. Le Corpus Vitrearum
signale que la verrière a été restaurée,
sans donner plus de précisions.
La présence de ce thème dans un vitrail
de la cathédrale de Sens paraît logique
dans la mesure où Thomas Becket, archevêque
de Canterbury, quand il était en exil forcé
en France, vint à Sens par deux fois : d'abord
en 1164, auprès du pape Alexandre III, lui aussi
en exil ; puis de 1166 à 1170, avant de revenir
à Canterbury et de trouver la mort dans le chœur
de sa cathédrale, sous les coups des chevaliers
de la cour d'Henri II.
On retrouve la griffe artistique du début du
XIIIe siècle : personnages élancés
et raffinement des plis dans les vêtements.
Sources : 1) Les vitraux
de la cathédrale de Sens, éditions
A˜PROPOS ; 2) Corpus
Vitrearum, les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, éditions du CNRS.
|
|

«L'Assomption» de Nicolas Restout
Deuxième quart du XVIIIe siècle. |

Statue provenant de la maison jadis habitée
à Sens par Thomas Becket.
On peut désormais la voir dans le déambulatoire
de la cathédrale, au-dessous de la verrière
consacrée à la Vie de saint Thomas Becket.
Il est possible que la statue représente le saint. |
|
À DROITE ---»»»
Thomas Becket revient en Angleterre par Sandwich, le port
de son archevêché.
Il veut éviter Douvres qui est un fief des partisans
du roi Henri II. |
|
|
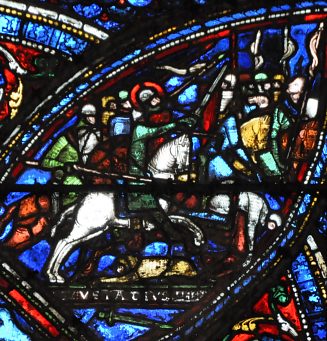
Eustache prend le commandement des armées de Trajan et
obtient la victoire.
Baie 21, La vie de saint Eustache, vers 1207-1215. |
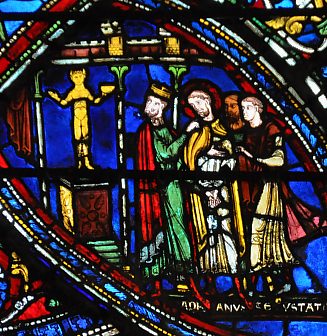
Hadrien demande à Eustache de sacrifier aux dieux, ce
qu'il refuse.
Baie 21, La vie de saint Eustache, vers 1207-1215. |

Arcades et statue romanes dans le déambulatoire nord.
Au-dessus, le vitrail de la vie de Thomas Becket (vers 1207-1215). |
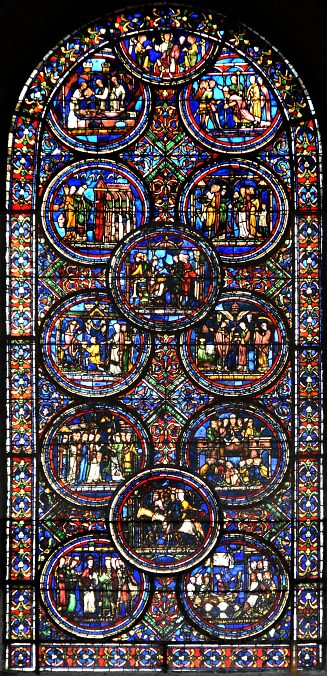
Baie 23, VIE DE SAINT THOMAS BECKET
Vers 1207-1215. |
 |
|

|

Thomas Becket est accueilli par les moines de Canterbury.
Baie 23, Vie de saint Thomas Becket , vers 1207-1215. |

Vierge à l'Enfant, XIVe siècle
Détail de la baie 14 dans la chapelle Sainte-Apolline
du déambulatoire sud. |
«««---
À GAUCHE
Chapelles Saint-Martial et Sainte-Apolline dans le déambulatoire
sud
C'est ainsi que se présentaient les chapelles des
bas-côtés nord
et sud détruites par Adolphe Lance à partir
de 1858.
Voir l'encadré
à la page 1. |
|
|
| LES TROIS CHAPELLES RAYONNANTES DU DÉAMBULATOIRE |
|

Le déambulatoire avec les trois chapelles rayonnantes protégées
par des grilles. |
|
Les trois
chapelles rayonnantes. Si le déambulatoire
regorge de richesses architecturales, qui sont une part de
l'histoire de l'architecture gothique et de son évolution,
les trois grandes chapelles rayonnantes présentent,
quant à elles, des richesses artistiques qu'il faut
prendre le temps d'admirer. Malheureusement, ces chapelles
sont en général fermées. Néanmoins,
avec de la chance, la chapelle Saint-Savinien
sera peut-être ouverte, ce qui vous permettra d'approcher
tout près du Martyre de saint Savinien, magnifique
bas-relief du XVIIIe siècle.
Historiquement, une première chapelle axiale, de forme
rectangulaire, a été érigée au
XIIe siècle, au moment où s'élève
la partie orientale de la cathédrale. Au XIIIe, la
chapelle est agrandie et devient polygonale. C'est son état
actuel. Viendront, vers 1550, la chapelle du Sacré-Cœur,
au sud, puis au XVIIIe siècle, son pendant, la chapelle
Sainte-Colombe,
au nord. L'ouvrage Sens, première cathédrale
gothique, nous apprend que la construction de la chapelle
Sainte-Colombe a été financée grâce
à un legs de 6000 livres de l'abbé Legris en
1703. Son nom mérite d'être rappelé.
Au milieu de cette chapelle s'élève le mausolée
du Dauphin et de la Dauphine, père et mère
de Louis XVI, lui-même petit-fils de Louis XV. Cette
œuvre de Guillaume Coustou le Jeune a été
terminée en 1777. La grille de la chapelle étant
fermée, le visiteur ne voit pas grand-chose des trois
grandes statues : l'Immortalité et la Religion d'un
côté ; l'Amour conjugal de l'autre.
La chapelle du Sacré-Cœur présente deux
œuvres d'art : une belle voûte à caissons,
typique de la Renaissance, et un vitrail du XVIe siècle
sur le thème de la Sibylle de Tibur. Les grilles,
là encore fermées, n'empêchent pas de
les contempler.
|
|
| LA CHAPELLE RAYONNANTE DU SACRÉ-CŒUR
(vers 1550) |
|
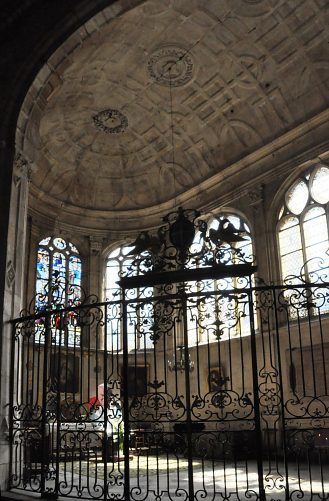
La chapelle rayonnante du Sacré-Cœur,
anciennement chapelle Notre-Dame de Lorette.
Devant les grilles toujours fermées, on peut admirer
la belle voûte
à caissons, typique de l'architecture de la Renaissance,
ainsi que le vitrail de la Sibylle de Tibur (XVIe siècle). |
|
La
verrière de la Sibylle de Tibur est
datée par le Corpus Vitrearum de l'année
1546 ou de l'année 1556. Toujours est-il qu'elle
fut offerte, comme l'ensemble de la chapelle Notre-Dame
de Lorette (ancienne dénomination de la chapelle
du Sacré-Cœur) par le chanoine Nicolas
Fritard vers 1550. Le vitrail est attribué
sans preuves à Jean Cousin l'aîné.
Quoi qu'il en soit, l'auteur du carton se serait peut-être
inspiré d'une gravure d'Antoine de Trente, elle-même
inspirée d'une œuvre du Parmesan.
Il s'agit d'illustrer un passage de la Légende
dorée de Jacques de Voragine. Rappelons-en
ici le thème principal. Le sénat roman
veut déifier l'empereur Auguste, mais celui-ci
veut savoir auparavant si le monde verra un jour naître
un homme plus grand que lui. Le hasard veut qu'il s'adresse
à la sibylle de Tibur (ancien nom de Tivoli)
le jour même de la Nativité. La prophétesse
voit apparaître un cercle d'or autour du soleil
et, en son milieu, «une vierge, d'une beauté
merveilleuse, portant un enfant sur son sein»
(traduction de Teodor de Wyzewa, La Légende
dorée, Diane de Selliers Éditeur).
La sibylle demande à l'empereur de regarder ce
prodige et lui déclare que cet enfant sera plus
grand que lui.
Le vitrail, donné ci-contre, fait une large part
à l'architecture antique et au ciel. Jacques
de Voragine précise qu'une voix, venant de nulle
part, déclara en désignant la Vierge :
«Celle-ci est l'autel du ciel [ara coeli]».
La chambre où eut lieu ce miracle fut consacrée
à la Vierge. Et, plus tard, on érigea
l'église de Santa Maria Ara Coeli à cet
endroit.
Cette prophétie servant de lien entre le monde
gréco-romain et le monde chrétien, le
christianisme a conservé les sibylles, qui sont
en fait des prophétesses païennes.
En 1814, lors du bombardement de la ville par les cosaques,
le vitrail fut traversé par un boulet. Restauré
à deux reprises en 1844 et en 1886, il faudra
attendre la restauration de 1999 pour arriver à
un résultat convenable.
Sources : 1) Les vitraux
de la cathédrale de Sens, éditions
A˜PROPOS ; 2) Corpus Vitrearum, Vitraux de Bourgogne,
de Franche-Comté et Rhône-Alpes.
|
|
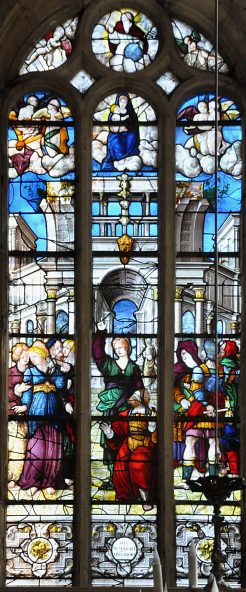 |
À DROITE ---»»»
Baie 6, LA SIBYLLE DE TIBUR
Année 1542 ou 1556. |
|
|

Baie 6, La Sibylle de Tibur, partie centrale, vers 1550.
La sibylle demande à l'empereur Auguste de regarder l'apparition
dans le ciel :
«une vierge d'une beauté merveilleuse portant un enfant
sur son sein» [Jacques de Voragine, La Légende dorée]. |

Les femmes qui accompagnent la sibylle de Tibur.
Les marques de verre brisé, qui ne correspondent à aucun
réseau de plomb, sont-elles les restes de l'impact du boulet
cosaque de 1814? |

Vierge à l'Enfant dans le haut du vitrail de la Sibylle.
Loin de resplendir d'«une beauté merveilleuse»,
la Vierge
semble plutôt soucieuse du sort terrestre qui guette son fils. |
| LA CHAPELLE RAYONNANTE SAINTE-COLOMBE (début
du XVIIIe siècle) |
|
|
|
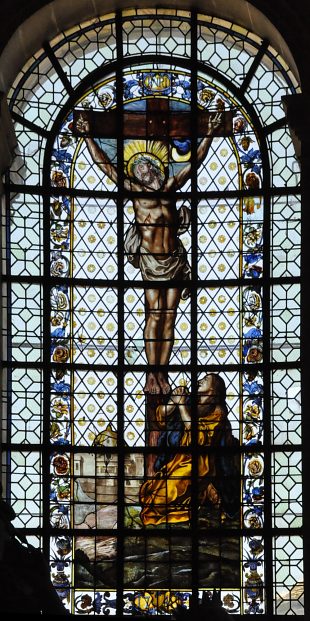
Baie 9, LE CHRIST EN CROIX AVEC LA MADELEINE (1748). |
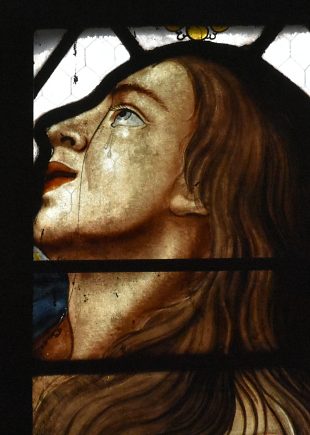
Sur le visage de la Madeleine coulent quelques larmes.
Vitrail de la baie 9 daté de 1748. |
|
| LA CHAPELLE AXIALE SAINT-SAVINIEN (début
du XIIe siècle, modifiée au début du XIIIe
siècle) |
|
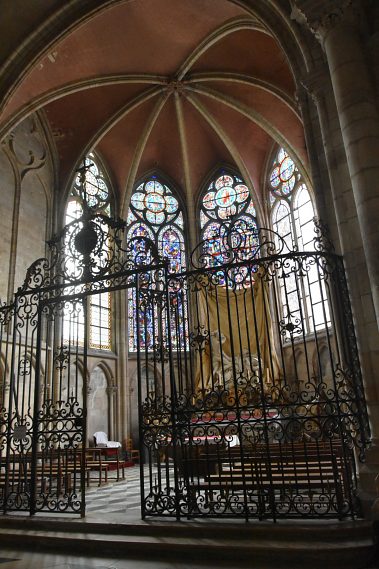
La chapelle axiale Saint-Savinien est en gothique classique
du XIIIe siècle. |

Saint Savinien dans la sculpture de Joseph Hermand, 1772. |
|

Le Martyre de saint Savinien, marbre de Joseph Hermand, 1772.
La sculpture est accompagnée d'une haute draperie en
stuc qui cache
une partie du vitrail des XIIe et XIIIe siècles qui se
trouve derrière. |
|
Le
Martyre de saint Savinien. Cette œuvre
magnifique de 1772 mérite d'être regardée
de près (quand les grilles de la chapelle sont
ouvertes). Ciselée dans le marbre par Joseph
Hermand, qui venait de réaliser les sculptures
et reliefs des jubés, elle s'insère dans
le réaménagement global de la cathédrale,
décidé par les chanoines au XVIIIe siècle.
Savinien est l'évangélisateur de la Sénonie.
Nous sommes au premier siècle de notre ère.
Suivons les Annales Hagiologiques de la France
(éditées en 1860 sous la direction de
Ch. Barthélemy) pour y découvrir l'épisode
qui clôt sa vie. Devant un tribunal romain, Savinien,
premier évêque de Sens, a proclamé
sa foi envers et contre tout. Il sait que, avec ses
compagnons, il est condamné à mourir.
On lit ensuite, écrit dans un style très
XIXe siècle : «Comme on le conduisait au
supplice, Savinien ayant obtenu du temps pour prier
se retira dans la crypte de l'église de Vif,
sous l'invocation du saint Sauveur, qui se trouvait
sur son chemin, et dans ces profondeurs qui lui servent
de base, célébrant le divin sacrifice,
- après en avoir accompli selon la coutume les
rites sacrés, il se démit des pouvoirs
de l'épiscopat entre les mains de Potentien,
qu'il nomma son successeur. Mais, les cruels licteurs
souffrant impatiemment ce retard, se précipitèrent
dans cette crypte et frappant de l'épée
et de la hache deux coups sur le sommet de la tête
du très-saint pontife incliné sur l'autel,
ils le tuèrent.»
La sculpture de Joseph Hermand respecte les grandes
lignes de ce meurtre. Un soldat s'apprête à
frapper Savinien de sa hache tandis qu'un autre l'a
saisi à la gorge. Cette œuvre, d'une grande
tension, est installée sur l'autel en 1772.
Malheureusement, le sculpteur a jugé bon de l'envelopper
dans une haute draperie en stuc. On voit, sur la photo,
qu'elle cache le bas de la verrière composite
qui se trouve derrière et qui rassemble des fragments
de vitraux des XIIe et XIIIe siècles.
|
|
|
|
|
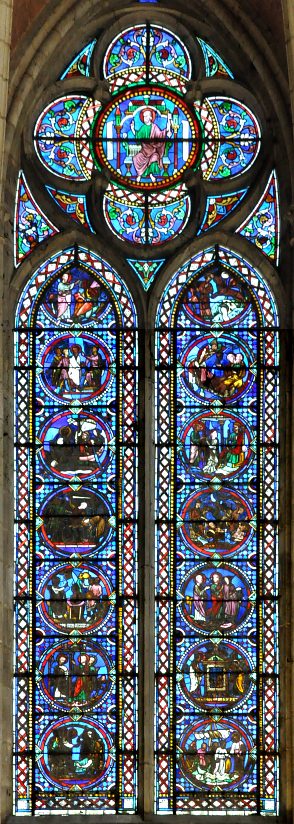
Baie 1, verrière composite
Vies de saint Thomas et de saint Savinien.
Vers 1180 et première moitié XIIIe siècle. |

L'orgue de tribune.
Deuxième quart du XVIIIe siècle et quatrième
quart du XIXe siècle. |
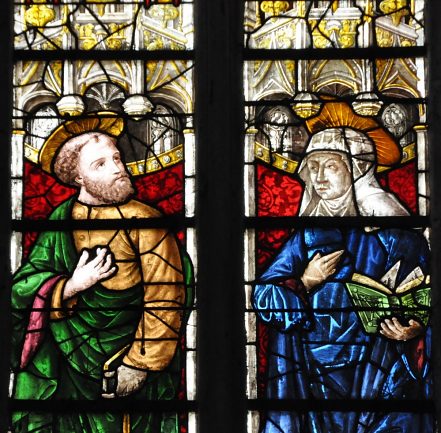 Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.
Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.
Détail de la baie 24 dans le transept. |
|
L'orgue
de tribune . Le premier orgue de la cathédrale
date de 1440. Installé sous les voûtes
du bas-côté nord, il est utilisé
pour les intermèdes musicaux. À cette
époque, en effet, les chants sont exécutés
a cappella par les chanoines. Au XVIe siècle,
un buffet réalisé par le décorateur
Jean Cousin l'Aîné et un nouveau
mécanisme viennent l'enrichir. En 1722, un nouvel
instrument le remplace. Il est installé près
de l'entrée du chœur, du côté
de la chapelle
de la Vierge. Cet emplacement étroit est
funeste pour la sonorité ; aucun agrandissement
n'est possible. Un instrument plus grand, qui réutilise
des parties du précédent, prend alors
place à l'endroit traditionnel que chacun connaît
: au revers de la façade occidentale. L'orgue
est livré en 1734. Sa puissance est accrue ;
la propagation du son est excellente.
À la Révolution, l'orgue est utilisé
pour les fêtes civiques et le culte de l'Être
suprême. Ce qui est peu. En 1802, le culte catholique
est restauré. L'orgue est doté d'une nouvelle
soufflerie. Mais, peu entretenu, l'instrument, très
fragile comme toutes les orgues, est signalé
en mauvais état lors de plusieurs inspections.
À la fin du XIXe siècle, cependant, Charles
Gounod a l'occasion d'y jouer et s'en fait le défenseur.
En 1890, il est restauré.
L'orgue est classé monument historique en 1973,
tandis qu'une restauration globale est entreprise dans
le style de la fin du XVIIIe siècle. Il est inauguré
le 20 octobre 1991. Source : Sens,
première cathédrale gothique, éditions
A˜PROPOS, 2014.
|
|
|

Vue d'ensemble de la nef depuis le chœur. |
 |
Documentation : «Sens, première
cathédrale gothique», éditions À PROPOS
2014
+ «Les vitraux de la cathédrale de Sens», éditions
À PROPOS 2013
+ «La cathédrale de Sens» d'Eugène Chartraire,
Petite monographie des grands édifices de la France, 1928
+ Bulletin monumental, La cathédrale de Sens, 1982
+ Corpus Viterarum, Les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté
et Rhône-Alpes, Éditions du CNRS |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|



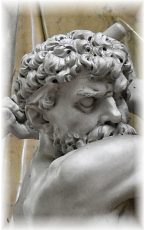

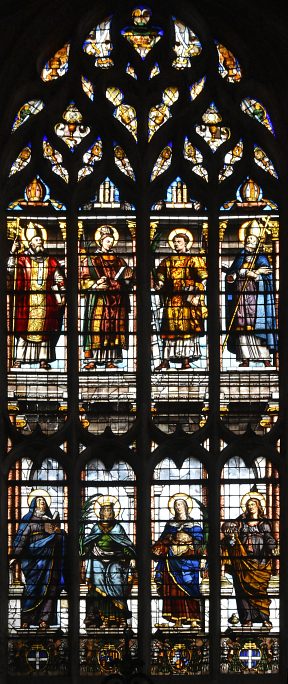
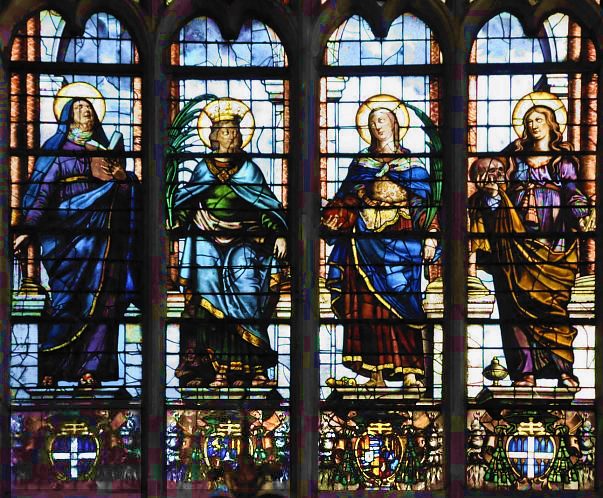
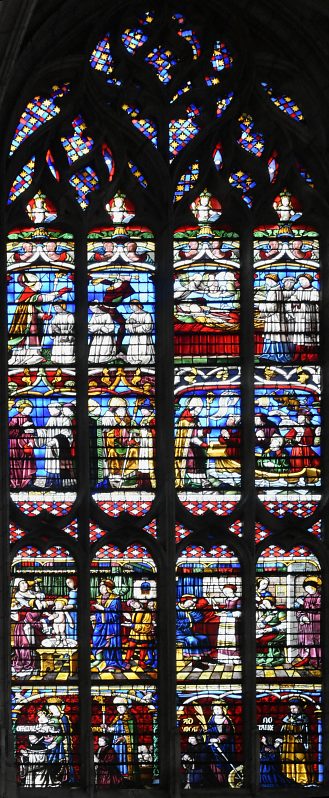
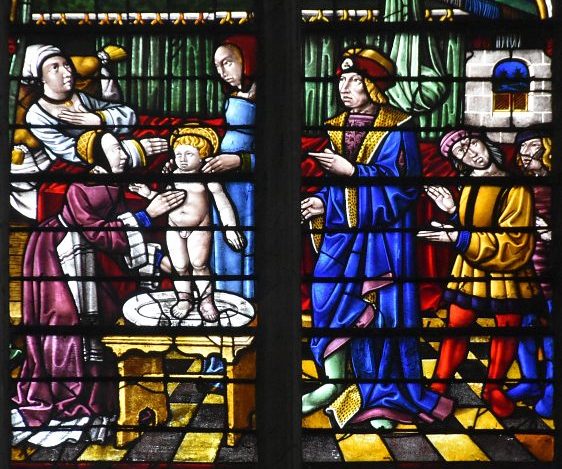





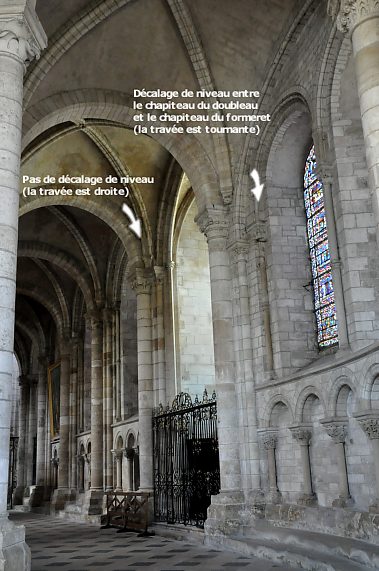
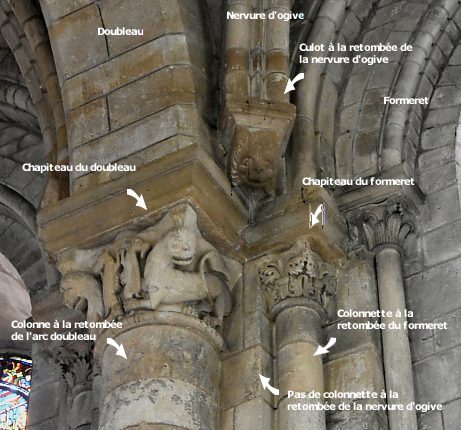
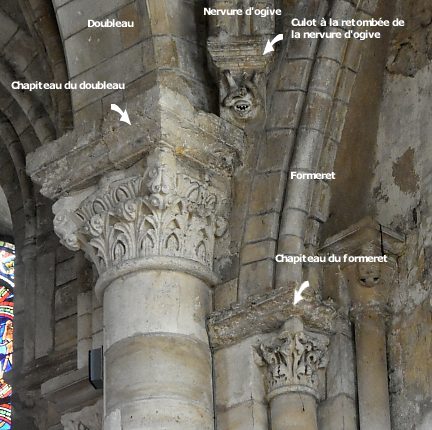





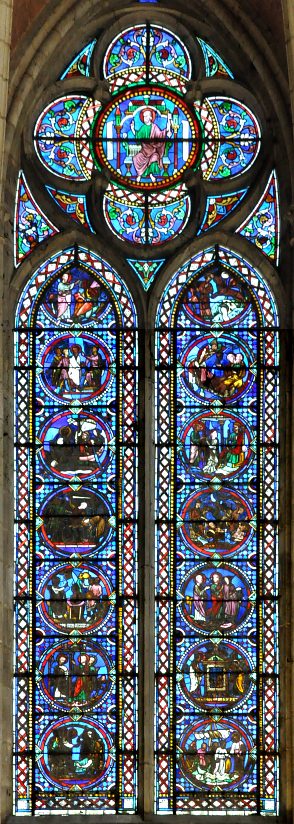



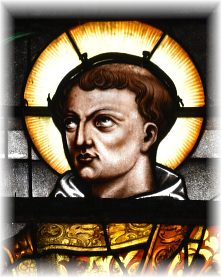

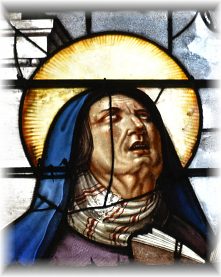
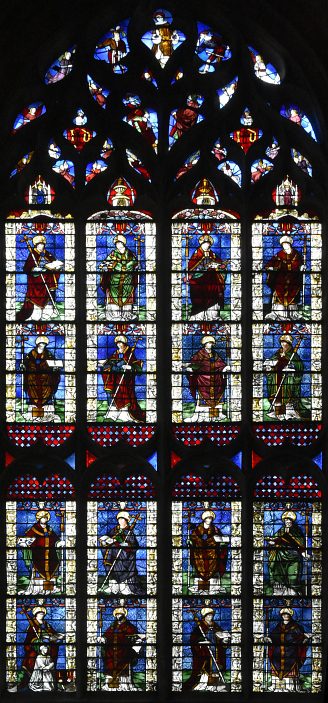





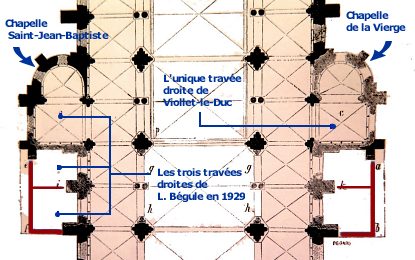





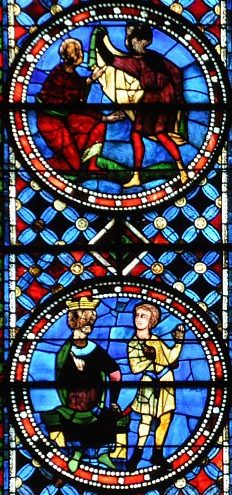
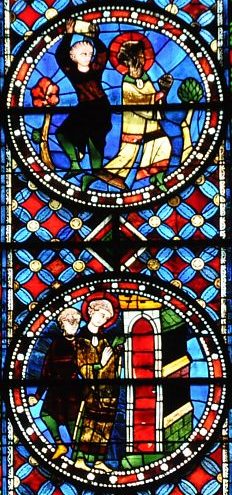




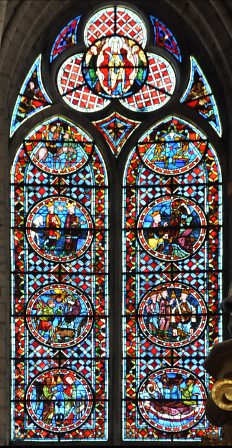

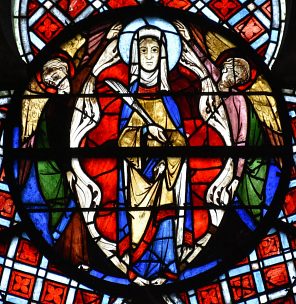







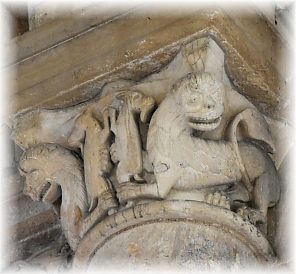


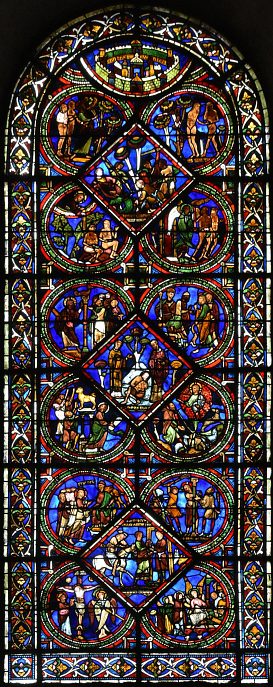
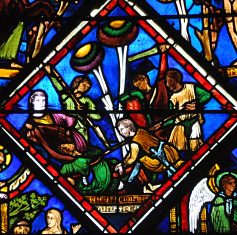


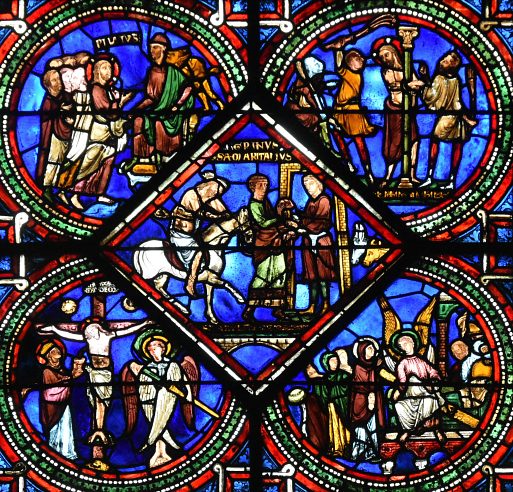

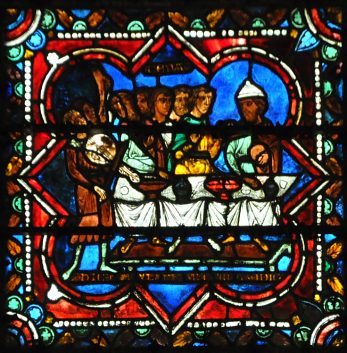
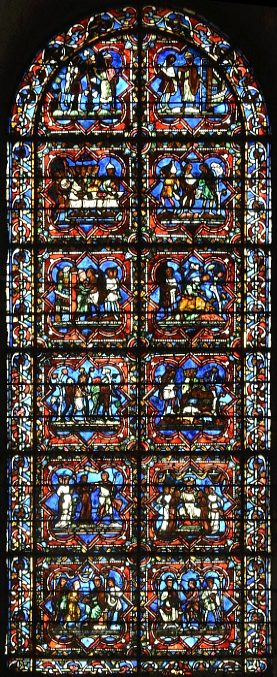


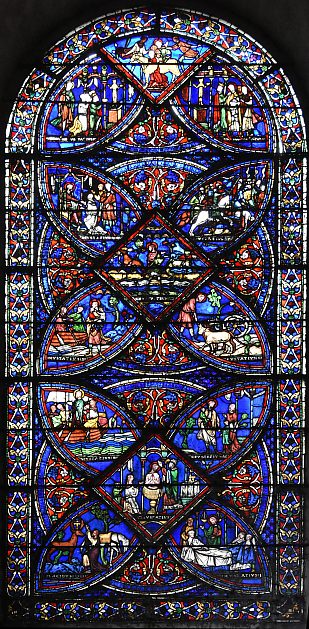
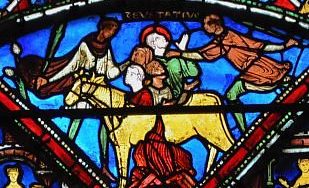




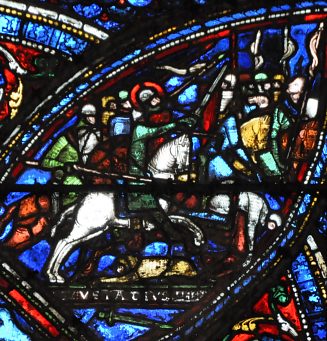
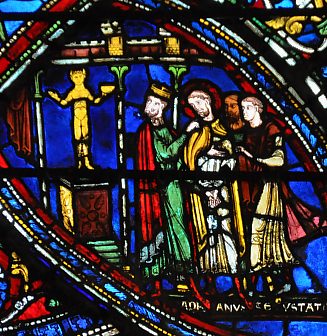

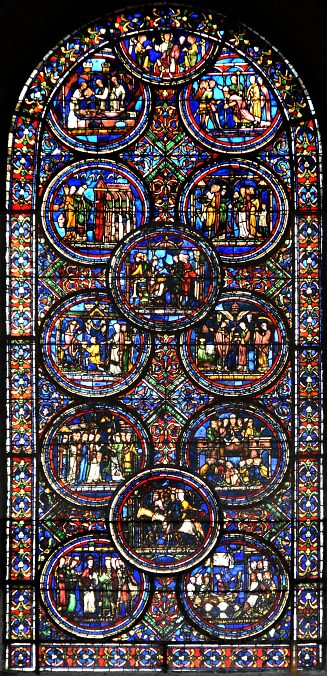




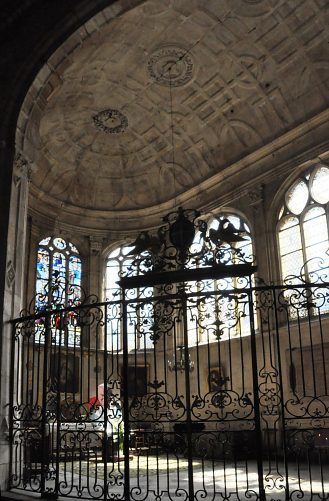
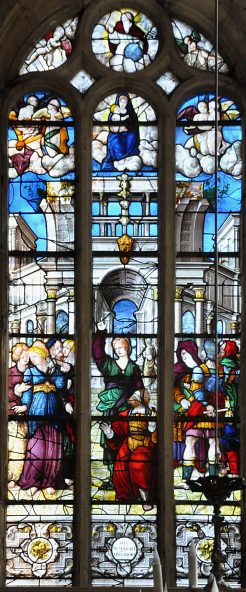
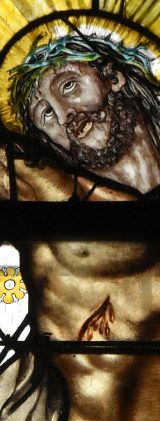



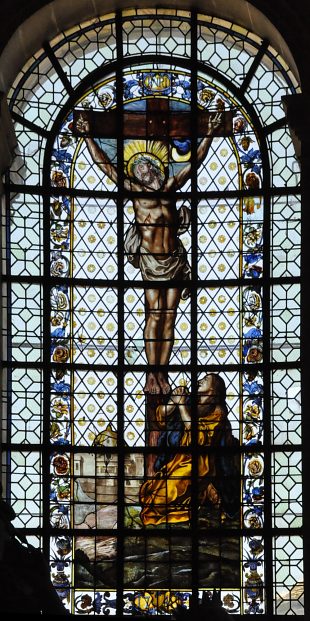
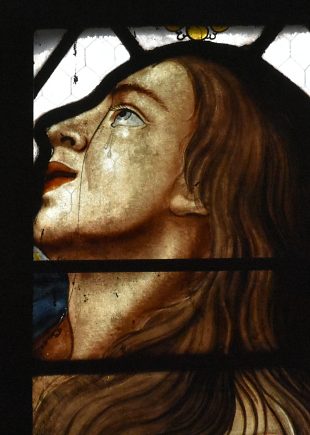
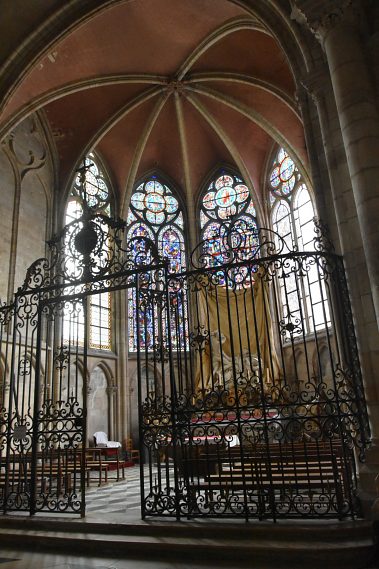






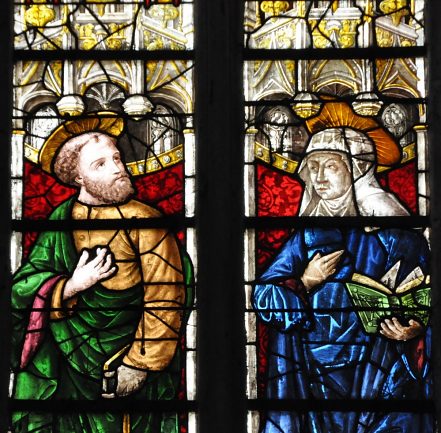 Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.
Saint Pierre et sainte Anne, XVe siècle.