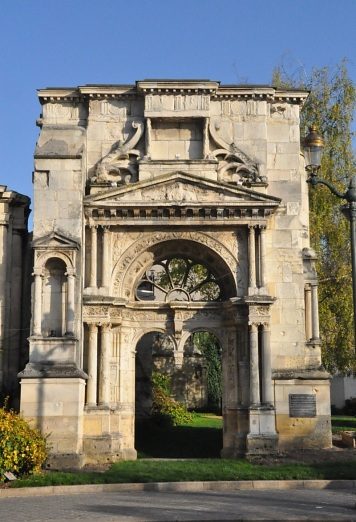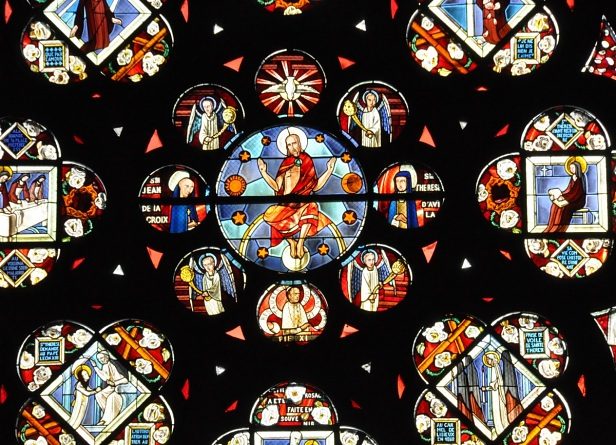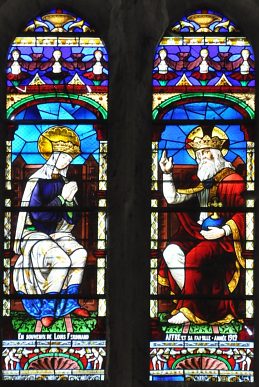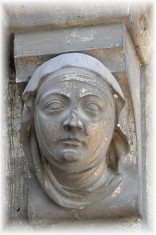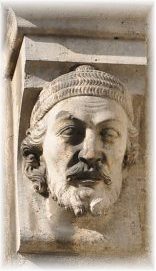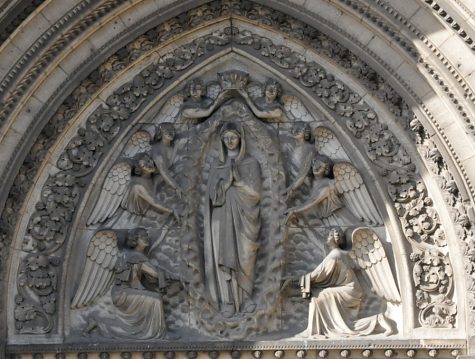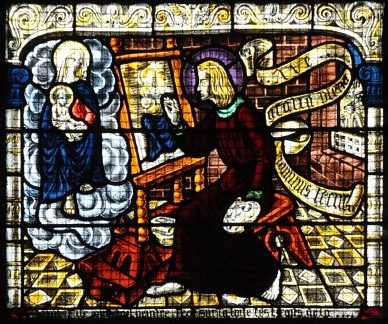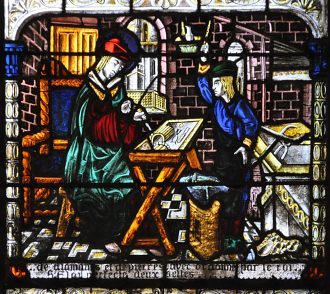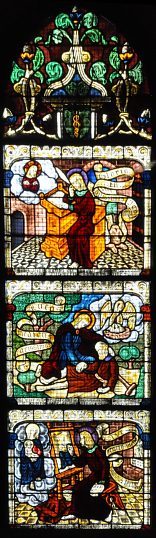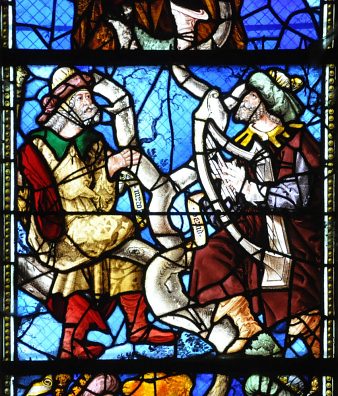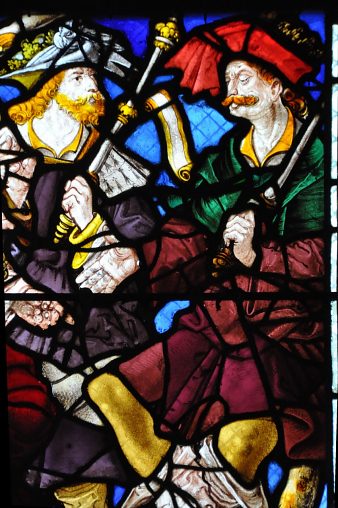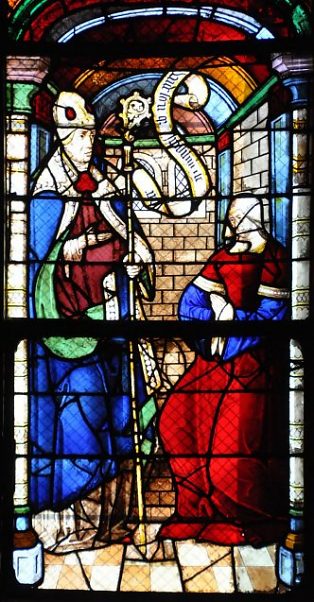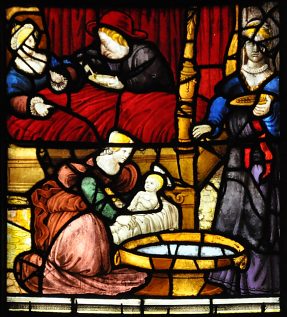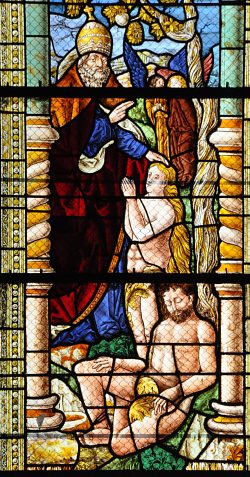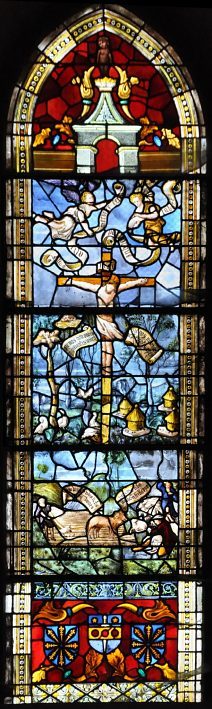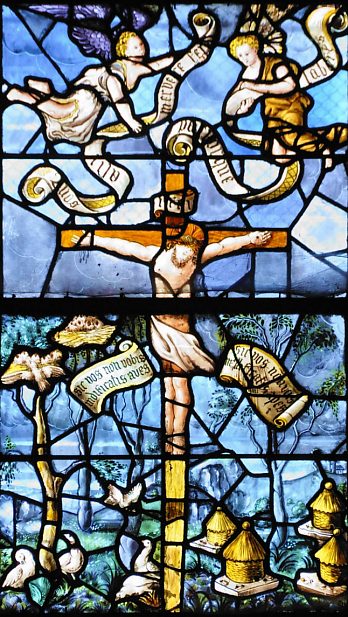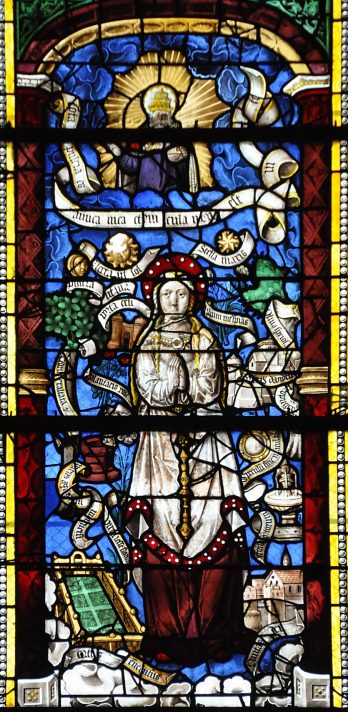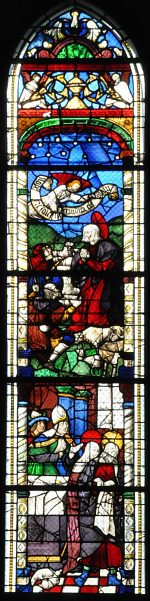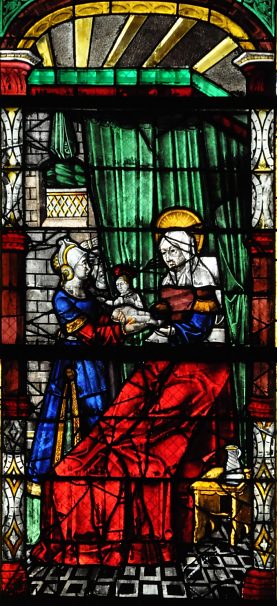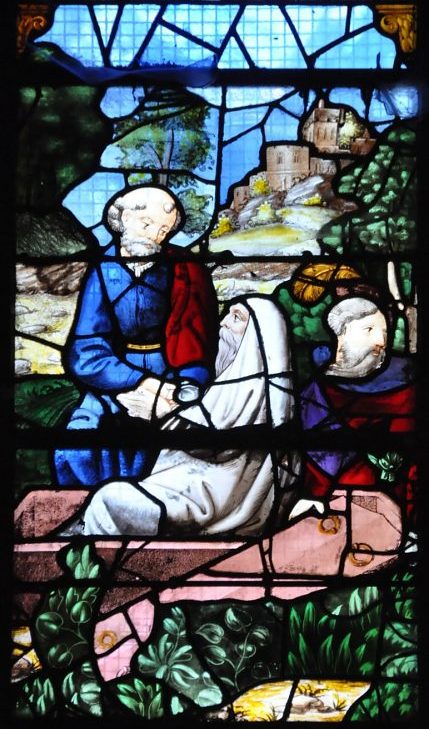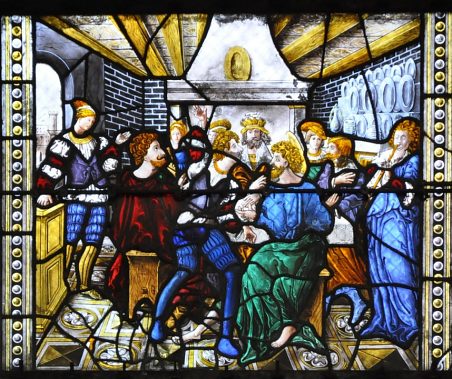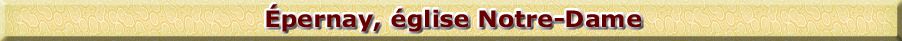 |
 |
Une première église Notre-Dame,
de style Renaissance, a été bâtie à Épernay entre 1520
et 1550. Détériorée au fil du temps, elle s'écroula partiellement
en 1824, fut restaurée entre 1826 et 1833 et s'écroula à
nouveau en 1892. Tout ce qu'il en reste est le
portail Saint-Martin, visible aujourd'hui sur une place de la
ville. La municipalité décida la construction d'une nouvelle église
Notre-Dame, tandis que l'ancienne était démolie en 1909. Le nouvel
édifice, de 73 mètres de long, eut pour architecte Paul Selmersheim
(1840-1916) qui s'inspira de l'église gothique de Braine dans l'Aisne.
Cette construction commença en 1898, s'arrêta en 1905,
et reprit enfin de 1910 à 1915. Lors de l'offensive allemande
de juillet 1918, des obus firent s'écrouler une partie de la voûte
et endommagèrent la façade. Les réparations s'étalèrent
de 1922 à 1925.
Dès 1915, l'édifice se vit enrichi des vitraux
Renaissance de l'ancienne église. Eux aussi subirent le coup des
bombardements de 1918. Ce qu'il en resta fut entreposé chez le peintre
verrier Soccard à Paris, mais son atelier prit feu, réduisant
encore la part des vitraux d'origine. Ceux-ci sont néanmoins visibles
dans le chœur
et les chapelles
absidiales, quoi qu'on y trouve aussi des copies et des pastiches.
À noter le bel Arbre
de Jessé daté de 1523, mais très restauré, et la verrière
des «Noces
de Pélagie» datée de 1533, histoire tirée de la
vie de «saint Thomas, apôtre» dans la Légende
dorée. L'église ayant son abside à l'ouest, les directions
liturgiques nord et sud sont utilisées dans cette page.
|
 |

La nef et le chœur de l'église Notre-Dame à Épernay. |

Vue d'ensemble de l'église Notre-Dame à Épernay. |
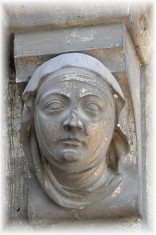
Culot à tête de moniale
sur la façade. |
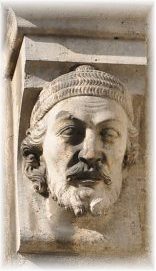
Culot à tête d'homme barbu
sur la façade. |
|
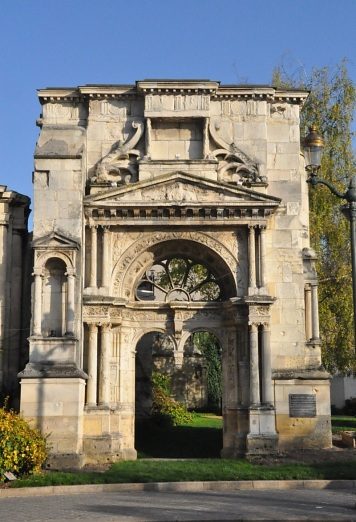
Le portail Saint-Martin,
dernier vestige de l'ancienne église d'Épernay.
Style Renaissance, XVIe siècle. |
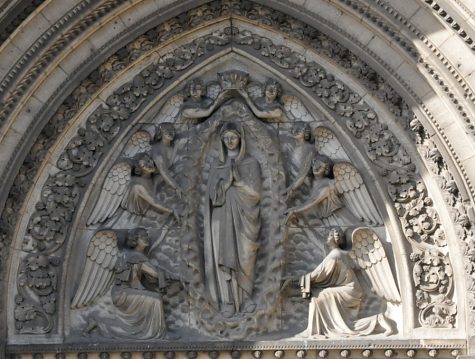
Bas-relief : «La Vierge adorée par les anges» (début
du XXe siècle)
Fronton du portail principal. |

Le chevet de l'église
et ses chapelles latérales et absidiales. |

Statue de la Vierge sur la façade.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. |
|
|
| LA NEF, SES VITRAUX
ET SES CHAPITEAUX SCULPTÉS |
|

La nef et son côté sud vu depuis l'avant-nef.
Le deuxième niveau de l'élévation de l'église est parcouru,
sans interruption, par un triforium.
Celui-ci est aveugle, sauf dans l'abside où il est scandé d'oculi
comme on peut le voir à gauche sur la photo. |
|

Rose de la façade (début du XXe siècle)
Scènes de la vie de sainte Thérèse d'Avila. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.
Feuilles représentant une tête d'homme. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.
Griffon dans un décor floral. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.
Tête de taureau dans un décor floral. |
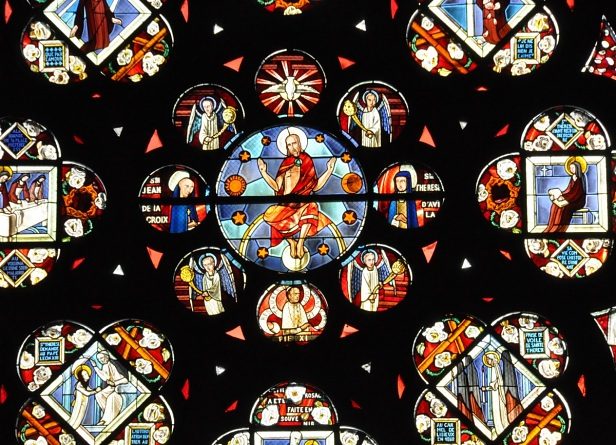
Rose des scènes de la vie de sainte Thérèse d'Avila
(partie centrale), début du XXe siècle. |
|

Le bas-côté sud vu du transept. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.
Feuilles représentant une tête d'homme. |

Chapiteau sur un pilier de la nef.
Tête d'homme cornu dans un décor floral. |

Élévations sud vues depuis le chœur.
Les baies du troisième niveau de l'élévation reçoivent
des vitraux en verre blanc.
L'église profite ainsi d'une grande luminosité. |

Statue d'une Vierge à l'Enfant.
Elle est datée de la fin du Moyen Âge [base Palissy]. |
|
|

Page de la Renaissance portant un écusson.
Oculus de la nef. Fin du XIXe - début du XXe siècle. |
|
««---
La statue de Notre-Dame.
Elle remonterait au XIIe ou au XIIIe siècle et
pourrait être la statue originale qui trônait
au portail nord de la cathédrale
de Paris jusqu'au XIXe siècle. Lors de l'importante
restauration de ce monument entreprise par l'architecte
Viollet-le-Duc, elle aurait été retirée de son emplacement
à cause de son état très dégradé et remplacée
par une copie plus petite. Elle réapparaît on
ne sait comment dans le presbytère d'Épernay
à l'époque où l'on construit la nouvelle
église Notre-Dame. L'architecte est-il à l'origine
de ce sauvetage inespéré? On l'ignore.
Source : livret de visite
de l'église Notre-Dame.
|
|

Page de la Renaissance portant un écusson.
Oculus de la nef.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. |
|

«La Conversion de la pécheresse»
École italienne, premier quart du XVIIe siècle [base Palissy]
(L'identification de cette toile est incertaine.)
Le site Internet du diocèse indique qu'il s'agit d'une copie
d'époque
d'Andréa Vaccaro, datée du XVIIIe siècle. |

Vitrail dans le transept, 1912.
Saint Berchaire, saint Rémi et saint Alpain. |

Statue de saint Christophe
portant l'Enfant. |

«Laissez venir à moi les petits enfants», tableau anonyme (qui aurait
besoin d'être restauré). |

Les Fonts baptismaux. |

Vitrail daté de 1912 siècle dans le transept.
Sainte Colette, sainte Jeanne d'Arc et sainte Jeanne de Chantal
(détail)
Ce vitrail n'est pas ce que le premier quart du XXe siècle
a produit de mieux. |

Monument funéraire avec gisant d'un homme, détail. |
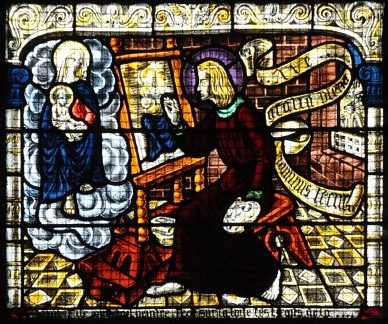
«Scènes de la vie de saint Luc», fin XIXe - début
du XXe siècle
Saint Luc, patron des peintres, peint le portrait de la Vierge
et de l'Enfant. |
|

Élévations nord dans la nef avec sa suite de chapiteaux sculptés
et ses oculi. |

Monument funéraire avec gisant. |
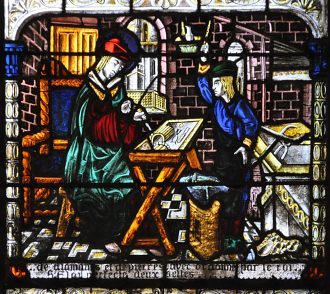
«Scènes de la vie de saint Éloi»
Vitrail de la fin du XIXe siècle - début du XXe
siècle. |
|
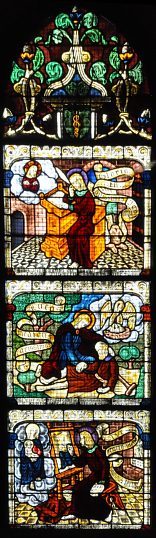
«Scènes de la vie de saint Luc»
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle.
|
|
| L'ARBRE DE JESSÉ
(daté de 1523) |
|

La chapelle de l'Arbre de Jessé est située dans le bas-côté
nord. |
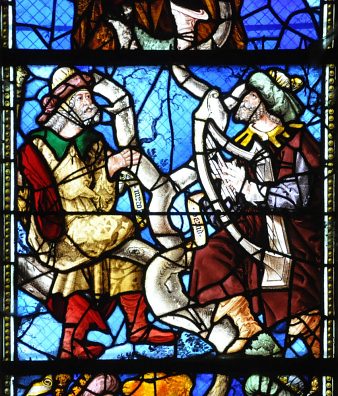
Baie 39, détail : le roi DAVID et sa lyre et le roi de
Juda JORAM. |
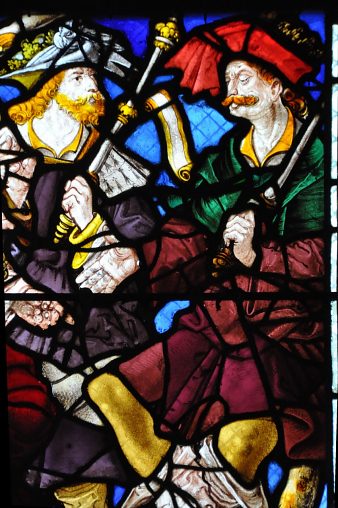
Baie 39, détail : deux rois de Juda. |

Baie 39, détail : le roi de Juda ASA et sa belle tunique
en jaune d'argent. |

Le bas-côté sud avec la statue du curé d'Ars.
Au fond, l'autel absidial de Saint-Vincent de Paul. |
|

Baie 39 : l'Arbre de Jessé de l'église Notre-Dame.
Daté de 1523, il est dit «très restauré»
par le Corpus Vitrearum. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JORAM. |
|

L'oculus en haut de l'Arbre de Jessé. |
|
L'Arbre
de Jessé. Il est daté de 1523
et comporte deux lancettes qualifiées de «très
restaurées» par le Corpus Vitrearum.
L'Arbre est une généalogie théologique du Christ
partant de Jessé, père de David, et que
l'on voit allongé en bas à gauche) pour
aboutir à la Vierge et au Christ en passant
par une liste imposante de rois de Juda.
Son tympan devrait recevoir une Vierge à
l'Enfant (disparue ou cassée?). Ici, les lancettes
sont surmontées d'un oculus affichant un ange
vert aux ailes rouges et portant un phylactère
(ci-dessus).
Les têtes de lancettes reçoivent
un seul roi de Juda. À droite : Manassé
(nom indiqué sur le phylactère).
|
|

Baie 39, détail : le roi de Juda
dans la tête de lancette gauche. |
|

Baie 39, détail : un roi de Juda. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JOTAM. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JORAM. |
|

Baie 39, détail : un roi de Juda. |

Baie 39, détail : le roi DAVID et sa lyre. |

Baie 39, détail : le roi de Juda JOTAM. |
|
|
|
|
|

«Sainte Geneviève» d'Eustache Lesueur
Deuxième quart du XVIIIe siècle [base Palissy]. |

L'absidiole nord et ses deux chapelles. |

Statue de Jeanne d'Arc
Copie de la sculpture de Marie d'Orléans. |

Statue de saint Vincent de Paul
portant l'Enfant Jésus. |
|

«La Naissance de la Vierge»
Première moitié du XVIe siècle
Chapelle du Sacré Cœur. |

Statue de saint Antoine de Padoue
avec l'Enfant Jésus. |

Bas-relief «La Mort de Louis XIII»
Autel de la chapelle Saint-Vincent de Paul
Fin du XIXe siècle. |
|

Chapelle du Sacré Cœur (fin du XIXe siècle)
et ses vitraux Renaissance qui illustrent la vie de la Vierge. |

«La Naissance de la Vierge», détail : Les donateurs
Première moitié du XVIe siècle. |
|

Chapelle absidiale sud de Saint-Vincent de Paul. |

«Scènes de la vie de saint Vincent, martyr»
Pastiche fin XIXe siècle de vitraux de l'époque Renaissance. |
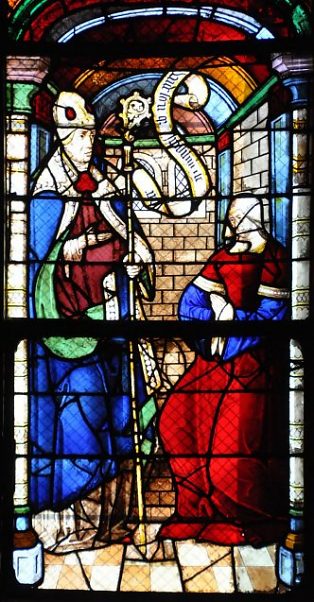 |
|
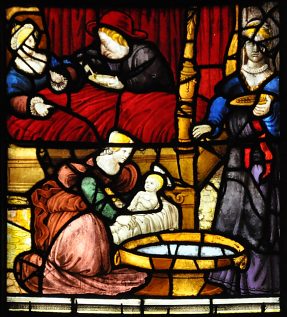
«La Naissance de la Vierge»
Registre du haut du vitrail
Première moitié du XVIe siècle. |

Chapelle absidiale nord de Saint-Joseph
et ses vitraux Renaissance sur la vie de saint Augustin. |

Vitrail de la Création.
Copie d'un vitrail de la première
moitié du XVIe siècle. |

Vitrail de saint Rémi. |
«««---
Vitrail dans la chapelle Saint-Joseph
Scène de la vie de saint Augustin, détail.
Première moitié du XVIe siècle
Cet ensemble de vitraux dédiés à la vie de saint
Augustin
est loin d'égaler les meilleures créations de l'époque. |
|
|

Bas-relief «Saint Vincent de Paul
et sainte Jeanne de Chantal»
sur l'autel de la chapelle Saint-Vincent de Paul
Fin du XIXe siècle. |
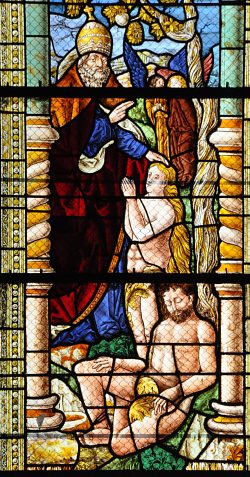
Vitrail de la Création (Le Père Céleste avec Adam et
Ève)
Copie du vitrail de la première moitié du XVIe siècle. |

«Notre-Dame au Rosaire»
Toile anonyme, XVIIIe siècle ? |

«Scènes de la vie de saint Vincent, martyr»
Pastiche fin XIXe siècle de l'époque Renaissance. |
|
| LE VITRAIL DES
VICAIRES ET L'ART DU PASTICHE AUX XIXe ET XXe SIÈCLES |
|
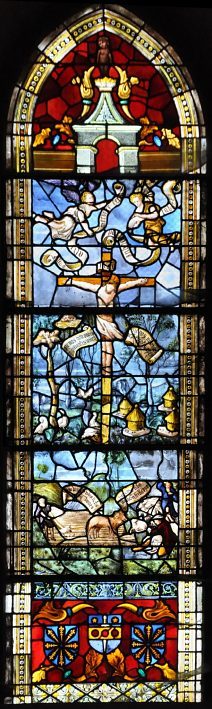
«Le vitrail des vicaires»
réalisé par Edmond Soccard
entre 1922 et 1925. |

«La Rencontre à la Porte Dorée»
Première moitié du XVIe siècle. |

Le Grand prêtre refuse l'offrande d'Anne et de Joachim
parce qu'ils n'ont pas d'enfant.
Vitrail de la première moitié du XVIe siècle. |
|
|
Le vitrail
de la Crucifixion a été appelé «vitrail
des vicaires» au XXe siècle.
Ce surnom se réfère aux messages inscrits sur
les phylactères qui entourent la croix : «ce
n'est pas pour vous que vous construisez des nids, oiseaux»,
«ce n'est pas pour vous que vous faites du miel,
abeilles». Tout comme le vicaire ne travaille
pas pour lui, mais pour le curé dont il est l'adjoint.
Ce vitrail de la Crucifixion semble sorti tout droit
de l'époque Renaissance. On y trouve les figures en
jaune d'argent, un beau paysage bleuté, le travail à
la grisaille, sans compter le riche réseau de plombs
de casse. Et pourtant, c'est une copie réalisée entre
1922 et 1925 par le peintre verrier Edmond Soccard.
Reprenons le fil de l'histoire. L'ancienne église d'Épernay
reçut à la Renaissance une riche verrière
créée par les artistes troyens. De démolition en reconstruction,
ces verrières furent replacées dans l'actuelle
église Notre-Dame en 1915. En 1918, elles sont très
endommagées par les bombardements. Le fils, Pierre,
de l'architecte de l'église Paul Selmersheim (1840-1916)
---»»
|
|
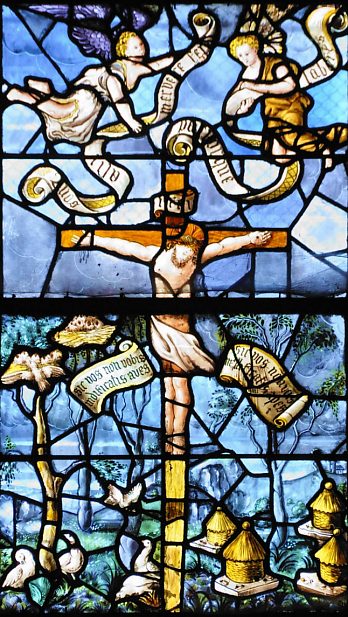
«Le vitrail des vicaires», détail. |
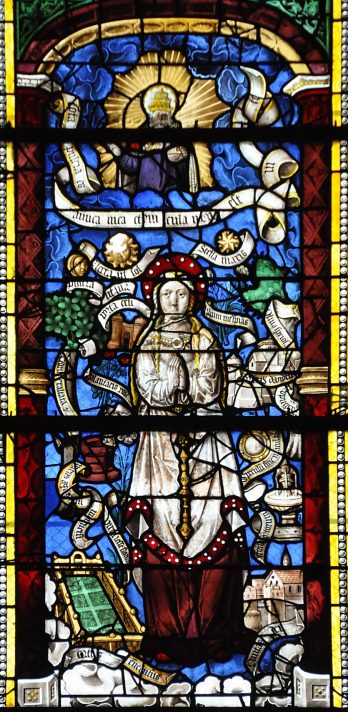
Baie 0, détail : les Litanies de la Vierge.
Vers 1530. |
|

«Le vitrail des vicaires», détail : Le panneau des laboureurs. |
|
---»» les confie
alors à son beau-frère Edmond Soccard
(1869-1934). C'est un très bon peintre verrier
qui travaille dans le XIIIe arrondissement de Paris,
malheureusement dans des locaux en bois. C'est là
qu'il stocke les vitraux d'Épernay. En octobre 1920,
un incendie éclate dans son atelier, détruisant les
caisses contenant les verrières. Avec ceux d'Épernay,
des vitraux provenant de la cathédrale
d'Amiens et de l'église de Balham dans les Ardennes
sont également perdus. On ne récupère que quelques
débris dans les décombres. Heureusement Soccard avait
pris des photos. C'est grâce à elles qu'il
a pu refaire, avec un réel talent, ce vitrail de la
Crucifixion. On a, par ce fait divers malheureux, un
aperçu de l'extraordinaire savoir-faire des peintres
verriers de la fin du XIXe siècle et du début
du XXe dans le pastiche des vitraux du Moyen Âge
et de la Renaissance. Savoir-faire qui rend parfois
bien difficile l'authentification des vitraux d'époque.
À la suite de cet incendie, le ministère
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts imposa des
conditions draconiennes dans les ateliers des peintres
verriers avant de leur confier des vitraux en dépôt
: incombustibilité des locaux, chambre forte pour le
stockage, prise de vue dès leur arrivée dans
les lieux et assurance.
Source : «Vitrail,
Peinture de lumière», Éditions Lieux Dits.
|
|
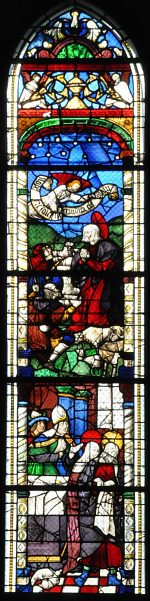
Saint Joachim et sainte Anne
Vitrail dans le chœur.
Première moitié du XVIe siècle. |

«La Rencontre à la Porte Dorée»
et «La Naissance de la Vierge»
Première moitié du XVIe siècle. |

«La Sainte Famille»
Première moitié du XVIe siècle. |
|
| LE TRANSEPT, LE
CHŒUR ET L'ABSIDE DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME |
|

Le transept et son autel de messe, placé là après
Vatican II.
Le triforium n'est pas interrompu par le transept. |

Le chœur et l'abside l'église Notre-Dame
La voûte a été partiellement détruite par les bombardements
en 1917. |
La Naissance de la
Vierge ---»»»
Première moitié du XVIe siècle
Vitrail dans le chœur. |
|
|

L'orgue dans le transept sud. |
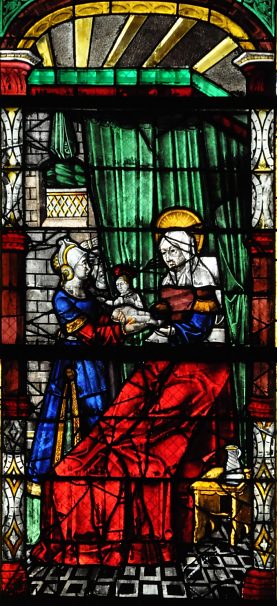 |
|

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. |

Scènes de la vie de Marie
(Nativité et Sainte Famille)
Vitrail dans le chœur.
|
|

Statue d'une Vierge à l'Enfant
(Copie de la Vierge gothique
du musée de Cluny).
À DROITE ---»»»
«Le Massacre des Innocents»
Détail, 1ère moitié du XVIe siècle. |

|

Saint Jacques le Majeur et saint Pierre.
Vitrail dans l'abside (vers 1925). |
|

Le chœur et ses vitraux Renaissance. |

L'abside (triforium et troisième niveau de l'élévation)
reçoit des vitraux du début du XXe siècle. |

Vierge à l'Enfant, détail.
(Copie d'une statue de Cluny). |

L'autel du Saint Sacrement dans le chœur.
Marbre de la Feuderie à Jeumont dans le Nord. |
|
| LE VITRAIL DE
LA CHARITÉ DE SAINT MARTIN, 2e quart du XVIe sièicle |
|

|

Baie 37 : la Charité de saint Martin, détail.
Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que Martin
a été représenté en uniforme d'officier romain.

«««---
Baie 37 : la Charité de saint Martin.
Don du prieur Jean Gautier
2e quart du XVIe siècle.
Les têtes de lancettes sont du XXe siècle.
|
|

Baie 37 : la Charité de saint Martin, détail. |
|
| BAIE 16, LE VITRAIL
DES NOCES DE PÉLAGIE (1533 et vers 1922) |
|

Baie 16 : les Noces de Pélagie.
1533 et restauré en 1922.
Saint Thomas et Abbanes arrivent à la cour du roi, père
de Pélagie.
On voit bien que le personnage à droite, vêtu d'un costume
vert, a une tête refaite au XXe siècle. |
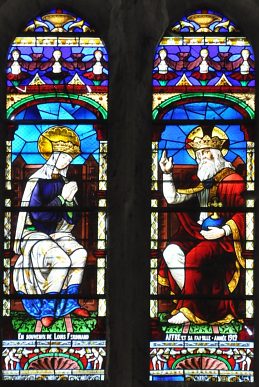
«La Bénédiction de la Vierge»
Vitrail dans l'abside (vers 1925). |

«Marie immaculée»
Tableau dans la nef. |

«Marie est promise au monde»
Tableau dans la nef. |
|

Baie 16, les Noces de Pélagie (vers 1533) : saint Thomas regarde
le ciel pendant le repas. |

Baie 16, les Noces de Pélagie (vers 1533) : le sommelier
est dévoré par un lion. |

Baie 38 : la Prédication du Christ et la Résurrection
de Lazare.
Vitrail de la chapelle des fonts baptismaux.
2e quart du XVIe siècle. |
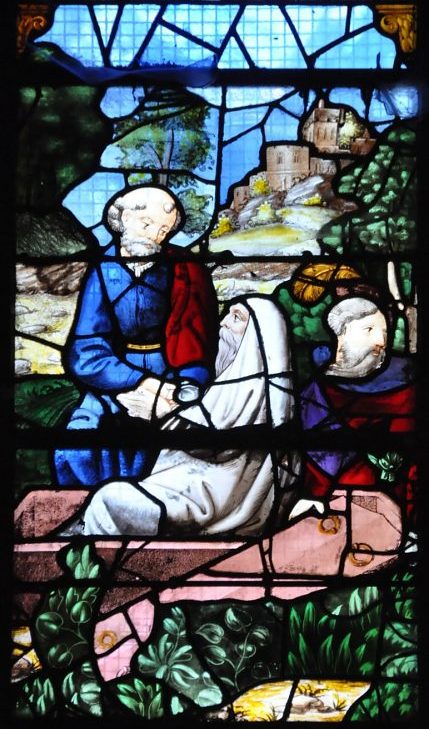
Baie 38 : la Résurrection de Lazare, détail du panneau
central.
Chapelle des Fonts baptismaux.
2e quart du XVIe siècle. |
|
|
Baie
16, «Les Noces de Pélagie» :
c'est un sujet assez rare dans l'iconographie chrétienne
et dans les vitraux. Le thème est expliqué dans
la vie de «saint Thomas, apôtre» de
la Légende dorée de Jacques de Voragine.
Sur invitation du Seigneur, saint Thomas part en Inde
construire un palais pour le roi de ce pays, Gondofer.
Il est accompagné du prévôt du roi, Abbanes. En
route, ils s'arrêtent dans une ville où
un roi célèbre les noces de sa fille, Pélagie.
Toute la ville doit y prendre part, y compris nos deux
voyageurs. Mais Thomas, plongé dans ses pensées, ne
mange rien et regarde vers le ciel (panneau ci-dessus).
Le sommelier, irrité, le soufflette (panneau ci-dessous).
Alors Thomas s'exclame : «Mieux vaut pour toi
que tu sois puni sur-le-champ d'une peine passagère,
et que dans la vie future ton acte te soit pardonné.»
Et il déclare que, avant qu'il se lève de table,
la main du sommelier sera apportée ici par des chiens.
Le sommelier sort puiser de l'eau, mais un lion l'attaque
et le tue (panneau ci-contre). Des chiens déchirent
son corps et l'un d'entre eux apporte la main coupable
dans la salle du festin. Jacques de Voragine ajoute
que saint Augustin blâme cette histoire et la
déclare apocryphe parce qu'elle représente une vengeance.
Ce vitrail, daté de 1533, est parfois présenté sous
le titre des Noces de Pélagie, fille du roi Gunduforus.
Mais, dans la Légende dorée, le roi qui invite
toute sa ville aux noces de sa fille Pélagie n'a pas
de nom. Alors que Gondofer est le nom donné au roi de
l'Inde chez qui se rendent saint Thomas et Abbanes.
Source : La Légende
dorée de Jacques de
Voragine, éditions Diane de Selliers, traduction de
Theodor de Wyzewa (les propos de Thomas sont tirés de
la traduction).
|
|
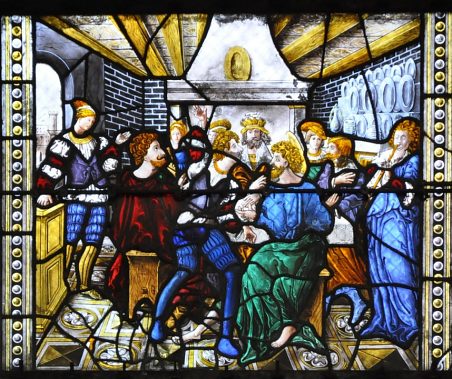
Baie 16, les Noces de Pélagie» (vers 1533) : le sommelier
soufflette saint Thomas. |

Le grand orgue Cavaillé-Coll dans le transept. |

Baie 38 : la Prédication du Christ, détail.
Chapelle des Fonts baptismaux.
2e quart du XVIe siècle. |
|

La nef vue depuis le chœur. |
Documentation : Livret de visite disponible
dans l'église
+ «Vitrail, peinture de lumière» aux éditions Lieux-Dits
+ «Corpus Vitrearum, Les vitraux de Champagne-Ardenne»,
éditions du CNRS, 1992
+ base Palissy + site Internet du diocèse. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |