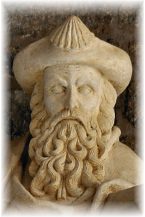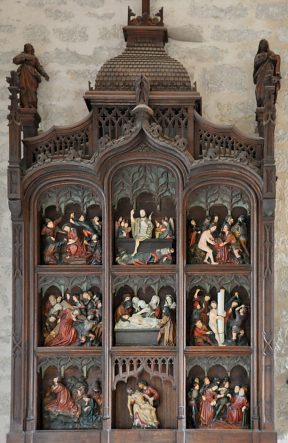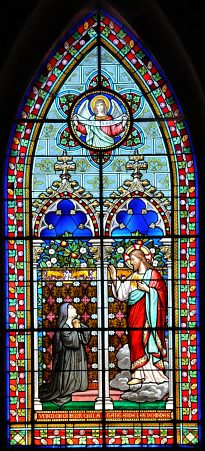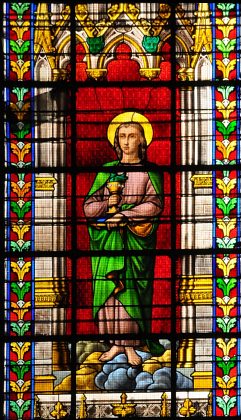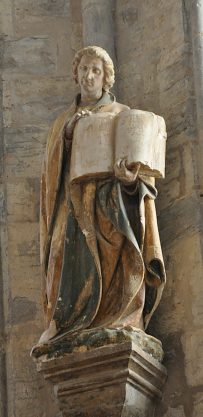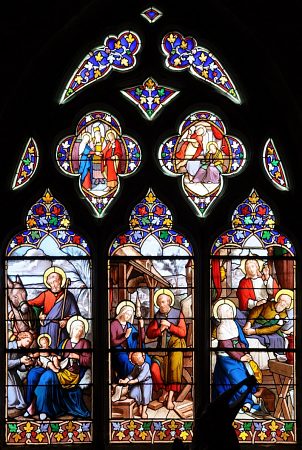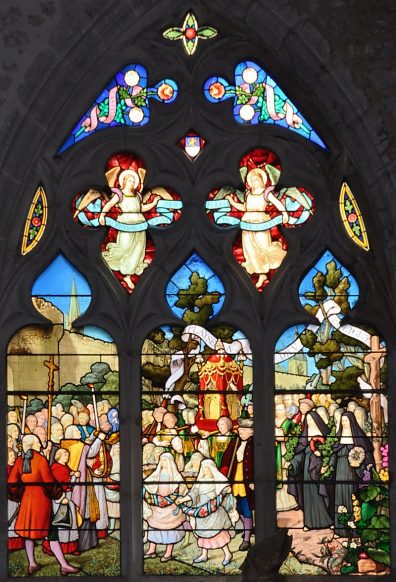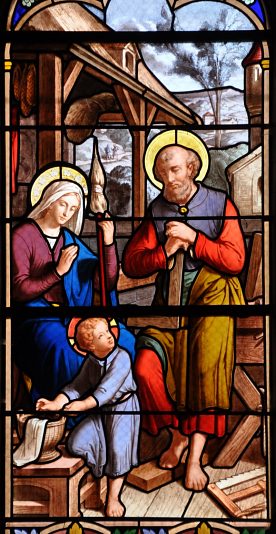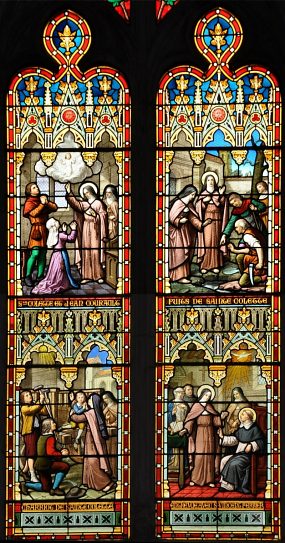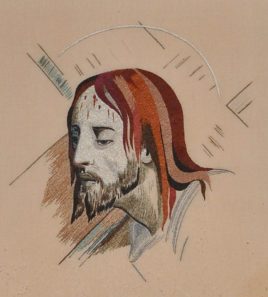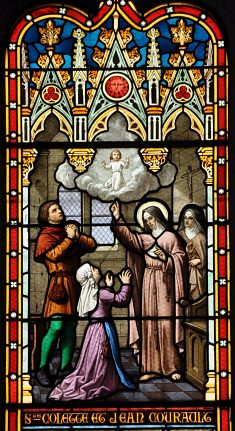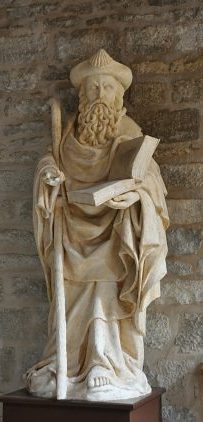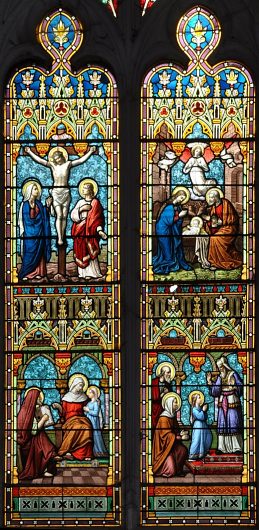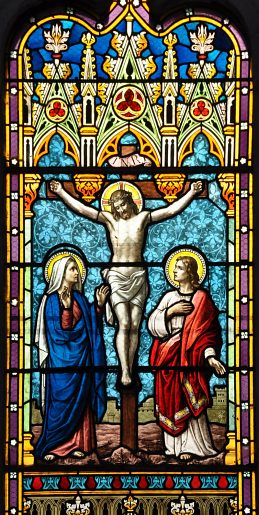|
|
 |
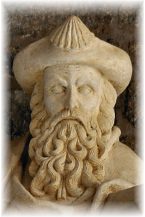 |
La construction de la collégiale
Saint-Hippolyte a commencé en 1415. C'est la même année
que sainte Colette créait, non loin, le monastère
des Clarisses. Le fondateur de l'église est un bourgeois
de Poligny, Jean Chousat, devenu «gouverneur des finances»
des ducs de Bourgogne. (Il possède sa statue dans le chœur.)
À sa demande, le pape Eugène IV érige l'église
en «collégiale insigne». À la mort de
Jean Chousat, le clocher est à peine commencé. La
générosité de l'évêque de Tournay,
Jean Chevrot, permit d'en achever la construction (aux alentours
de 1450).
Malheureusement, la ville de Poligny va subir les affres de la guerre
de Dix Ans (1635-1644), épisode meurtrier et sanglant
qui a opposé la France de Richelieu à la Maison d'Autriche
et que les historiens appellent la «période française»
de la guerre de Trente Ans (1618-1648). La Franche-Comté,
que Richelieu veut conquérir, est mise à sac par les
Français et leurs alliés, les princes protestants
allemands. Bien des petites villes et des villages sont détruits,
brûlés, les habitants massacrés. La province
va perdre 60% de sa population (morts ou exilés). C'est lors
de cet épisode tragique que la ville de Poligny et sa collégiale
sont livrées aux flammes. Tous les vitraux d'origine de Saint-Hippolyte
sont brisés.
Au niveau de l'architecture, l'intérieur de la collégiale
est assez sobre. Arcades simples, colonnettes assez chiches montant
jusqu'à la naissance des voûtes, pas de chapiteau.
L'intérêt de l'église réside dans sa
magnifique collection de statues bourguignonnes du XVe siècle
créées par les meilleurs sculpteurs du temps (Claus
de Werve, Jean de la Huerta, etc.). On pourra admirer entre autres
une superbe Vierge
du fondateur de Claus De Werve dans l'absidiole sud.
|
 |

Vue d'ensemble de la nef de la collégiale Saint-Hippolyte
La poutre de gloire date de la première moitié du XVe
siècle, la chaire à prêcher du XVIIIe siècle. |

Le portail principal est ornée de deux œuvres :
la Vierge à l'Enfant de
Jean de la Huerta et le bas-relief du Martyre de saint Hippolyte. |

Vierge à l'Enfant
Atelier de Jean de la Huerta, milieu du XVe siècle. |

Piéta de la fin du XVe siècle au-dessus de la porte sud. |

Le porche, devant le portail principal, a été
ajouté au XVIIe siècle. |

Bas-relief dans le tympan du portail principal : Le Martyre
de saint Hippolyte. |
|

Vue extérieure, XVe siècle. Le dôme du clocher,
qui remplace
une flèche tombée en 1638, date du XVIIe siècle. |

L'entrée sud porte encore les marques
du gothique flamboyant |
|

Vue de la collégiale depuis le chevet. |

Vierge à l'Enfant en albâtre.
École de Brou, XVIe siècle.
Chapelle du Saint Sacrement. |

Statue de Saint Étienne lisant.
Fin du XVe ou premier tiers du XVIe siècle.
Albâtre, restes de polychromie |
|
La statuaire
bourguignonne en Franche-Comté.
Au XVe siècle, plusieurs Polignois occupent
des postes de haut rang à la cour des ducs de Bourgogne.
C'est le cas de Jean Chousat, «gouverneur des finances»
des ducs. Ils sont donc bien placés pour solliciter
les artistes les plus en vue de la cour afin que ceux-ci travaillent
pour eux et leur ville.
Ces artistes vont ainsi embellir les monuments que la générosité
- ou le goût de la gloire - des bourgeois de Poligny
vont les amener à faire construire. Le grand Claus
Sluter (mort à Dijon
en 1406) ne participera pas à cette «campagne»
artistique. En revanche, son neveu, Claus De Werve, de même
que Jean de la Huerta, vont créer quelques chefs d'œuvre.
Source : panneau dans la nef.
|
|

Le bas-côté sud avec, à droite, la chapelle du Saint Rosaire
et le priant de Thomas de Plaine vu de dos.
Au fond à gauche dans l'absidiole, la chapelle du fondateur. |

Statue de saint Blaise.
Albâtre polychromé du XVe siècle. |
|
Les ornements
perdus de l'église.
Jean Chousat et sa femme Blanche Guillet ne furent pas les
seuls à consacrer une partie de leurs biens à
l'édification de l'église Saint-Hippolyte de
Poligny. On note aussi le chancelier Jean de Thoisy, évêque
de Tournai, et Nicolas Rolin qui lui succéda dans sa
charge. Ces deux très hauts fonctionnaires de l'administration
ducale étaient originaires d'Autun. En 1429, Jean Chousat
et son épouse avaient d'ailleurs financé l'installation
d'un doyen et de douze chanoines.
En 1448, une nouvelle donation accrut le prestige de l'église.
Un prélat d'origine polinoise, Jean Chevrot, qui avait
déjà fait élever une chapelle dédiée
à la Vierge et à saint Antoine et desservie
par trois chapelains, ajouta le financement d'un chantre expert
en l'art de musique pour apprendre et instruire quatre enfants.
De plus, dans son testament de 1458, Chevrot donna, pour la
décoration du chœur, trois tapisseries des Sibylles
et un «tapis des VII sacrements de la Sainte Église»
[cité par Pierre Quarré].
Près de deux siècles plus tard, la guerre de
Trente Ans s'abattit sur la ville.
|
En 1638, les troupes françaises
pillèrent l'église et la brûlèrent.
Pierre Quarré écrit : «Il ne reste malheureusement
aucun des ornements liturgiques, chapes d'or à images,
avec orfrois garnis de perles, croix reliquaires, châsses,
paix, calices, statuettes d'argent doré, donnés
par Jean Chevrot et dont l'inventaire de 1477 permet de mesurer
le nombre et la richesse. La plupart des œuvres d'art
qui faisaient parure à l'église depuis le XVe
siècle et rehaussaient l'éclat des cérémonies
disparurent, lorsque l'église fut pillée et
brûlée, le 29 juin 1638, par les troupes françaises
qui, sous le commandement du duc de Longueville, s'emparèrent
de la ville de Poligny.»
La seule richesse qui reste de l'église est sa collection
de statues du XVe siècle.
Source : Congrès archéologique
de France, 118e session, 1960, Franche-Comté, article
«La Collégiale Saint-Hippolyte de Poligny et
ses statues» par Pierre Quarré.
|
|
| LES CHAPELLES
LATÉRALES SUD |
|

Bas-côté sud : trois chapelles avec leurs priants.
Thomas de Plaine est à gauche ; Pierre de Versey, au
centre ;, et, caché dans la dernière chapelle
à droite, Jean Chevrot. |

Priant de Jean Chevrot, évêque de Tournay.
XVe siècle.
|
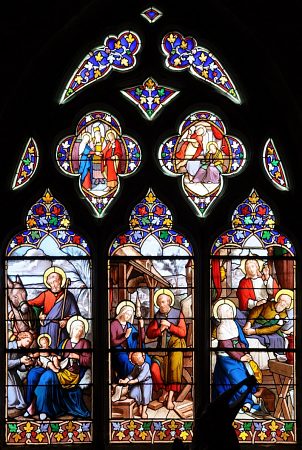
«Scènes de la vie de saint Joseph» dans la
chapelle Saint-Joseph.
Vitrail du XIXe siècle. |

Chapelle latérale sud Saint-François-Xavier.
En face du tableau : priant de Pierre de Versey,
polinois, évêque d'Amiens, XVe siècle. |
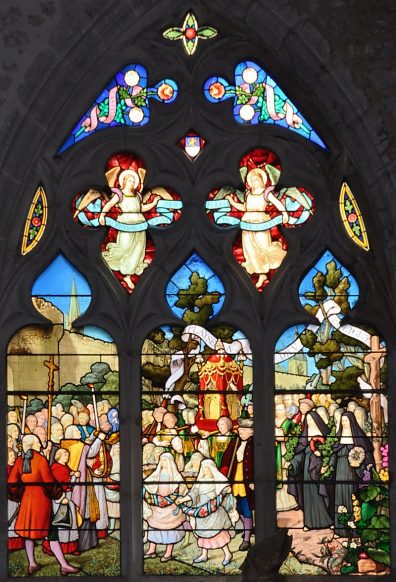
Vitrail du XIXe siècle : Réception à Poligny
du corps de sainte Colette.
Les restes de la sainte ont été offerts
à la collégiale, au XVIIIe siècle,
par Louise de France, abbesse de Saint-Denis et
fille de Louis XV. |
|

Statue de Vierge à l'Enfant
XVe siècle. |

Clé de voûte
dans une chapelle latérale. |

Statue de sainte Catherine
Albâtre polychromé du XVe siècle. |
|

Priant de Pierre de Versey, polinois, évêque
d'Amiens.
Il était également le neveu de Jacques
Coytier,
polinois, médecin de Louis XI.
Pierre, traces de polychromie et de dorures, XVe
siècle. |

Vierge à l'Enfant en albâtre, détail.
École de Brou, XVIe siècle. |
|
|
|

Priant de Jean Chevrot, évêque de Tournay, XVe siècle.
(Chapelle Saint-Joseph, dite de Tournay)
Grâce à sa générosité le clocher
put être construit. |

Clé de voûte dans une chapelle latérale
XVe siècle. |

Clé de voûte avec deux anges tenant un écusson
Chapelle du Saint-Sacrement , XVe siècle. |
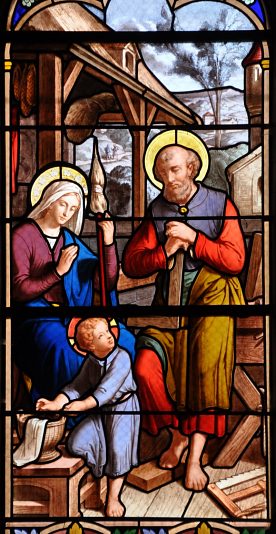
Vitrail «Scènes de la vie de sainte Joseph»
Détail, XIXe siècle |

Tableau «Saint-François Xavier»
Chapelle Saint-François d'Assise
Ce tableau ressemble au «Saint
François-Xavier mourant sur le côte de Chine»
de Claude Perrin et daté
de 1709, visible dans l'église Saint-Just
à Arbois. |

Réception à Poligny du corps de sainte Colette, détail. |
|

«Résurrection d'une religieuse par sainte Colette»
Vitrail de L. Bégule, Lyon, 1892 |

Chapelle latérale sud du Saint Rosaire avec le priant de Thomas
de Plainevu de dos. |

Priant de Thomas de Plaine, président au Parlement de
Bourgogne.
Plâtre d'Antoine le Moiturier
Copie d'une statue de la première moitié du XVe siècle
au Louvre.
(Chapelle du Saint Rosaire) |

Statue de sainte Barbe.
Pierre polychrome du XVe siècle.
(Chapelle du Saint Rosaire) |
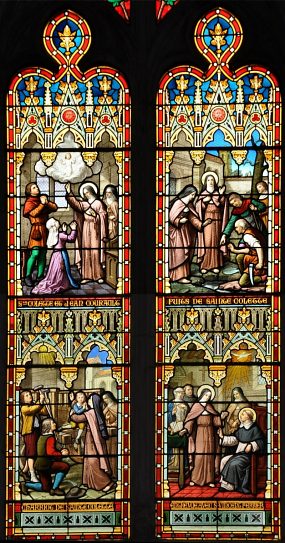
Scènes de la vie de sainte Colette.
Vitrail du XIXe siècle. |
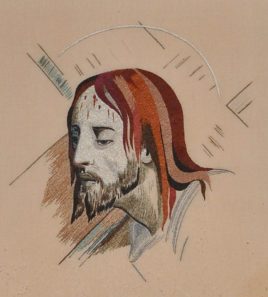
Chemin de croix, station VII :
Jésus tombe pour la seconde fois, détail.
XXe siècle. |
|

Statue de sainte Anne et Marie.
XVe siècle. |

Chemin de croix, station III :
Jésus tombe sous le poids de la croix
XXe siècle. |
|

«La Confrérie du Saint-Sacrement de Poligny», détail.
Vitrail du XIXe siècle.
Tous les ordres de la société sont représentés
: clergé, robe, noblesse et gens du peuple. |
 |
 |
 |
|

Vitrail de la «Confrérie du Saint-Sacrement de Poligny
1247-1896»
XIXe siècle. |

La chapelle du fondateur.
Le fondateur de l'église, Jean Chousat, est enterré
au pied de l'autel. |

La Vierge du fondateur par Claus De Werve
1429.
Chapelle du fondateur. |
|
|
|
|
L'art
bourguignon au XVe siècle.
Avec le duc Philippe le Hardi et Claus Sluter, l'art
européen va prendre un tournant décisif.
Jusque-là confiné dans l'étroitesse
des cours, l'art quitte cette espèce d'adoration
égoïste pour l'objet précieux, sa
merveilleuse technique et son matériau rare pour
s'ouvrir à un univers d'œuvres monumentales,
propres à saisir les esprits.
Le duché de Bourgogne, au XVe siècle,
est un État puissant et riche. Il intègre
la Belgique actuelle, une partie de la Hollande et l'est
de la France. L'autonomie de ses villes marchandes est
la source de sa prospérité.
Vers la fin du XVe siècle, ce bel édifice
disparaît. Par mariage, les possessions hollandaises
rejoignent l'Empire : c'est la fin de la première
période de splendeur pour les cités marchandes
comme Bruges ou Gand. Quant au duché, après
une guerre, Louis XI l'annexe à son royaume.
Source : «L'art au
XVe siècle», éditions Hazan.
|
|

«L'Assomption», tableau attribué à Jordaëns (XVIIe siècle)
dans la chapelle du fondateur. |
 |
|
| LA POUTRE DE
GLOIRE DU XVe SIÈCLE ET LA CHAIRE À PRÊCHER
DU XVIIIe SIÈCLE |
|

La poutre de gloire, en bois polychrome, date de la première
moitié du XVe siècle

| La Vierge de la poutre de
gloire ---»»» |
|

|

Scènes de la vie de sainte Colette, XIXe siècle
«Entrevue avec saint Vincent Ferrier» |

La chaire à prêcher du XVIIIe siècle. |

La cuve de la chaire à prêcher
et ses panneaux sculptés en bois polychrome.
|

L'ange souffleur sur l'abat-son
de la chaire à prêcher
Cet ange souffleur, qui ne repose sur l'abat-son
que d'un seul pied tandis que l'autre paraît en
mouvement, fait montre d'un grand dynamisme
dans son attitude.
La chaire à prêcher vient de
l'église
du couvent des Jacobins. |
| LES CHAPELLES
LATÉRALES NORD |
|

Le bas-côté nord et ses chapelles latérales. Au fond, la chapelle
du Saint-Sacrement. |
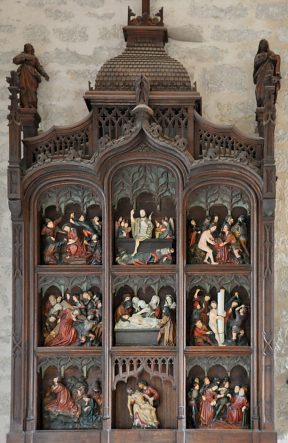
Retable de la Passion en bois sculpté polychrome, XVe siècle.
(Chapelle nord près de l'entrée de l'église.) |

Retable de la Passion, XVe siècle
Panneau : Jésus porte sa croix. |

Piéta de 1615 provenant du couvent des Capucins.
(Chapelle nord près de l'entrée.) |

Retable de la Passion, XVe siècle.
Panneau : La mise au tombeau |

«Scènes de la vie de la Vierge», XIXe siècle
La Présentation de Marie au temple. |

Statue de sainte Anne et de Marie
École de Brou, XVIe siècle.
(Chapelle du Saint-Sacrement) |

Statue de saint Nicolas
XVIIe siècle.
(Chapelle du Saint-Sacrement)
|

Le retable de la chapelle Saint-Vernier.
Saint Vernier est le patron des vignerons. |

«La Vierge au Rosaire»
Tableau de J.M. Combette, 2e quart du XIXe siècle.
(Chapelle du Saint Rosaire) |

Statue de saint Bon, albâtre du XVe siècle,
détail. |
|

Vitrail des scènes de la vie de la Vierge, XIXe
siècle.
La Présentation de Marie au temple, détail. |

Chapelle du Saint-Sacrement
Le retable est de style Louis XVI.
Il est encadré de deux belles statues : saint
Léonard à gauche
et saint Nicolas à droite. |
|
|
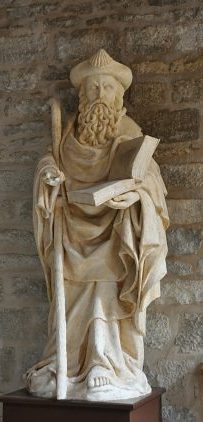
Statue de saint Jacques le Majeur
Jean de la Huerta, XVe siècle. |

Saint Aligius, évêque
Vitrail du XIXe siècle. |

|
|

Statue de saint Léonard
Attribuée à Claus De Werve
Premier tiers du XVe siècle.
Saint Léonard est le patron des prisonniers.
«««---
Un angelot sur le retable
de la chapelle Notre-Dame
XVIIIe siècle. |
|
|
|
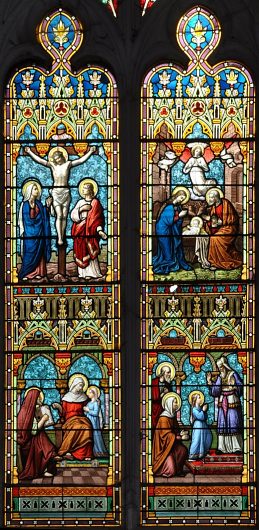
Vitrail des scènes de la vie de la Vierge.
XIXe siècle. |

«La Vierge au rosaire», détai.
Tableau de J.M. Combette, deuxième quart du XIXe siècle |
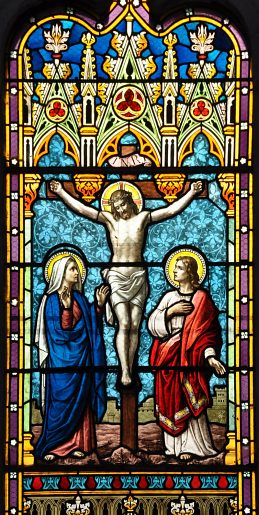
Vitrail des scènes de la vie de la Vierge
Détail : La Crucifixion (XIXe siècle) |
|

Chapelle Notre-Dame, retable du XVIIIe siècle.
Les statues sont des XIXe et XXe siècles. |

Peinture murale (XIXe ou XXe siècle)
dans la chapelle Notre-Dame. |
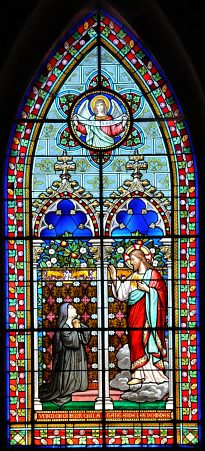
Apparition du Sacré Cœur à
Marguerite-Marie Alacoque.
Vitrail du XIXe siècle. |

Statue de saint Jean-Baptiste
par Jean de la Huerta, XVe siècle. |

Vitrail de l'apparition du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie Alacoque,
détails. |
 |
|

Statue de saint Paul
Premier tiers du XVe siècle.
Plâtre, copie d'après l'original qui est au
Metropolitan Museum New York. |
| LE CHŒUR,
LES STALLES DU XVIIe SIÈCLE ET LES BOISERIES DU XIXe
SIÈCLE |
|

Le chœur de la collégiale Saint-Hippolyte.
Quatre belles statues du XVe siècle ornent le chœur entre
les trois baies vitrées :
Jean Chousat, la Vierge à l'Enfant, saint Jean et saint André. |

La Vierge
Vitrail du XIXe siècle dans le chœur de l'église. |

Statue de Jean Chousat († 1433) , XVe siècle
JEAN CHOUSAT, fondateur de l'église, était gouverneur
des finances des ducs de Bourgogne. |
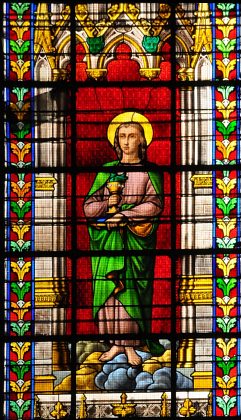
Saint Jean.
Vitrail du XIXe siècle dans le chœur de l'église |

Statue de Vierge à l'Enfant
dans le chœur, XVe siècle. |
|
La statue
de Jean Chousat dans le chœur.
Cette statue, donnée ci-dessus, pose problème.
Depuis quand un notable, ayant certes œuvré à
l'édification de l'église, peut-il se permettre
de se faire représenter dans une statue en pied, qui
plus est dans le chœur de l'église et en pendant
de saint Jean ? Dans son article du Congrès archéologique,
Pierre Quarré apporte des réponses.
Une historienne, Mlle Jalabert, écrivit en 1947 que
c'était par pure vanité que le receveur du duc
de Bourgogne s'était fait représenter en chasseur,
la chasse au faucon étant un signe de noblesse. Vanité
toujours le fait de mettre sa statue dans le chœur, en
pendant de l'évangéliste saint Jean, son patron.
Le raisonnement paraît un peu court. Pierre Quarré
fait remarquer que, en Bourgogne, les membres des familles
ducales, qu'ils soient capétiens ou valois, ne se sont
jamais autorisé pareille vanité. Quand ils sont
en pied, c'est à l'extérieur des églises,
sur le piédroit des portails. Quand c'est à
l'intérieur, «les clercs comme les laïcs
ne sont jamais debout, mais agenouillés, ou bien couchés
sur leurs tombeaux.»
C'est pourquoi, à la suite de l'archéologue
Louis Réau, Pierre Quarré pose la question :
|
cette statue n'est-ellepas tout
simplement celle de saint Thibault sous les traits
de Jean Chousat ? Le culte de ce saint s'était développé
en Bourgogne. Son iconographie était celle d'un jeune
chevalier partant pour la chasse, faucon au poing, à
pied ou à cheval. La ville de Poligny possède
d'ailleurs une autre statue de ce saint.
L'hypothèse est séduisante. En effet, pourquoi
Jean Chousat, qui avait tenu les comptes de la recette générale
des ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur, se serait-il
fait représenter dans une attitude et des vêtements
qui ne correspondaient pas à ses fonctions? Pierre
Quarré envisage aussi comme très vraisemblable
le fait que Chousat, justement de par ses fonctions, se soit
adressé à Claus de Werve, neveu et continuateur
de Sluter pour sculpter un saint Thibault sous ses propres
traits.
Source : Congrès archéologique
de France, 118e session,
1960, Franche-Comté, article «La Collégiale
Saint-Hippolyte de Poligny et ses statues» par Pierre
Quarré.
|
|

«Le Martyre de saint Laurent»
Tableau d'A. Richard, deuxième quart du XVIIIe siècle. |

«Le Martyre de saint Hippolyte»
Tableau du XVIIe siècle (auteur inconnu). |

Le maître-autel de l'église et les boiseries du XIXe
siècle.
Le maître-autel en marbre date du XVIIIe siècle. Il accompagnait
l'imposant retable de l'église du couvent des Jacobins.
Les stalles, à l'arrière-plan, sont du XVIIe siècle. |

Le tabernacle est orné d'un bas-relief du XVIIe siècle. |

Saint Pierre et sa clé
Statue du chœur, XIXe siècle. |

Saint Jacques le Majeur
Statue du chœur, XIXe siècle. |

Saint André et sa croix
Statue du chœur, XIXe siècle. |

Vierge à l'Enfant
Statue du chœur, XIXe siècle. |

Les boiseries du chœur (XIXe siècle) et leurs statues.

| Statue de saint Jean l'Evangéliste
dans le chœur attribuée à Claus De Werve,
XVe siècle ---»»» |
|
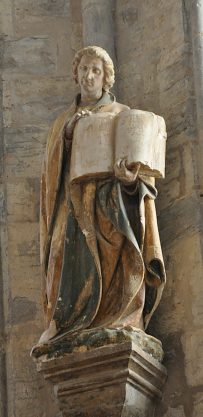 |
|
|

L'orgue de tribune est un Cavaillé-Coll de 1859
Le buffet de l'orgue provient de Carcassonne. Il date de 1687. |
| Peinture murale près de l'orgue
: Saint Christophe porte l'Enfant-Jésus. ---»»» |
|
|

Le soubassement et la tribune de l'orgue |

|

Boiseries du XVIIe siècle sur le soubassement
de l'orgue de tribune. |
|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur.
La chaire à prêcher date du XVIIIe siècle. |
Documentation : Brochure «Collégiale
Saint-Hippolyte, Poligny» disponible dans la nef
+ «Congrès archéologique de France, 118e session,
1960, Franche-Comté», article «La Collégiale
Saint-Hippolyte de Poligny et ses statues» par Pierre Quarré. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|