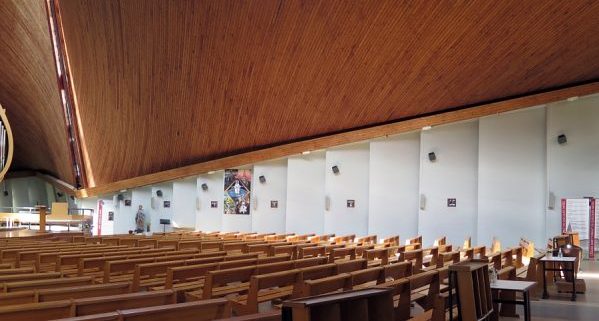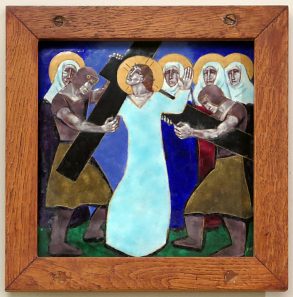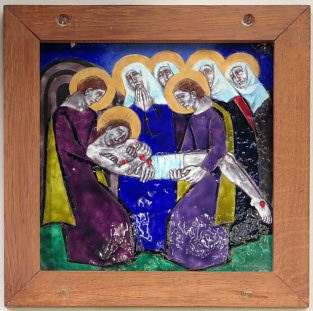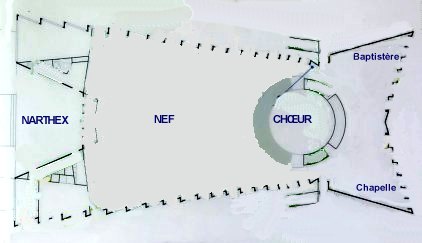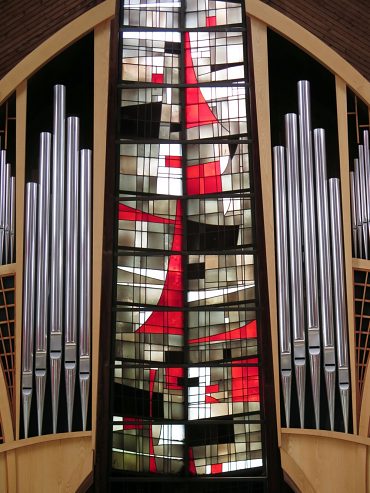|
|
 |
 |
Historiquement, la ville de Marly-le-Roi
est la fusion de deux bourgs : Marly-le-Bourg (ou Marly-le-Bas)
et Marly-le Haut. Au Moyen Âge, chaque bourg dispose de son église,
un petit édifice peu fréquenté que les siècles vont rendre rapidement
vétuste. Dans les années 1670, quand Louis XIV fait bâtir un château
à Marly, il réorganise le village : Marly-le-Bourg est détruit tandis
que la population de Marly-le-Haut s'accroît. Les deux églises sont
alors réunies en une seule : celle du Haut. Une nouvelle église
Saint-Vigor
remplacera l'ancienne, délabrée, mais en conservera la dédicace.
Vers la fin des années 1950, la population de Marly double
car des ensembles d'habitation sont construits dans le quartier
des Grandes-Terres. Saint-Vigor
ne suffit plus : il faut un second lieu de culte.
L'église Saint-Thibaut, parfois appelée Saint-Thibaut-des-Grandes-Terres,
est construite de 1962 à 1964 par le trio d'architectes Perrouin,
Lunel et Jung qui adoptent les règles issues du concile Vatican
II. Sa forme est tellement originale qu'elle a mérité la création
d'une maquette
exposée dans l'édifice.
Selon l'historien Kerstin Wittman-Englert, les deux décennies 1960-70
se singularisent par la multiplicité des créations d'églises selon
trois références principales : l'église-tente ; l'église-nef et
l'église-maison communautaire. L'idée source est de privilégier
une image simple à laquelle les paroissiens peuvent facilement s'associer.
Depuis le Moyen Âge, les architectes favorisaient au contraire
les édifices où se multipliaient signes et symboles, parfois ésotériques.
Saint-Thibaut appartient à la famille des église-tentes. La toiture
est en forme de tente d'Abraham, la tente que le patriarche
dresse dans le désert au cours de ses pérégrinations. À ce
titre, Saint-Thibaut évoque l'ecclesia peregrinans, «le Peuple
de Dieu en chemin, qui quitte son pays pour marcher vers son Dieu»,
écrivent Christine Blanchet et Pierre Vérot dans leur ouvrage Architecture
et arts sacrés de 1945 à nos jours.
Cette vogue d'églises-sculptures monumentales va disparaître à la
fin des années 1960 au profit de formes moins vastes.
L'architecture de l'édifice, orienté nord-sud, est remarquablement
pensée. De par la disposition des volets sur les côtés, toute la
lumière latérale est dirigée vers le chœur.
Assis dans la nef, les fidèles ne voient que deux murs opaques.
Cette architecture qui veut concentrer les regards vers le sanctuaire
se retrouve à l'église Notre-Dame
au Cierge à Épinal,
une église moderne consacrée en 1958, éclairée par les vitraux de
Gabriel Loire.
Saint-Thibaut, construite exclusivement grâce aux dons des paroissiens,
a reçu de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île
de France, le label Architecture Remarquable du XXème siècle.
|
 |

Vue d'ensemble de l'église Saint-Thibaut depuis l'entrée.
Les statues de la Vierge à l'Enfant (à gauche) et de
saint Joseph (à droite) se remarquent à peine. |
|
|

La façade de l'église est orientée au sud-est. |

La maquette de l'église vue du côté sud (au sens
liturgique). |
|
Saint
Thibaut de Marly (1/2).
Thibaut est issu d'une branche de la maison de Montmorency.
Né vers 1205, il est, par sa mère, arrière-petit-fils
de Louis VI le Gros.
Après un bref séjour à la cour
de Philippe Auguste, Thibaut renonce au métier
des armes promis par son statut d'aîné
et choisit l'engagement religieux. À la mort
de son père, en 1226, il refuse son droit d'aînesse,
donc son héritage et se fait moine à l'abbaye
cistercienne des Vaux de Cernay.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|

Le chevet de l'église et sa toiture
en forme de tente d'Abraham (maquette). |
|
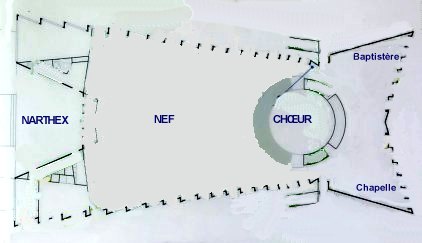
Plan de l'église Saint-Thibaut. |

La façade de l'église et son grand narthex (maquette). |
|
Saint
Thibaut de Marly (2/2).
---»» En 1230, il en devient le prieur,
puis l'abbé en 1235.
Après cinq ans de mariage, le jeune roi Louis
IX et son épouse Marguerite de Provence n'ont
toujours pas d'enfant. Le roi intercède alors
auprès de Thibaut. Celui-ci s'engage à
prier pour que la Couronne ait un héritier. Ses
prières seront exaucées.
Thibaut s'éteint en 1247. Il sera canonisé
sous la pression des fidèles dès 1270,
année de la mort de Louis IX (canonisé
lui-même en 1297).
Source : panneau dans la
nef.
|
|
|
|
|
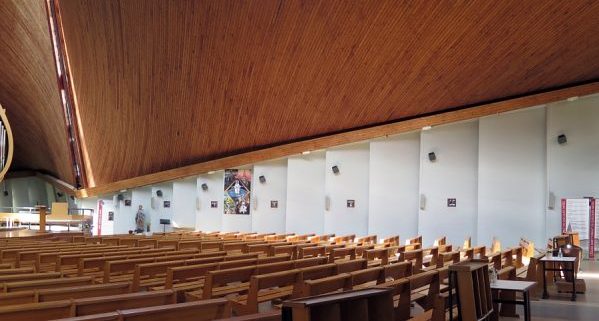
Les murs latéraux ne montrent apparemment aucune ouverture
sur l'extérieur. |
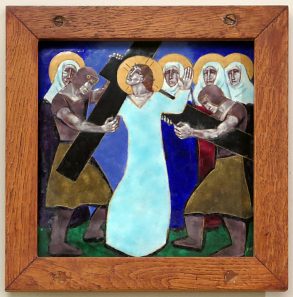
Chemin de croix, station V :
Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix.
Artiste inconnu. |
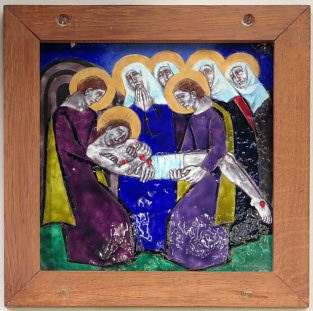
Chemin de croix, station XIV :
Jésus est mis dans le sépulcre.
Artiste inconnu. |
 |
|
Ce que le desservant voit pendant l'office.
---»»»
Les murs latéraux font entièrement place à
la lumière.
|
|

La chapelle qui accueille le baptistère est à l'arrière du chœur. |

Une salle de prière et son vitrail contemporain. |
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-THIBAUT |
|

Le chœur de l'église : l'autel disparaît devant
la masse des grandes orgues. |

Les grandes orgues sont coupées en deux
pour ne pas interrompre le vitrail-fuseau
qui s'élève vers le firmament. |
|
Le
chœur.
De toute évidence, le chœur de l'église
Saint-Thibaut a été mûrement réfléchi
par les architectes.
Le visiteur qui rentre dans l'édifice ne s'aperçoit
pas de la césure en deux moitiés des grandes orgues
qui trônent dans le chœur. Le vitrail à thème géométrique
qui s'élève vers le sommet de la voûte en forme de «tente
d'Abraham» donne l'impression de faire partie
de l'instrument.
|
|
|

Le soubassement du maître-autel est orné de l'Agneau mystique. |

L'élévation de la voûte en forme de «tente
d'Abraham»
au-dessus du chœur est impressionnante. |

Statue moderne de la Vierge à l'Enfant, détail.
Artiste inconnu. |
 |
|
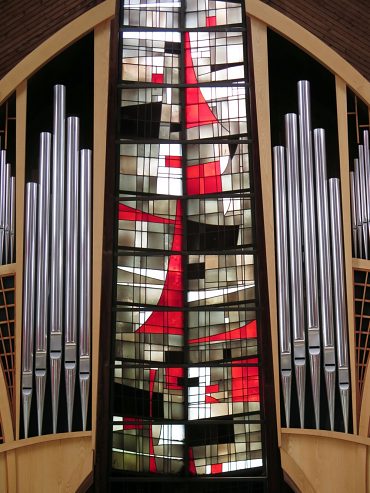
Vitrail à thème géométrique séparant
les deux moitiés des grands orgues. |

Un vitrail-fuseau chemine entre les deux pans de la voûte
avant de rejoindre le sommet de la «tente d'Abraham». |
|
«««--- Vitrail
de la façade au sud-est, détail :
le soleil se lève sur les maisons et les immeubles.
|
|
|

Vue de la nef depuis le chœur. |
Documentation : Site Internet du diocèse de Versailles
+ panneaux d'information dans la nef
+ «Église Saint-Vigor et Saint-Étienne, 1689-1989» de Lucien Reversat, éditions Champflour, 1989
+ «Architecture et arts sacrés de 1945 à nos jours» de Christine Blanchet et Pierre Vérot, Archibooks + Sauterau Éditeur, 2015. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|