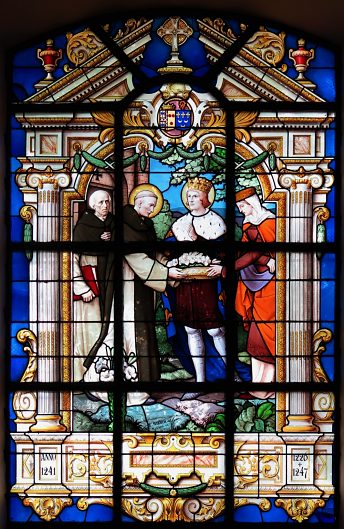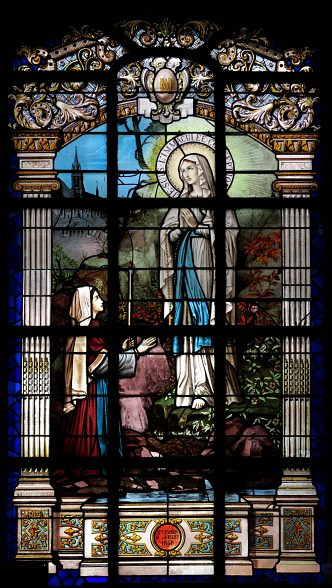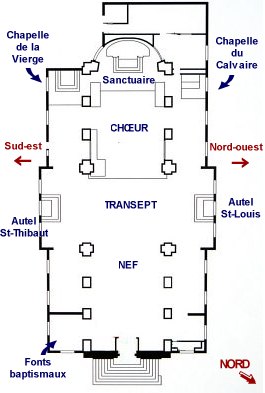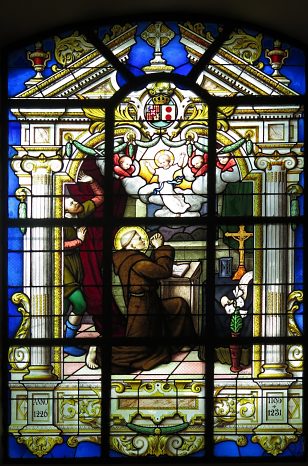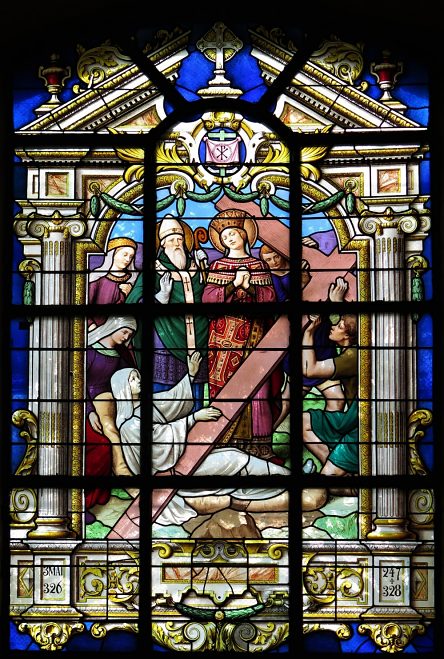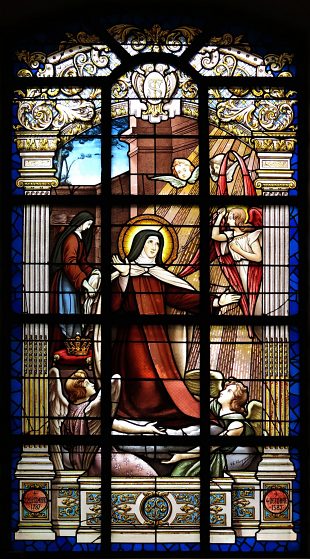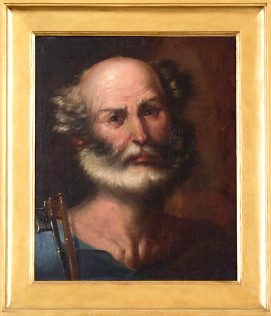|
|
 |
 |
À la fin du XVIIe siècle,
Marly-le-Roi
nait de la réunion de deux paroisses : Marly-le-Bourg (ou
Marly-le-Bas) et Marly-le-Chastel (ou Marly-le-Haut). La première
est dédicacée à saint Étienne, la seconde,
à saint Vigor. Les églises de ces deux paroisses sont
en mauvais état, voire menacent ruine.
En mars 1681, à la demande des habitants, Louis XIV, qui
fait construire un château royal à Marly, promulgue
un décret réunissant les deux paroisses. La petite
église de Marly-le-Bourg est détruite. Celle de Marly-le-Chastel
reçoit dès lors la double dédicace de saint
Vigor et de saint Étienne.
La construction du château, qui a démarré en
1679, fait venir des centaines d'ouvriers et artisans. La vieille
église de Marly-le-Chastel ne suffit plus. C'est pourquoi
Louis XIV demande à l'architecte Jules Hardouin-Mansart
de lui proposer le plan d'une nouvelle église. Devant l'urgence,
la construction, entièrement prise en charge par la Couronne,
sera menée bon train. La première pierre est posée
en avril 1688 par Louis de Ruzé, contrôleur des Bâtiments
du Roi. L'édifice est consacré un an plus tard, en
avril 1689. Pour assurer le service du culte, le roi offrira de
nombreux ornements et des objets liturgiques, dont la chaire
à prêcher, toujours en place.
Sous la Terreur, l'église est pillée. L'édifice,
d'abord fermé, devient temple de la Raison. En 1800, sous
le Consulat, il est rendu au culte catholique.
De style classique, l'église Saint-Vigor n'offre guère
d'intérêt architectural. Les voûtes sont en anse
de panier, à l'exception de celle du sanctuaire
qui est en cul de four et de celles des deux chapelles latérales
qui ont un plafond plat. La croisée du transept est surmontée
d'une vaste coupole aplatie. Une large corniche dorée sépare
le premier niveau de l'ensemble des voûtes dont l'ossature
est en bois.
L'ordonnancement intérieur applique les principes de la Contre-Réforme
: rien ne doit empêcher les fidèles de voir le déroulement
de l'office. Ainsi la nef
ne possède qu'un large vaisseau ; le transept
n'est pas saillant ; les deux chapelles latérales communiquent
avec le chœur
qui lui-même, peu développé, n'a pas de déambulatoire.
Au niveau artistique, on peut trouver dans l'église quelques
tableaux et copies intéressants. Les vitraux,
qui sont de la toute fin du XIXe siècle, illustrent des apparitions
de la Vierge et du Sacré-Cœur, ainsi que des épisodes des vies de
saint Louis et de saint Thibaut.
|
 |

La nef et le chœur
de Saint-Vigor vus depuis l'entrée. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE SAINT-VIGOR |
|

La façade de l'église Saint-Vigor est orientée
au nord-est.
L'oculus au-dessus de la porte et le clocher sur le côté
relèvent de la tradition gothique. |
|
Le
château de Verduron.
En face du côté nord-ouest de l'église
Saint-Vigor (côté sud au sens liturgique)
s'élève la grille du château de
Verduron. Cette ancienne demeure de Victorien Sardou
(qui s'y installa en 1863) présente, dans son
jardin, un spectacle peu commun : une allée de
sphinx.
Ces sculptures, réalisées par l'archéologue
Mariette, proviennent du pavillon égyptien de
l'Exposition universelle de 1867.
La somptueuse grille qui barre l'entrée de la
propriété est inspirée du domaine
de Versailles.
Elle a été réalisée en 1873
par Poupart, un artisan local.
Source : panneau d'information
devant la propriété.
|
|
|
Saint
Vigor.
C'est un saint entouré de légendes : il
brisait le pouvoir des dragons et des serpents. De date
de naissance inconnue, on sait qu'il est mort vers 536-538.
Très pieux et obéissant, élevé
au monastère du père Vaast, il fut nommé
évêque de Bayeux
par acclamation vers 511 après ses prodiges contre
les dragons. Sa vie est un combat permanent pour éradiquer
dans l'esprit du peuple l'ancienne religion gauloise.
Source : L'église
Saint-Vigor de Lucien Reversat.
|
|
|

L'église Saint-Vigor et son côté sud (au
sens liturgique)
Dessin extrait de l'ouvrage «Église Saint-Vigor et Saint-Étienne». |

L'entrée du château de Verduron et son allée
des sphinx. |
|
| LA NEF ET LE TRANSEPT
DE L'ÉGLISE SAINT-VIGOR |
|

La nef et son bas-côté nord (le nord étant pris
au sens liturgique). |
|
|
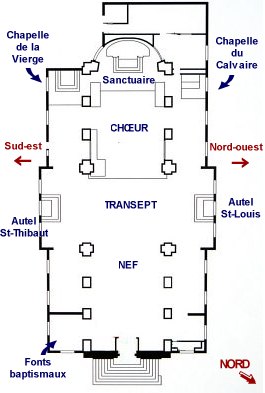
Plan de l'église Saint-Vigor. |

Confessionnal du XVIIIe siècle. |

Sur la porte du confessionnal du XVIIIe siècle est
gravée une page de l'Évangile selon saint Matthieu. |
|

«La Sainte Famille»
Copie d'une œuvre d'Andrea del Sarto. |

«Saint Thibaut (?) en prière»
Tableau anonyme.
XVIIIe siècle (?) |
|

«L'Assomption»
Tableau de M. Follier, habitant de Marly-le-Roi, 1839. |

La nef et le bas-côté sud (au sens liturgique) vus depuis
l'entrée de l'église. |
|

Chemin de croix, station III :
Jésus tombe pour la première fois.
XIXe ou XXe siècle. |

«L'Adoration des bergers»
Copie anonyme d'un tableau de 1612
du peintre hollandais Abraham Bloemart. |
|
|

Le bras sud du transept (le sud est pris au sens liturgique).
Le sud liturgique de l'église est orienté au nord-ouest
géographique. |
|
Les
sept vitraux historiés de l'église Saint-Vigor.
Les documents d'archives indiquent que le roi Louis
XV, vers 1755-1762, fit don de 700 livres à la
paroisse pour l'entretien des vitraux. On sait que ceux-ci
étaient clairs. Il s'agissait sûrement
de simple verre blanc entouré d'une frange colorée,
peut-être à fleurs de lys.
Quoi qu'il en soit, à la fin du XIXe siècle,
ces vitraux, bien dégradés, demandèrent
à être remplacés. Les paroissiens
voulaient des vitraux dans l'air du temps, c'est-à-dire
historiés. Une souscription fut ouverte. La tâche
reviendra à l'atelier parisien de Louis-Charles-Marie
Champigneulle (1853-1905) qui travaillera sur le
projet à partir de 1888.
Quatre verrières étaient prévues
pour orner les deux chapelles latérales. Trois
illustrent des apparitions : celle de la
Vierge à Bernadette Soubirous à Lourdes
en 1858 ; celle du Sacré-Cœur
à Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial
entre 1675 et 1689 ; celle de la Vierge à la
Salette en 1846. La quatrième évoque sainte
Thérèse d'Avila, carmélite.
«L'église de Marly possédait une
relique de cette sainte, offerte par le Carmel de l'avenue
de Saxe à Paris», lit-on dans l'ouvrage
de Lucien Reversat sur l'église Saint-Vigor.
Le vitrail de l'apparition de la Salette semble ne jamais
avoir été réalisé, ce qui
fait que la chapelle de la Vierge n'est ornée
que du vitrail de l'Apparition
à Bernadette. Dans celui-ci figure, avec
une grande précision, la première basilique
construite à Lourdes en 1876 sur instruction
du pape Pie X.
Le vitrail de sainte
Thérèse d'Avila possède aussi
un détail intéressant. On y voit, à
l'arrière-plan, Louise de France, fille de Louis
XV, entrée au Carmel de Saint-Denis
«afin de faire pénitence pour les péchés
de la Cour et de la France». Devant elle, une
couronne royale est posée sur un coussin, alors
qu'elle lave humblement la vaisselle du couvent.
Les quatre vitraux historiés du transept
sont très légèrement postérieurs
aux précédents. Datés des années
1902-1903, ce sont des créations de l'atelier
d'Henry Carot sur des cartons d'Émile
Hirsch.
De part et d'autre de l'autel Saint-Thibaut se trouvent
le vitrail de saint Antoine
de Padoue en extase et celui de saint
Louis rendant visite à saint Thibaut. En
face, l'autel Saint-Louis est accompagné, de
part et d'autre, d'une illustration de saint Louis portant
la couronne d'épines en procession (ci-dessous
à droite) et de l'Invention
de la Vraie Croix par sainte Hélène,
mère de l'empereur Constantin.
Ces sept scènes historiées sont insérées
chacune dans un cadre architectural très travaillé.
|
|
|

«Saint Louis avec saint Roch intercédant pour la guérison
d'un malade»
Tableau anonyme dans le retable du bras sud du transept.
Autel Saint-Thibaut. |

Vitrail de l'Invention de la Vraie Croix, détail. |
|
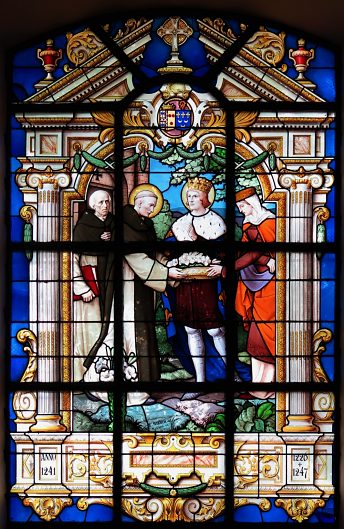
«La Rencontre de saint Louis et de saint Thibaut en 1241»
Atelier Henri Carot, carton d'Émile Hirsch.
Années 1902-1903. |

Sainte Geneviève ou sainte Germaine.
Oculus du transept. |

«Saint Thibaut offrant à saint Louis et à
Marguerite de Provence un lys à onze branches»
Joseph-Marie Vien (1716-1809)
Versailles, Chapelle du Petit Trianon.
Cliquez sur le tableau. |
|

«Saint Louis portant la couronne d'épines en procession»
Atelier Henri Carot, carton d'Émile Hirsch.
Années 1902-1903.

|
«Saint
Louis portant la couronne d'épines».
Le roi saint Louis, suivi de plusieurs prélats, porte
en procession la couronne d'épines que lui ont remise
les moines dominicains de Sens.
Lucien Reversat, dans son ouvrage sur Saint-Vigor, précise
que l'église de Marly a possédé une parcelle
de cette relique. Elle était insérée
dans la grande croix reliquaire de la Passion.
Au bas du vitrail sont portées la date de 1248 (réception
de la sainte couronne) et les dates de la naissance et de
la mort de saint Louis (1215-1270).
|
|
|
«La
Rencontre de saint Louis et de saint Thibaut».
Au XIIIe siècle, Thibaut de Marly est l'abbé
de l'abbaye bénédictine de Vaux-de-Cernay, entre
Versailles
et Rambouillet.
En 1241, le roi saint Louis et son épouse Marguerite
de Provence n'ayant toujours pas d'enfants, se rendent à
Vaux pour rencontrer Thibaut dont la réputation de
sainteté est déjà bien établie.
Ils lui demandent d'intercéder pour eux auprès
du Très-Haut pour que leur couple ait une descendance.
Thibaut se recueille, puis offre à ses visiteurs une
corbeille de dix fleurs de lys, annonçant les dix enfants
qu'ils auront plus tard. Dans le tableau du peintre Joseph-Marie
Vien (ci-dessus), Thibaut offre un lys à onze branches.
Précisons que le couple royal a bien eu onze enfants.
Le cinquième (et troisième fils), Jean, mourut
très rapidement après sa naissance. Il n'est
souvent pas compté.
|
|

Retable dans le bras nord du transept.
Autel Saint-Thibaut.

|
Les retables
du transept.
Selon la base Palissy, les deux retables qui s'élèvent
à l'extrémité des bras du transept datent
probablement de la construction de l'église, c'est-à-dire
vers la fin des années 1680.
|
|
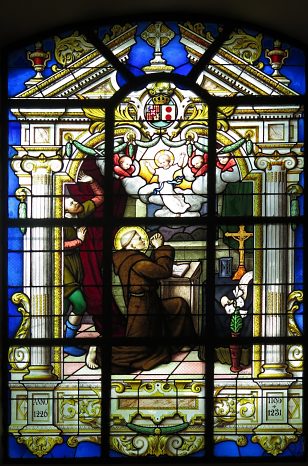
«Saint Antoine de Padoue en extase»
Atelier Henri Carot, carton d'Émile Hirsch.
Années 1902-1903. |
|
«Saint
Antoine de Padoue en extase».
Saint Antoine parcourt l'Auvergne et le Limousin pour
prêcher. En 1226, il s'arrête chez le seigneur
de Châteauneuf-la-Forêt. Celui-ci, intrigué
par la lumière qui sort de la chambre du moine,
entrouvre la porte et voit saint Antoine en extase.
Ce dernier s'apprête à prendre dans ses
bras l'Enfant Jésus qui descend du Ciel.
|
|
|

«Saint Thibaut de Marly avec l'évêque de Paris»
Tableau anonyme dans le retable du bras nord du transept. |
|
«Saint
Thibaut avec l'évêque de Paris».
Ce tableau montre Thibaut de Marly venant solliciter
l'évêque de Paris, Guillaume III d'Auvergne. Thibaut
a besoin de son aide pour obtenir l'autorisation d'agrandir
l'abbaye de Vaux-de-Cernay.
L'évêque ne semble pas d'accord et désigne
le plan de l'abbaye, qu'il juge déjà assez
étendue. Thibaut se récrie et, levant
la main, invoque peut-être l'état de vétusté
de l'édifice.
|
|
|
|
|
|

La Vierge à l'Enfant.
Statue de Robert le Lorrain (1666-1743).
Chapelle de la Vierge. |
|
Apparition de Notre-Dame à
sainte Bernadette. ---»»»
Vitrail de l'atelier de Charles Champigneulle, Paris.
Années 1890.
Chapelle de la Vierge.
|
|
|
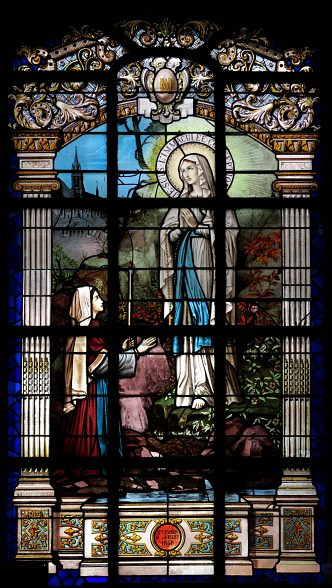
|

La basilique de Lourdes bâtie en 1876 par le pape Pie X.
Détail du vitrail ci-contre. |
|
«Apparition
de la Vierge à Bernadette».
Ce vitrail, très classique dans sa composition,
a le mérite de montrer, à l'arrière-plan
et de manière très précise, la
basilique de Lourdes, telle qu'elle a été
construite en 1876 sous le pontificat du pape Pie X.
|
|
|
|
|
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-VIGOR |
|

Le chœur de l'église Saint-Vigor.
Le sanctuaire (où se trouve le maître-autel) est fermé
par un garde-corps.
Sur la gauche, la chapelle
de la Vierge. |

L'ange adorateur à gauche du retable du chœur, détail.
Bois sculpté de Noël Jouvenet (vers 1681) et peint. |
 |
|

«La Prédication de saint Vigor», 1862.
Tableau de Friedrich Bouterwek (1806-1867)
dans le retable du chœur.
|
«««--- La Colombe
du Saint-Esprit à la voûte du sanctuaire.
|
|

L'ange adorateur à droite du retable du chœur, détail.
Bois sculpté de Noël Jouvenet (vers 1681) et peint. |
|
Les
anges du sanctuaire.
Le maître-autel de Saint-Vigor, tout comme les
anges qui l'entourent proviennent de l'avant dernière
chapelle du château de Versailles. Lorsque la chapelle
royale du château fut achevée, Louis
XIV fit transférer autel et anges à Marly. Ce
qui place ce transfert après 1710.
Les deux rondes-bosses, réalisées en bois
doré, seraient l'œuvre du sculpteur Noël
Jouvenet et dateraient de 1681-1682 environ.
Elles ont été peintes en gris clair en
1875 à la demande du curé de Marly.
Sources : base Palissy
et documentation dans l'église.
|
|
|
|
|

Détail du garde-corps de la chapelle
du Calvaire. |
|
Le
sanctuaire.
Le maître-autel, avec ses anges, ses colonnes
composites et son fronton, provient de la chapelle du
château de Versailles
avant la création de la chapelle
royale. Il a pris la place d'un autel primitif.
La voûte du sanctuaire de l'église Saint-Vigor
étant basse, il a fallu, lors de l'installation
de ce nouveau maître-autel, supprimer la croix
et les angelots qui surmontaient son fronton.
Initialement, le maître-autel était orné
d'une copie, réalisée par le peintre Stiemart,
de La Nativité de Jésus-Christ
d'après le Corrège. On y voit actuellement
une œuvre du peintre allemand Friedrich Bouterwek
(1806-1867) : La Prédication de saint Vigor,
datée de 1862.
Pour la petite histoire, indiquons que, lors de la restauration
des années 2010, on a découvert que les
fleurs de lys qui ornaient jadis le retable avaient
été consciencieusement arasées,
sans doute sous le Révolution. Une seule, située
au niveau de la plinthe, a échappé au
vandalisme.
Source : Documentation
affichée dans l'église.
|
|

Détail de la clôture du chœur fermant le sanctuaire. |
|
La
clôture de chœur.
Cette clôture en fonte moulée et peinte
regorge d'objets liturgiques et d'ornement végétal.
On en donne ci-dessus un panneau avec la tiare d'un
évêque qui surmonte l'Agneau mystique placé
au centre d'une couronne. Dans les branches qui partent
de la couronne se trouvent des croix, des crosses, des
phylactères, des pampres, etc.
Cette clôture est datée de la seconde moitié
du XXe siècle.
Source : base Palissy.
|
|
|

La nef et le chœur
vus depuis le sanctuaire. |
Documentation : «L'église
royale de Marly» de Jacques Vidal, imprimerie de Marky-le-Roi, imprimeur-éditeur,
1972
+ «Église Saint-Vigor & Saint-Étienne 1689-1989» de Lucien Reversat,
Éditions Champflour, Marly-le-Roi, 1989
+ panneaux d'information dans l'église
+ base Palissy. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|