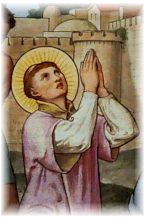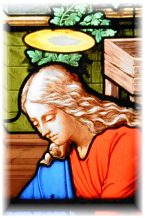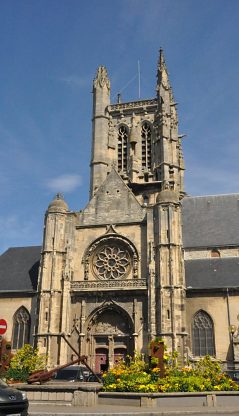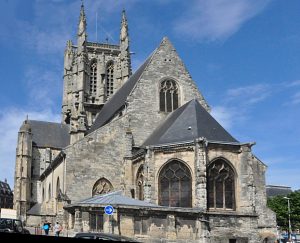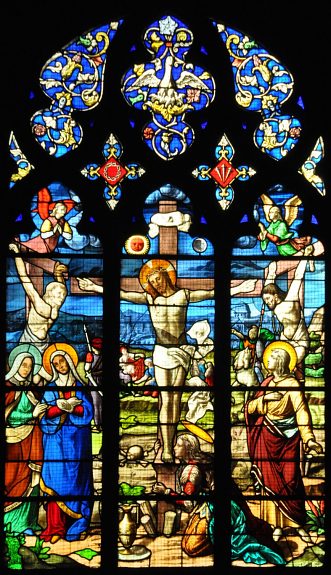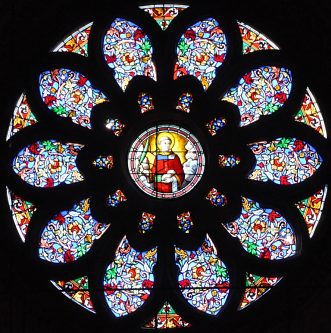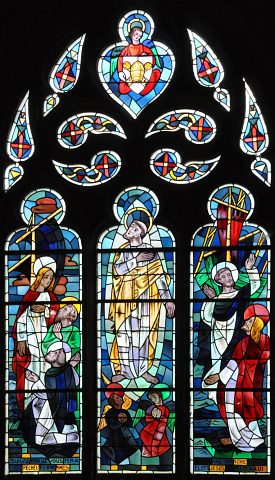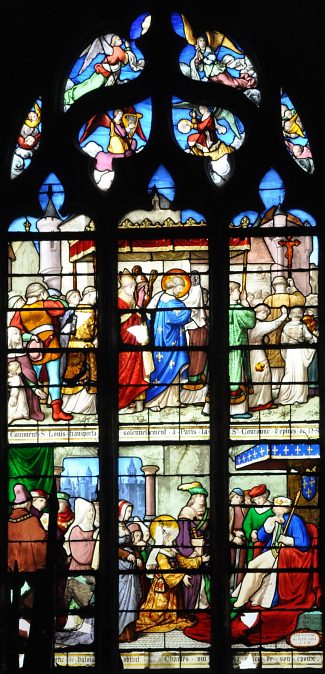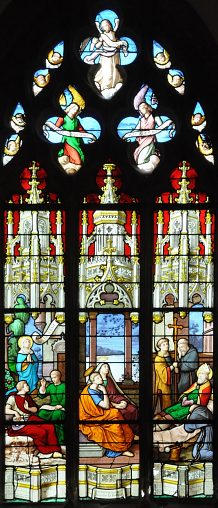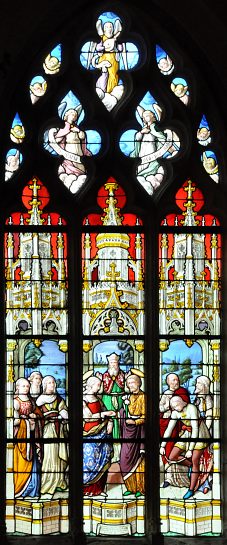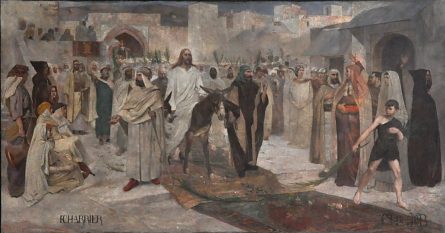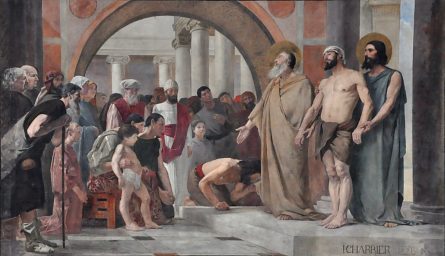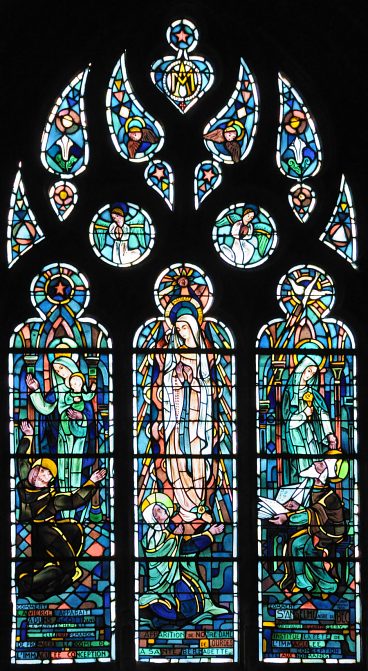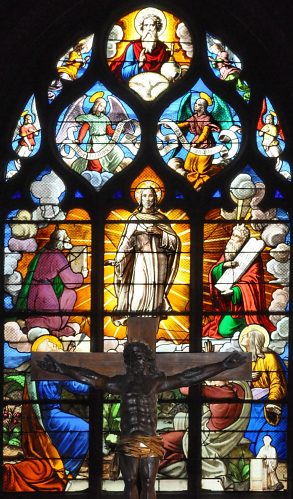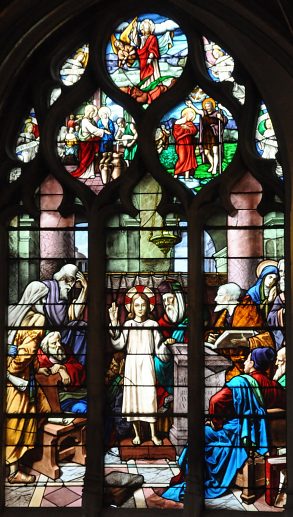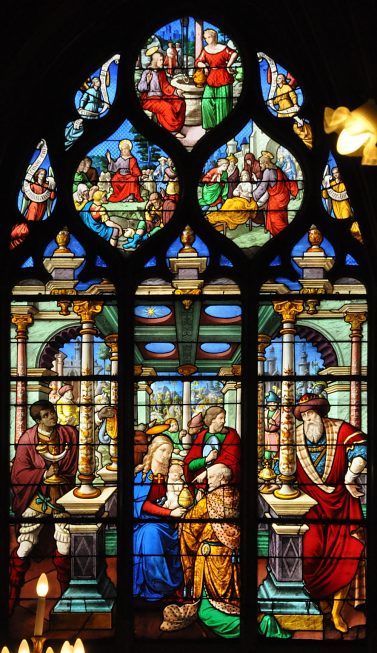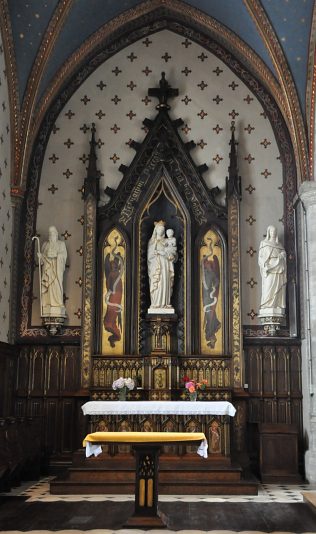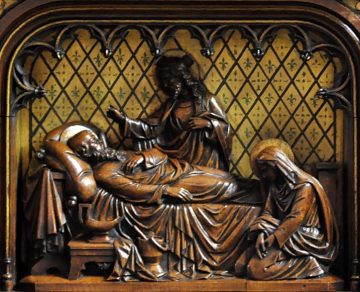|
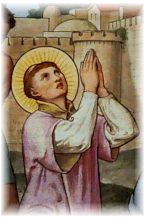 |
L'église Saint-Étienne
de Fécamp remonte au début du XVIe siècle.
Elle a été érigée à l'emplacement
d'une église romane, devenue trop petite, pour être
le monument privilégié des marins de la ville - le
site dominait le port. Quant à l'imposante abbatiale
de la Trinité, elle restait le domaine des moines. Saint-Étienne
n'a pas été achevée : seuls furent construits
le transept et le chœur, ainsi que la belle abside aux cinq
fenêtres flamboyantes.
À la fin du XIXe siècle, les armateurs et les marins
fécampois souhaitent agrandir l'édifice. L'architecte
Camille Albert est chargé d'élargir les bas-côtés
et de construire un clocher néo-gothique flamboyant (qui
n'est d'ailleurs toujours pas terminé puisque ses niches
sont vides de statues). De la sorte, le grand chœur Renaissance
initial est devenu la nef et le transept a pris la place de l'avant-nef.
Le portail sud date de la Renaissance, le portail ouest, du milieu
du XIXe siècle.
Armateurs et marins mirent également la main à la
poche pour embellir l'église : on peut y voir une série
de toiles marouflées au-dessus des arcades de la nef, des
retables en bois sculpté dans les chapelles, tandis que l'abside
et les bas-côtés resplendissent de nombreux vitraux.
La plus grande partie d'entre eux a été créée
par des peintres verriers rouennais (J. Boulanger à la fin
du XIXe siècle et Ch. Simon au début du XXe). L'atelier
Lorin à Chartres a, quant à lui, posé deux
vitraux d'un aspect moderne au cours du XXe siècle.
Les éléments d'architecture qui nous viennent de la
Renaissance et la très belle décoration XIXe siècle
font de l'église Saint-Étienne un édifice religieux
plus qu'intéressant et qui ne doit pas être éclipsé
par l'abbatiale
de la Trinité.
|
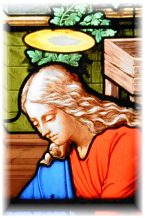 |

La nef et le bas-côté nord de l'église Saint-Étienne
Dès l'entrée, l'œil est attiré par les quatre
imposantes piles Renaissance qui soutiennent le clocher. |

Vue d'ensemble de l'église
La partie occidentale que l'on voit ici devait être, à
l'origine,
prolongée par une nef qui n'a jamais été
construite. |
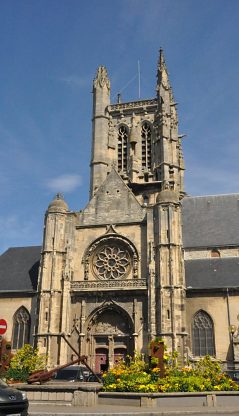
Le portail sud date de l'époque Renaissance
Le clocher flamboyant a été construit au XIXe
siècle. |

Le tympan du portail Renaissance représente la
Lapidation de saint Étienne
Il a été fortement détérioré
par l'usure du temps. |

Le portail Renaissance |
|
|
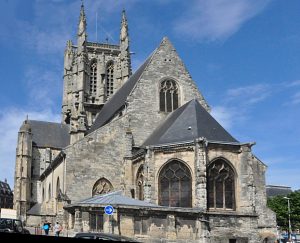
Le chevet Renaissance date du XVIe siècle |

Le clocher en néo-gothique flamboyant
a été construit à la fin du XIXe siècle. |
|

Vue générale de l'église
En l'absence de soleil, Saint-Étienne de Fécamp
est une église assez sombre. |

Statue de saint Étienne
XVIIe siècle. |
 |
|

Le transept et ses voûtes datent de la Renaissance |

Saint Expédit dans
le transept ressemble étrangement
à l'empereur Auguste.
Mais le saint brandit une croix
dans la main droite.
|

Chapelle latérale sud des Trépassés dans le transept. |
«««---
Vitrail des âmes du purgatoire dans la chapelle des Trépassés
(J. Boulanger, Rouen, 1891)
La Vierge implore de son Fils l'indulgence pour les âmes
qui brûlent au purgatoire. |
|
|

Le transept Renaissance et la chaire à prêcher du XVIIIe siècle |

La cuve de la chaire à prêcher (XVIIIe siècle) |
|
Saint
Étienne, à qui est dédié
en France un certain nombre de cathédrales, est
présenté comme un proto-martyr.
C'est même le premier d'entre eux. Tout part d'un
désaccord sur l'emploi du temps des apôtres,
nous dit la Légende dorée de Jacques
de Voragine. Après la Résurrection, ceux-ci
veulent se consacrer entièrement à la
prédication, sans s'occuper des soins matériels
du culte. Ils réunissent leurs fidèles
et leur demandent de choisir sept hommes de bonne réputation
qui prendront cet emploi en charge. Le premier choisi
fut Étienne, désigné depuis comme
archidiacre. Courroucés par les miracles qu'il
réalisait et par son aplomb dans les discussions,
les «Juifs» le lapidèrent pour blasphème
: Étienne avait dit qu'il voyait les Cieux ouverts
et Jésus assis à la droite de Dieu. À
cette lapidation - qui eut lieu, selon Jacques de Voragine,
le jour même de l'Ascension - assista le futur
apôtre Paul, alors adolescent, chargé de
garder les vêtements des bourreaux.
|
|
|

Détail du vitrail «Les âmes du purgatoire»
J. Boulanger, Rouen, 1891 |

Statue de saint Roch
XVIIe siècle |

Statue de saint Pierre
XVIIIe siècle |
|

La voûte du transept avec les chapelles latérales
Début du XVIe siècle |

«L'Annonciation», peinture anonyme |
|
|

Statue équestre de saint Martin partageant son manteau
XVIIe siècle |

Clé pendante Renaissance dans le transept |
|
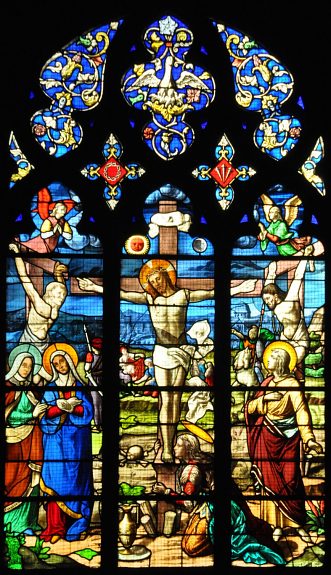
Vitrail «La Crucifixion» de J. Boulanger, fin du
XIXe siècle |
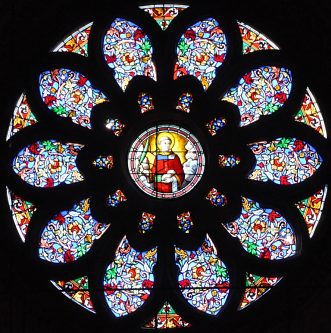 |
|

Statue de saint Martin au-dessus de l'entrée sud de l'église |

Saint Jean l'Évangéliste
dans les peintures murales de la nef |
«««---
À GAUCHE
Rosace de la fin du XIXe siècle dans le transept
avec saint Étienne au centre |
|
|

Saint Nicolas
Vitrail de la fin du XIXe siècle |

La nef vue depuis le bas-côté nord avec la chapelle de la Vierge sur
la gauche
Sans présence de soleil, il est difficile d'apprécier
la belle ceinture de peintures marouflées au-dessus des arcades
de la nef. |

Saint Étienne, pape et martyr
Vitrail de la fin du XIXe siècle |
|
|

La chapelle du Sacré-Cœur dans le transept
Son aménagement et ses boiseries sculptées datent
de la fin du XIXe siècle |
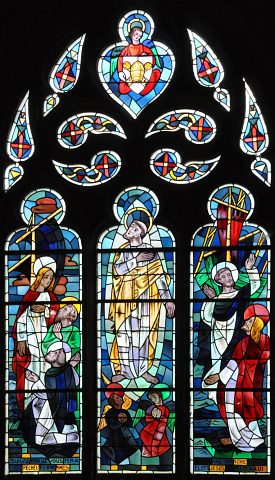
Vitrail des scènes de la vie de saint Pierre
Atelier Lorin, Chartres , XXe siècle |

Chapelle Saint-Pierre dans le bas-côté nord |

Les boiseries de la chapelle du Sacré-Cœur, XIXe siècle |
|
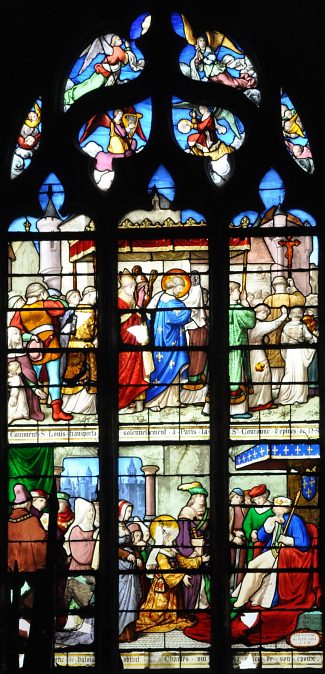
«Saint Louis transporte à Paris la sainte Couronne
d'épines»
«Catherine de Valois obtient du roi Charles la grâce
de son époux»
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1882 |

Vue des chapelles latérales nord
avec la statue de saint Étienne au premier plan |

«Saint Louis transporte à Paris la sainte Couronne
d'épines», détail
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1882 |
|
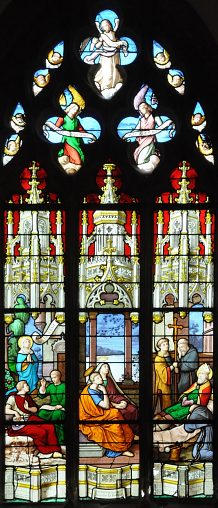
Scènes de la vie de saint Augustin
Augustin devisant, Augustin et sa mère Monique à
Patras, la mort de saint Augustin
Vitrail de J. Boulanger, fin du XIXe siècle |

«Jésus apaise la tempête»
Vitrail de J. Boulanger, fin XIXe siècle |
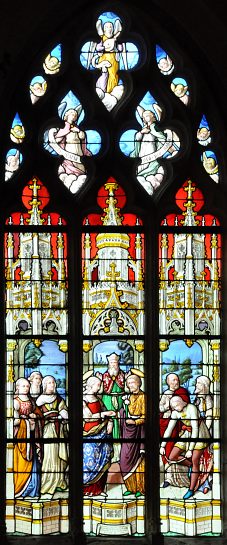
«Le Mariage de la Vierge»
Vitrail de J. Boulanger, fin XIXe siècle |
|

Chapelle Notre-Dame de Lourdes (bas-côté nord)
|

Un ange portant un phylactère
Retable de la chapelle Saint-Joseph |
| LA NEF ET LES PEINTURES MURALES DU XIXe
SIÈCLE (TOILES MAROUFLÉES) |
|

«Le pape Léon Ier le Grand arrête Attila» par Charrier
(1890) |

«La Conversion de saint Paul» par F. Bassot (1886) |

«La Lapidation de saint Étienne» (signature illisible) |
|
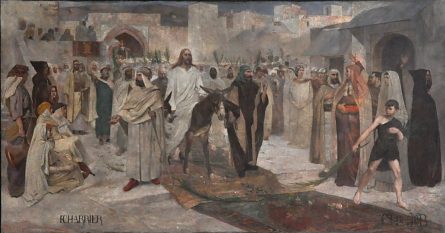
Toile marouflée de la nef : «L'entrée du Christ
à Jérusalem» par Charrier |
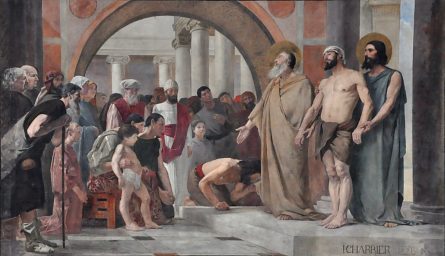
Toile marouflée de la nef : Scène avec deux apôtres
(thème non reconnu) par Charrier |
|
Le
vitrail de l'Immaculée Conception
de l'atelier Lorin à Chartres est composé
de trois lancettes à la gloire de Marie. Celui
de gauche représente Jean Duns Scot (1270-1308).
Ce moine écossais a été l'un des
premiers à défendre la conception immaculée
de Marie. Dans celui du milieu, la Vierge apparaît
à Bernadette Soubirous en 1858. Celui de droite
montre l'apparition de Marie à saint Anselme,
abbé du Bec et archevêque de Cantorbery
: elle lui demande de promouvoir le culte de l'Immaculée
Conception.
Source : panneau dans la
nef.
|
|
|
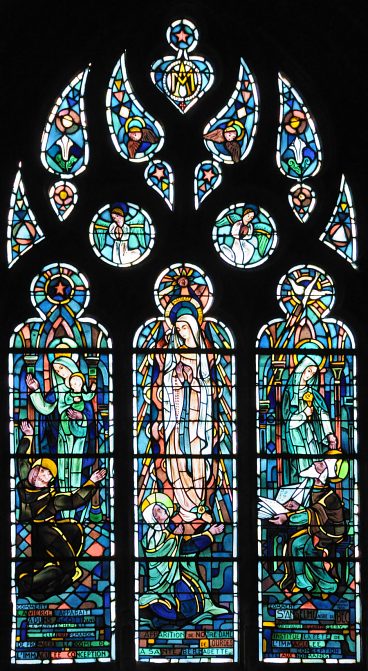
Vitrail de l'Immaculée Conception
Atelier Lorin, Chartres, XXe siècle |
|

Toile marouflée de la nef : Le pape Léon Ier en gros plan
Statue de sainte Marguerite, XVIe siècle ---»»» |

|

Vitrail : Jésus apaise la tempête (Boulanger, fin du XIXe siècle)
Partie centrale en gros plan |

Saint Charles Borromée distribue la Communion aux pestiférés
de Milan (vitrail de J. Boulanger), fin du XIXe siècle |

L'Évangéliste saint Matthieu
au-dessus d'un pilier de la nef
Peinture de la fin du XIXe siècle |
| LE CŒUR XIXe SIÈCLE DE L'ÉGLISE
SAINT-ÉTIENNE |
|

Le chœur de l'église et son bel aménagement de
la fin du XIXe siècle :
Peintures murales, vitraux de J. Boulanger, voûte étoilée
avec clés pendantes dorées, autel en marbre et Christ
en croix. |
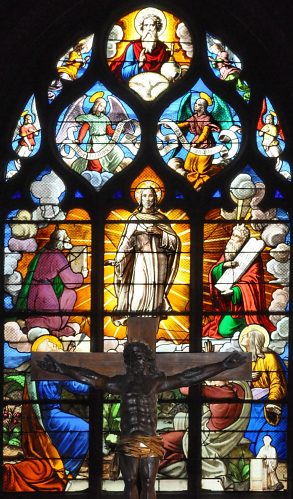
«La Transfiguration» dans le chœur
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884
Au premier plan, le Christ en croix est du XIXe siècle. |

Les peintures murales dans le chœur, XIXe siècle
Saint Jean-Baptiste et saint Jacques Apôtre |
| |
|

Le chœur avec son orgue
et son aménagement XIXe siècle |

«L'Annonciation» dans le chœur
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884 |
|

La voûte étoilée du chœur
Une décoration typique du XIXe siècle |

«L'Adoration des anges» dans le chœur
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884 |
|

L'orgue de chœur (XIXe siècle) |

La translation du corps de saint Étienne
Peinture dans le soubassement du maître-autel (XIXe siècle) |
|
|

Le maître-autel en marbre, XIXe siècle |
|
La
décoration des églises au XIXe siècle.
Après le Concordat, il faut remeubler les églises
françaises, fort mises à mal pendant la
Révolution. On récupère ce qu'on
peut trouver et surtout l'on crée : autels, retables,
confessionnaux, statues, copies de tableaux ou tableaux
originaux, fresques, chaires à prêcher,
bancs d'église, sans oublier le service du culte
(calices, ostensoirs, burettes, etc.). C'est un véritable
pan de l'artisanat français qui est mis à
contribution au cours du XIXe siècle, alors que
la foi revit après la tourmente révolutionnaire.
Cet artisanat est bien vite secondé par les processus
industriels quand les techniques sont au point. L'heure
est aux styles néo-gothique et néo-roman.
Les «gourous», comme les architectes Lassus
et Viollet-le-Duc, inspirent des publications spécialisées
d'art chrétien pour donner des modèles
à tous les curés dans toutes les paroisses
de France. Dessins et croquis d'autels, de stalles,
de ciboires, de vêtements sacerdotaux même,
accompagnent conseils et recommandations. En matière
de peinture, on sollicite le talent des meilleurs artistes
du temps comme Ingres et Delacroix ainsi que les lauréats
du Grand Prix de Rome.
N.J. Chaline, dans l'un des articles cités en
source, explique, pour ce qui est des tableaux, que
les œuvres sont données par des particuliers,
mais surtout par l'État, qui est le grand donateur
de l'époque. Maires, curés et évêques
pressent le Pouvoir pour obtenir une copie d'un tableau
de maître ou un original acheté dans les
salons et les expositions par le Bureau des Travaux
d'Art (rattaché au ministère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts). Ainsi en 1841, Ludovic
Vitet, alors député de la Seine-Inférieure
(et futur président de la Commission des Monuments
historiques), s'adresse au ministre de l'Intérieur
en faveur de l'église Saint-Étienne de
Fécamp. Les paroissiens souhaitent avoir une
copie du tableau de Lebrun représentant le martyre
de saint Étienne. Le ministre répond positivement
et ajoute que la copie «sera exécutée
aux frais du ministère». L'année
suivante, le tableau est envoyé à Fécamp.
Cependant il n'y a nulle copie du tableau de Charles
Lebrun visible dans l'église Saint-Étienne...
Source : «Ces
églises du dix-neuvième siècle»,
éditions Encrage, 1993. Articles «Décor
et mobilier» et «Marbre, or et plâtre...»
par N.J. Chaline.
|
|

Les peintures murales de saints et de saintes dans le chœur,
XIXe siècle. |
|

L'ensemble du chœur (XIXe siècle)
avec la toile marouflée de la Lapidation de saint Étienne
et le vitrail de la Crucifixion de J. Boulanger |
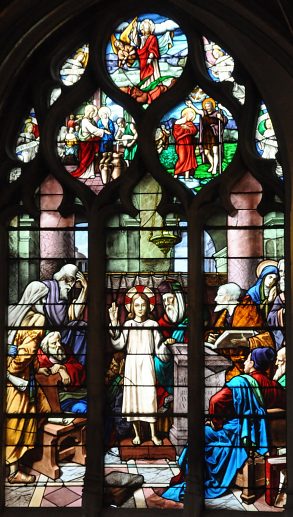
«Jésus parmi les docteurs de la Loi» dans le chœur
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884. |

«Jésus parmi les docteurs de la Loi», détail. |
|
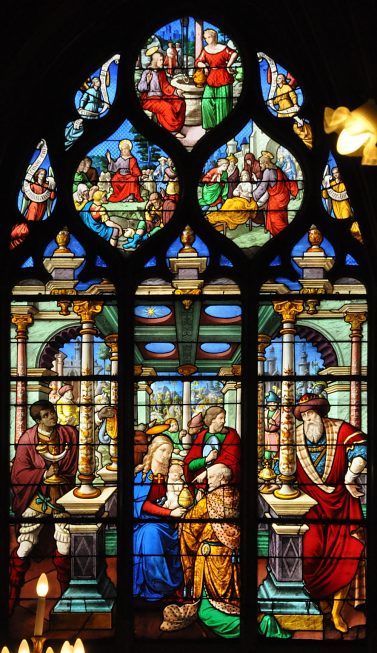
«L'Adoration des Mages» dans le chœur
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884 |

Vue générale du chœur depuis le milieu de l'allée
centrale |
|

«La lapidation de saint Étienne», peinture
dans le soubassement du maître-autel, XIXe siècle |

«L'Adoration des anges» dans le chœur, partie
basse en gros plan
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, 1884
La beauté de ce vitrail-tableau est remarquable. Ceux
qui apprécient cet art pourront
se reporter avec intérêt aux vitraux XIXe siècle
de l'église Saint-Joseph
à Angers. |
|
| LES CHAPELLES ABSIDIALES DE LA VIERGE ET DE SAINT-JOSEPH |
|

Le chœur et la chapelle de la Vierge |
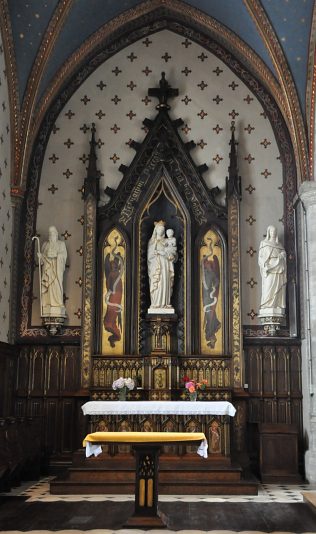
Chapelle absidiale nord de la Vierge
et son aménagement de la fin du XIXe siècle |

Statue de la Vierge à l'Enfant (partiel), XIXe siècle
Chapelle de la Vierge |
 |
|
«Le Mariage de la Vierge», partie
basse ---»»»
Vitrail de J. Boulanger, Rouen |
|
|

«La Vierge donne le Rosaire à saint Dominique»,
partie basse
Vitrail de J. Boulanger, Rouen, fin XIXe siècle |

«Le Christ à la colonne» (XVIIIe siècle)
Tableau de Pierre-Charles Le Mettay, né à Fécamp
en 1726 |

«La Sainte Famille» (partiel)
Vitrail de J. Boulanger, Rouen |
|

|

Le bas-côté nord et ses stations du Chemin de croix |
«««---
À GAUCHE
«Saint Pierre, pêcheur d'hommes»
Vitrail de Ch. Simon, Rouen, 1908 |
|

|

|
À gauche et ci-dessus
en gros plan
«Sainte Élisabeth de Hongrie distribue de la nourriture
aux pauvres»
Vitrail de Ch. Simon, Rouen, 1908 |
|

Les anges avec leurs phylactères dans le soubassement
de l'autel
Chapelle absidiale de la Vierge |

Le bas-côté sud et la chapelle Saint-Joseph |

Statue de saint Fiacre
dans la chapelle Saint-Joseph |

Un ange et son phylactère
Chapelle absidiale Saint-Joseph |
|

Chapelle absidiale Saint-Joseph
dans le bas-côté sud
Comme le reste des aménagements de l'église,
le retable est du XIXe siècle, notamment le beau bas-relief
en bois de la mort de Joseph dans le soubassement. |

Un ange en prière
Chapelle Saint-Joseph |
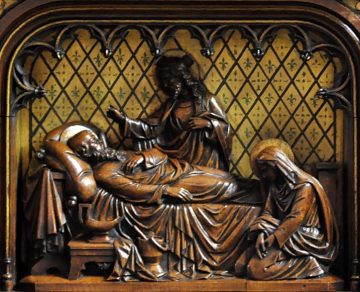
La Mort de saint Joseph (chapelle Saint-Joseph)
Bas-relief en bois verni dans le soubassement du retable, XIXe
siècle |

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur |
|

L'orgue de tribune est presque caché contre la façade
occidentale.
À cet endroit, au XVIe siècle, il était prévu
de prolonger l'église
vers l'ouest et de construire une nef. |
Documentation «Visite des églises
de Fécamp», brochure disponible à l'abbatiale
de la Sainte-Trinité
+ «Ces églises du dix-neuvième siècle»,
éditions Encrage, 1993, ISBN 2-906389-42-0 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |