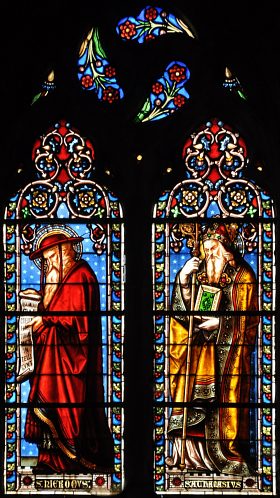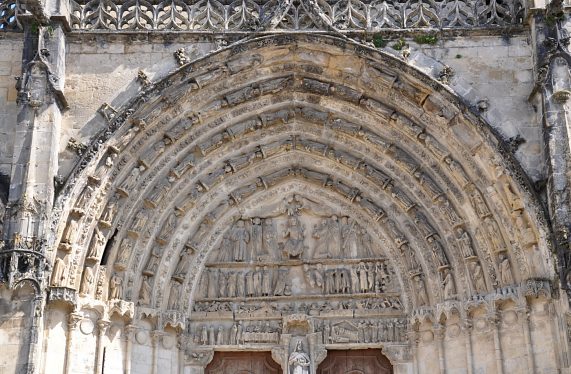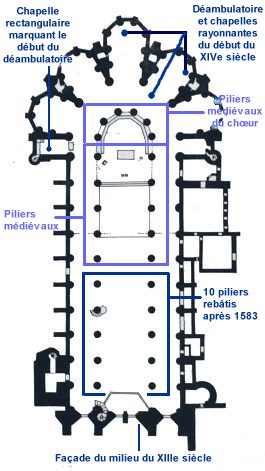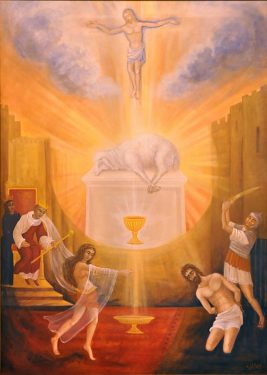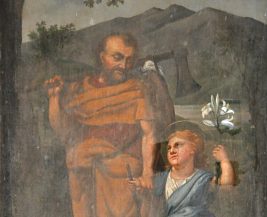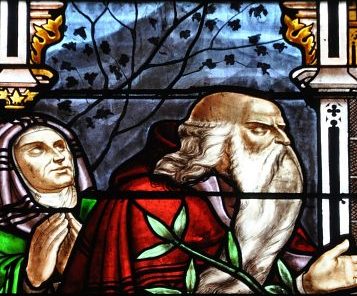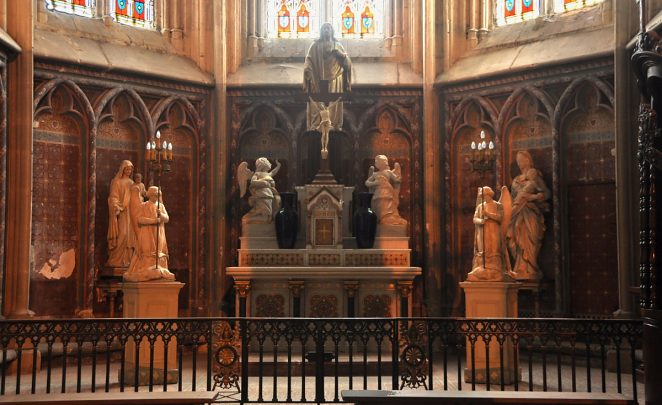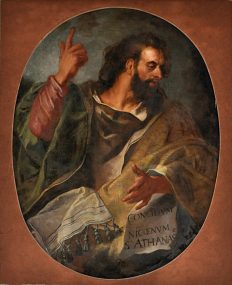|
|
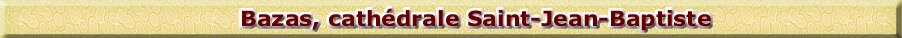 |
 |
Bazas est une très ancienne ville
de Gironde. Souvent balayé par les envahisseurs (Vascones,
Normands) ou les conquérants (Pépin le Bref, puis
Charlemagne), le Bazadais, selon les chroniques, aurait eu un épiscopat
depuis le Ve siècle. Cependant on ne trouve la trace d'une
cathédrale que pour apprendre qu'un premier édifice
a été détruit par les Normands ; puis que,
à partir de 1070, il aurait été reconstruit
sous l'impulsion de l'évêque Raymond II et consacré
par le pape Urbain II. C'est pourquoi l'usage fait remonter la base
du clocher, de style roman, au XIe siècle. Quoi qu'il en
soit, le Chronicon Vazatense révèle que la
pose de la première pierre de la cathédrale gothique
actuelle eut lieu en 1233. Les trois portails occidentaux ne sont
pas postérieurs au milieu du XIIIe siècle. Il est
vraisemblable qu'ensuite la construction a progressé de l'ouest
vers l'est, en conservant une partie de l'assise romane, et s'achevant
par le nouveau chœur
qui ne vint remplacer l'ancien qu'au XIVe siècle. Selon l'historien
Jacques Gardelles, la cathédrale du XIe siècle devait
déjà être un grand édifice. Son imposante
largeur montre qu'on lui destinait une charpente et non pas une
voûte.
Les travaux du nouvel édifice gothique avancèrent
lentement à cause du manque de fonds. Deux fois, en 1308
et 1312, le pape Clément V, originaire de Bazas, dut intervenir.
D'abord par des indulgences pour inciter les dons ; ensuite, en
attribuant une part des revenus du diocèse à la construction.
Les parties hautes de la nef, telles qu'on les voit aujourd'hui,
étaient-elles bâties à cette époque?
Voir l'encadré
qui traite de cet intéressant sujet, développé
par Jacques Gardelles. Toujours est-il que le chevet (piliers du
chœur, déambulatoire et chapelles rayonnantes) était
complètement achevé au XIVe siècle. Le revers
de la façade ne sera terminé qu'en 1537.
En 1561, les huguenots opèrent une trouée dans l'enceinte
murale («la Brèche») et pénètrent
dans Bazas. Ils cassent les statues des portails, les autels et
les orgues. Les archives sont brûlées, les ornements
et les vases sacrés, volés. En 1577, ils se rendent
maîtres de la ville et entreprennent une destruction en règle
de l'édifice. Seule une rançon de dix mille écus
épargnera la sculpture des portails. En dehors de la façade,
ne subsistent que les murs latéraux, une partie des piliers
de la nef et tout le système du chevet. En 1583, l'évêque
Arnaud de Pontac lance la reconstruction, en grande partie
sur sa fortune personnelle. Un de ses descendants achèvera
le chantier en 1635.
À la Révolution, un travail de sape, mené à
la barre de fer, détruit les dernières statues de
la façade. La cathédrale de Bazas a été
classée dans la première liste des monuments historiques
français en 1840.
Aujourd'hui, Saint-Jean-Baptiste est l'un des plus beaux édifices
religieux de Gironde. Son harmonie architecturale, voulue par Arnaud
de Pontac, est tout à fait remarquable. Le visiteur portera
un œil attentif aux vitraux
du XIXe siècle : quelques-uns d'entre eux illustrent des
scènes de la Bible rarement représentées.
|
 |

Vue d'ensemble de la nef de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
85 mètres de long sur 23 mètres de large. La voûte
centrale mesure 20 mètres de haut. |
|
|

Le chevet de la cathédrale vu depuis la promenade de
la Brèche. |

La rose occidentale, de style flamboyant, est une vraie splendeur.
Comme tout le deuxième niveau de la façade, elle
date du début du XVIe siècle.
Le couronnement à fronton et à ailerons (voir
photo à gauche) a été terminé en
1725.
Voir la rose plus succincte de l'église Saint-Sauveur
à Saint-Macaire. |

Le vitrail de la rose occidentale
posé par l'atelier Joseph Villiet (entre 1852 et 1862) |

Le médaillon central de la rose occidentale
M. Parenteau, curé de Bazas présente la cathédrale
(après les restaurations)
au cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. |
|

Les trois portails de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste constituent
l'élément artistique principal du bâtiment.
L'ensemble, du milieu du XIIIe siècle, a subi les dégradations
des huguenots et des révolutionnaires.
À gauche, portail Saint-Pierre. Au centre, portail dédié
à Saint-Jean-Baptiste. À droite, portail dédié
à la Vierge. |
| LE PORTAIL CENTRAL
(2e MOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE) |
|
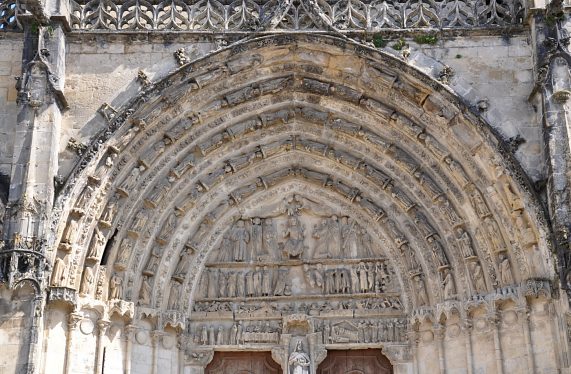
Le tympan et l'archivolte du portail central. |
|
Le
portail central (2e moitié du XIIIe
siècle) est consacré au Jugement dernier.
Seul le registre du bas illustre l'histoire de saint
Jean-Baptiste. On y voit, à droite, la naissance
et la prédication du Précurseur ; à
gauche, le festin d'Hérode et la décollation.
Les trois autres registres du tympan reprennent un thème
assez commun dans les portails des cathédrales
: la résurrection des morts qui sortent
de leur tombeau ; le Pèsement des âmes,
puis la séparation entre élus et damnés
; enfin, le Christ assis montrant ses plaies,
accompagné de la Vierge, de saint Jean l'Évangéliste
et d'anges.
Malgré les mutilations commises par les huguenots
et les révolutionnaires (ces derniers ont décapité
méticuleusement beaucoup de figurines), malgré
l'usure du temps, les éléments du bas-relief
qui subsistent indiquent un ensemble d'une grande beauté
et d'un grand réalisme dans les expressions faciales
des personnages. La scène du Léviathan,
brutale dans ses menaces, est prompte à maintenir
les indécis dans le droit chemin : un démon
précipite un damné, la tête la première,
dans l'entrée de l'enfer. Mais la sculpture la
plus admirable se trouve peut-être dans le registre
de la Résurrection des morts : les corps sortent
du tombeau nus comme des vers, et l'un d'entre eux présente
ses fesses (voir 2e
photo ci-dessous). Il est vrai que le Moyen Âge
n'est pas une époque pudibonde.
Les cinq voussures de l'archivolte sont de la même
qualité artistique, avec de beaux drapés
dans les vêtements. En dépit de quelques
chefs coupés, on distingue encore bien les anges
qui écrasent des démons dans la première
voussure, les anges qui portent des cierges ou des couronnes
dans la deuxième, les prophètes dans la
troisième, les martyrs portant un livre, une
palme ou un autre attribut dans la quatrième,
enfin, des confesseurs dans la voussure externe, dont
saint Nicolas.
|
|

Le tympan du portail central (2e moitié du XIIIe siècle).
En bas, l'histoire de sant Jean-Baptiste ; au-dessus, le Jugement
dernier. |

Tympan du portail central
En haut, la résurrection des morts ; en bas, la naissance
de Jean-Baptiste et la prédication du Précurseur. |

Le repas d'Hérode dans le tympan du portail central
Malgré l'usure du temps, on distingue encore bien Hérode
et Hérodiade. À droite, est-ce Salomé qui
tient un document? |

Les Justes dans le tympan du portail central.
Saint Michel amène six élus vers le paradis, figuré
par un porche gothique où se tient un ange. |
|

Les cinq voussures du portail central
Ici, la partie gauche. |

Voussures internes du portail central : deux rangées
d'anges. |

Un démon précipite un damné dans la gueule
du Léviathan
Tympan du portail central. |

Le Christ montrant ses plaies, entouré de la Vierge et
de saint Jean.
Tympan du portail central. |

Sous le linteau du portail central, bas-relief d'un homme se
bouchant
les oreilles pour ne pas entendre la parole sacrée. |

Sous le linteau du portail central, bas-relief d'un homme accroupi
(qui écoute la parole sacrée). |
|
| LE PORTAIL SUD
DÉDIÉ À LA VIERGE (2e MOITIÉ DU
XIIIe SIÈCLE) |
|
Les voussures du portail
sud (2e moitié du XIIIe siècle) : ---»»»
Anges, Vie de Marie, Arbre de Jessé, Zodiaque et
Occupations des Mois. |
|

Le tympan du portail sud : Dormition et Couronnement de la Vierge. |
|
Portail
sud dit «de la Vierge».
Le premier registre illustre la Dormition : la
Vierge est étendue sur son lit, entourée
des apôtres ; au-dessus du lit, le Christ porte
l'âme de sa mère. Le registre supérieur
est consacré au Couronnement de Marie
environné d'anges.
L'ornementation des voussures du portail sud contient
un bel arbre de Jessé (3e voussure). On
reconnaît sans peine David avec sa lyre (donné
ci-dessous). Suivent ensuite neuf rois de Juda (qu'il
est impossible d'identifier) le long de l'arc de cercle.
La 4e voussure est double : elle accueille le Zodiaque
et les Occupations des mois. Enfin, la 1ère
voussure, ornée d'anges, accompagne la deuxième
qui est une illustration de scènes de la vie
de Marie, de sa naissance à la Fuite en Égypte,
même s'il est parfois difficile d'identifier certaines
parties.
|
|

Un roi de Juda
Arbre de Jessé dans le portail sud. |

David dans l'arbre de Jessé
Voussure du portail sud. |
|
 |

La Balance et le Scorpion
dans le Zodiaque du portail sud. |

Le Bélier dans le Zodiaque.
Voussure du portail sud. |
|
| LE PORTAIL NORD
DÉDIÉ À SAINT PIERRE (2e MOITIÉ
DU XIIIe SIÈCLE) |
|

Le portail nord. |

Soubassement du portail nord. |
|
Portail
nord dit «de Saint-Pierre».
Le tympan de ce portail illustre, dans le registre supérieur,
une scène assez cocasse (voir photo à
droite) : une barque vide est ballottée par les
eaux ; à côté, saint Pierre est
à moitié enfoncé dans l'eau. Jean
Vallery-Radot (Congrès archéologique
de Bordeaux-Bayonne en 1939) voit dans ce bas-relief
l'histoire de Pierre au lac de Génézareth
: le Christ, qui est en train de marcher sur les eaux,
appelle Pierre : celui-ci descend de sa
barque, marche lui aussi sur l'eau en direction de Jésus,
mais, vu la violence du vent, il a peur et commence
à s'enfoncer.
Le commentaire affiché dans l'église sépare,
quant à lui, les deux scènes : Pierre
s'enfonce parce qu'il commence à douter de pouvoir
marcher sur les eaux, donc il pèche par manque
de foi ; et le frêle esquif isolé qui paraît
à la dérive est le symbole d'une Église
qui a besoin d'un chef pour la guider.
En 1987, dans son rapport pour le Congrès
archéologique de France, l'historien Jacques
Gardelles voit, plus prosaïquement dans ce bas-relief,
saint Pierre jeter ses filets dans les eaux du lac Tibériade.
Le registre suivant illustre l'épisode de la
Pêche miraculeuse.
Le registre du bas, décomposé en trois
scènes, consacre la primauté de Pierre.
La scène de gauche illustre les paroles du Christ
: «Tu es Pierre et sur cette pierre... »
; au centre, le martyre de saint Pierre, crucifié
la tête en bas ; à droite, la décollation
de saint Paul assis devant son bourreau, à côté
un Néron couronné tient un glaive.
Comme sur l'archivolte du portail sud, le portail nord
offre quatre voussures, la dernière étant
double. La première comprend six prélats
(pour Jean Vallery-Radot, ce sont six pontifes) ; la
deuxième montre huit anges céroféraires
(porteurs de cierges) ou thuriféraires (porteurs
de l'encensoir) ; la troisième rassemble les
Vierges folles (à droite) et les Vierges sages
(à gauche) ; enfin, la quatrième illustre
des scènes de la Genèse.
|
|
|

Le tympan du portail nord illustre des scènes de la vie
de saint Pierre. |

Deux bas-reliefs rapportés, situés
dans l'ébrasement gauche du portail nord :
L'Annonce aux bergers et la Nativité |

Les voussures droites du portail nord.
De gauche à droite : les prélats, les anges, les
vierges folles et,
dans la voussure double de la droite, des scènes de la
Genèse.
Ici, en haut, Caïn, accompagné d'un démon,
présente les prémices
de la moisson ; Caïn assassine son frère ; Malédiction
de Caïn. |

Le registre supérieur du tympan du portail nord : une
barque à la dérive et saint Pierre enfoncé
dans l'eau.
a donné lieu à trois descriptions différentes
données dans l'encadré ci-contre. |
|
 |
|
Le style
et la décoration des portails.
Dans son article sur la cathédrale de Bazas pour le
Congrès archéologique de France de 1987
en Bordelais et en Bazadais, l'historien Jacques Gardelles
nous livre une analyse pertinente de la décoration
des voussures.
Il remarque d'abord que les thèmes du Zodiaque,
de l'Occupation des Mois, ainsi que le cycle de la
Création et de la Chute de l'homme se retrouvent
dans les voussures des portails du transept septentrional
de la cathédrale
de Chartres. Pour ce qui est du style, les voussures de
Bazas sont à cent lieues du style roman tel qu'on le
voit à la Sauve ou
la Réole, géographiquement tout près.
De plus, dans la nef, les chapiteaux, les thèmes floraux,
la mouluration des bases, des tailloirs, des astragales, tout
comme les plantes traitées au naturel, sont «de
type nettement septentrional» et font pencher pour une
datation «assez voisine de 1240-1250».
Même opposition d'époque pour l'étude
des figures et des vêtements. On remarque, à
Bazas, «l'ampleur des draperies tuyautées ou
à larges pans s'écrasant parfois au sol.»
Tout cela est bien contraire à d'autres sculptures
de la région dont le style ne dépasse pas le
premier quart du XIIIe siècle. Les visages dans les
bas-reliefs de Bazas sont «le plus souvent larges, parfois
ronds et souriants». Ils évoquent certains personnages
de Paris et de Reims.
On ne peut donc les situer que dans le second tiers ou le
milieu du XIIIe siècle.
Et Jacques Gardelles de conclure : «Tout semble concorder
pour attribuer à cette période l'exécution
des portails occidentaux de la cathédrale de Bazas
(...). Cet important ensemble marque donc le triomphe définitif
de la sculpture gothique dans une région qui restait
encore, malgré l'apparition de formes nouvelles, assez
fidèle à certaines traditions de la plastique
romane. Dans ce domaine, comme dans celui de l'architecture,
la cathédrale de Bazas apparaît donc comme le
premier succès d'un art importé : l'art gothique
de l'Ile-de-France, de la Champagne et de la Picardie.»
Source : Congrès archéologique
de France, 145e session,
Bordelais et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale
de Bazas rédigé par Jacques Gardelles.
|
|
«««---
Les voussures du portail sud, détail de la partie droite.
À gauche : une Vierge folle,
À droite en haut : Caïn, accompagné d'un
démon, présente
les prémices de la moisson ; en bas : Caïn assassine
son frère. |
|
|
|

La nef avec l'élévation nord.
Dans cette partie de la nef, les piliers datent de la reconstruction
(1583-1635) entreprise par l'évêque Arnaud de Pontac. |
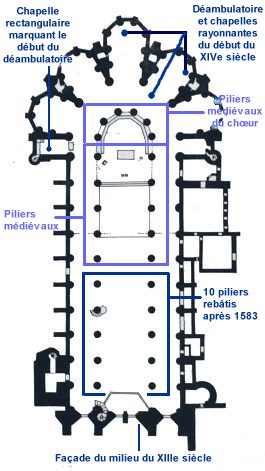
Plan de la cathédrale de Bazas. |
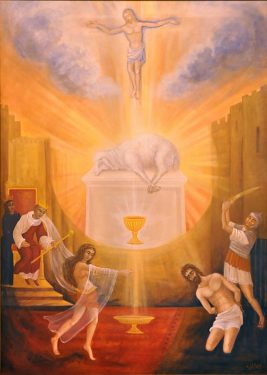
Décollation de saint Jean-Baptiste
Tableau dans le bas-côté nord du chœur.
Est-ce un tableau contemporain? |
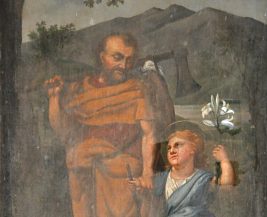 |
|
|
Architecture
I.
Un trait frappe dès que l'on pénètre
dans la cathédrale de Bazas, c'est sa très
belle harmonie architecturale, et ceci malgré
la période de reconstruction post-guerres de
Religion. L'édifice est à trois niveaux,
dont deux sont ornés d'une belle série
de vitraux du XIXe siècle dus à l'atelier
Joseph Villiet. On constate que le triforium
est aveugle. Il est séparé des grandes
arcades par une corniche double qui s'interrompt au
passage des renflements, eux-mêmes prolongations
des piliers de la nef jusqu'à la retombée
des ogives. Certes, le parement nu du triforium semble
pauvre, mais les chapiteaux ioniques qui séparent
les ouvertues aveugles sont du meilleur effet. Loin
d'être surchargé, l'ensemble est très
élégant. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste,
c'est, avant tout, le monde de la pierre avec juste
ce qu'il faut d'ornementations pour l'habiller.
Dans son article de 1987 sur la cathédrale de
Bazas pour le Congrès archéologique
de France en Bordelais et en Bazadais, l'historien
Jacques Gardelles émet une thèse
passionnante, plutôt iconoclaste. Cette thèse
est reprise dans son ouvrage Aquitaine gothique
(éditions Picard). Après avoir disserté
sur les arcades, celles des bas-côtés et
les voûtes de ces mêmes bas-côtés,
et commenté leur construction au début
du XIVe siècle, J. Gardelles pose une question
toute simple : «Était-on passé dès
lors à la mise en place des parties hautes du
grand vaisseau - triforium et fenêtres hautes
- et à son voûtement?» Autrement
dit, a-t-on réellement bâti le triforium
aveugle, les parties hautes et la voûte de la
nef au XIVe siècle? Il ajoute qu'on n'en
a aucune preuve. Bien plus, on constate que le pignon
occidental et les butées des contreforts voisins
ne contiennent pas la moindre trace de construction
médiévale : tout remonte entièrement
au XVIe siècle.
Jacques Gardelles enfonce le clou : ces constatations
architecturales «semblent bien prouver que les
constructeurs médiévaux ne menèrent
pas cette tâche à terme et, sans doute,
ne la commencèrent pas : le contexte militaire
et économique des périodes postérieures
à l'occupation du Bazadais en 1323 par les troupes
du roi de France et surtout les premiers épisodes
de la guerre de Cent ans de 1337 à 1346 ne durent
guère favoriser la poursuite de l'œuvre.»
Y avait-il donc une charpente en bois sur la nef? Jacques
Gardelles ne pose pas la question et on ne possède
aucun document sur l'édification d'une voûte
en pierre au XVe siècle ou au début du
XVIe. Rappelons que la région était pauvre,
les revenus du Clergé restaient faibles et que
l'on s'est battu dans la contrée jusqu'à
la bataille de Castillon de 1453, victoire française
écrasante qui a signé la fin de la guerre
Cent Ans.
Continuons le raisonnement. S'il y avait une charpente
en bois au niveau de la corniche qui surplombe les grandes
arcades, qu'est-ce que les huguenots ont exactement
saccagé en 1577-1578? La charpente évidemment,
qu'ils auraient fait tomber en sapant une dizaine de
piliers dans la partie occidentale de la nef, les voûtes
des bas-côtés et les grandes statues des
portails. C'est à peu près tout et c'est
fort peu. Dans ce cas, la présence d'un triforium
aveugle ne serait due qu'à un manque de ressources,
la fortune personnelle d'Arnaud de Pontac ne suffisant
pas à créer un triforium gothique digne
de ce nom. On sait que les huguenots ont sapé
les piliers occidentaux de la nef, provoquant l'effondrement
de ce qui était au-dessus. Mais les piliers orientaux
n'ont pas été touchés. On peut
donc penser qu'une éventuelle voûte en
pierre, au-dessus de ces mêmes piliers, serait
restée en place. Or aucun document de la reconstruction
n'en fait mention et les archéologues n'ont détecté
aucune trace médiévale dans la voûte
de la nef. On imagine difficilement une dizaine d'ouvriers
cassant une voûte en pierre à coups de
marteau et de burin. Il semble quand même plus
simple de saper les piliers pour que la voûte
s'effondre. Or, répétons-le, ces piliers
orientaux dans la nef sont toujours en place et remontent
bien à l'époque médiévale.
Alors? Ajoutons que Jacques Gardelles lui-même
écrit, à propos de la cathédrale
romane qui a précédé l'édifice
gothique : «Sa largeur importante - 24 mètres
- montre bien qu'elle ne devait pas être destinée
à être voûtée, mais à
être couverte en charpente.» Laissons le
lecteur se faire une opinion sur cet intéressant
sujet, mais reconnaissons que la thèse de J.
Gardelles est des plus séduisante et dédouanerait
les huguenots d'un excès de saccage.
Terminons avec une petite touche de pudeur toujours
possible : les reconstructeurs auraient pu taire que
la voûte détruite par les huguenots n'était
qu'une charpente de bois pour ne pas étaler la
misère de la région, incapable de réunir
les fonds pour terminer la nef et bâtir une voûte
en pierre...
Sources : 1) Congrès
archéologique de France, 145e session, Bordelais
et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale
de Bazas par Jacques Gardelles ; 2) Aquitaine Gothique
de Jacques Gardelles, éditions Picard.
|
|

Abaque carré à thème floral
sur une pile reconstruite au XVIe siècle. |

Abaque carré avec tête d'angelot
sur une pile reconstruite au XVIe siècle. |

Abaque carré à thème floral, détail.
Pile reconstruite au XVIe siècle. |

Tête d'angelot sur un abaque carré
d'une pile reconstruite au XVIe siècle. |
«««---
Joseph et l'Enfant Jésus, détail
Tableau anonyme, XVIIIe siècle (?) |
|
|
 |

Chapiteau de la fin du XIIIe siècle
sur l'élévation d'un mur goutterau. |

Chapiteau de la fin du XIIIe siècle
sur l'élévation d'un mur goutterau. |

L'une des deux chapelles voûtées du bas-côté
sud (XIIIe siècle). |
| «««---
Le bas-côté sud ne possède plus que
deux chapelles (XIIIe siècle). |
|
|

Dieu maudit le serpent et lui montre Marie
qui donnera un Rédempteur au monde.
Atelier Joseph Villiet (1852-1862)
Dans le tympan, Adam et Ève sont chassés du Paradis. |

Idylle de Ruth et Booz, scène centrale du vitrail
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |
|
|
Les
vitraux de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
de Bazas méritent une certaine attention. Ils
ont été posés par l'atelier de
Joseph Villiet dans la décennie 1852-1862.
Leurs scènes historiées frappent le visiteur
car on y trouve des illustrations qui, non seulement
sont très belles, mais aussi fort rares.
Si le second niveau de l'élévation de
la nef aligne - de façon assez académique
- les prophètes, les saints et les saintes, le
premier niveau brille par sa recherche descriptive de
sujets évangéliques et surtout bibliques.
Des scènes comme l'idylle
entre Ruth et Booz, ou le
trouble d'Esther devant Assuérus ne se voient
pas partout.
Dans la scène de Noé qui sort de l'Arche,
l'auteur du carton a choisi un Noé
au visage sévère, déterminé
à prendre son travail à bras-le-corps
: repeupler la Terre !
Les chapelles absidiales illustrent des thèmes
relatifs aux saints de leur dédicace : Pierre,
Jean-Baptiste et Joseph. Ou, de façon plus classique,
à la Vierge et au Saint-Sacrement.
On remarquera plus particulièrement les scènes
de la vie de saint Jean-Baptiste avec un roi Hérode,
très pensif devant le résultat de la décollation
qu'il vient d'ordonner.
Cette page donne de larges extraits des vitraux de la
cathédrale.
|
|

L'élévation nord (côté occidentale)
reconstruite à la fin du XVIe siècle |
|
La
nef occidentale reconstruite.
Les piles monocylindriques sont surmontées d'un
abaque carré décoré de têtes
d'angelots ou de motifs classiques (photo ci-dessus).
Le tout est prolongé par un renflement jusqu'au
chapiteau ionique, au niveau du triforium aveugle, chapiteau
qui reçoit la retombée du doublon et des
ogives. Dans la partie orientale, les piles ont été
épargnées par les protestants. Elles sont
constituées de massifs cylindriques flanqués
chacun de quatre colonnes engagées à chapiteaux.
|
|
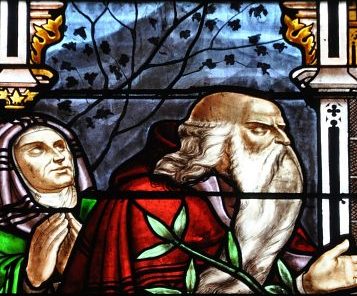
Noé sort de l'Arche (d'un air décidé à
tout reconstruire).
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |
|
|

Les parties hautes de la nef et la voûte quadripartite.
(Ensemble reconstruit à la fin du XVIe siècle
et au XVIIe). |

Tableau dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste
Saint Dominique prêchant la croisade contre les Albigeois
(?)
XVIIIe siècle (?) |
 |
|

Esther se trouble devant Assuérus
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

La Sainte Famille
Premier niveau de la nef, au sud.
Atelier bordelais de Joseph Villiet (1852-1862) |
«««---
La chapelle des Fonts baptismaux est l'une
des deux qui viennent du XIIIe siècle (côté
sud). |
|
|

Les voûtes des deux premières travées du
bas-côté sud
sont les deux seules à posséder liernes et tiercerons.
Elles ont été reconstruites à la fin du
XVIe siècle. |

Esther se trouble devant Assuérus, détail
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

Ancienne clé de voûte en bas-relief
XVIe siècle.
Le Christ en croix est entouré par quatre anges. |

Clé de voûte avec fleur et tête d'homme
dans un bas-côté. |
|

Piéta, auteur anonyme
(Don du roi Louis-Philippe). |
|
La
Reconstruction (1/2).
Ce mot pourrait faire croire qu'il s'agit de la reconstruction
de l'édifice après la seconde guerre mondiale.
Ce n'est qu'à moitié faux car les destructions
des huguenots, perpétrées avec l'aide
d'architectes, ont opéré comme un véritable
chapelet de bombes.
Voûte de la nef, fenêtres hautes, triforium
(voir l'encadré
sur l'architecture), voûtes des bas-côtés,
tout a été cassé méticuleusement
au cours des années 1577 et 1578, quand les protestants
étaient maîtres de la ville. Il ne restait
que la façade occidentale (conservée contre
une rançon de dix mille écus), les murs
latéraux des bas-côtés, six piliers
de la nef près du chœur,
les piliers du chœur, les arcades du chevet et
les chapelles absidiales.
L'édifice n'était plus qu'«un monceau
de décombres», lit-on dans la brochure
éditée par les Amis de la Cathédrale
de Bazas. On ne possède aucune information sur
les vitraux, mais il est probable que pas un n'a dû
échapper à ce travail de sape. Il faut
reconnaître que les deux bombes anglaises qui
sont tombées de plein fouet sur la cathédrale
de Nevers le 16 juillet 1944 ont fait moins de dégâts...
Suite à droite ---»»
|
|
 |
|

Ces piliers du bas-côté sud sont dans la partie
orientale de la nef :
ils remontent au XIIIe siècle et sont constitués
de massifs cylindriques
flanqués de quatre colonnes engagées à
chapiteaux. |
|
La
Reconstruction (2/2).
---»» C'est grâce à
un évêque énergique, Arnaud de
Pontac, que la reconstruction fut entreprise. Mais
il n'y avait plus de pape Clément V pour concéder
des indulgences aux donateurs et accroître leur
générosité. Quant à la contrée,
elle était assez pauvre. Le prélat lança
donc la reconstruction à ses frais, avec toutefois
quelques aides annexes.
La première phase des travaux fut menée
de 1583 à 1605 (année de la mort de l'évêque).
En 1605, les voûtes des parties hautes manquaient
toujours. Pour leur construction, Arnaud de Pontac légua
douze mille écus d'or à son successeur,
qui n'était autre que son neveu Geoffroy, président
au Parlement de Bordeaux.
Puis le fils de Geoffroy, Arnaud, prit le relais. Les
travaux s'achevèrent en 1635. Au dessus de l'arcade
d'axe dans l'abside, un texte
en latin, gravé sur une table de marbre noir,
commémore la restauration.
Il est assez surprenant de constater qu'Arnaud de Pontac
a choisi une reconstruction à l'identique. Le
prélat avait vraisemblablement connu la cathédrale
avant le saccage huguenot et en avait conçu une
profonde admiration pour sa séduisante harmonie
gothique. Bien des églises partiellement détruites
au cours de la guerre de Cent Ans ou des guerres de
Religion ont vu le style gothique faire place au style
Renaissance dans les parties reconstruites.
À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, ces
marques Renaissance sont rares. On les voit partiellement
dans les abaques carrés qui surmontent les dix
piliers monocylindriques de la nef occidentale : ils
sont en partie ornés d'angelots.
Le style gothique initial a également été
respecté dans les grandes arcades : elles sont
en tiers-point et retombent par pénétration
dans les supports. De plus, le réseau des baies
au second niveau est de style flamboyant.
Source : Congrès
archéologique de France,
102e session, Bordeaux et Bayonne, 1939, article sur
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste rédigé
par Jean Vallery-Radot.
|
|
«««---
La trace de la reconstruction se voit nettement dans
la différence de style des piliers de la nef :
avant, avec colonnettes engagées ; après,
monocylindriques. |
|
|

La Résurrection de Lazare, scène centrale
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

Les Patriarches Jacob et Joseph
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |

La Mort de saint Martin, auteur anonyme
Tableau du XVIIIe siècle. |
|
Vitraux.
Les parties hautes de la nef sont ornées de vitraux
à personnages dont on donne à gauche l'archétype.
Deux personnages, souvent richement habillés, se tiennent
soit de face, soit de profil, sur un fond d'azur étoilé,
tandis que le contour de la lancette se termine, dans sa partie
haute, par deux colimaçons rappelant la crosse d'un
évêque.
|
|

Moïse présente les tables de la Loi, scène centrale.
Rappelons que les Juifs, profitant de son absence, ont façonné
un veau d'or qu'ils ont adoré.
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |
 |

Saint Isodore |
Saint Martin et saint Paulin
---»»»
Atelier Joseph Villiet (1852-1862) |
|

Le bas-côté sud du chœur et les grilles menant au
déambulatoire. |
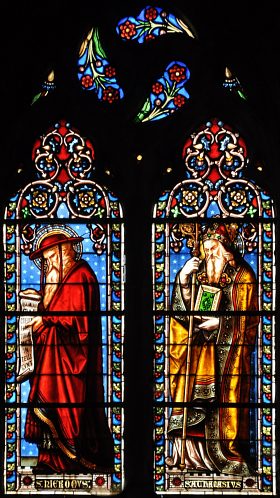
Saint Jérôme et saint Athanase. |

Sainte Thérèse d'Avila et sainte Jeanne de Valois. |
| LE CHŒUR
ET L'ABSIDE DE LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE |
|

Le chœur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. |
 |

Le maître-autel de la cathédrale, de style Louis XVI, est du
XVIIIe siècle. Il vient de l'abbaye cistercienne du Rivet. |
| «««---
Sous l'arcade axiale : inscription latine dédiée
à Arnaud de Pontac et à sa famille. |
|

Vitrail axial de la haute nef :
Jésus et saint Jean-Baptiste.
Atelier Joseph Villiet (vers 1852-1862). |
|
L'abside, la voûte du chœur
et ses vitraux ---»»»
du XIXe siècle à grands personnages.
Le triforium aveugle est interrompu au niveau de l'abside
et remplacé par un parement assez grossier.
|
|
|

Un ange dans le chœur. |
|
Le
chœur de la cathédrale.
Sans doute les donateurs traditionnels du
Bazadais se montrèrent-ils tièdes au début
du XIVe siècle quand on se mit à édifier
le chevet. Le pape Clément V, originaire de Gironde,
dut réveiller leur ardeur en concédant,
en 1308, des indulgences à tous ceux qui se manifesteraient
tant pour le chevet que pour la restauration du cloître
(dont il ne reste rien). En 1312, une autre bulle papale
attribua à la construction de l'édifice
les revenus des bénéfices qui se retrouveraient
vacants dans le diocèse (c'est-à-dire
sans titulaire). Seuls les revenus de la première
année de vacance étaient concernés,
mais le principe devait s'appliquer pendant cinq ans,
Les historiens attribuent donc au début du XIVe
siècle les cinq piles du rond-point ainsi que
les grandes arcades en tiers-point qui retombent par
pénétration dans ces piles. On peut constater,
sur la photo
ci-dessus qui présente l'ensemble du chœur,
que le tiers-point est particulièrement resserré.
Au-dessus de la corniche qui court tout le long de la
nef et de l'abside commence le travail des restaurateurs
de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle.
Le triforium aveugle n'est qu'un parement nu, d'aspect
assez vulgaire. La grande table
de marbre noir commémorant l'œuvre des
de Pontac, bienfaiteurs du monument, est suspendue dans
l'abside. Comme dans la nef, les réseaux des
baies du dernier étage ont été
refaits lors de la restauration.
Le mobilier du chœur provient de l'abbaye cistercienne
du Rivet, supprimée à la Révolution.
Il en est ainsi du beau maître-autel de style
XVIIIe siècle, et peut-être aussi de la
grille de communion et des grilles fermant les bas-côtés
du chœur. Même supposition pour plusieurs
grands tableaux suspendus dans les bas-côtés
du chœur.
Sources : 1) Congrès
archéologique de France, 102e session, Bordeaux
et Bayonne, 1939, article sur la cathédrale rédigé
par Jean Vallery-Radot ; 2) Aquitaine gothique
de Jacques Gardelles, Éditions Picard.
|
|
 |
|
| LE DÉAMBULATOIRE
ET LES CHAPELLES RAYONNANTES (XIIIe & XIVe SIÈCLES) |
|

Le déambulatoire nord et les chapelles rayonnantes.
On voit, à droite, la jonction très maladroite
de la retombée
d'ogive sur la pile du rond-point du chœur.

Détail du mauvais raccord de la retombée d'ogive
---»»»
dans le déambulatoire (voir l'encadré à
droite). |

Chapelle sud dite des Pénitents
Le déambulatoire s'ouvre sur deux chapelles de plan rectangulaire,
dites chapelles des Pénitents. |
 |
 |
|

Le visage du Christ ou de saint Jean
dans une clé de voûte. |
|
Architecture
II.
Ni le déambulatoire, ni les chapelles rayonnantes
n'ont été la cible des huguenots pendant
les guerres de Religion. L'ensemble est donc arrivé
à peu près intact depuis le XIVe siècle.
Dans le déambulatoire aux formes gothiques très
pures, un point doit retenir l'attention : celui des
jointures des retombées d'ogives sur les
colonnettes des piles du chœur. Jean Vallery-Radot
en fait la remarque dans son rapport sur la cathédrale
de Bazas (Congrès archéologique de
France tenu à Bordeaux et Bayonne en 1939).
Côté chapelles rayonnantes, les fortes
nervures en amande s'ajustent parfaitement sur les colonnettes
de même profil et de même calibre qui montent
depuis les supports (que l'on voit à la naissance
des chapelles rayonnantes). En revanche, côté
chœur, la jonction est tout à fait grossière
(voir photo ci-contre).
Jean Vallery-Radot en déduit que : 1) les colonnettes
côté chœur n'ont pas été
prévues pour recevoir les retombées d'ogives
du déambulatoire ; 2) comme, au nord, certaines
astragales ont été conservées -
montrant que les piliers devaient accueillir des chapiteaux
-, «le constructeur des voûtes du déambulatoire
[les] a fait disparaître en vue de ménager
une retombée par pénétration correspondante
[sic] à celle qui était prévue
par ailleurs.»
L'historien en conclut logiquement : «Les piles
du rond-point ont donc été plantées
au cours d'une période de travaux antérieure
à celle qui vit s'élever le déambulatoire
et les chapelles rayonnantes.»
Jacques Gardelles précise, dans sa présentation
de 1987 : «Tout se passe comme si les deux éléments
[rond-point et déambulatoire avec chapelles]
avaient été construits par deux maîtres
différents à deux différents moments»,
le premier élément construit étant
évidemment le rond-point.
Sources : 1) Congrès
archéologique de France, 102e session, Bordeaux
et Bayonne, 1939, article sur la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
rédigé par Jean Vallery-Radot ; 2) Congrès
archéologique de France, 145e session, Bordelais
et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale
rédigé par Jacques Gardelles.
|
|
«««---
Le déambulatoire sud du début du
XIVe siècle et ses chapelles rayonnantes.
Les huguenots n'ont pas touché
le déambulatoire et les chapelles. |
|
|
|
|

La Décollation de saint Jean-Baptiste
Scène centrale du vitrail. |

Le roi Hérode contemplant Salomé dansant.
Chapelle absidiale Saint-Jean-Baptiste. |

Salomé présente à Hérode la tête
de saint Jean
Chapelle absidiale Saint-Jean-Baptiste.
Atelier Joseph Villiet (vers 1852-1862) |

Le roi Hérode est en plein doute
quand il reçoit la tête de Jean-Baptiste. |
QUATRE TABLEAUX
DE SAINTS
PEINTS PAR FRANÇOIS LEMOINE,
FIN DU XVIIIe SIÈCLE,
CHAPELLE AXIALE |
|
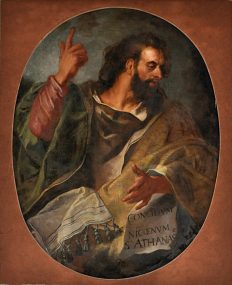
Saint Athanase par François Lemoine. |

Saint Basile par François Lemoine. |

Saint Jean Crysostome par François Lemoine. |

Saint Grégoire de Nazianze par François Lemoine. |
«««---
La danse de Salomé et
Salomé contemplant la tête de saint Jean.
Peintures de la chapelle Saint-Jean-Baptiste. |
|
|

Déambulatoire sud (fin du XIIIe, début du XIVe
siècle). |

|

La Manne
dans le tympan d'un vitrail de
la chapelle du Saint-Sacrement. |
«««---
Statue de la Vierge
Chapelle axiale de la Vierge |
|

Les vitraux de la chapelle axiale de la Vierge illustrent des
épisodes de la vie de la Vierge :
Annonciation, Couronnement et Présentation de Jésus
au Temple.
Atelier Joseph Villiet (années 1852-1862) |

Chapelle axiale de la Vierge. |
|
La
chapelle de la Vierge.
Avec ses cinq pans, c'est la plus vaste des chapelles
rayonnantes. Comme les autres, elle remonte au début
du XIVe siècle, puisque les huguenots ont eu
la gentillesse de ne pas détruire le déambulatoire
et les chapelles de l'abside dans les années
1570.
Les vitraux des trois baies centrales illustrent des
scènes de la vie de Marie : Annonciation, Couronnement
et Présentation au Temple. Les pans 4 et 5, qui
sont dans le prolongement de la verrière (et
qui sont cachés sur la photo ci-dessus) reçoivent
le texte des litanies.
|
|
|
 |

Chapelle rayonnante Saint-Pierre
Les peintures murales illustrent la vie de saint Pierre. |
«««---
L'Éducation de la Vierge, auteur anonyme
Tableau du XVIIe siècle dans la chapelle Saint-Joseph. |
|
|

Les vitraux de la chapelle absidiale Saint-Pierre
illustrent trois épisodes de sa vie : l'Appel de Pierre
; Pierre reçoit
les clés du Royaume ; un ange délivre Pierre de
sa prison romaine. |

Chapelle rayonnante Saint-Pierre : illustration de la pêche
miraculeuse. |
|

L'orgue de tribune est du facteur Robert Chauvin de Dax.
Il a été inauguré en septembre 1983. |
|
Aucune documentation n'a été
trouvée sur les peintures murales des chapelles
rayonnantes. Comme Joseph Villiet s'adonnait aussi à
la peinture murale, il faut admettre que celles des
chapelles St-Jean-Baptiste et St-Pierre sont de sa main.
|
|
|

La nef vue depuis le chœur.
Le mur occidental et les élévations des bas-côtés
sont de la fin du XIIIe siècle.
Tout le reste de l'architecture (notamment les piles rondes) est de
la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. |
Documentation : Congrès archéologique
de France, 102e session, Bordeaux et Bayonne, 1939, article sur la
cathédrale de Jean Vallery-Radot
+ Congrès archéologique de France, 145e session, Bordelais
et Bazadais, 1987, article sur la cathédrale de Jacques Gardelles
+ «Aquitaine Gothique» de Jacques Gardelles, éditions
Picard
+ brochure «La Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas»
publiée par l'Association des Amis de la Cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Bazas. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|