|
|
 |
 |
Au XIIIe siècle, la population
de Riom
s'accroît. Il faut un nouveau lieu de culte à la ville
basse qui s'étend. Ce sera Notre-Dame du Marthuret, édifiée
sur l'initiative du clergé séculier et avec, en 1251,
l'approbation du pape Innocent IV. Nous sommes au cœur du «beau
XIIIe siècle», une période d'accroissement démographique
et d'enrichissement économique.
En 1263, avec Alphonse de Poitiers, le site d'implantation infra
muros est décidé : la nouvelle église sera
érigée dans un quartier de pauvres et de classes moyennes
(où l'on compte les tanneurs). Le nom de Marthuret apparaît
dans une bulle du pape Nicolas IV en 1291.
Un incendie frappe l'édifice au début du XIVe siècle.
Il faut le rebâtir. Le pape Clément V accorde des indulgences
à ceux qui contribueront à cette reconstruction. Le
style choisi sera un gothique rayonnant propre à la région
auvergnate, qualifié parfois de gothique
méridional. L'église est à nef unique,
bordée de chaque côté par une suite de chapelles
peu profondes. Le chœur est pentagonal. Au XVIIe siècle,
il sera lui aussi bordé de petites chapelles.
Au XVe siècle, le duc Charles de Bourbon, comte de Clermont,
puis duc du Bourbonnais, donne son accord pour gagner un peu d'espace
sur la rue principale qui borde l'église à l'ouest.
La façade est alors retouchée et embellie.
Au XVIe siècle, la confrérie des tanneurs fait bâtir une chapelle
de style Renaissance au sud (chapelle
Saint-Jacques) ; la tour au nord-ouest est partiellement reconstruite
après un tremblement de terre survenu dans les années 1470.
Le XIXe siècle va notablement modifier l'église et
l'agrandir : petites chapelles latérales nord et sud transformées
en étroits bas-côtés après percement
des murs ; quatre vastes chapelles ajoutées au sud ; chœur
prolongé de trois absidioles avec déambulatoire ;
façade
enrichie et restructurée en style flamboyant.
L'église Notre-Dame du Marthuret n'a pas l'intérêt
historique et archéologique de Saint-Amable,
pourtant on y trouve de belles œuvres d'art comme la Vierge
à l'oiseau, des statues de saints du XVIIe siècle
ou de grandes toiles du XIXe siècle. Enfin, les amateurs
de vitraux anciens
pourront y admirer deux verrières datées l'une du
XVe siècle (baie
n°3), l'autre du XVIe (baie
n°4).
|
 |

La nef et le chœur de Notre-Dame du Marthuret vus depuis l'entrée. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DU MARTHURET |
|

La façade réaménagée au XIXe siècle
donne dans la rue du Commerce.
|

Le chevet est tenu par d'épais contreforts.
Depuis le XIXe siècle, il est prolongé de
trois chapelles rayonnantes sans fenêtre. |
|

L'église Notre-Dame du Marthuret et la ville de Riom.
Ici, la tour nord et son dôme du XVIIe siècle. |
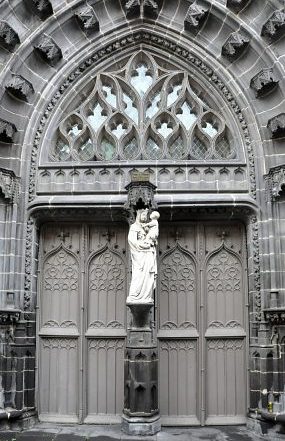
Le portail central et son remplage flamboyant.
L'essentiel de cette structure vient du XIXe siècle.
La statue du trumeau est une copie de la
Vierge à l'Oiseau. |
|
|
Architecture
extérieure (2/2).
---»» L'élévation sud de la
façade a été enrichie d'une tour,
identique à celle du nord, mais sans dôme.
Sur la rue, les tours ont été percées
d'ouvertures en arc brisé où ont pris
place des fenêtres tréflées. Ce
«trèfle»,
si souvent précisé dans les présentations
de l'église, est si discret qu'on le distingue
à peine depuis la rue...
Enfin, deux portes de style flamboyant ont été
rajoutées au nord et au sud, celle du nord étant
murée.
Bref, en comparant les dessins avant et après les travaux
du XIXe siècle, on peut dire que la façade a été vandalisée.
Seule la rose flamboyante au-dessus du portail central
n'a pas été touchée.
Curieusement, dans son Histoire du vandalisme
(dont la première édition date de 1958),
l'historien Louis Réau ne parle pas de Notre-Dame
du Marthuret, pas plus qu'il ne parle de la ville Riom.
De toute façon, l'église Notre-Dame ne
semble pas intéresser grand-monde. Prosper Mérimée,
inspecteur général des Monuments historiques
depuis 1834, passe à Riom
en 1837. Dans ses Notes d'un voyage en Auvergne,
iI s'étend longuement sur l'église Saint-Amable
et la Sainte-Chapelle, mais ne dit rien de Notre-Dame.
|
|
|
|
Architecture
extérieure.
La façade, qui donne dans l'actuelle rue du Commerce
est la seule partie vraiment intéressante de
l'église.
Quant au chevet
et à ses chapelles du XIXe siècle, leur
élévation est réalisée en
andésite sombre, une pierre volcanique riche
en minéraux ferromagnésiens. Sur la façade
et les côtés, la couleur de l'élévation
est plus claire.
Le XIXe siècle a totalement transformé
la façade du XVe siècle. Il faut s'imaginer
une façade sans tour sud, sans garde-corps reliant
les tours, un portail central avec un tympan nu, simplement
surmonté d'une rose à remplage flamboyant.
Le XIXe siècle a rajouté l'archivolte
et son remplage, lui aussi flamboyant. Il l'a surmontée
d'un gable (qui cache le bas de la rose) et a prolongé
par des pinacles les deux contreforts qui entourent
le portail.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|

Sur la tour nord, une discrète fenêtre «tréflée»
loge dans une baie en arc brisé. |

Porte de style flamboyant rajoutée
au XIXe siècle sur le côté sud de la façade. |
|
| ASPECT INTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DU MARTHURET |
|

Élévation nord de la nef.
C'est au XIXe siècle que les murs qui séparaient les
chapelles ont été percés d'ouvertures en arc
brisé.
On remarque que la cinquième travée, celle qui jouxte
le chœur, possède
un arc en plein cintre. |
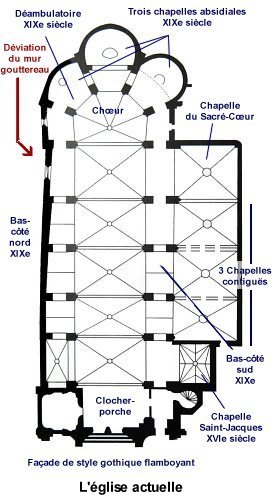
Plan de l'église Notre-Dame du Marthuret.
Passez la souris sur l'image pour voir
le plan d'avant le XIXe siècle. |
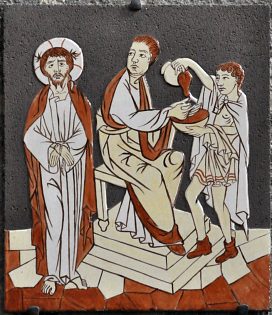
Le chemin de croix de l'église est contemporain.
Ici, la station I : Jésus est condamné. |

Groupe sculpté polychrome de sainte Anne et Marie, détail.
XVIIe siècle. |
|
|
Architecture
intérieure.
Le plan du XIIIe siècle est celui d'une nef unique
de 40 m de long sur 8,50 m de large, à cinq travées.
Cette nef est bordée au nord et au sud d'une
suite de chapelles peu profondes et de profil inégal,
séparées par des murs de refend. Le style
architectural est celui du gothique rayonnant, terme
parfois remplacé dans les présentations
de l'église par le gothique
méridional.
Le plan ci-contre montre une légère déviation
rentrante dans le mur gouttereau nord. Pour Anne Courtillé
(Auvergne, Bourbonnais, Velay gothiques, Picard,
2002), cela est sans doute dû «à
l'implantation délicate du grand édifice
dans un maillage d'habitations et d'échoppes
antérieures».
Le manque de symétrie se distingue d'ailleurs
aussi dans le chœur
pentagonal (qui à l'origine n'avait pas d'absidioles).
À l'ouest, la travée-porche remonte au
XVe siècle.
Le XIXe siècle va rajouter les trois absidioles
du chœur,
le grand espace du côté sud avec ses quatre
chapelles, et percer tous les murs de refend qui séparaient
les anciennes chapelles. De la sorte, on aboutit, au
nord et au sud, à un étroit bas-côté
scandé d'ouvertures en arc brisé où
le visiteur a l'impression d'être englouti dans
les vieilles pierres. Même chose dans le chœur
avec, cette fois, la création d'un étroit
déambulatoire.
Conséquence : les murs de refend ont laissé
la place à d'épaisses piles rectangulaires
ornées, côté nef, d'un faisceau
de trois minces colonnettes qui monte jusqu'à
la retombée des voûtes ogivales. Un trio
de petits chapiteaux à feuillages, haut perché,
peine à casser l'effet d'élancement.
Les repères archéologiques montrent que
la nef a été construite avant le chœur
; de plus, la cinquième travée est plus
large que les autres et son arc est en plein cintre.
Ces éléments poussent Anne Courtillé
à s'interroger sur le rôle passé
de cette travée. A-t-elle abrité, au tout
début de la vie de l'édifice, un chœur
primitif fermé par un chevet plat ? La
construction de la nef s'est-elle déroulée
d'ouest en est de façon régulière,
avec une cinquième travée qui serait une
liaison architecturale entre la nef et le chœur ?
Ou bien le chantier a-t-il commencé par cette
travée - de manière hésitante -
pour se poursuivre ensuite vers l'ouest et aboutir à
la façade ? Il est difficile de répondre
à ces questions et toutes les possibilités
restent ouvertes.

À son entrée dans la nef, un aspect étonne
le visiteur : l'absence de fenêtres au premier
niveau. La photo ci-dessus montre en effet un vitrail
dans la cinquième travée (baie
n°3), mais rien ailleurs. En fait, une seconde
petite baie (n°5)
existe dans la première chapelle au nord-ouest,
près de la tour. Elle accueille une rose
blottie dans un remplage flamboyant. Le visiteur constate
encore que les hautes fenêtres, larges et nombreuses,
suffisent pour éclairer l'édifice. Cependant,
à l'origine, il y avait bel et bien des fenêtres
au premier niveau.
Anne Courtillé écrit ainsi que «le
parement extérieur montre encore au nord des
traces de petites baies en plein cintre ou d'un quadrilobe».
La baie
n°3 actuelle, qui abrite un large vitrail à
deux lancettes, vient d'un percement plus tardif. On
ne sait pas quand ces ouvertures primitives ont été
bouchées.
En revanche, au sud, le mur gouttereau a été
éventré au XIXe siècle pour ouvrir
la nef sur quatre nouvelles chapelles. On ne sait si
ce mur était percé d'ouvertures ou, du
moins, s'il en avait gardé des traces.
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
La clé de voûte
ci-dessus à droite présente les armoiries
de Jean, duc de Berry
et d'Auvergne de 1360 à 1416. Les fleurs de lys
montrent son appartenance
à la famille royale. Jean de Berry était
le frère du roi Charles V. |
|
|
Le
gothique méridional (1/2).
L'architecture de l'église Notre-Dame du Marthuret
est souvent classée en gothique méridional.
C'est partiellement exact car l'intérieur se
rattache en partie au gothique rayonnant.
Dans son Mémento pratique d'archéologie
française paru en 1930, Vincent Flipo,
alors professeur à l'École spéciale
d'architecture, donne quelques clés pour définir
le gothique méridional. Il part d'un constat
: «Le Midi de la France, écrit-il, n'a
jamais adopté franchement les principes gothiques
et s'est contenté d'une formule pauvre et bâtarde,
étroitement liée aux traditions romanes
si fortes dans la région.»
---»» Suite 2/2
ci-dessous.
|
|
|

Saint Jean-Baptiste.
Statue polychrome du XVIIe siècle. |

Trio de chapiteaux sur les piliers de la nef.
Une simple couronne de feuillages
est insérée entre deux bagues. |

Saint Paul.
Statue polychrome du XVIIe siècle. |
|
|
Le gothique
méridional (2/2).
---»» À ce rejet il décèle
plusieurs causes : le manque de ressources financières
pour les constructions religieuses par suite du développement
des hérésies ; la présence très
influente d'ordres religieux comme les Dominicains ou les
Franciscains qui font de la pauvreté des sanctuaires
l'une de leurs règles ; les guerres religieuses (plus
fréquentes qu'au Nord) obligeant bien souvent les bâtisseurs
à fortifier leurs églises.
Conséquence : le plan des édifices est toujours
simple ; la nef est unique, large et sans transept ; le chœur
se termine par une abside ronde ou polygonale ; la présence
d'un déambulatoire est exceptionnelle ; les chapelles
latérales sont, malgré tout, fréquentes.
Au niveau extérieur, les contreforts très épais
sont la règle (pour des raisons défensives)
au détriment des arcs-boutants, très rares.
Les chapelles latérales se logent bien souvent entre
les contreforts.
Quant aux façades, Vincent Flipo constate qu'elles
sont pauvres ; beaucoup sont fortifiées par des tours
et des mâchicoulis ; les clochers sont nombreux, placés
sur la façade occidentale ou sur le flanc de l'église.
Après cette énumération, on comprend
que l'architecture de Notre-Dame du Marthuret puisse être
assimilée au gothique méridional. En déambulant
dans l'édifice, le visiteur pourra en constater l'aspect
défensif, parfois un peu lourdaud. Les travaux du XIXe
siècle ont-ils respecté ce choix initial ?
Peut-être pas : les chapelles du déambulatoire,
bâties à cette époque, montrent des traces
de baies obstruées.
En revanche, la façade
occidentale, autrefois très modestement ornée
et donc fidèle au gothique méridional et à
son aspect défensif, a été, comme le
souligne Anne Courtillé «transformée en
un flamboyant voyant finalement assez inapproprié»
(Auvergne, Bourbonnais, Velay gothique, Picard, 2002).
|
|

Saint Pierre brandissant la clé du Paradis, détail.
Statue polychrome du XVIIe siècle. |

Les fenêtres hautes de l'élévation ne bénéficient
d'aucun encadrement spécial.
De chaque pile, trois colonnettes s'élèvent jusqu'à
la retombée des voûtes.
Leurs petits chapiteaux à feuillages se remarquent à
peine depuis le bas de la nef. |

Ce passage étroit sous des arcades en arc brisé
a été construit au XIXe siècle en même
temps que les chapelles au sud. |

Baie 3, détail : les trois chérubins
du tympan
sont du XIXe siècle
(Atelier Émile Thibaud). |
|
|
Baie
3 : vitrail de l'Annonciation (1/2).
La scène principale est datée de
la période 1450-1460. L'ange, un genou
à terre, transmet le message divin à
Marie qui est accompagnée de la colombe
du Saint-Esprit.
La facture de ce vitrail, «extrêmement
proche de celle des vitraux de la Sainte-Chapelle
de Riom,
permet de l'attribuer de façon certaine
à l'atelier de Bourges
(...)», écrit le Corpus Vitrearum.
On remarque, derrière la Vierge, un vase
contenant six lys. Trois sont avec une fleur épanouie,
trois avec une fleur fermée.
La vitrerie de la Sainte-Chapelle a été
réalisée aux frais de Charles Ier,
duc de Berry, et fils de Jean. La présence
de ces lys porte à croire qu'il en est
de même de ce vitrail.
Les dais d'architecture gothique et les chérubins
du tympan sont des ajouts d'Émile Thibaud
au XIXe siècle.
Vus de près, les deux visages sont gangrénés
par une grisaille parasite. Passez la souris sur
le visage en gros plan de la Vierge pour voir
un visage «nettoyé».
---»» Suite 2/2
à droite plus bas.
|
|

Saint Jean l'Évangéliste.
(Reconnaisssable au calice qu'il tient à la main.)
Statue polychrome du XVIIe siècle. |
|
|

Baie 3 : Vitrail de l'Annonciation (vers 1450-1460)
Les deux dais d'architecture gothique et le soufflet sommital
ont été créés par Émile Thibaud
au XIXe siècle.
La restauration de 1999-2000 a supprimé la plupart des
plombs de casse de la scène du XVe siècle. |
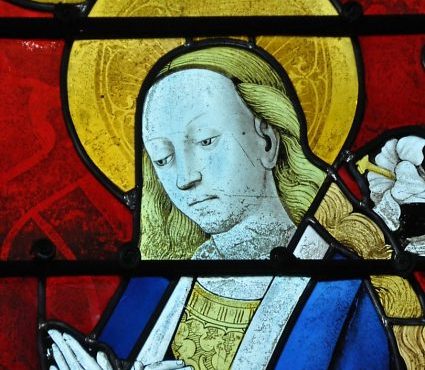
Baie 3, détail : la Vierge de l'Annonciation et
sa grisaille parasite.
Passez la souris sur le vitrail pour voir un visage «nettoyé»
par l'informatique. |
|
Baie
3 : vitrail de l'Annonciation (2/2).
---»» Le vitrail n'est pas à son
emplacement d'origine : des filets verticaux le complètent
sur les côtés, et la taille des personnages
est trop importante au regard de la baie et de son emplacement.
En 1999-2000, le vitrail a été restauré
par une collaboration entre l'atelier d'Emmanuel Barrois
(de Brioude) et celui Frédéric Pivet (de
Valdivienne dans la Vienne). Le Corpus informe
que les restaurateurs en ont retiré la plupart
des plombs de casse, ce qui a dû modifier considérablement
l'aspect général de cette Annonciation.
|
|
|

Élévation sud de la nef.
La chapelle Saint-Jacques se trouve à droite. On reconnaît
la Vierge à l'oiseau à l'entrée. |
| LA CHAPELLE SAINT-JACQUES
DANS LE CÔTÉ SUD |
|

La Vierge à l'oiseau.
Fin du XIVe siècle - XVe siècle. |
|
La
Vierge à l'oiseau (1/2).
Le thème de la sculpture est tiré d'un
évangile apocryphe, les Récits de
Thomas l'Israélite : l'Enfant-Jésus
s'amusait à modeler des oiseaux avec de la terre,
puis à souffler dessus pour leur donner vie.
L'un d'entre eux, réveillé trop vite,
lui a piqué le doigt. Ce qui correspond à
l'expression un peu déroutante de l'Enfant.
De quelle époque date cette sculpture ? Pour Paul
Gauchery, auteur de l'étude sur l'église
Notre-Dame du Marthuret pour le Congrès archéologique
de France tenu à Moulins et Nevers,
en 1913, il faut la rattacher au XVe siècle.
Elle serait due à un artiste de l'école
du Berry. Paul Gauchery rappelle qu'au XIXe siècle,
bien des érudits se sont penchés sur le
mystère de son origine. La notice de présentation
de l'église parle, quant à elle, de la
fin du XIVe siècle.
Paul Gauchery ajoute une information intéressante
: un examen chimique et microscopique a révélé
que le matériau n'est pas de la roche d'Auvergne.
C'est un «beau calcaire jurassique que l'on trouve
à Aprement (Nièvre), écrit-il,
et surtout à Charly (Cher), où la pierre,
d'un grain très fin, durcit à l'air.».
---»» Suite 2/2
ci-dessous.
|
|

Baie 4, détail : saint Jean l'Évangéliste.
Tête refaite au XIXe siècle. |
|

Voûte en étoile de la chapelle Saint-Jacques. |
|
La
chapelle Saint-Jacques.
Cette chapelle du XVIe siècle, bâtie hors
œuvre sur le côté sud par la confrérie
des tanneurs, présente trois curiosités
remarquables : une voûte en étoile, une
splendide statue médiévale et un vitrail
de 1538.
Sa vue d'ensemble, sans intérêt, n'est pas donnée dans
cette page. On en voit néanmoins une partie dans la
grande
photo ci-dessus, à droite.
Les nervures de sa voûte en étoile retombent
sur des culots ornés d'une coquille Saint-Jacques.
La clé de voûte centrale représente
l'apôtre Jacques le Majeur avec son bâton
de pèlerin (photo ci-contre à droite).
Les deux principales œuvres d'art s'imposent aux
yeux du visiteur : d'abord la statue de la Vierge à
l'oiseau dont l'origine, la date et l'auteur sont incertains
; ensuite le vitrail de la baie 4 (ci-dessous) qui éclaire
la chapelle. Daté de 1538 et partagé en
trois lancettes, il présente une Vierge à
l'Enfant entre saint Jacques et saint Jean l'Évangéliste.
Voir les détails plus
bas.
|
|

Baie 4 : 3 lancettes à personnages.
De gauche à droite : saint Jacques le Majeur, la Vierge,
saint Jean l'Évangéliste.
Atelier du peintre verrier de Bourges Jean Lécuyer, 1538. |
|
Vitrail
de la baie 4 (daté de 1538).
C'est l'un des deux vitraux Renaissance de l'église.
Il est à trois lancettes et présente trois
grandes figures : saint Jacques le Majeur, la Vierge
et saint Jean l'Évangéliste. La date de 1538
est portée dans le dais qui abrite la Vierge.
Le Corpus Vitrearum écrit : «Par
son style et par sa technique d'exécution très
particulière, en raison aussi du monogramme I.L.
relevé dans la lancette droite sur le calice
de saint Jean l'Évangéliste, cette œuvre
a été attribuée au peintre verrier
d'orgine parisienne actif à Bourges
des années 1520 à sa mort en 1556, Jean
Lécuyer.» Le Corpus ajoute qu'il
doit s'agir ici d'une production «bon marché».
Notons que la tête de saint Jean (à gauche)
a été refaite. En revanche, celle de saint
Jacques (à droite) est d'origine. Le nom du personnage
figure dans le couronnement qui le surmonte.
Le soubassement est constitué de trois panneaux
présentant les bustes de saint Antoine, sainte
Marguerite et sainte Françoise, tous créés
par Émile Thibaud au XIXe siècle (avant
1842).
Le tympan contient trois ajours intéressants.
Les deux ajours inférieurs sont d'Émile
Thibaud (Éducation de la Vierge et saint Madeleine
pénitente). L'ajour supérieur appartient
à la verrière originale. On y voit le
Père céleste bénissant (ci-dessous),
mais le Corpus précise que la tête
a été cassée, que le verre est
sale et qu'on y décèle quelques restaurations.
Le vitrail a été restauré en 1916 par l'atelier Félix
Gaudin.
|
|
|

Saint Jacques le Majeur et son bâton de pèlerin
orne la clé centrale de la voûte ogivale
de la chapelle Saint-Jacques. |

La Vierge à l'oiseau, détail. |

Baie 4, détail : saint Jacques le Majeur.
Jean Lécuyer, 1538. |

La Vierge à l'oiseau, détail. |
|
|
La Vierge
à l'oiseau (2/2).
---»» C'est avec cette pierre, précise-t-il,
qu'ont été réalisées les sculptures
de la cathédrale
de Bourges et, dans la même ville, du palais du
duc Jean, du palais
Jacques Cœur et de l'hôtel Lallemant.
Pendant la Révolution, la statue est cachée
par la corporation des bouchers. Au XIXe siècle, elle
est badigeonnée en gris et prend place au trumeau du
portail de la façade.
En 1932, on en fait une copie (qui la remplace sur le trumeau),
tandis que l'original est installé dans la chapelle
Saint-Jacques.
En 1991, une restauration a permis de retrouver, cachée
sous le badigeon, une magnifique polychromie qui met en valeur
une qualité d'exécution exceptionnelle.
Aucun texte ne prouve que cette statue se trouvait, avant
la Révolution, à l'église Notre-Dame. Le panneau d'information
disposé dans la nef évoque la possibilité de la Sainte-Chapelle,
construite par Jean de Berry dans son palais de Riom,
ou encore du château de Nonette (sud du Puy-de-Dôme) autre
propriété du duc, démantelée au XVIIe siècle.
Dans le Dictionnaire des églises de France (Robert
Laffont, 1966), le chanoine Bernard Craplet se dit très
irrité par le heurt entre la beauté plastique
de l'œuvre et l'énigme de son origine.
Il fait néanmoins une description dithyrambique de
cette Vierge : «Jamais sculpteur du Moyen Âge,
écrit-il, n'a su représenter avec autant de
bonheur la joie émerveillée et craintive à
la fois d'un tout petit enfant et encore moins le demi-sourire
à fond de tristesse de la Vierge. Elle regarde intensément
son Fils, pensant déjà qu'elle le perdra un
jour. L'ombre de la croix se profile dans le lointain... Tout
ceci suggéré sans que bouge presque un muscle
du visage.»
Si le chanoine veut admirer une Vierge à «la joie émerveillée»
tenant son enfant dans ses bras, la Vierge au raisin de la
basilique
Saint-Urbain à Troyes
exaucera tous ses vœux.
|
|

Baie 4, détail : l'Éducation de la Vierge.
Atelier Émile Thibaud, XIXe siècle. |

Baie 4, détail : le Père céleste au tympan,
Verrière d'origine datée de 1538. |

Baie 4, détail du soubassement : saint Antoine.
Atelier Émile Thibaud, XIXe siècle. |
| LES CHAPELLES
DU CÔTÉ SUD |
|

Au sud, l'autel de la Vierge noire termine le grand espace divisé
en trois chapelles.
La quatrième chapelle, dédiée au Sacré-Cœur,
se trouve derrière l'autel de la Vierge noire.
On remarque que la lumière vient de la voûte. |
|
La
Vierge noire.
Cette œuvre est la statue-reliquaire de Notre-Dame
du Marthuret (une petite loge est ménagée
dans son dos pour y abriter des reliques). Elle est
en noyer massif polychrome et daterait du XIVe siècle.
Ce n'est pas une Vierge hiératique, c'est-à-dire
répondant à des règles fixées
par la tradition religieuse, même si elle est
assise en majesté. L'enfant, au visage presque
adulte, semble, quant à lui, prendre la posture
d'une personne assise dans un fauteuil. La brochure
de présentation éditée par la paroisse
voit dans l'attitude et le regard de la Vierge beaucoup
de tendresse. Elle fait remarquer aussi la souplesse
et l'élégance de sa robe.
L'œuvre a été restaurée au
XIXe siècle. À cette occasion, les visages
ont été repeints en noir.
|
|
|

La Vierge noire.
XIVe siècle ?
|

«Descente de croix»
Alexis Valbrun (1803-1852). Huile sur toile.
Présentée au Salon en 1839, l'œuvre a été
critiquée pour son expressionnisme jugé excessif.
Achetée par l'État en 1840, la toile a été
offerte à l'église Notre-Dame du Marthuret. |

Baie 5 : rose du XIXe siècle
dans un remplage flamboyant du XIVe.
Première chapelle au nord. |

«Adoration des Mages»
Guy François (1578-1650). |

«Ecce Homo»
Henri Joseph de Forestier, 1819. Huile sur toile. |

Chapelles du côté sud et leurs grandes toiles du XIXe
siècle. |
|
Les vitraux
de l'église.
Une certaine opacité entoure les premiers siècles
de construction de l'église. Les historiens ont tenté
d'utiliser les vitraux comme points de repère.
Ainsi les fragments encore en place dans la vitrerie de l'abside
(tympans des baies 100 à 103) sont peut-être
les témoins de la construction au début du XIVe
siècle. En effet, en 1291, le pape Nicolas IV promulgue
une bulle accordant des indulgences à ceux qui visiteront
l'église. Et, en 1308 surtout, Clément V accorde
à son tour des indulgences à ceux qui contribueront
par leurs dons à la réédification de
l'édifice.
Ensuite, le vitrail de la baie
3 , très semblable à ceux de la Sainte-Chapelle
de Riom,
fournit un autre jalon : l'époque de Charles Ier, duc
de Berry.
La datation de la chapelle
Saint-Jacques est facilitée par la présence d'un vitrail
daté de 1538.
En 1793, les révolutionnaires remplacent par du verre
blanc les parties ornées d'armoiries et de fleurs de
lys.
Après la Révolution, l'ensemble de la vitrerie
a besoin d'être restauré et complété.
En 1836, la fabrique de l'église fait une proposition
qui paraît aujourd'hui bien étrange : déplacer
les vitraux de la Sainte-Chapelle de Riom,
à cette époque non restaurés et inaccessibles
au public, à Notre-Dame du Marthuret. Ainsi, appuie
le chapitre, tout le monde pourrait les voir. Quant au transport,
il pourrait se faire aisément sans aucune casse.
En 1840, ce projet est enterré : la taille des vitraux
de la Sainte-Chapelle excède celle des baies de l'église
; et l'État, propriétaire de la Sainte-Chapelle,
ne veut pas se dessaisir de son bien au bénéfice
de la ville, propriétaire de l'église. De plus,
il devrait payer le verre blanc et son installation dans la
chapelle... La fabrique se contenta de faire restaurer les
vitraux et sollicita l'atelier Émile Thibaud à
Clermont-Ferrand.
|
|

«Entrée triomphale du Christ à Jérusalem»
Charles Müller (1815-1892). Huile sur toile.
Ce grand tableau a été présenté au Salon
en 1844 et a suscité l'admiration des visiteurs. Il est arrivé
à Riom en 1845. |

«La Vierge donnant le Rosaire à saint Dominique»
Auteur inconnu. Huile sur toile, XVIIe siècle. |

«Le Christ devant Pilate»
Auteur inconnu, 2e moitié du XVIe siècle (?). Peinture sur bois.
D'après un dessin de Martin de Vos de 1581. |
| LE CHŒUR
ET LE DÉAMBULATOIRE |
|

Le chœur est séparé de la nef par un arc triomphal.
Il est éclairé par trois grandes baies que l'atelier
Émile Thibaud a pourvu de vitraux au XIXe siècle (baies
101-100-102).
Les tympans des ces vitraux ont conservé leurs éléments
anciens (vers 1400). |

Clé de voûte du chœur : le Père céleste. |

Baie 101 : lancettes d'Émile Thibaud :
saint Jean l'Évangéliste, Éducation
de la Vierge
et saint Joseph avec l'enfant (1843).
Tympan autour de 1400. |
|

Baie 100 : l'Assomption.
Atelier Émile Thibaud, 1843
Le tympan est daté aux alentours de 1400. |
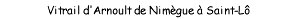 |
|
Baie
100.
Cette verrière a été commandée
par le curé de l'église, l'abbé
Chabrier. Le dessin serait inspiré d'un
vitrail attribué à Arnoult de
Nimègue et daté de 1513, visible
à l'église Notre-Dame à Saint-Lô.

Tympan daté vers
1400 :
Dans le trèfle supérieur, un ange,
sur un fond damassé rouge, tient un phylactère
dont l'inscription est effacée.
Au-dessous, deux anges, qui ont le dos tourné,
tiennent chacun un encensoir. Le fond est, cette
fois, un damas bleu. On remarque la présence
de lys et de rosettes de fleurs.
|
|
|

Le chœur et l'étroit déambulatoire.
Le déambulatoire a été créé
au XIXe siècle en perçant les murs
qui séparaient les chapelles rayonnantes peu profondes
du XIVe. |

Baie 102, détail du tympan : anges dans les ajours
(datés vers 1400). |
|
Baie
102, le tympan (vers 1400).
Dans la rangée inférieure (ci-dessus),
le trèfle de gauche possède en son centre
un ange portant deux des instruments de la Passion :
la lance et le fouet. Dans les quatre lobes : des anges
ailés sur fond damassé bleu.
Au centre du trèfle de droite, on distingue une
sainte (aspect très endommagé). Elle aussi
est accompagnée, dans les lobes, par des anges
ailés. Le peintre verrier de l'année 1400
a utilisé les mêmes cartons pour le dessin
de ses anges.
Selon le Corpus Vitrearum, l'état du
tympan de la baie 102 est moind dégradé
que celui de la baie 100 donné plus haut.
|
|

L'orgue de tribune est dû au facteur Joseph Callinet.
Il date de 1838.
Après quelques interventions malheureuses au XXe siècle,
il a retrouvé son éclat lors de la restauration
de 1990. |

Le buffet de l'orgue reçoit une ornementation
en bois de type flamboyant. |

Un roi de Juda dans l'Arbre de Jessé.
XIXe siècle. |
|
|
|
Le
chœur de l'église Notre-Dame.
Le chœur, construit après la nef,
vraisemblablement vers la fin du XIVe siècle,
est en forme de pentagone dont seuls les trois côtés
orientaux sont ouverts à la lumière par
de grandes baies.
Ce chœur est séparé de la nef
par un grand arc triomphal, matérialisé
par deux fortes piles très saillantes (photo
ci-dessus) qui se rejoignent en arc brisé. Ces
piles sont profilées selon une suite de tores
et de gorges.
Ce qui est actuellement le déambulatoire n'existait
pas au XVe siècle. Ce n'est qu'au XVIIe qu'ont
été ajoutées des chapelles rayonnantes
très peu profondes, transformées au XIXe
en déambulatoire par percement des murs primitifs.
Dans le chœur, l'élévation jusqu'à
la clé de voûte sommitale se fait par des
piles au profil prismatique sans chapiteau. Si on y
associe le type de remplage des baies, on reconnaît
là des marques du gothique flamboyant.
Le XIXe siècle a élargi ce chœur
en lui ajoutant trois absidioles dont les murs (photo
ci-dessus) paraissent bien défraîchis et
sans ornementation autre que la statue et le dais qui
surmontent l'autel. Voir la chapelle Saint-Antoine de
Padoue plus
bas. Les cinq chapelles peu profondes sont devenues
déambulatoire.
Le Père céleste de la clé de voûte
(donnée à gauche) rappelle, de manière
plutôt brutale, celui de la Sainte-Chapelle. Dans
son ouvrage Auvergne, Bourbonnais, Velay gothiques
(Picard, 2002), Anne Courtillé fait une description
peu flatteuse de cette sculpture : le Créateur
se tient à l'étroit dans son hexalobe,
avec des mains grossièrement façonnées
; les doigts sont épais et le drapé du
vêtement ne présente que quelques plis
obliques.
|
|

Baie 100, détail : les anges du tympan (vers 1400). |
|
Les
vitraux du chœur.
Ces trois grands vitraux de cinq mètres de haut
attirent l'attention du visiteur depuis l'entrée.
Leur taille est maximale car ils occupent tout l'espace
du second niveau de l'élévation.
Le point le plus intéressant est que les ajours
de leurs remplages accueillent des vitraux datés
aux alentours de 1400.
En effet, en 1843, le peintre verrier clermontois Émile
Thibaud, chargé de créer les
grands personnages sous dais gothiques pour les trois
lancettes de chaque verrière, a soigneusement conservé
les ajours des tympans. On y voit des anges logés dans
des trèfles, parfois accompagnés de décors floraux.
Le Corpus Vitrearum précise que ces
parties anciennes sont très dégradées
et les verres corrodés. Quant à la grisaille,
elle est effacée.
|
|
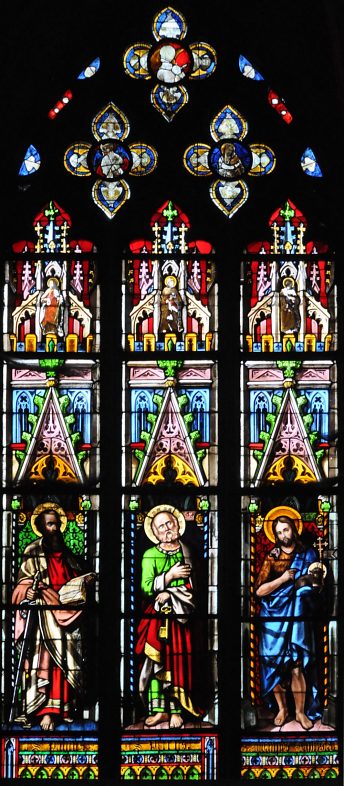
Baie 102 : saint Pierre, saint Paul et saint Jean-Baptiste.
Atelier Émile Thibaud, 1843.
Les ajours du tympan sont datés aux alentours de 1400. |

Arbre de Jessé du XIXe siècle.
Atelier inconnu. |
|

Baie 101, détail : saint Jean l'Évangéliste, Éducation de la
Vierge et saint Joseph avec l'Enfant.
Atelier Émile Thibaud, 1843. |

Chapelle rayonnante Saint-Antoine de Padoue
dans une absidiole du chœur.
XIXe siècle. |

L'Arbre de Jessé, détail de la partie basse.
XIXe siècle. |

La nef de Notre-Dame du Marthuret vue depuis le chœur. |
Documentation : «Auvergne, Bourbonnais, Velay
gothiques» d'Anne Courtillé, Éditions Picard, 2002
+ Congrès archéologique de France tenu à Moulins
et Nevers en 1913, article de Paul Gauchery
+ «Dictionnaire des églises de France», Éditions
Robert Laffont, 1966
+ «Les vitraux d'Auvergne et du Limousin», Corpus Vitrearum, Presses
Universitaires de Rennes, 2011
+ «Mémento pratique d'archéologie française» de Vincent Flipo, éditions
Firmin-Didot, 1930
+ brochure sur l'église éditée par la paroisse
+ panneaux d'information disposés dans la nef de l'église. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|





























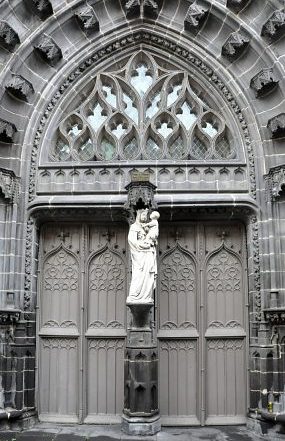


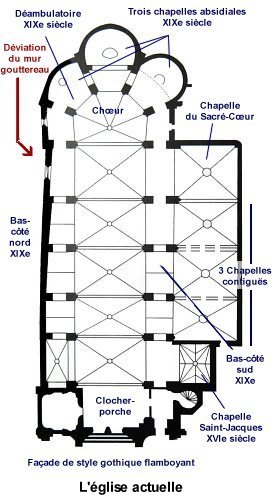
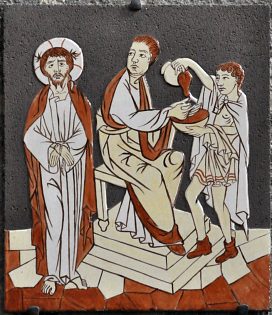













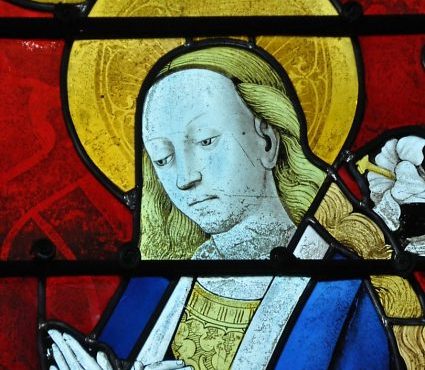


















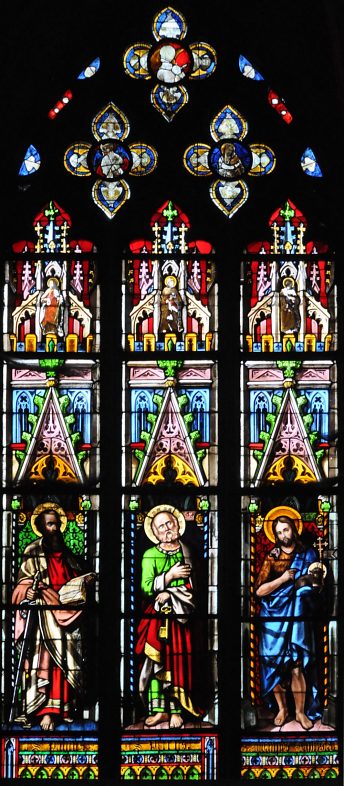

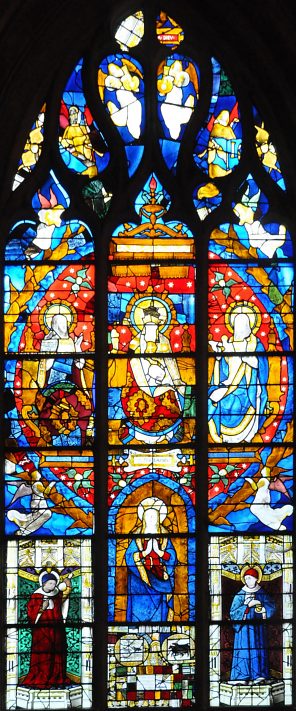 Vitrail d'Arnoult de Nimègue à Saint-Lô.
Vitrail d'Arnoult de Nimègue à Saint-Lô.