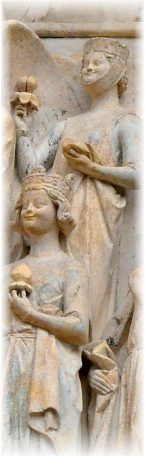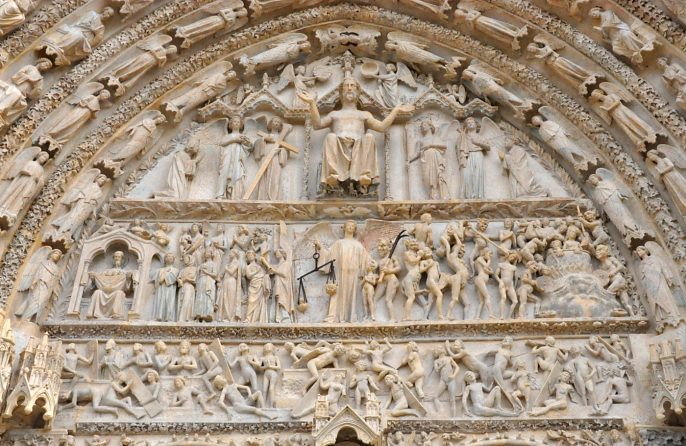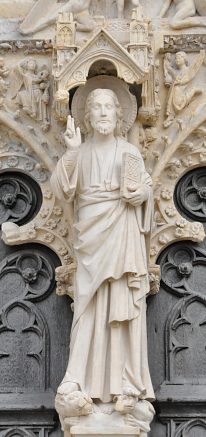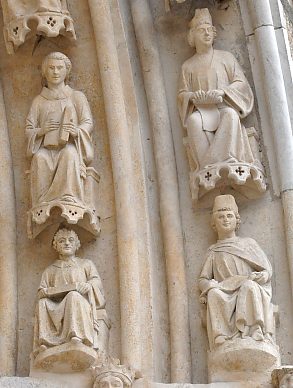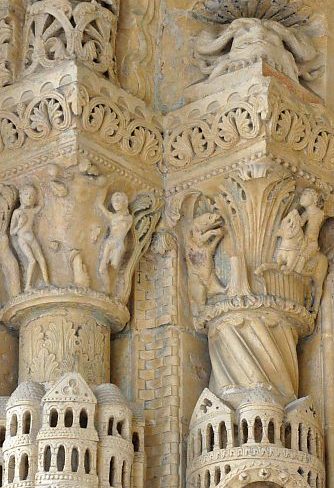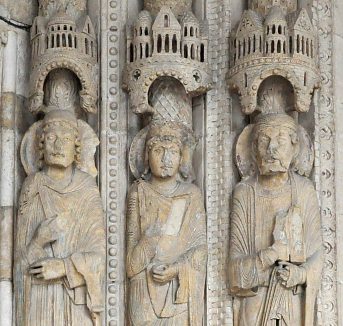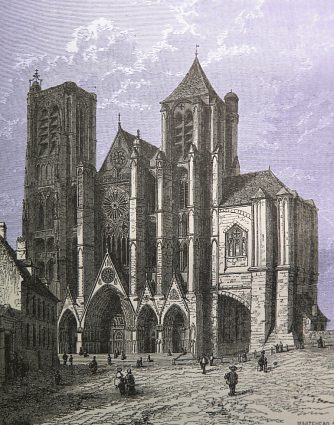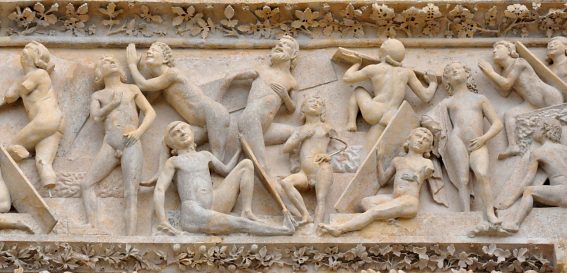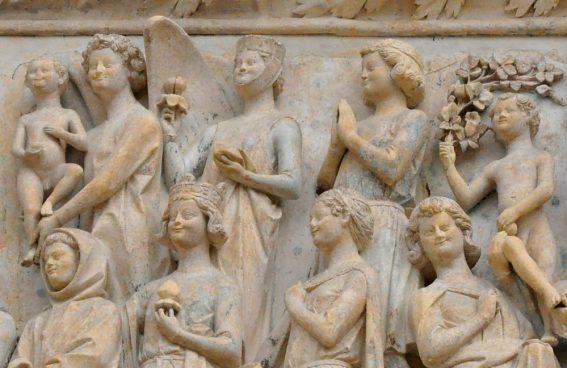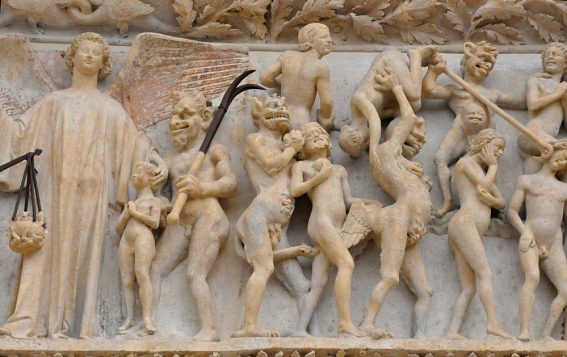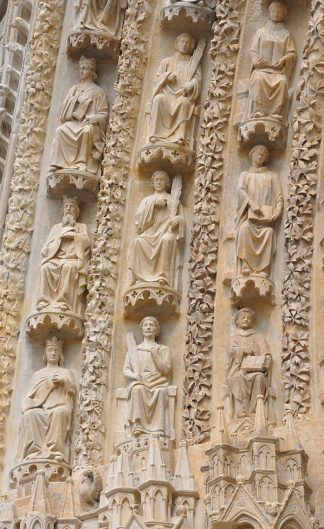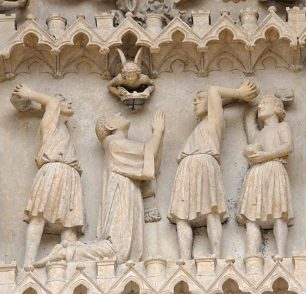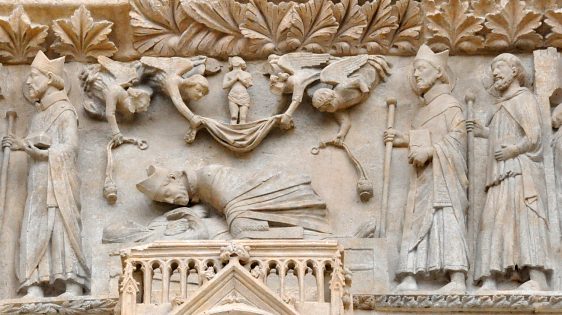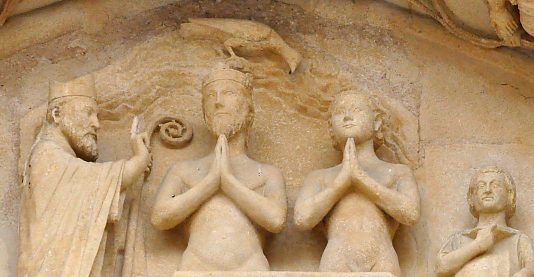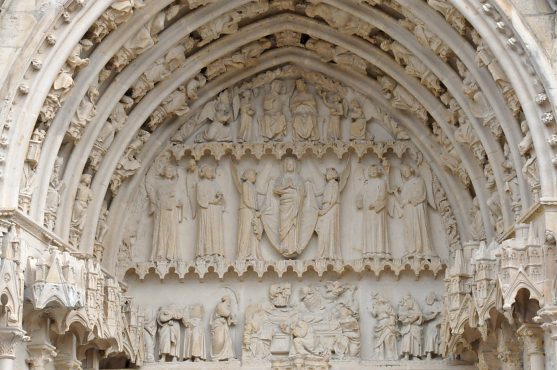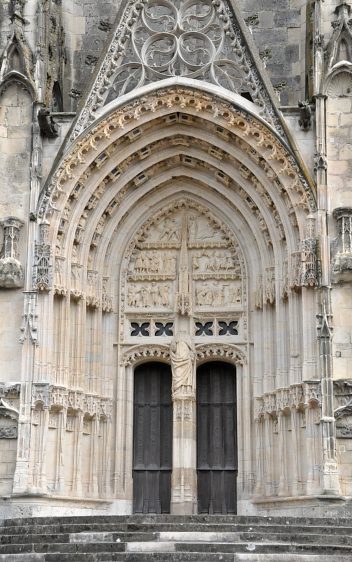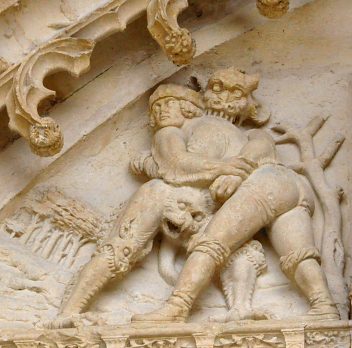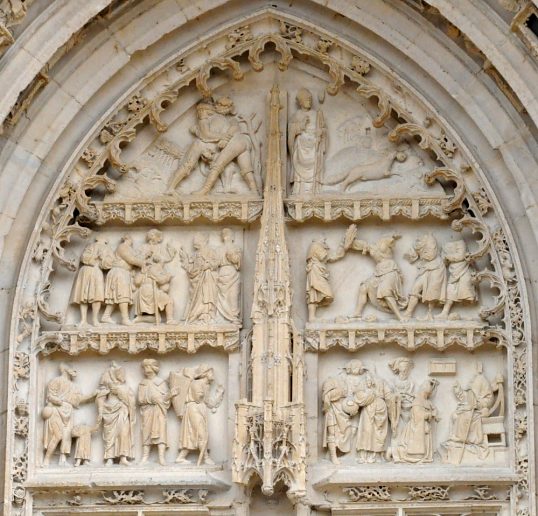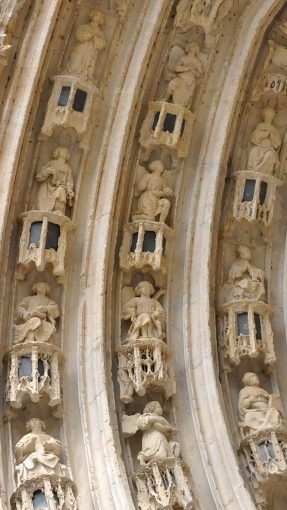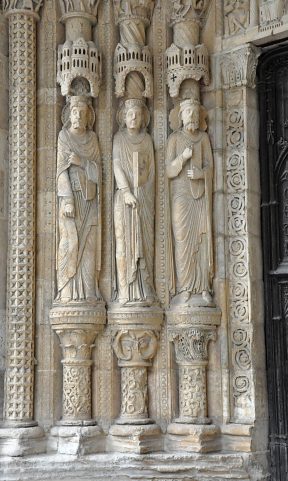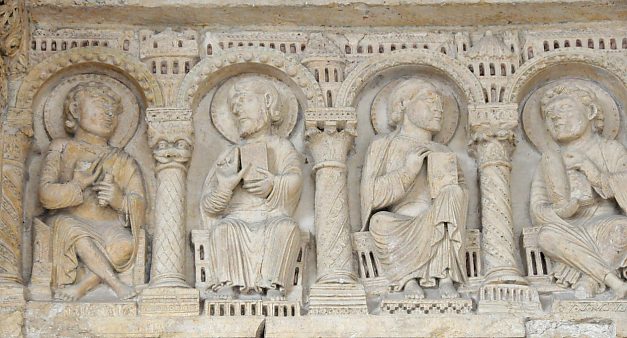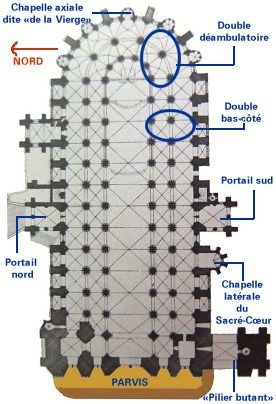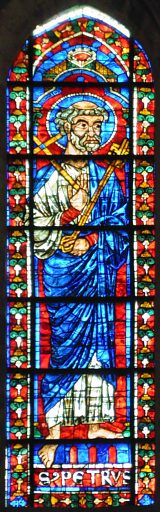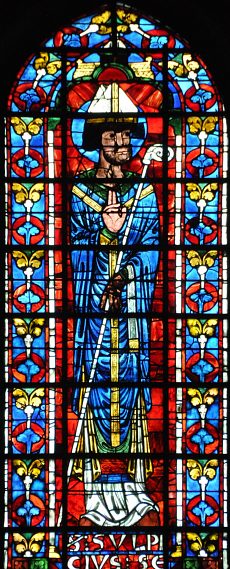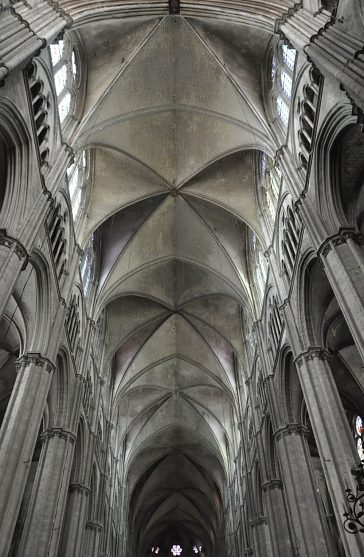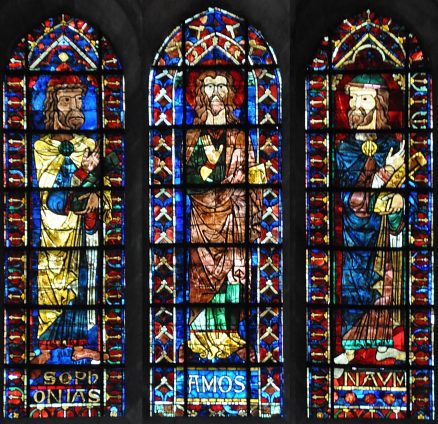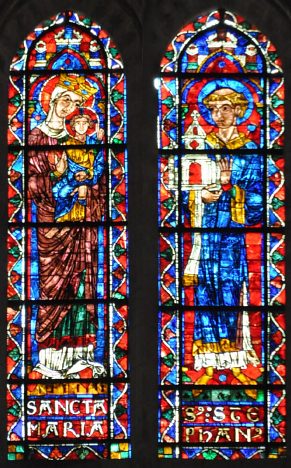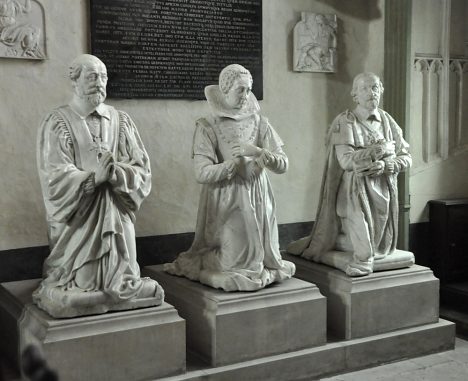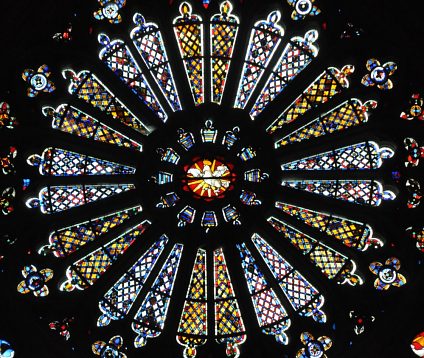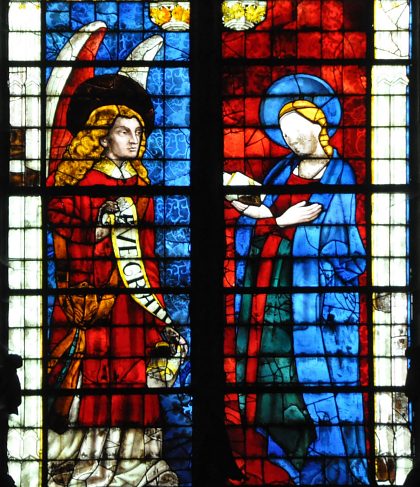|
|
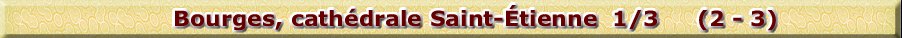 |
 |
On sait peu de choses sur les édifices
qui ont précédé la cathédrale Saint-Étienne.
Le légendaire saint
Ursin aurait établi un sanctuaire, au début de
notre ère, à l'emplacement du monument actuel. Un
autre aurait été construit par saint Pallais. Néanmoins,
une chose est sûre : au VIIe siècle, il existait bien
à Bourges
une cathédrale voisine des remparts. Et l'on a retrouvé
des vestiges d'une cathédrale du XIe siècle. Toujours
est-il que, vers la fin du XIIe, le chapitre veut lancer la construction
d'un nouvel édifice plus vaste que la cathédrale romane
dont il dispose. Celui-ci débordera l'ancien à l'est
et à l'ouest. À l'est, la déclivité
du terrain conduit à bâtir une église
basse (vers 1194-1195) sur laquelle reposera le futur chœur.
L'archevêque, Henri de Sully, va donner 500 livres
tournois pour la construction. Après le chœur, la nef
suivra, puis la façade occidentale (vers 1250). L'architecte
du chantier est inconnu, mais sa compétence, voire son génie,
sont certains. Il restera dans l'Histoire sous le nom de maître
de Bourges.
L'édifice, sans transept ni cloisonnement, privilégie
l'unité d'ensemble et le volume. Le maître de Bourges
révolutionne l'art de l'élévation : il supprime
les tribunes, implante un circuit d'arcades démesurées
(19 mètres de haut) de l'avant-nef jusqu'à l'abside
et assure l'équilibre de l'ensemble par des arcs-boutants
idoines. On en tire l'impression que l'élévation de
la nef possède cinq niveaux. Cette prouesse technique et
artistique ne sera reprise nulle part ailleurs. La cathédrale
est enfin consacrée le 13 mai 1324. Elle possède déjà
une magnifique galerie de vitraux dans son déambulatoire.
Dans un monument de cette taille (117 mètres de long), les
périls sont permanents : un énorme «pilier butant»
est bâti au XIVe siècle pour contrebuter la tour sud
qui menace de s'écrouler. La tour nord s'écroulera
en 1506 (dégradant les deux portails nord de la façade
ouest). Tout sera reconstruit au début du XVIe siècle
et les maçons laisseront à la postérité
la tour de beurre.
Aux XVe et XVIe siècles, à la suite de donations (dont
celle de Jacques Cœur), les chapelles latérales viennent
évider les murs droits au nord et au sud. De beaux vitraux,
dont l'Annonciation
(XVe siècle) et la présentation
des Tullier (XVIe) les illuminent. En 1562 , les huguenots saccagent
les portails. Au XVIIIe siècle, ce sont les chanoines eux-mêmes
qui se chargent des dégradations : démolition du jubé
du XIIIe ; suppression du maître-autel (qui datait de 1526) ;
suppression de dix-huit lancettes des verrières du XIIIe
siècle représentant des saints évêques
de Bourges.
Stalles et tapisseries disparaissent aussi. Le mobilier et l'aspect
intérieur du chœur sont mis à la mode. À
son tour, la Révolution va tout saccager. Le mobilier disparaît,
vendu ou volé. La cathédrale devient temple de la
Raison.
Le XIXe siècle fut celui des restaurations. Parfois pas très
heureuses quand elles portent sur des verrières du XIIIe
siècle ou des petites sculptures des portails, elles deviennent
rigoureuses quand elles sont menées par l'architecte Bœswillwald
de 1882 à 1890, selon un principe impérieux : refaire
et restaurer le gros œuvre tel qu'on le trouve.
La cathédrale Saint-Étienne de Bourges
est un monument incontournable parmi les grands édifices
français. Ceci pour deux merveilles : les portails et les
vitraux (qui offrent un historique de l'art du vitrail du XIIIe
au XVIIe siècle). Incontournable aussi pour la nef et son
élévation, unique au monde. On peut rajouter un quatrième
point qui enchante bien des visiteurs : l'atmosphère de féerie
qui règne dans le déambulatoire grâce aux 25
grandes verrières du XIIIe siècle. Pour les passionnés
d'art sacré, déambuler dans le déambulatoire
de la cathédrale de Bourges
est un incontournable.
|
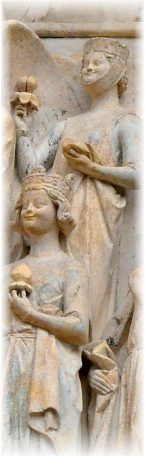 |

Un édifice de 117 mètres de long et une nef haute de
36 mètres sous clé attend le visiteur
à son entrée dans la cathédrale. Les piliers
de 19 mètres de haut accentuent encore l'élévation. |

La façade occidentale date du début du XIIIe siècle. |

Le «pilier butant» est indispensable pour que la tour
sud
ne s'écroule pas. Sa construction date
de la fin du XIVe siècle ou du début du XVe.

Depuis la tour nord (ou tour de beurre)
jusqu'au pilier butant inclus, la distance est de 73 mètres.
|

Les jardins de la cathédrale donnent
une très jolie vue sur le chevet.
Les arcs-boutants du chevet ont été
restaurés dans les années 1820. |

Le côté sud de la cathédrale et le portail
sud. |
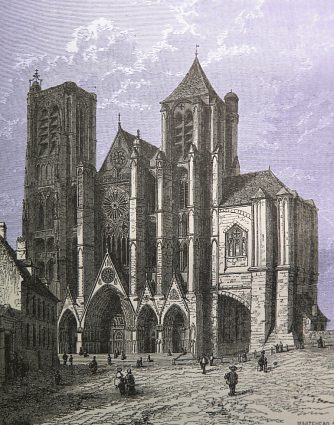
Dessin du XIXe siècle de la cathédrale de Bourges.
Sur la gauche, la «tour de beurre». À droite,
le «pilier butant». |
|
La
tour de beurre, bâtie au début
du XVIe siècle (sur la gauche du dessin ci-contre)
doit son nom au financement de sa construction. Celui-ci
a été assuré par les «taxes»
versées par les fidèles pour pouvoir manger
du beurre pendant le carême. Le visiteur peut
monter à son sommet.
|
|
|

Les cinq portails de la façade occidentale constituent l'une
des merveilles de la cathédrale (avec les vitraux et l'élévation
de la nef).
Les portails du Jugement dernier, de Saint-Étienne et de Saint-Ursin
sont du début du XIIIe siècle (avec restauration de
nombreuses statues au XIXe).
Les portails de la Vierge et de Saint-Guillaume ont été
rebâtis au XVIe siècle après l'écroulement
de la tour nord en 1506. |
| LE PORTAIL OCCIDENTAL DU JUGEMENT DERNIER |
|
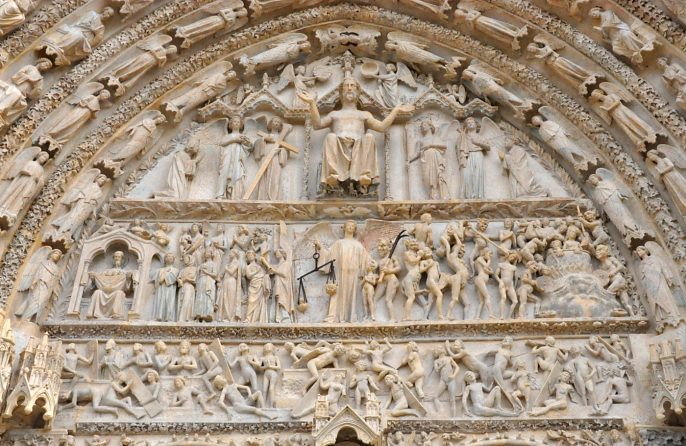
Le tympan du Jugement dernier est une merveille. Il est daté
des années 1240-1250.
On reconnaît, en bas, la Résurrection des morts ; au-dessus,
le Jugement des âmes qui sont séparées en élus
et damnés.
Tout en haut, le Christ-Juge, sur son trône, est entouré
d'anges portant les instruments de la Passion.
|
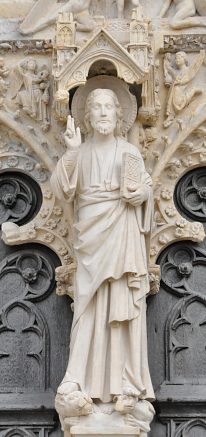
La statue du Sacré-Cœur
au centre du portail du Jugement dernier
(Sculpteur Caudron, années 1840). |
|
Le
portail du Jugement dernier (1240-1250) (1/2)
Le portail présente un large tympan à
trois niveaux entouré de voussures accueillant
la Cour céleste. Cette Cour se répartit
en six rangs de figurines où se succèdent
chérubins et séraphins, anges et archanges,
saints de l'Ancien Testament, puis autres saints et
saintes.
Le tympan propose l'iconographie traditionnelle du Jugement
dernier : la Résurrection des morts, le Pèsement
des âmes et le Christ-roi entouré d'anges.
Les deux premières scènes sont très
vivantes, notamment le Pèsement des âmes
où l'on retrouve l'opposition entre élus
et damnés. Les élus, qui affichent des
mines réjouies, avancent vers Abraham sous la
conduite des anges. Quant aux damnés, ils sont
priés de presser le pas en direction du chaudron
infernal où les diables vont les précipiter.
Il faut regarder ces démons de plus près
(voir photo en gros plan plus
bas).
L'abbé Crosnier, secrétaire général
du Congrès archéologique, écrit
dans son rapport de la visite des congressistes à
la cathédrale de Bourges
en octobre 1849 : «ne serait-ce donc pas assez
pour nous inspirer l'horreur du démon de le représenter
avec son corps velu, sa figure contournée et
grimaçante, ses cornes sur la tête et des
griffes aux mains et aux pieds ? Non, il faut,
dans l'esprit de l'artiste, que sa malice soit représentée
d'une manière plus frappante encore, et c'est
pourquoi il a couvert d'un épouvantable masque
toutes les parties saillantes de son corps, masque sur
les seins, sur le ventre, sur les genoux ; une longue
queue se termine par une tête de serpent qui presse
de ses cruelles morsures ceux qui, dans le trajet qui
sépare le plateau de la balance de la marmite
enflammée, voudraient ralentir le pas.»
--»» Suite 2/2
à droite.
|
|
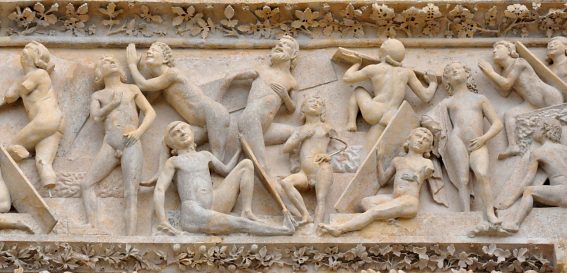
La Résurrection des morts dans le linteau du tympan du
Jugement dernier (1ère moitié du XIIIe siècle). |
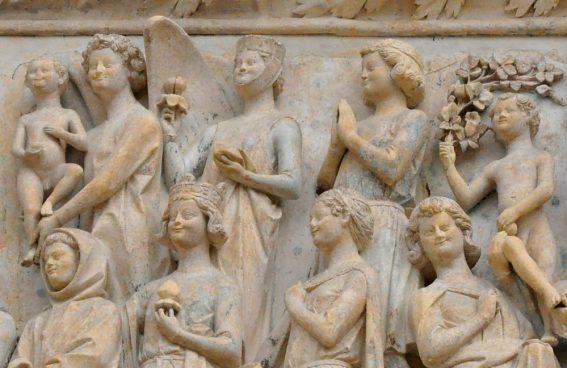
Après le jugement de l'archange saint Michel, les élus,
qui sont pris en charge par les anges, affichent des mines réjouies.
Tympan du Jugement dernier (1ère moitié du XIIIe
siècle).
Un franciscain se tient en bas à gauche : preuve de l'influence
de la doctrine de François d'Assise dès cette
époque. |
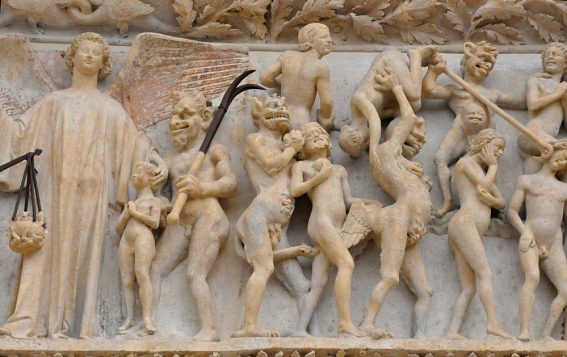
Scène du pèsement des âmes : les damnés
sont poussés vers l'entrée des enfers par les
diables.
Tympan du Jugement dernier (1ère moitié du XIIIe
siècle).

Le prince des démons attend le verdict de la balance
avec un sourire malicieux. Un crapaud s'accroche
à l'âme d'un élu pour essayer de faire pencher
la balance du côté du mal.
On notera que les parties saillantes des démons sont
couvertes de masques. |
|

Les damnés sont mis à bouillir par les démons
dans un chaudron
chauffé par le souffle enflammé du Léviatan.
Dans l'iconographie, la gueule du Léviatan symbolise
l'entrée des enfers. |
|
Le portail du Jugement dernier
(1240-1250) (2/2).
---»» Le portail central, comme d'ailleurs
les autres portails de la façade occidentale,
n'a plus de grandes statues. Le rapport du Congrès
archéologique tenu à Bourges
en 1898 révèle que «les grandes
statues décapitées par les protestants
en 1562, et jetées dans les remparts dont elles
bouchèrent les brèches, ont presque toutes
disparu.» Les six statues mutilées qui
se tiennent dans les ébrasements du portail central
ne présentent guère d'intérêt.
Bien sûr, ce portail ne nous est pas arrivé
intact du Moyen Âge. Deux des voussures furent
restaurées en 1833. Le sculpteur Romagnesi recréa
trente-huit statues de prophètes et de diacres.
Un travail si médiocre que le sculpteur Caudron
fut chargé de tout refaire dans la décennie
suivante. Ce dernier utilisa une technique ingénieuse,
celle du ciment de Vassy. Jean-Yves Ribault, conservateur
en chef du patrimoine, précise dans son ouvrage
cité en source que le ciment de Vassy, dit ciment
romain, est une «matière hybride et plastique,
à base de poudre de pierre et d'huile, qui durcissait
progressivement après moulage et façonnage.
Il suffisait alors de fixer les pièces ainsi
obtenues aux bas-reliefs à l'aide de goujons
de fer et de cuivre». C'est ainsi que fut restauré
le bas-relief de la Résurrection des morts. Trente
des trente-trois personnages n'avaient pas de tête,
de bras ou de jambes.
Malheureusement, cette espèce de mastic s'écaillait
quelques années après la pose. En 1848,
l'archéologue Didron à ce sujet rédigea
un rapport accablant.
Sources : 1) Un chef
d'œuvre gothique, la cathédrale de Bourges
de Jean-Yves Ribault, éditions Anthèse,
1995 ; 2) Sessions du Congrès archéologique
tenues à Bourges en 1849 et 1898.
|
|
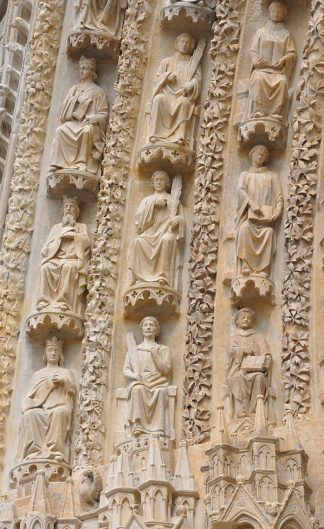
Saints et saintes dans les voussures du portail du Jugement
dernier.

Dans les années 1830, une quarantaine de statues
ornant les voussures de ce portail ont été refaites.
|
|
| LE PORTAIL OCCIDENTAL SAINT-ÉTIENNE |
|

Vue d'ensemble du portail Saint-Étienne.
La statue du saint sur le trumeau date des années 1840.
(Sculpteur Caudron). |
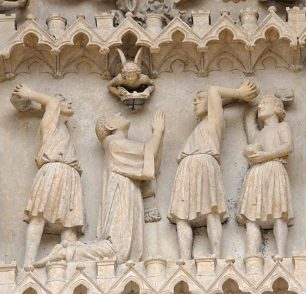
La Lapidation de saint Étienne, détail.
(vers 1230-1235)
Tympan du portail Saint-Étienne. |
|
|
| LE PORTAIL OCCIDENTAL SAINT-URSIN |
|

Vue d'ensemble du portail Saint-Ursin
(vers 1230-1235, restauré au XIXe) siècle. |

Saint Ursin prêchant devant la population de Bourges.
Détail du tympan du portail Saint-Ursin. |
|

Le tympan du portail Saint-Ursin est consacré à
la vie légendaire d'Ursinus (ou Ursin). Vers 1230-1235. |
|
Le
portail Saint-Ursin.
Daté des années 1230-1235, il illustre
quelques épisodes de la vie d'Ursinus, légendaire
apôtre et premier évêque de la ville
de Bourges.
Dans le compartiment du bas à droite, Ursin reçoit
sa mission. Saint Just l'accompagne pour partager ses
travaux. Ursin part, emportant avec lui le sang de saint
Étienne dans un petit coffre. Saint Just meurt
avant d'arriver à Bourges
et Ursin se charge de l'ensevelir. À gauche,
il commence sa prédication en Berry.
Dans le compartiment au-dessus, Ursin convertit Léocade,
qui est le souverain du pays, et consacre à saint
Étienne l'église qu'il a fait élever.
Enfin dans le haut du tympan, il baptise Léocade
et son fils Lusor.
Source : Congrès
archéologique,
session tenue à Bourges en 1849.
|
|
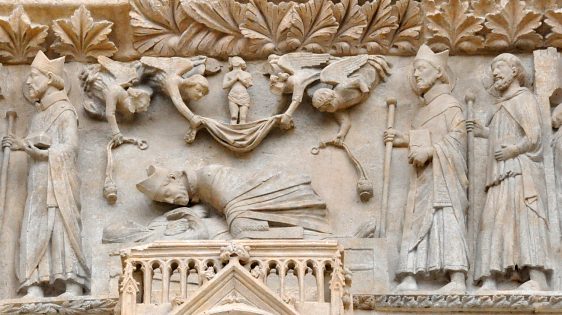
Au centre, saint Ursin se penche sur le corps de son ami Just
qu'il doit ensevelir.
À droite, Ursin et Just sont en route vers Bourges. Le
coffre que porte Ursin contient le sang de saint Étienne.
Tympan du portail Saint-Ursin (vers 1230-1235). |
|
|
La
vie de saint Ursin (1/3).
L'hagiographie est assez lâche sur le cas
saint Ursin. Selon les sources, son existence
est donnée au 1er, au IIe, voire, dans
certaines monographies de la cathédrale,
au IIIe siècle de notre ère. On
rapproche Ursin d'un juif dénommé
Nathanaël, devenu Ursin par le baptême
et disciple du Christ. Dans l'image de droite
tirée du tympan du portail de Saint-Ursin,
on voit Ursin agenouillé devant un pape
portant une clé. Ce n'est pas saint Pierre,
mais saint Clément. Nous sommes à
la fin du premier siècle. Comme cette version
de la vie d'Ursin semble avoir inspiré
les sculpteurs médiévaux, nous donnons
ici un résumé de la vie de ce prélat
légendaire tirée des annales hagiologiques
de la France. Les sources précisent que
cette vie a été écrite au
cinquième siècle par un auteur anonyme
(voir infra).
Ursin était l'un des soixante-douze disciples
de Jésus. Lui et d'autres compagnons furent
envoyés par les apôtres dans les
Gaules pour y répandre l'Évangile.
Secondé par Justus, il prit la direction
de Bourges,
emportant le sang du proto-martyr, Étienne.
Valère partit pour Trèves, Saturnin
pour Toulouse, Trophime pour Arles, Austremoine
pour l'Auvergne, etc. Peu avant d'arriver à
Bourges,
Justus mourut et fut enseveli par Ursin. Le disciple
commença alors sa prédication auprès
des pauvres et des vieillards, puis auprès
des «gens d'une médiocre naissance
et fortune», et enfin auprès des
hommes et des femmes d'un plus haut rang. Quelques
ennemis s'opposèrent à lui, envoyèrent
leurs chiens à sa poursuite, mais Ursin
«semait parmi le peuple une plus abondante
prédication, jusqu'à ce que (...)
une innombrable affluence des peuples accourût
à ses saints enseignements, et, telle que
le cerf altéré à une source
d'eau vive, réclamât de lui le breuvage
de la parole d'en haut et un prompt baptême
dans les fonts sacrés», écrit
notre hagiologue du XIXe siècle, Ch. Barthélemy.
À cette époque, un dénommé
Léocadius commandait en Bourgogne et en
Aquitaine au nom de l'empereur de Rome. Ce gouverneur
était un homme pieux, quoique païen,
et au courant de la nouvelle foi qui se répandait.
Le siège principal de son pouvoir se situait
à Lyon ; le second, à Bourges.
Là, il avait fait construire une écurie
qu'Ursin put bientôt récupérer,
purifier et transformer en église. Le prédicateur
y plaça le sang du bienheureux Étienne.
Et des miracles se produisirent.
Bientôt Ursin se mit à penser que,
pour mieux honorer cette relique, il fallait une
demeure plus digne. Les nobles qui venaient l'écouter
prêcher lui montrèrent alors le palais
de Léocadius. Demeure idéale en
effet, mais comment l'obtenir ? «Il
faut offrir des présents au prince et à
ses serviteurs», répondirent-ils.
Malheureusement, Ursin, appliquant les principes
de pauvreté, ne possédait rien.
Aussi les nobles et le peuple réunirent-ils
trois cents pièces d'or dans un vase d'argent
qu'ils lui donnèrent en l'engageant à
se rendre à Lyon, où se trouvait
Léocadius. --» Suite 2/3
à droite.
|
|
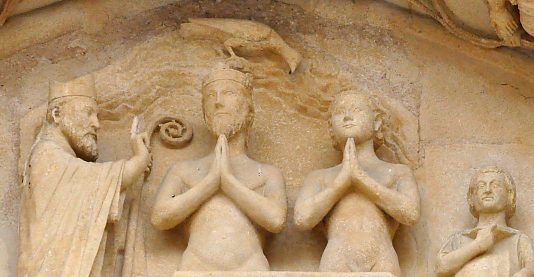
Le baptême de Léocadius et de Lusor par Ursin
(tympan du portail Saint-Ursin) |
|

Ursin est envoyé en mission dans les Gaules par
saint Clément pape,
qui tient la clé de saint Pierre. Il est accompagné
de Just, derrière lui.
Détail du tympan du portail Saint-Ursin (début
du XIIIe siècle). |
|
--»»
La vie de saint Ursin (2/3).
---»» Parvenu à Lyon, le prédicateur
se présenta et exposa l'objet de sa démarche.
Trouvant un gouverneur très ouvert à
ces idées nouvelles et offrant son palais
de bonne grâce, Ursin en profita pour prêcher
et pour l'exhorter à devenir fidèle
de l'Église. Léocadius, plein de
bonne volonté, prit trois pièces
d'or dans le vase, comme «arrhes de bénédiction»
et renvoya Ursin à Bourges
avec son présent.
Revenu dans sa ville, Ursin se mit à la
tâche : le palais du gouverneur fut nettoyé,
puis consacré à saint Étienne.
Les reliques y furent déposés solennellement.
L'ancienne église, qui était issue
des écuries, devint baptistère.
Peu de temps après, le gouverneur vint
à Bourges,
s'entretint avec Ursin et demanda à être
baptisé, ainsi que son fils Lusor. Par
la suite, Léocadius abandonna tous les
biens qu'il possédait à Bourges
et dans ses environs au profit d'Ursin et de l'Église.
Selon notre hagiographe, Dieu avertit Ursin du
jour de sa mort. Ayant laissé à
Sénécien, qui fut donc le deuxième
évêque de Bourges,
la charge de continuer son œuvre, il s'éteignit
dans la vingt-septième année de
sa prédication. --»» Suite
3/3
à gauche.
|
|
|
|
|
La vie
de saint Ursin (3/3)
---»» C'est une belle histoire. Pour Jean-Yves
Ribault, auteur, en 1995, d'un très docte ouvrage sur
la cathédrale Saint-Étienne, c'est sans doute
une invention. Il rapporte que, d'après Grégoire
de Tours,
c'est à la suite d'un songe «que l'on découvrit
dans une nécropole suburbaine le sarcophage miraculeusement
désigné» et qu'on dut y lire la mention
épigraphe d'un défunt nommé Ursinus.
Ensuite l'histoire s'enchaîna. On transforma Ursinus
en saint Ursin. Et Grégoire de Tours,
toujours selon Jean-Yves Ribault, élabora «un
récit fondateur, à l'aide sans doute de souvenirs
de famille». Le gouverneur Léocade, rencontré
plus haut, était en effet l'un de ses ancêtres.
Quant à l'hypothèse, difficilement soutenable, des disciples
envoyés en Gaule dès la fin du premier siècle, Jean-Yves Ribault
rappelle que, au VIe siècle, l'église de Bourges,
tout comme ses voisines (Toulouse, Arles, Issoire,
etc.), avait besoin de se doter d'une origine antique. Se
savoir rattachés à Rome, c'était consolider la communauté
chrétienne, renforcer sa foi et légitimer le pouvoir de l'évêque.
En matière d'hagiographie, les choses sont souvent
compliquées, parfois aussi un peu ubuesques. Dans la
Vie de tous les saints de France éditée
en 1860, Charles Barthélemy conte l'histoire de saint
Ursin telle qu'énoncée ci-dessus (et connue
d'après un auteur anonyme). Bathélemy prend
soin d'écrire que Grégoire de Tours,
dans les quelques détails qu'il nous a laissés
sur saint Ursin, a suivi des Actes, perdus pendant
longtemps, mais heureusement retrouvés en 1848 par
un savant, M. Faillon. Celui-ci les a tirés d'un manuscrit
de l'abbaye de Saint-Germain-en-Laye, conservé à
l'époque (1860) à la bibliothèque royale
de Paris. Faillon prouve d'abord (on ne sait comment) que
l'auteur des Actes de saint Ursin est antérieur
à Grégoire de Tours.
Puis il émet l'idée que cet auteur a vécu
à la fin du Ve ou au commencement du VIe siècle,
Grégoire de Tours
ayant vécu, quant à lui, dans la seconde moitié
du VIe siècle.
Charles Barthélemy rapporte cette conclusion de M.
Faillon : «Nous pensons que ces Actes sont un
monument fidèle de l'origine de l'Église de
Bourges,
et qu'étant plus anciens que saint Grégoire
de Tours,
on doit les préférer à la narration de
cet écrivain, dans les points où il a cru devoir
s'en écarter, comme aussi aux nouvelles légendes
de saint Ursin insérées dans la liturgie de
Bourges.»
Ainsi se trouve légitimé le récit de
la vie de saint Ursin rapporté par Charles Barthélemy
dans ses annales hagiologiques...
Rappelons qu'au XIXe siècle, après les épreuves
de la Révolution, la réaction catholique a consisté,
dans le traitement des récits hagiographiques, à
compulser des histoires pour servir à l'édification
des fidèles. Cet argument donnait bonne conscience,
mais ouvrait la voie à pas mal d'affabulations, justifiées
comme on pouvait.
Sources : 1) La vie de tous
les Saints de France, collection dirigée par Charles
Barthélemy, Bureau des annales hagiologiques de la
France, 1860 ; 2) Un chef d'œuvre gothique : la cathédrale
de Bourges par Jean-Yves Ribault, éditions Anthèse,
1995.
|
|
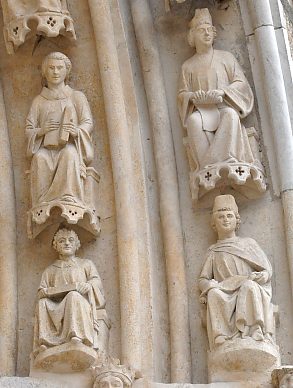
Extrait de la Cour céleste dans les voussures
du portail de Saint-Ursin. |
| LA FRISE D'ARCATURE DANS LES RETOMBÉES
D'OGIVES |
|

Illustrations de la Genèse dans les retombées d'ogives du portail
central.
Dans le haut de l'image, on aperçoit la partie basse de cinq
des six statues qui subsistent dans les niches des ébrasements
de la façade occidentale. |

L'Arche de Noé dans l'histoire de la Genèse
Frise de l'arcature de la façade occidentale,
XIIIe siècle, restauré au XIXe. |
|
La frise
d'arcature dans les retombées d'ogives. Même
si les huguenots ont copieusement saccagé la façade
en 1562 et fait disparaître la quasi-totalité
des grandes statues, il nous est encore possible d'admirer
la superbe frise d'arcature qui longe les cinq portails de
la façade occidentale, sous les niches contenues dans
les ébrasements. Elle aussi savamment vandalisée
en 1562, cette frise a fait l'objet d'une restauration dans
les années 1840, notamment les scènes de la
Genèse sur le portail central et les deux portails
sud (Saint-Étienne et Saint-Ursin).
Sur les deux portails nord (Vierge et Saint-Guillaume) figurent
des scènes de l'Enfance du Christ et de la vie de Marie,
sculptées lors de la reconstruction de ces deux portails
à la suite de l'écroulement de la tour nord
en 1506.
Pour ce qui est de la Genèse (Création du monde,
Adam et Ève, histoire de Noé), les historiens
de l'art restent interloqués par l'absence totale d'ordre
chronologique dans la succession des scènes. Jean-Yves
Ribault dans son ouvrage consacré à la cathédrale
écrit qu'on y observe «des scènes énigmatiques,
des lacunes, des juxtapositions inattendues, et du point de
vue matériel des ruptures de maçonnerie, des
raccords hétéroclites, sans compter les incertitudes
dues aux restaurations modernes».
Aidé par une étude de l'historienne Laurence
Brugger, celui-ci évoque la piste d'une source hébraïque
dans l'élaboration des scènes. Argument que
Laurence Brugger étaye par la présence à
Bourges
de chrétiens hébraïsants, réunis
autour de Guillaume de Bourges, juif converti par saint Guillaume.
Source : Un chef d'œuvre
gothique, la cathédrale de Bourges
par Jean-Yves Ribault, éd. Anthèse, 1995.
|
|

L'Annonciation dans la frise de l'arcature.
Début du XVIe siècle. |

Jésus devant Caïphe dans la frise de l'arcature.
Début du XVIe siècle. |

Scènes de la vie de Jésus (Jésus au jardin des
Oliviers et autre scène non identifiée)
Frise de l'arcature de la façade occidentale, début
du XVIe siècle. |

Scènes de la vie de Jésus (Jésus et la Samaritaine,
Entrée de Jésus à Jérusalem)
Frise de l'arcature de la façade occidentale, début
du XVIe siècle. |
| LE PORTAIL OCCIDENTAL DE LA VIERGE |
|

Vue d'ensemble du portail de la Vierge.
Il a été reconstruit dans les années 1510-1515
après la chute de la tour nord en 1506. |

Les voussures du portail de la Vierge, détail. |
|
|
| LE PORTAIL OCCIDENTAL SAINT-GUILLAUME |
|
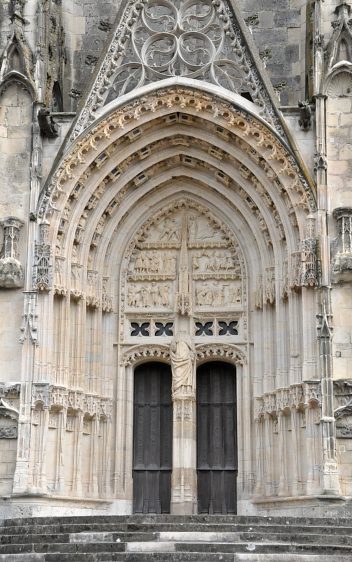
Vue d'ensemble du portail Saint-Guillaume.
Comme le portail de la Vierge, il a été reconstruit
dans les années 1510-1515 après la chute de la
tour nord en 1506. |
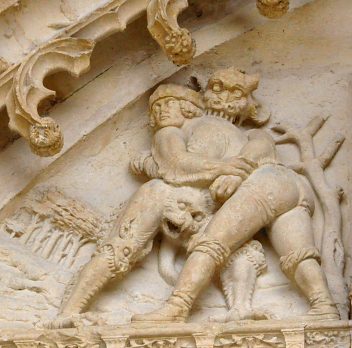
Guillaume, chez les Cisterciens de Pontigny,
est aux prises avec les tentations du démon (?) |

La Fuite en Égypte.
Bas-relief de la vie de Marie dans les arcatures des portails
nord
Début XVIe siècle. |
|
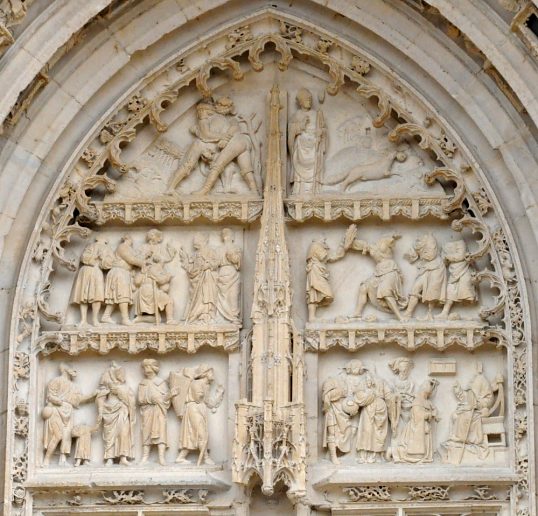
Le tympan du portail Saint-Guillaume illustre des épisodes
de la vie de saint Guillaume, archevêque de Bourges.
Il est l'œuvre des sculpteurs du début de la Renaissance,
vers 1510-1515. |
|
Le
portail Saint-Guillaume.
Très endommagé lors de la chute
de la tour nord en 1506, il a été rebâti
dans les années 1510-1515 (comme le portail
de la Vierge).
L'archivolte est orné d'anges en prière
ou jouant de la musique. Le tympan illustre la vie de
saint Guillaume, archevêque de Bourges.
Il est difficile d'associer les scènes du tympan
à des épisodes précis de la vie
de ce saint.
Selon le père Giry, hagiographe bien connu au
XIXe siècle, l'existence de Guillaume se caractérise
par une douceur d'âme, une tempérance,
une recherche du calme et de la solitude, mêlées
à une mortification permanente.
Il fut d'abord moine au monastère de Grandmont,
près de Limoges. En butte à l'exaspération
que suscitait le trop-plein de ses vertus, il se réfugia
chez les Cisterciens de Pontigny. Peu après,
il fut nommé abbé de Fontaine-Jean (diocèse
de Sens),
puis abbé de Châlis (diocèse de
Senlis). Enfin, et à son grand dam, il fut nommé
archevêque de Bourges
en 1200.
Prières, pauvreté, mortifications, refus
de toute violence marquent son épiscopat. Le
Père Giry rapporte aussi quelques miracles (dont
la guérison d'un bras paralysé). Guillaume
refusa aussi l'usage de la violence contre les Albigeois.
Des gens du roi Philippe Auguste prirent cette attitude
pour de la faiblesse et voulurent attenter aux droits
de l'Église. Mais Guillaume leur tint tête
et en acquit l'affection du roi. Guillaume s'éteignit
en janvier 1209. Sur sa tombe se produisirent quelques
miracles. Source : Vie
des saints par le père
Giry, corrigée & complétée
par Paul Guérin, éditions de 1862.
|
|
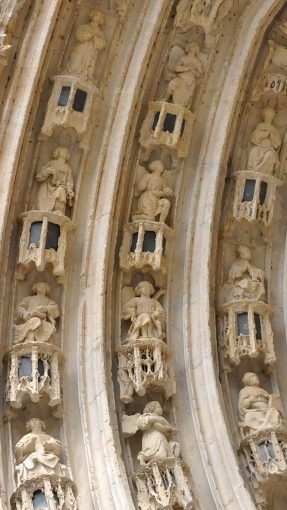
Détail des voussures du portail Saint-Guillaume. |

Frise d'arcatures dans les ébrasements du portail Saint-Guillaume.
Dans les deux portails de gauche de la façade occidentale
(Vierge et Saint-Guillaume),
la frise illustre des scènes de l'Enfance du Christ et
de la vie de Marie.
Début du XVIe siècle. |
|
|
|

Aspect général du portail méridional. |
|
Le
portail méridional (1/2).
Tout comme le portail septentrional (non donné
dans cette page et très délabré),
il n'est pas contemporain des portails de la façade
occidentale. En effet, les sculptures des ébrasements
(largement illustrées ci-contre et ci-dessous)
affichent un caractère roman, qui cependant tend
déjà vers le gothique. L'explication nous
en est donnée par les historiens.
Au tout début du XIIIe siècle, les autorités
décidèrent de remplacer la cathédrale
romane par une cathédrale gothique plus vaste.
Lorsqu'on démolit le chœur et les ailes
de l'édifice, les portails romans, qui avaient
été sculptés vers 1160, furent
démontés et non détruits. L'objectif
était déjà de s'en resservir pour
l'ornementation des futurs portails nord et sud de la
nouvelle cathédrale. On en imagine aisément
les raisons : la qualité des œuvres, le
coût moindre, le temps gagné. De plus,
les thèmes iconographiques de ces portails (Christ
en majesté au sud et Vierge en majesté
au nord) s'inséraient parfaitement dans la vision
doctrinale voulue par l'évêque et le chapitre.
---»» Suite 2/2
à droite.
|
|

Détail des ornements romans
dans les voussures et les ébrasements du portail sud. |
|

Portes, trumeau et tympan du portail méridional. |
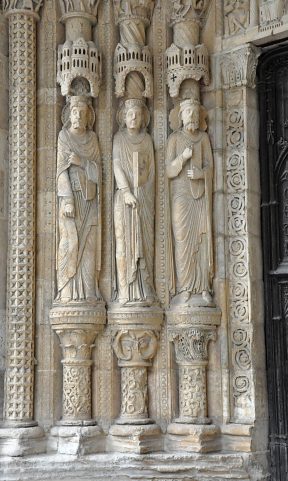
Trois personnages couronnés.
Piliers gauches du portail méridional.
|
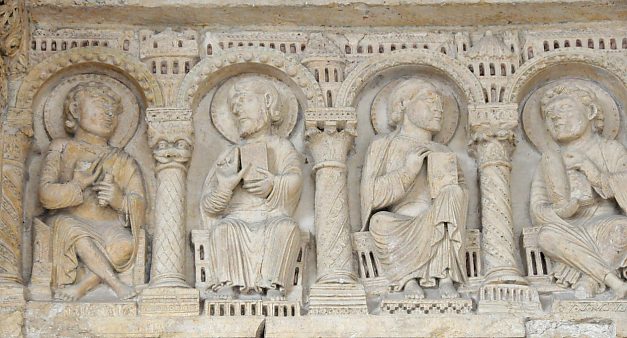
Le linteau du tympan accueille les douze apôtres (vers 1160). |
|
Le
portail méridional (2/2).
---»» Les deux portails sont enrichis chacun
d'un porche. Le plus élégant est le portail méridional.
Au centre du tympan, dans une mandorle, le Christ
nimbé (i.e. avec une auréole) tient le Livre
d'une main et bénit de l'autre. Est-il juge ou docteur ?
L'abbé Crosnier, secrétaire général du Congrès archéologique
et auteur du rapport de la visite des congressistes
à Bourges
en 1849, pose la question. Il rappelle aussi que c'était
là un grand sujet de débat au XIIIe siècle.
Autour de la mandorle figurent les quatre symboles du
tétramorphe.
Au-dessous, le linteau réunit les douze apôtres.
L'abbé Crosnier signale qu'ils sont à
leur place naturelle. En effet, si le Christ est regardé
comme juge, ils doivent juger avec lui. S'Il est regardé
comme docteur, ils sont en charge de la propagation
de sa divine doctrine.
Les sujets sculptés dans les chapiteaux qui surmontent
les colonnes du portail se rattachent à l'un
et à l'autre thème. Ils indiquent les
efforts du Mal contre le Bien, la lutte du vice contre
la vertu. On y voit la chute d'Adam ainsi qu'un griffon
et un dragon qui se disputent une petite âme (au
centre de la photo ci-dessous). À côté,
Samson déchire la mâchoire d'un lion, et
un dragon attaque un homme à terre. L'abbé
Crosnier ajoute : «Il est impossible de ne pas
reconnaître ici ce duel terrible entre le vice
et la vertu, qui a commencé avec le monde, le
génie du mal dont J.-C., par sa doctrine, est
venu affaiblir l'empire en attendant qu'à la
fin des siècles il l'enchaîne pour l'éternité.»
À part les scènes historiées, la
décoration montre une abondance de motifs romans
traditionnels : l'aspect géométrique avec
les carrés, les cercles, les triangles combinés
en damiers, etc., tout comme l'aspect végétal
avec les fleurs et les feuilles stylisés.
Sources : 1) Congrès
archéologique de France, session tenue à
Bourges en 1849 ; 2) Un chef d'œuvre gothique
: la cathédrale de Bourges par Jean-Yves
Ribault, éditions Anthèse, 1995.
|
|
|

Ces magnifiques sculptures romanes dans les chapiteaux des piliers
droits du portail sud représentent le combat du vice contre
la vertu.
Les sculptures sont datées aux alentours des années
1160. |
|
Qui a
payé la construction de la cathédrale Saint-Étienne
(1/2) ?
L'origine du financement est souvent un thème oublié
des historiens de l'architecture. Il est vrai que les sources
n'abondent pas. Nous sommes à peu près convenablement
renseignés pour la cathédrale de Bourges
et Jean-Yves Ribault développe ce sujet dans son ouvrage.
Tout part d'une donation de 500 livres en monnaie de Gien,
payable en sept ans, faite par l'archevêque Henri
de Sully en 1195. À cause de sa mauvaise santé,
il sent sa mort approcher et veut œuvrer pour son église.
Selon Jean-Yves Ribault, l'interprétation des termes
latins utilisés par notre prélat montre que
celui-ci souhaitait la construction d'un nouvel édifice
et non pas de simples réfections sur le bâtiment
roman qui existe alors, un bâtiment d'ailleurs qualifié
de «peu solide» après les fouilles du XIXe
siècle.
À ces 500 livres, l'archevêque, dans sa donation,
joint «toutes les taxes qui nous reviendront désormais,
jusqu'à la fin de notre vie, sur les justiciables qui
comparaîtront devant notre tribunal». Il s'agit
donc de donner à la fabrique les profits exceptionnels
de gestion tirés des amendes, mais en aucun cas ce
qu'on appellerait aujourd'hui le fond de roulement. Bizarrement,
Jean-Yves Ribault écrit que le prélat donne
à la fabrique «les profits qu'un archevêque
tire de ses droits de juridiction, de chancellerie ou de simples
secrétariat, ensemble de taxes, amendes et redevances
diverses dont le montant, variable d'un exercice à
l'autre, est certainement fort important.» Déduction
un peu surprenante car les «redevances diverses»
font bien partie du fond de roulement. À moins qu'il
ne faille comparaître devant le tribunal ecclésiastique
pour les verser...
Quoi qu'il en soit, 500 livres et le reste, cela fait déjà
une forte somme. Il faut y ajouter les dons et legs traditionnels
des particuliers, ainsi que les revenus provenant des tournées
de prédication organisées par Henri de Sully
dans sa province. Il faut aussi ajouter le rôle des
reliques.
Après la mort d'Henri de Sully, l'abbé cistercien
Guillaume du Donjon lui succède en 1199. Il
est désigné par Eudes de Sully, évêque
de Paris et frère d'Henri. Tout dévoué
à la construction de sa cathédrale, Guillaume
reçoit d'Eudes de Sully une relique insigne : un morceau
de la mâchoire de saint Étienne. Et d'autres
reliques de la part du chantre de Chartres.
Les offrandes suscitées par toutes ces reliques furent
affectées au chantier. Guillaume mourut en 1209. Il
prit froid alors qu'il prêchait dans la cathédrale
(le chœur en construction était mal raccordé
à la nef romane qui subsistait en attendant la nouvelle).
Son corps fut inhumé dans l'église
basse. Il attira aussitôt une foule de pèlerins
qui laissèrent vraisemblablement de nombreuses aumônes.
Tous ces dons et legs ne suffisaient pas et la fabrique dut
recourir à l'emprunt. En 1237, on s'en alla présenter
au pape Grégoire IX la piteuse situation du budget
diocésain, criblé de dettes. Le résultat
fut que seules les dettes vraiment utiles à l'Église
devaient «être prises en compte». Aurait-on
décidé de ne pas honorer les «petites»
dettes ?...
En 1241, ce même pape sollicita officiellement l'aide
des habitants du diocèse.
Autre financement possible : l'abbé J.J. Bourassé
écrit, dans son ouvrage de 1880, que, selon certains
auteurs, Philippe le Bel avait dans une grande mesure contribué
à l'achèvement complet des voûtes en 1315.
Il ne cite malheureusement pas le nom de ces auteurs. Jean-Yves
Ribault cite à son tour cette information et parle
d'un don du roi de quarante livres tournois en 1313 pour consolider
l'édifice que les infiltrations d'eau fragilisaient
dangereusement. --»» Suite 2/2
à droite.
|
|
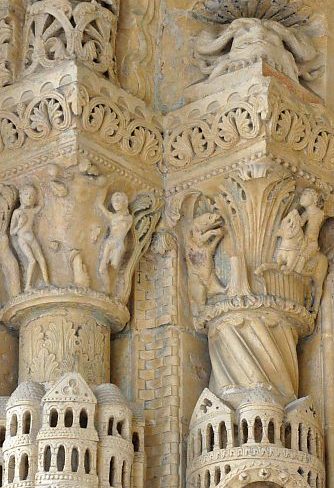
Sculptures et chapiteaux romans des piliers gauches (vers 1160).
Portail sud de la cathédrale. |
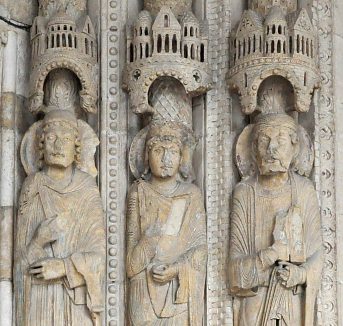
|
|
Qui a payé la construction
de la cathédrale Saint-Étienne (2/2) ?
---»» C'est un don qui doit être souligné car les têtes couronnées
intervenaient rarement, seulement en cas de péril immédiat,
lorsqu'il fallait entreprendre des travaux rapidement et qu'on
ne pouvait pas attendre que dons et quêtes viennent financer
l'urgence. La cathédrale Notre-Dame
à Évreux
est presque une exception : Louis XI lui attribua des fonds
importants par dévotion pour la Vierge.
Arriva le temps des chapelles latérales. Le duc Jean
de Berry, grand donateur de la cathédrale, fit
commencer la construction de la chapelle
du Sacré-Cœur,
la plus grande des chapelles latérales. L'élan
était donné. Au XVe siècle, nobles, membres
du haut-clergé, riches marchands, dont Jacques Cœur,
vont suivre son exemple.
La technique était bien rodée : une chapelle
latérale venait s'insérer entre deux arcs-boutants
consécutifs. Le mur gouttereau extérieur était
d'abord évidé. Puis, quelques mètres
plus loin, l'espace était fermé par un mur d'appui.
Ce mur possédait en général une grande
baie pour abriter un futur vitrail. Au-dessus, la chapelle
était fermée par une voûte sur croisée
d'ogives.
Posséder une chapelle dans une cathédrale était très valorisant
pour son propriétaire : son statut social s'en trouvait confirmé
et l'espérance de son salut, renforcée. D'autant plus qu'il
devait pourvoir aussi à l'ornementation de sa chapelle : mobilier,
statues, vitraux, vêtements sacerdotaux, etc.
On se reportera avec intérêt au financement de
la cathédrale
Notre-Dame d'Amiens
et à celui de la grande église Notre-Dame
à Dole,
dans le Jura. À Dole,
au XVIe siècle, avant de démarrer les travaux,
le financement s'est appuyé sur un intéressant
processus de ventes d'espaces sur plan.
Sources : 1) Un chef d'œuvre
gothique : la cathédrale de Bourges par Jean-Yves
Ribault, éditions Anthèse, 1995 ; 2) Les
plus belles cathédrales de France par J.J. Bourassé,
Tours, 1880 ; 3) La cathédrale Saint-Étienne
de Bourges, éditions Ouest-France, texte de Jean-Yves
Ribault.
|
|
«««---
Les trois grandes statues des piliers droits (vers 1160) : à
gauche, le prophète Jonas ; à droite, Moïse.
Portail sud de la cathédrale, art roman. |
|

Portail méridional : le Christ est entouré du Tétramorphe.
Dans le ruban du-dessous : les douze apôtres.
Art roman, vers 1160. |
| L'ARCHITECTURE INTÉRIEURE, LA NEF ET LES
GRANDES VERRIÈRES |
|
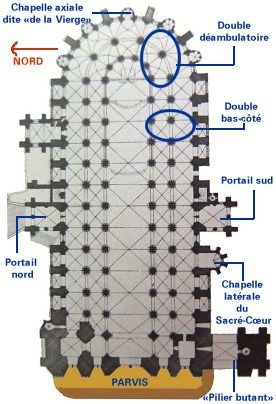
Plan de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges.
(d'après Desmarest, 1943).
Saint-Étienne est une cathédrale sans transept.
|

«Halte pendant la fuite en Égypte»
de Jean-Hilaire Belloc (1787-1866). |
|
Les
vitraux des fenêtres hautes du chœur.
Ils sont datés du début du XIIIe siècle,
tout comme ceux du déambulatoire. «(...) Ce sont
de majestueuses figures isolées sous architecture,
tantôt présentées de face tantôt en léger mouvement,
toutes identifiées par de grandes inscriptions
parfaitement lisibles du sol» [Corpus Vitrearum].
Ces vitraux se présentent sous la forme d'un double
cortège qui se déploie de part et d'autre
du double vitrail axial : saint
Étienne offre sa cathédrale à la Vierge qui
porte l'Enfant Jésus. Vers le sud, on voit saint
Pierre (ci-contre) qui conduit les évangélistes
et les apôtres auxquels ont été rajoutés trois
saints confesseurs ou martyrs.
Au nord, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament
conduits par le Précurseur et dernier des prophètes,
saint Jean-Baptiste. On pourra se reporter aux
grands personnages du chœur de la cathédrale
Saint-Pierre de Beauvais
qui rappellent ceux de Bourges.
Source : Les vitraux
du Centre et des Pays de la Loire, Corpus Vitrearum,
éditions du CNRS, 1981.
|
|
|

Saint Paul
dans les grandes verrières
(baie 202, vers 1220-1225). |
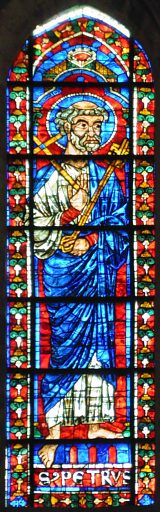
Saint Pierre
dans les grandes verrières
(baie 202, vers 1220-1225). |
|
|
|
|

Toute la beauté de l'architecture intérieure de la cathédrale
Saint-Étienne
ressurgit dans cette vue de l'élévation sud. |
|
Architecture
intérieure.
Le mode d'élévation dans la nef de la cathédrale
de Bourges
est unique dans le monde gothique. Les historiens désignent
par le titre de Maître de Bourges l'architecte
médiéval inconnu qui a réalisé cette splendide prouesse.
Cette élévation est en effet l'une des trois merveilles
de la cathédrale Saint-Étienne. La photo ci-dessus
en donne une bonne illustration.
On voit une série de grandes arcades, hautes de 19 mètres,
qui ouvre le champ de vision vers la deuxième élévation,
celle qui borde le premier bas-côté. Il n'y a donc pas
de tribune. Les poussées latérales sont équilibrées
par des arcs-boutants ad hoc. On constate aussi
la similarité du dessin tripartite de l'élévation
de la nef principale et celui de l'élévation du premier
bas-côté : arcades, triforium identique et fenêtres.
Évidemment, la part des arcades dans la hauteur diffère.
Pourtant, cela ne retire rien à l'impression globale,
tout à fait extraordinaire, qui fait croire, par la
fusion des volumes, que l'élévation de la cathédrale
possède cinq (!) niveaux. La multiplicité des fenêtres
favorise l'éclairage de l'ensemble, qui est tout à fait
satisfaisant.
Cette remarquable imagination d'un maître dans l'art
de construire n'a pas plu à tous les visiteurs. Ainsi,
Prosper Mérimée écrit dans ses Notes d'un
voyage en Auvergne, publiées en 1838 : «(...) l'œil
le moins exercé est d'abord choqué du contraste entre
la hauteur inusitée des arcades et le peu d'élévation
des galeries supérieures et des fenêtres qui les surmontent
; ces galeries sont basses et comme écrasées.»
En somme, Mérimée regrette que le Maître de Bourges
n'ait pas respecté la proportion traditionnelle attribuée
aux arcades dans l'élévation totale. Certes, il fallait
dégager le champ de vision sur l'élévation du bas-côté,
mais le «véritable système gothique» [Mérimée] n'en
a pas moins été violé, tout comme le goût artistique.
Pour notre inspecteur des Monuments historiques, on
a rarement vu la hauteur des grandes arcades dépasser
la moitié de la hauteur totale. Il termine sa critique
par un argument original : «Le raccourcissement des
fenêtres produit encore un effet plus fâcheux, c'est
de diminuer l'impression de surprise que cause dans
la fabrique gothique une voûte séparée des piliers qui
la soutiennent par un vide immense.»
La voûte
de la cathédrale Saint-Étienne est sexpartite : chaque
voûte couvre deux travées et conduit à une alternance
de piliers forts et de piliers faibles. Ici, la caractéristique
est qu'on ne perçoit pas cette différence dans l'apparence
des piliers (une dissimulation à l'évidence voulue par
le Maître de Bourges). Les piliers forts ont
un diamètre à la base de 2,58 mètres ; les piliers faibles,
de 2,20 mètres. Leur parement est identique : huit colonnettes.
L'autre (petite) différence entre les forts et les faibles
vient du nombre de colonnettes au-delà du chapiteau,
c'est-à-dire à hauteur du triforium jusqu'à la
voûte : cinq contre trois (voir photo
ci-dessus).
On se reportera à la basilique Saint-Jean-Baptiste
de Chaumont
pour une alternance «pile forte-pile faible» bien visible.
Sources : 1) Un chef
d'œuvre gothique : la cathédrale de Bourges par
Jean-Yves Ribault, éditions Anthèse, 1995 ; 2) La
cathédrale Saint-Étienne de Bourges, éditions Ouest-France,
texte de Jean-Yves Ribault ; 3) Notes d'un voyage
en Auvergne de Prosper Mérimée, éditions Adam Biro,
1989.
|
|
«««--- Deux visages
de prophètes dans les fenêtres hautes du chœur.
Le premier est Daniel, le deuxième n'est pas identifié
(vers 1220-1225). |
|
|

Les grandes fenêtres du chœur (vers 1220-1225).
À gauche, le vitrail axial : la Vierge et saint Étienne. Les
autres vitraux sont occupés par les apôtres.

Les verrières du chœur de la cathédrale de Bourges sont loin
d'égaler en splendeur celles du chœur de la cathédrale
de Tours. |

Le double bas-côté sud.
Le bas-côté extérieur (partie droite de la photo)
a 9 mètres de haut et 5 mètres de large.
Ce bas-côté donne accès aux chapelles latérales. |
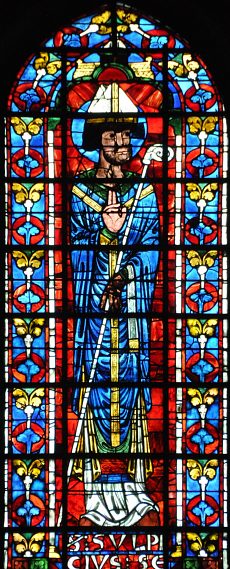
Vitrail (vers 1220-1225) de Saint Sulpice le Bon,
ancien archevêque de Bourges. |
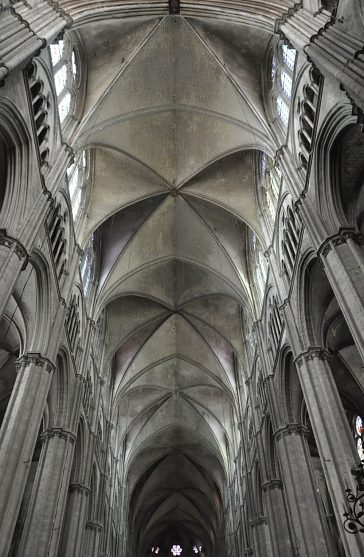
La voûte sexpartite culmine à 36 mètres
sous clé.
Quand le Maître de Bourges a choisi la voûte sixpartite,
la voûte quadripartite
avait déjà commencé à s'imposer
dans les grandes cathédrales de France. |

Statue de la Vierge à l'Enfant. |
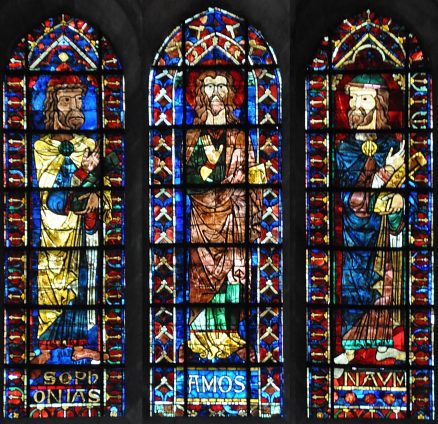
Prophètes Sophonias, Amos et Naum.
Vitrail des grandes fenêtres du chœur
(Vers 1220-1225). |
|
|
|
| LA NEF ET SON MOBILIER - LE GRAND ORGUE |
|

Le grand orgue et le «grand housteau». |

La Vierge à l'Enfant
Statue en argent. |
|
L'orgue
et le «grand housteau».
La tribune à encorbellement du grand orgue date de 1599.
Flanquée de deux très beaux balcons circulaires joliment
sculptés, elle repose sur une grande poutre du XVe siècle,
elle-même sculptée d'anges musiciens. Malheureusement,
le bas de la tribune est la plupart du temps plongé
dans la pénombre.
Le buffet d'orgue est en chêne sculpté et date de 1663.
L'orgue date de 1985 (facteur Kern) et rassemble des
éléments des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Derrière l'orgue se trouve l'une des plus belles verrières
de la cathédrale, que l'on appelle le «grand housteau».
Celui-ci comprend six lancettes à personnages
et une rose.
Mise en place par Guy de Dammartin, architecte du duc
Jean de Berry à la fin du XIVe siècle, la rose,
donnée ci-contre, est assez sobre : elle ne reçoit
que des motifs de mosaïque avec la colombe du Saint-Esprit
en son centre.
Les personnages des six lancettes (milieu du XVe siècle)
situées au-dessous de la rose sont malheureusement partiellement
cachés par le grand orgue. On trouve de gauche à droite
: les saints Guillaume et Jacques, l'Annonciation, puis
saint Étienne et saint Ursin (?).
La baie a été restaurée en 1546 par le maître verrier
Jean Lescuyer. Vers 1920, l'atelier Chigot a refait
toutes les têtes des personnages, sauf une. Elles ont
été remplacées au milieu du XXe siècle.
Source : Les vitraux
du Centre et des Pays de la Loire, Corpus Vitrearum,
CNRS, 1981.
|
|
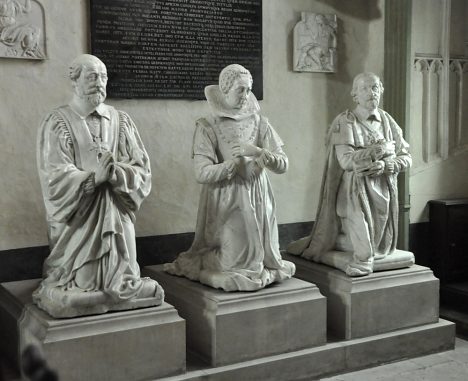
Chapelle Jacques-Cœur : trois statues de la famille de
l'Aubespine
dues au ciseau du sculpteur flamand Philippe de Buyster (3e
quart du XVIIe siècle).
De gauche à droite : Guillaume de l'Aubespine, conseiller
d'État (†1629,)
sa femme Marie de la Châtre, leur fils Charles de l'Aubespine
qui fut garde des Sceaux (†1653). |

L'un des deux balcons circulaires de la tribune du grand
orgue
de la cathédrale. La tribune est datée de
1599. |

Le prophète Malachie
Grandes fenêtres du chœur.
Vers 1220-1225. |
|

La chaire à prêcher (XIXe siècle ?)
ne contient rien de remarquable.
| Le Père céleste
dans une clé de voûte ---»»» |
|

Priant du maréchal de Montigny (†1617).
Sa grande ressemblance avec Henri IV
a été soulignée par Prosper Mérimée.
Œuvre du sculpteur Michel Bourdin. |
 |
|

Écu aux armes du Berry tenu par quatre anges dans le
«grand housteau». |
L'Annonciation dans
le «grand housteau» (milieu du XVe siècle)
---»»»
(L'intervalle entre les deux lancettes a été
réduit.) |
|
|

Le grand orgue de la cathédrale Saint-Étienne.
Derrière, la verrière de la fin du XIVe siècle est appelée le
«grand housteau». |
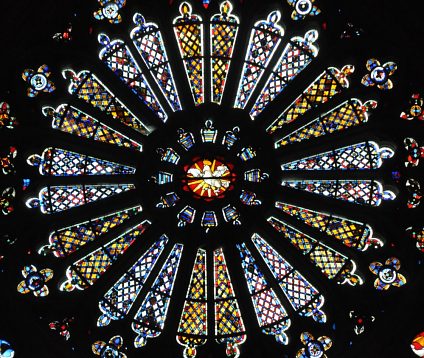
La rose du «grand housteau» sur la façade
occidentale (vers 1395).
Au centre, la colombe du Saint-Esprit.
Les rayons de la rose accueillent des motifs de mosaïque assez
simples. |

Porte gothique embellie de personnages sculptés. |

L'horloge astronomique de 1424
a été restaurée dans les années
1990. |

«L'Adoration des bergers»
Tableau de Jean Boucher (1568-1633).
1ère moitié du XVIIe siècle.
Le peintre avait l'habitude de se représenter dans ses
toiles : c'est l'homme
qui regarde vers la droite, d'un air pensif, dans la partie
gauche de la toile. |
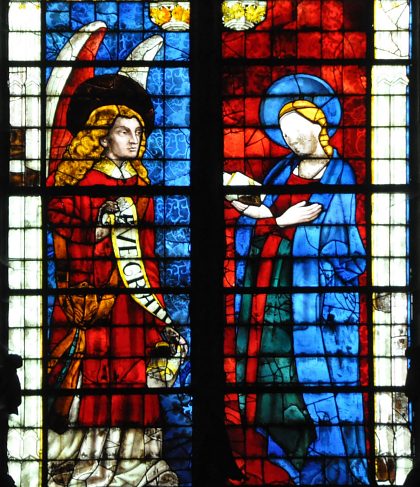 |
|
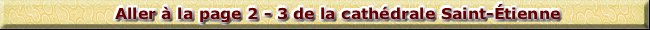 |
Documentation : «Un chef d'œuvre
gothique, la cathédrale de Bourges» de Jean-Yves Ribault,
éditions Anthèse, 1995
+ «La cathédrale de Bourges et ses vitraux»
par Jean Verrier, éditions du Chêne, Paris.
+ «La cathédrale Saint-Étienne de Bourges»,
éditions Ouest-France, texte de Jean-Yves Ribault.
+ «Les Grands vitraux de Bourges» d'Hervé Benoît,
© Centre Saint-Jean de la Croix, 2001
+ «Les plus belles cathédrales de France» par J.J.
Bourassé, Tours, 1880
+ «Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire», Corpus
Vitrearum, CNRS, 1981
+Sessions du Congrès archéologique de France tenues
à Bourges en 1849 et 1898
+ «Dictionnaire des églises de France», ©
éditions Robert Laffont, 1967
+ «La vie de tous les Saints de France», collection dirigée
par M. Ch. Barthélemy, Bureau des annales hagiologiques de
la France, 1860
+ «Vie des saints» par le père Giry, corrigée
& complétée par Paul Guérin, éditions
de 1862.
+ «Notes d'un voyage en Auvergne» de Prosper Mérimée,
éditions Adam Biro, 1989 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|