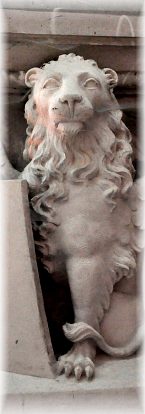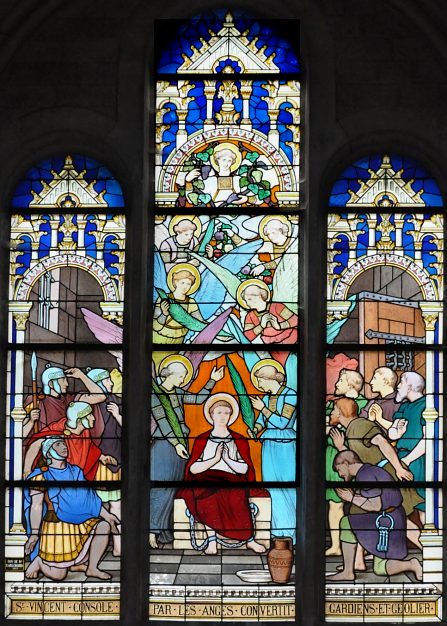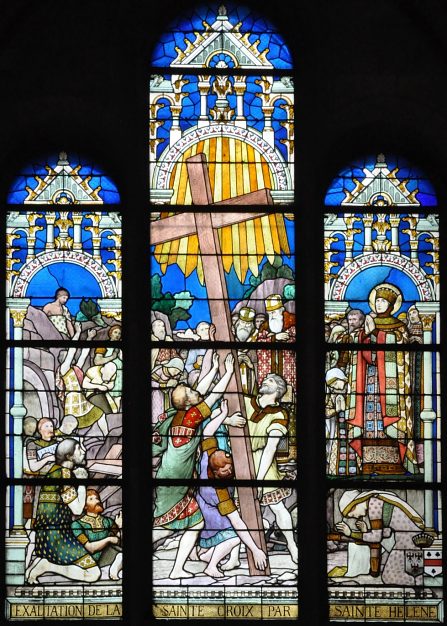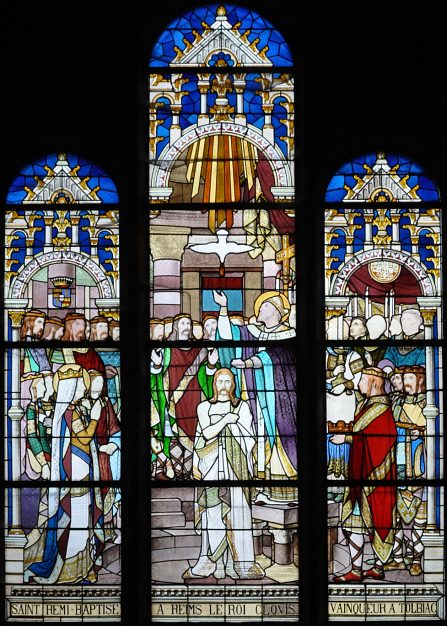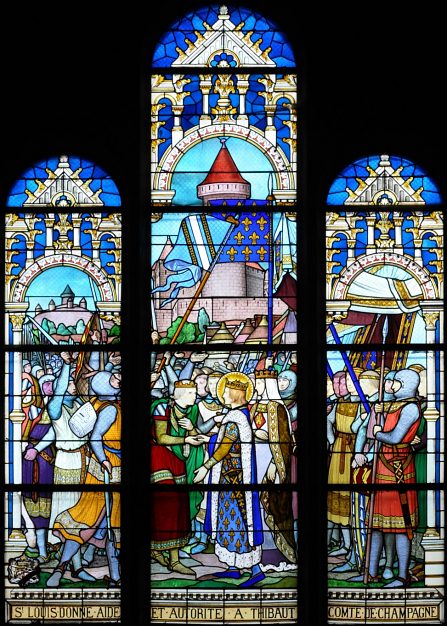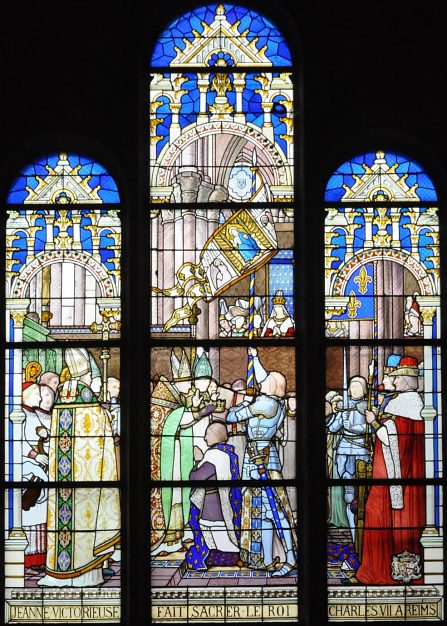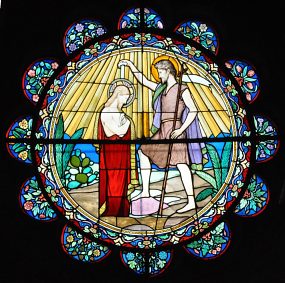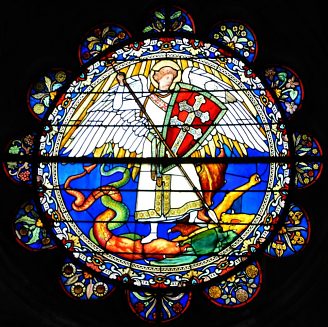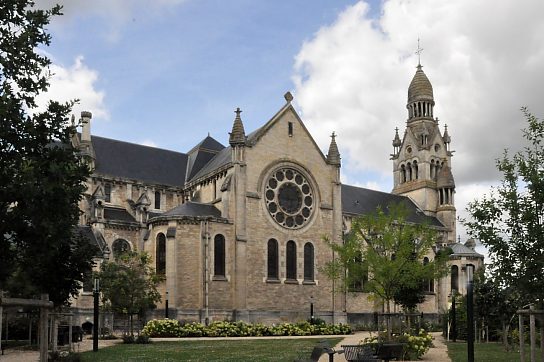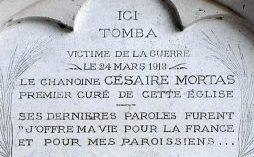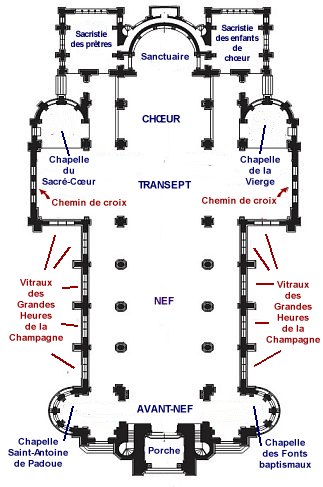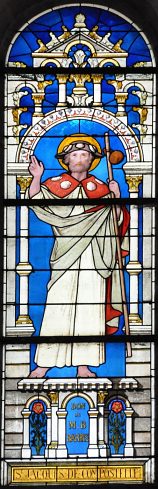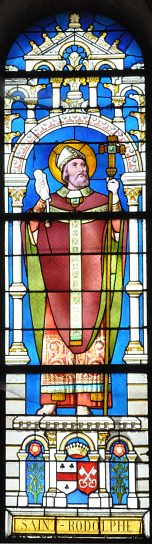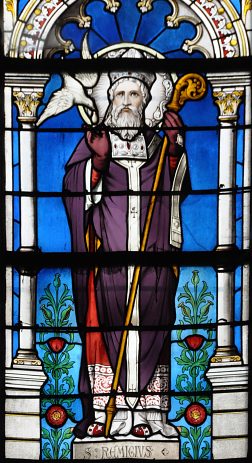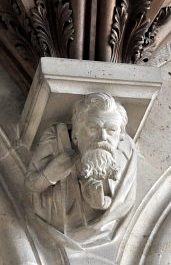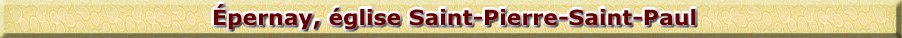 |
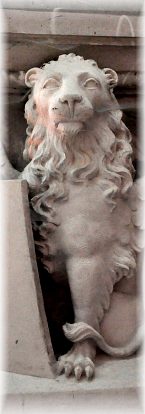 |
À la fin du XIXe siècle,
Épernay,
pour son besoin cultuel, dispose, en son centre, de l'ancienne église
Notre-Dame (qui sera démolie en 1909). Cependant, la ville
s'étend vers le sud et les habitants des nouveaux quartiers
réclament la création d'une paroisse avec son église
propre. En 1893, une pétition conduit le Conseil municipal
à autoriser la création d'une chapelle paroissiale.
Épernay
demeure la ville du champagne. C'est aussi celle du comte Paul
Chandon de Briailles, directeur de la maison de champagne Moët
& Chandon. Celui-ci va faciliter l'ensemble du projet en faisant
d'abord don d'un vaste terrain en zone sud. Puis, lui et ses deux
fils prennent à leur charge le coût de la construction
et son aménagement, c'est-à-dire l'église, le presbytère,
le mobilier et tous les objets du service liturgique.
On ne peut ainsi concevoir l’église Saint-Pierre-Saint-Paul sans
faire référence à la famille Chandon : en plus
d'apporter tous les fonds nécessaires, elle siège
au conseil de Fabrique, choisit les architectes et les entreprises.
Le terrain offert, très humide et instable, doit être
stabilisé. Le futur édifice s’appuiera donc sur 72
puits de 7 mètres de profondeur. La première pierre est posée
en mai 1895 ; les travaux s'achèvent en juillet 1897 avec
la bénédiction de Monseigneur Latty, évêque de Châlons. En 1907,
la chapelle paroissiale devient église paroissiale.
L'architecte Édouard Deperthes (1833-1898) dessine les plans
du nouvel édifice et opte pour le style, alors à la
mode, du romano-byzantin. L'architecte Henri Piquart (1860-1946)
assure l'exécution des travaux. Le style romano-byzantin
se traduit, à l'extérieur, par la présence
de multiples flèches en lancette (clocher
et chevet).
Le plan de l'église
est en croix latine : vaisseau
central à quatre travées bordé de bas-côtés
; transept saillant
; vaste chœur terminé
par un hémicycle voûté en cul-de-four. À
noter que le chœur
est flanqué de deux sacristies reliées par un couloir contournant
l’abside. On compte également quatre chapelles, quasiment identiques
: deux dans l'avant-nef (Fonts
baptismaux et Saint-Antoine
de Padoue) et deux bâties en absidioles (chapelle
de la Vierge et chapelle
du Sacré-Cœur). Les voûtes de l'église sont en
pendentifs.
Point pittoresque : les architectes n'ont pas voulu se faire oublier.
Ils sont représentés deux fois : à l'extérieur,
de part et
d'autre du porche et, à l'intérieur, sur les piliers
qui soutiennent la tribune de l'orgue
Cavaillé-Coll.
En 1970, des travaux ont affecté l'église ; une partie
de l'ancien mobilier a disparu. Ainsi, il n'y a ni chaire à
prêcher ni banc d'œuvre. Néanmoins, l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul mérite la visite pour sa série
de vitraux illustrant
les Grandes
Heures de la Champagne (atelier Charles Champigneulle) ainsi
que pour son Chemin
de croix (partiel, il est vrai) en bronze de l'artiste Anatole
Marquet de Vasselot.
Le clocher-porche
de l'église est dirigé vers le nord. Le chœur
est au sud. On emploie donc dans cette page les directions liturgiques
qui replacent le chœur
à l'est.
|
 |

Vue d'ensemble de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul depuis l'entrée. |
|
|

La façade de l'église s'élève face au nord (ouest liturgique). |

Le chevet de l'église disparaît un peu derière
les deux murs vitrés des chapelles de service. |
| De part et d'autre
du porche : les deux architectes de l'église. |
|

L'architecte Édouard Deperthes (1833-1898). |

L'architecte Henri Piquart (1860-1946). |
|

Sur les quatre côtés, les ouvertures du clocher romano-byzantin
sont surmontées d'un cordon de denticules.
Ce cordon est embelli d'une tête humaine et d'une tête
animale.
À cette hauteur, seuls un téléobjectif ou une
paire de jumelles permettent de les observer. |
|
|

Clocher romano-byzantin.

Les flèches bleues indiquent les têtes romanes
difficilement visibles depuis le sol. |

«L'Adoration des Mages»
Peinture murale sur le tympan de l'entrée nord (ouest liturgique).
XXe siècle, auteur inconnu. |
| ASPECTS INTÉRIEURS
DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL |
|

L'élévation sud (au sens liturgique) et son bas-côté. |
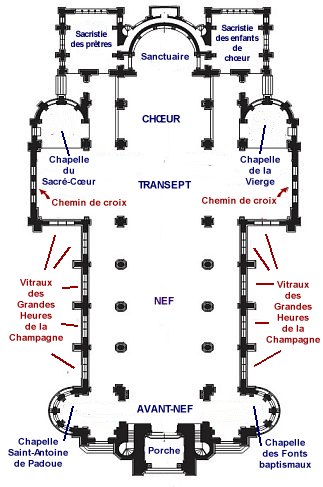
Plan de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. |
|
Architecture
intérieure.
Le style choisi par l'architecte Édouard Deperthes
(1833-1898) est le romano-byzantin. Cependant ce n'est
pas la version la plus luxueuse qui en est proposée
à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Dans un plan en croix latine, une série de piles
monocylindriques scande la nef et la sépare des
bas-côtés. L'arcature en plein cintre apparaît
assez pauvre : un simple cordon de dents de scie orne
l'archivolte tandis que l'intrados n'est qu'un cavet.
Ayant assuré l'éclairage de la nef par
huit grands vitraux tripartites qui laissent beaucoup
de place aux couleurs claires, l'architecte s'est contenté,
au second niveau de chaque travée, d'incorporer
une petite fenêtre néo-romane en haut d'un
pan de mur nu.
Chaque travée du vaisseau central est couverte
d'une voûte bombée sur pendentifs, séparée
de ses voisines par deux sobres rouleaux. Ceux-ci retombent,
une fois passés les tailloirs et les chapiteaux,
sur un triplet composé d'une pile cylindrique
associée à deux colonnettes amputées
de leur partie basse. La liaison de ces colonnettes
avec l'arcature ne fait guère preuve d'élégance
(photo ci-contre).
L'architecture étant très homogène,
le chœur
et les chapelles
absidiales répètent cet aspect sobre
: arcatures simples, cordons en dents de scie et intrados
en cavet.
En contraste, le romano-byzantin de l'église
Notre-Dame
des Victoires à Angers
(achevée en 1904) présente un aspect nettement
plus chaleureux.
Si le mobilier d’origine a en majorité disparu à la
suite de travaux de 1970, le visiteur pourra néanmoins
s'arrêter devant les clôtures
en bronze qui subsistent et qui ferment encore quelques
chapelles. Ornées d’un motif de palmettes ponctué
de symboles paléochrétiens, ces clôtures relèvent
de l'Art nouveau.
|
|

La chapelle des Fonts baptismaux.
On remarquera la clôture Art nouveau (fin du XIXe
siècle)
qui ferme la chapelle.
|

Les Fonts dans la chapelle des Fonts baptismaux.
|

Saint Antoine de Padoue portant l'Enfant, détail.
Chapelle Saint-Antoine de Padoue. |
|
|
|

Retombée du voûtement sur un pilier de la nef. |

Statue de saint Jean-Baptiste
XIXe-XXe siècles
Chapelle des Fonts baptismaux. |
|

Une clôture à palmettes en bronze de la fin du XIXe siècle
ferme la chapelle des Fonts baptismaux.
C'est l'une des rares clôtures d'origine qui subsistent dans
l'église. |

Saint Romain capture la gargouille.
Vitrail dans la chapelle des Fonts. |

L'autel de la chapelle Saint-Antoine de Padoue. |
|
La
Gargouille.
Saint Romain, évêque de Rouen
au VIIe siècle, est souvent associé à
la capture de la gargouille, un animal fabuleux qui
terrorisait les environs de Rouen.
C'est là l'origine mythique des gargouilles qui
servent à l'évacuation des eaux de pluie
le long des murs gouttereaux des églises.
Voir à la cathédrale Notre-Dame
de Rouen, l'histoire de ce conte illustré dans un
vitrail du XVIe siècle.
|
|
|

«Saint Memmie ressuscite au pont de Nau le fils du gouverneur romain»
Vitrail n°1 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |
| LES VITRAUX DES
GRANDES HEURES DE LA CHAMPAGNE |
|
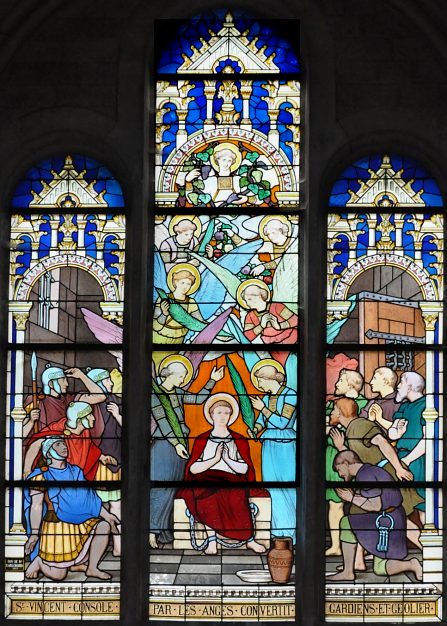
«Saint Vincent consolé par les anges convertit gardiens et geôliers»
Vitrail n°2 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Saint Loup intervient auprès d'Attila et le décide à épargner
Troyes»
Vitrail n°3 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Saint Berchaire aidé par saint Nivard construit l'abbaye de Hautvillers»
Vitrail n°4 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |
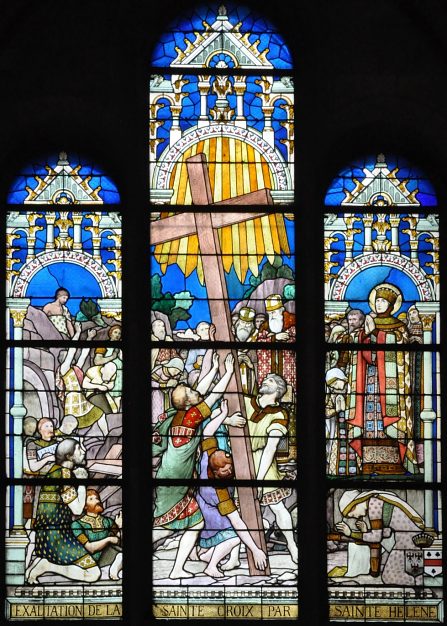
«Exaltation de la sainte Croix par sainte Hélène»
Vitrail n°5 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Exaltation de la sainte Croix par sainte Hélène», détail.
Vitrail n°5 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904.
|
|
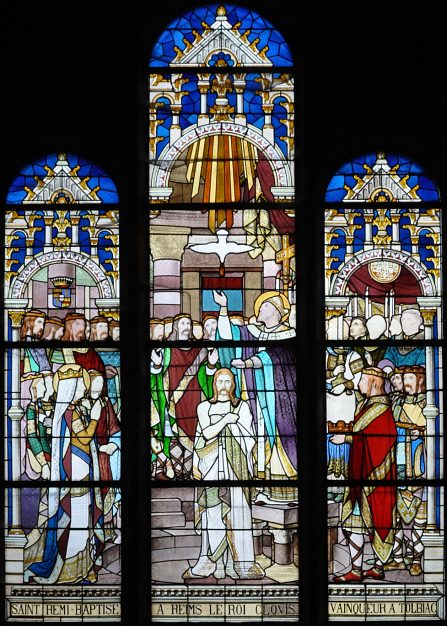
«Saint Rémi baptise à Reims le roi Clovis vainqueur à Tolbiac»
Vitrail n°6 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |

«Le pape Urbain II prêche la croisade au concile de Clermont»
Vitrail n°7 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |
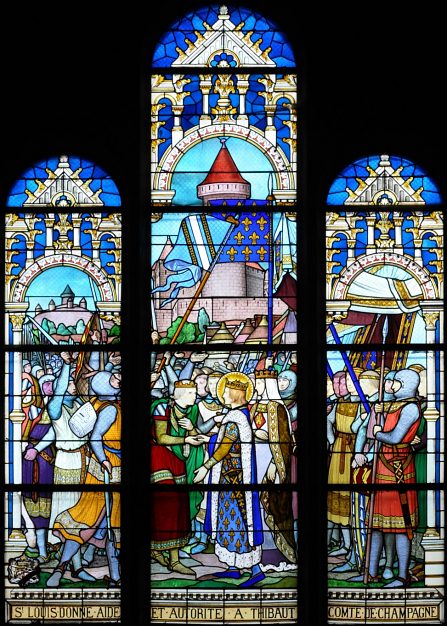
«Saint Louis donne aide et autorité à Thibault, comte de Champagne»
Vitrail n°8 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |
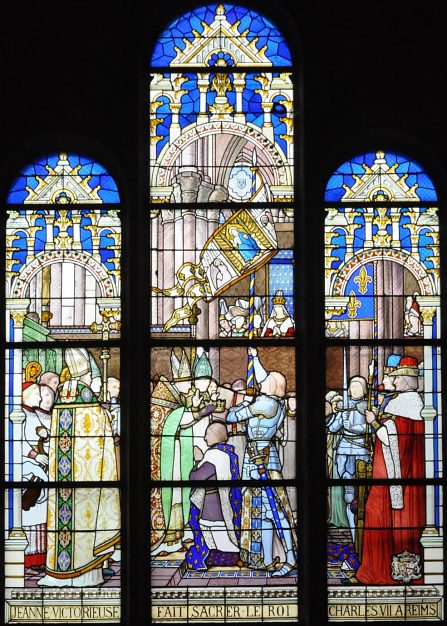
«Jeanne victorieuse fait sacrer le roi Charles VII à Reims»
Vitrail n°9 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904. |
 |

«Saint Louis donne aide et autorité à Thibault, comte de Champagne»,
détail.
Vitrail n°8 de la nef illustrant les Grandes Heures de la Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904.
|
«««--- «Saint Jean-Baptiste
de la Salle visité par Jacques II et l'archevêque de Paris»
Vitrail n°10 de la nef illustrant les Grandes Heures de la
Champagne.
Atelier Charles Champigneulle, 1903-1904.
|
|
Saint
Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719).
Né à Reims
en 1651, c'est l'une des grandes figures de la Champagne.
Soucieux de l'éducation des enfants pauvres, il fonda l'Institut des Frères des écoles chrétiennes.
|
|
| LE TRANSEPT ET
SON CHEMIN DE CROIX |
|

Le chœur et le bras nord (au sens liturgique) du transept. |
|
Le Chemin
de croix.
C'est l'une des curiosités et aussi l'une des belles
œuvres d'art de l'église.
Le Chemin devait comprendre sept panneaux de bronze illustrant
chacun deux stations. Son auteur, Anatole Marquet de Vasselot
(1840-1904) ne réalisa malheureusement que deux de
ces panneaux.
Le premier réunit les stations I et II : Jésus
est condamné et Jésus portant sa croix.
Le second illustre les stations XIII et XIV : la Descente
de Croix et la Déploration.
Ces sculptures en haut et bas-reliefs font alterner les scènes
religieuses et les représentations symboliques.
Les autres stations, comme la station
V (Simon le Cyrénéen aide Jésus
à porter sa croix), plus tardives, s'inspirent
du style de Vasselot. Leur auteur ne semble pas être
référencé.
|
|

Chemin de croix, station I : Jésus est condamné.
Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle, |

Chemin de croix, stations XIII et XIV : Descente de croix et Mise
au tombeau.
Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle, |
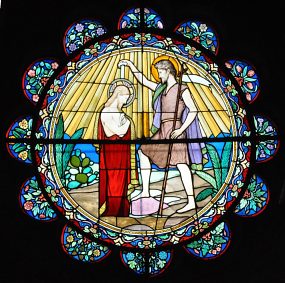 |

Chemin de croix, station V : Simon le Cyrénéen aide
Jésus à porter sa croix.
Bronze, successeur d'Anatole Marquet de Vasselot, XXe siècle,

«««--- Le Baptême du
Christ, détail de la rose du bras nord (au sens liturgique)
du transept.
Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |
|

Le chœur, le bras sud (au sens liturgique) du transept et la
nef vus depuis le sanctuaire. |
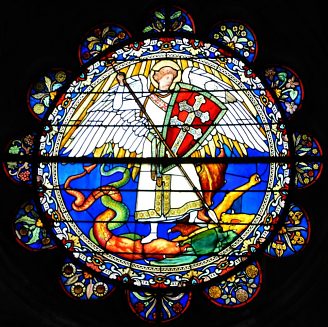
«Saint Michel terrassant le démon»
Détail de la rose du bras sud (au sens liturgique) du transept.
Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |

Chemin de croix, station XIII : la Descente de croix.
Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle,

Armoiries de Monseigneur
Latty, évêque de Chalons-en-Champagne, dans un oculus du transept.
---»»»
Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |
|
 |
 |

Chemin de croix, station XIV : Déploration.
Bronze d'Anatole Marquet de Vasselot, fin du XIXe siècle,

«««--- Armoiries du cardinal
Sourrieu, archevêque de Rouen,
dans un oculus d transept.
Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |
|

Sainte Cécile.
Atelier Charles Champigneulle, 1897. |

Statue de Jeanne d'Arc, XXe siècle.
Bras nord (au sens liturgique) du transept. |

Saint Christian.
Atelier Charles Champigneulle, 1897. |

L'Éducation de la Vierge, détail. |

Armoiries de la famille Chandon.
Atelier Charles Champigneulle, |
|
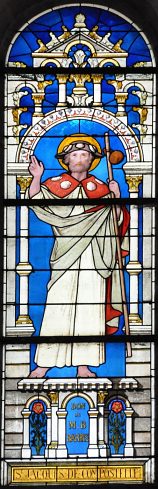
Saint Jacques de Compostelle.
Atelier Charles Champigneulle, 1897. |
|
| LE CHŒUR
ET LES DEUX CHAPELLES ABSIDIALES |
|

Le chœur est encadré par les statues assises de saint Pierre et de
saint Paul.
À droite, l'entrée de la chapelle de la Vierge de Miséricorde.
Dans le sanctuaire, l'abside reçoit sept vitraux à grands
personnages. |

Chapelle de la Vierge de Miséricorde.
Absidiole sud (au sens liturgique). |

La clé de voûte de la chapelle du Sacré-Cœur représente
le blason de la famille Moët à Épernay. |

L'Agneau de Dieu dans l'ornementation murale de l'abside.
D'après un dessin d'Henri Rapin, 1929. |
|
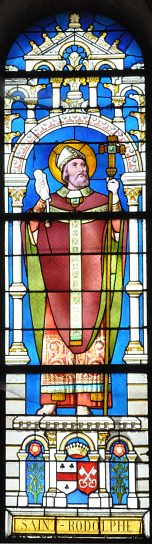
Saint Rodolphe.
Atelier Charles Champigneulle, 1897. |

Chapelle du Sacré-Cœur.
Absidiole nord (au sens liturgique). |
|

Statue de saint Pierre à l'entrée du chœur. |

Statue de saint Paul à l'entrée du chœur.
Création de la société Blondeau, Senart et Cie.
|
|

La Vierge à l'Enfant, détail.
XXe siècle.
Chapelle de la Vierge de Miséricorde. |
|
Les
statues de saint Pierre et saint Paul.
Ces deux statues en bronze qui trônent sur
des sièges de marbre encadrent l'entrée
du chœur.
Celle de saint Pierre est la copie de la statue
(de plus grande taille) exposée dans la
basilique Saint-Pierre du Vatican.
Cette statue de saint Pierre est aussi une œuvre
courante que l'on trouve dans beaucoup d'églises.
Celle de saint Paul, en revanche, est nettement
plus rare.
Pendant de la statue de saint Pierre, et comme
elle d'un mètre quarante de haut, elle
a été réalisée par
le sculpteur Senart de l'entreprise Blondeau,
Senart et Compagnie qui avait, à l'époque,
reçu commande de ces deux statues de bronze.
|
|
|
|
|
|

Le maître-autel est orné, à ses extrémités,
des symboles des quatre Évangélistes. |
 |
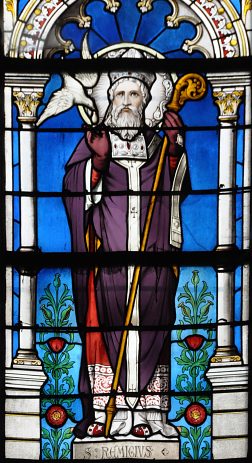 |
|

Détail du maître-autel sculpté dans le calcaire. |
|
Le
maître-autel (fin du XIXe siècle).
Il est sculpté en calcaire avec, au centre, un tabernacle
fermé par une porte en cuivre. L'un des points
les plus intéressants est la présence,
aux extrémités de l'autel, des symboles
des quatre Évangélistes. L'ange et le lion sont
donnés ci-dessous.
L'arcature qui sert de toile de fond à ce majestueux
autel abrite un mur ocre orné de petites mosaïques.
On y trouve les symboles traditionnels du christianisme
: le pélican, l’agneau,
les grappes de raisin et les gerbes de blé. Ces mosaïques
datent de 1929 et ont été réalisées
d'après un dessin d'Henri Rapin.
|
|

Détail du maître-autel : l'Ange et le lion,
symboles des Évangélistes Matthieu et Marc. |
«««---
Détail de deux vitraux de l'abside :
saint Denys et saint Rémi.
Atelier Charles Champigneulle, autour de 1900. |
|
|
|
|

L'orgue de tribune est un Cavaillé-Coll de 1898. |

L'architecte Henri Piquart. |
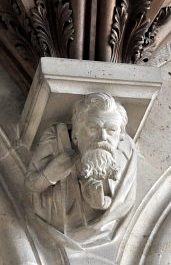
L'architecte Édouard Deperthes. |
|
L'orgue
de tribune.
Cet orgue est dû à la largesse de Paul
Chandon de Briailles qui admirait l'œuvre du facteur
Aristide Cavaillé-Coll. Chandon lui commanda
six orgues. L'un se trouve à la basilique
du Sacré-Cœur de Paris, un deuxième à
l’église Notre-Dame
d’Épernay. Celui de la tribune de l’église Saint- Pierre-Saint-Paul
a été installé en 1898.
Les architectes sont sculptés sur les piliers de pierre
qui soutiennent la tribune : Édouard Deperthes († 1898)
tient un compas dans sa main gauche ; Henri Piquart
(† 1946) soutient le tailloir d’un chapiteau.
L'orgue, classé en 1979 au titre des Monuments historiques,
n'a subi aucune modification depuis sa mise en place.
|
|
|

Le chœur et la nef vus depuis le sanctuaire. |
Documentation : Brochure sur l'église Saint-Pierre-Saint-Paul
de l'Office de Tourisme
+ Site Internet de l'Inventaire général du Patrimoine
culturel. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |