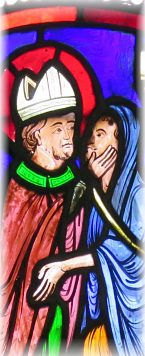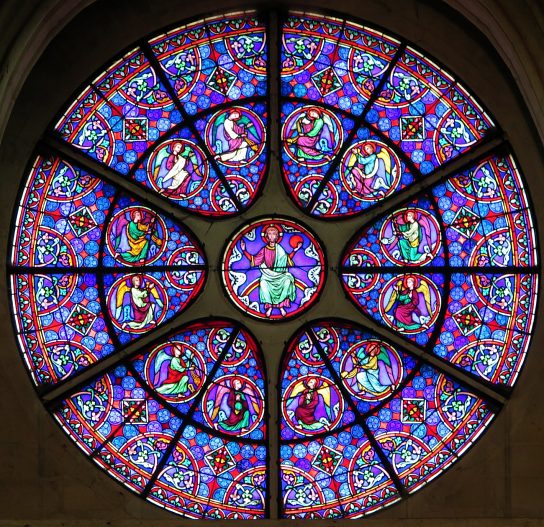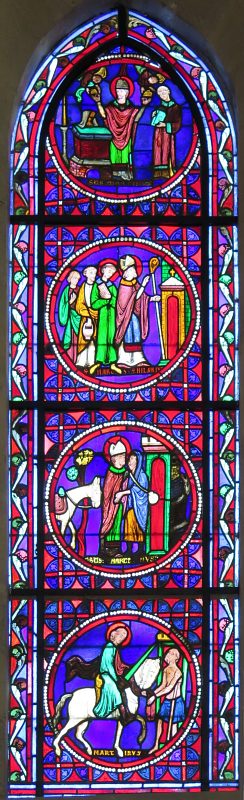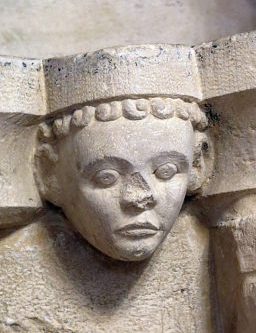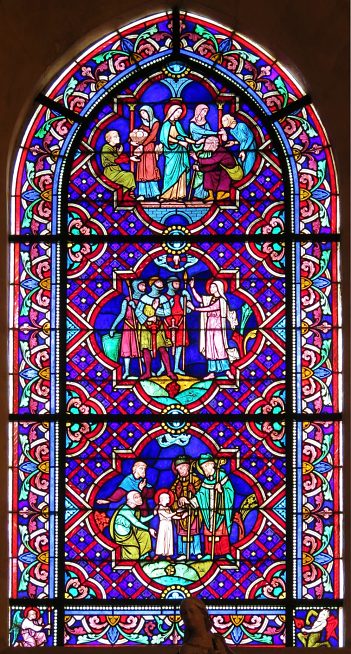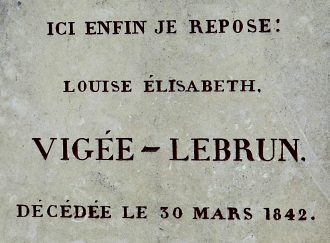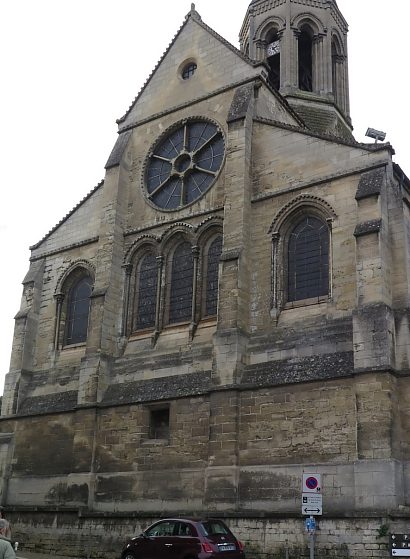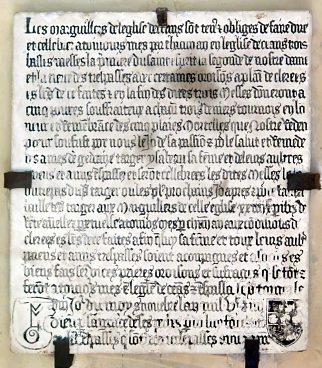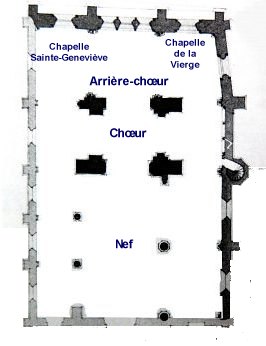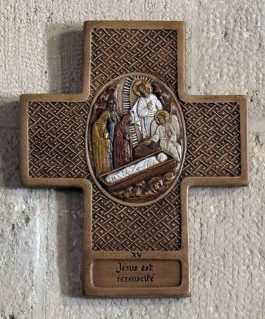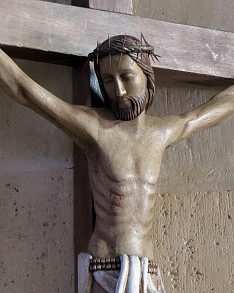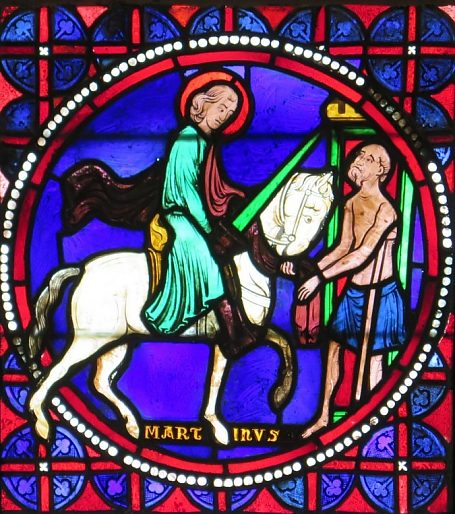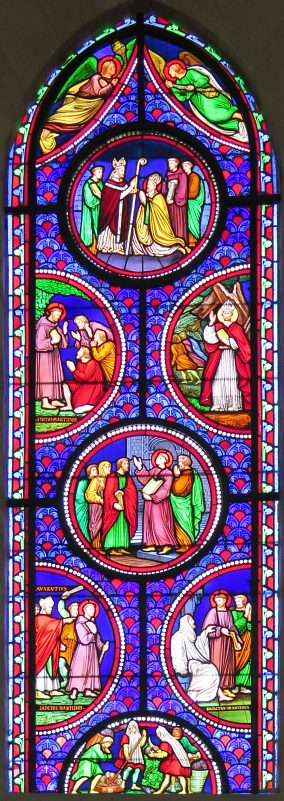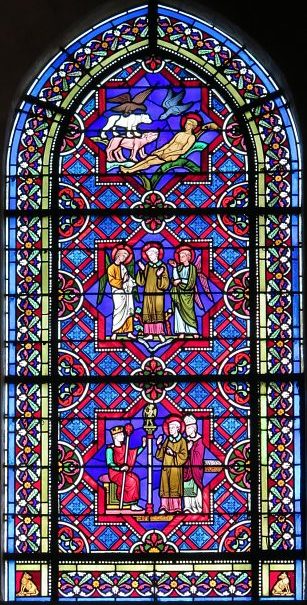|
|
 |
 |
Il y a peu de références qui traitent
du passé de l'église Saint-Martin. En 1968, dans le Dictionnaire
des églises de France, Georges Poisson, conservateur au musée
de l'Île-de-France, situe la construction de l'église au XIIIe siècle,
avec remaniement postérieur. En 2000, le Patrimoine des Communes
des Yvelines donne le XIIe siècle, avec une importante restauration
au XIXe. Auparavant, en 1989, Jacques et Monique Laÿ, après une
étude fouillée, donnaient dans leur livre Louveciennes mon village
une première datation au XIe siècle...
Bref, l'église Saint-Martin remonte au Moyen Âge ; elle est
romane avec un clocher néo-roman de la fin du XIXe siècle. Les parties
les plus anciennes (XIe ou XIIe siècle) sont le chœur
avec ses quatre piles massives et le chevet.
Au cours des âges, la nef a subi des modifications ou des aménagements
qui ont toujours respecté l'aspect roman.
Jusqu'à la Révolution, la vie de l'église s'écoule sans heurt. Au
XVIIe siècle, la paroisse profite des dons des riches seigneurs
qui s'installent au village de Louveciennes ou dans les environs
proches. Au XVIIIe, la comtesse du Barry, qui possède un château
au village et qui va y vivre vingt-quatre ans, se montre très généreuse
: les accessoires du culte sont en partie renouvelés, voire complétés.
Lors de la Révolution, l'église est d'abord transformée en Temple
de la Raison, puis, devant le peu de succès du Temple, en
grenier à foin. Son état se dégrade ; le bas-côté nord finit par
s'effondrer. Sous l'Empire et jusqu'en 1818, des restaurations hâtives
sont entreprises. À la chute de l'Empire, Louveciennes est
envahie par l'ennemi. La soldatesque pille les maisons et dérobe
le mobilier de l'église, notamment une coupe et un ciboire. Élisabeth
Vigée Le Brun, habitante de Louveciennes, paiera de sa poche
le remplacement de ces deux objets sacrés.
Des modifications importantes vont s'étaler le long du XIXe siècle
: la nef est raccourcie ; une nouvelle façade est érigée
à l'ouest. Enfin, vers la fin du siècle, les murs latéraux et les
voûtes sont restaurés.
L'église est classée monument historique en 1889.
Avec leurs médaillons à petites saynètes, les vitraux
du XIXe siècle sont des pastiches du vitrail du XIIIe que l'on peut
voir dans une verrière (baie
1) de l'arrière-chœur.
Les amateurs de vieilles pierres trouveront dans Saint-Martin de
nombreuses marques romanes, dont des chapiteaux et des consoles.
Le chevet comprend deux piscines,
dont l'une est géminée. Enfin, dès son entrée, le visiteur ne peut
qu'être frappé par les imposants piliers du XIIe siècle qui délimitent
le chœur et soutiennent
le clocher.
|
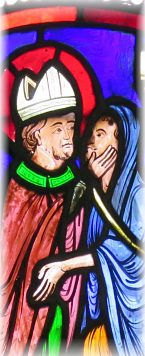 |

Vue d'ensemble de l'église Saint-Martin depuis l'entrée.
L'aspect massif des piliers du chœur est une composante essentielle
de l'église. |
| LE CIMETIÈRE
DES ARCHES À LOUVECIENNES |
|

Huit arches de l'aqueduc traversent le cimetière des Arches. |
|
Le cimetière
des Arches et l'aqueduc (1/2).
Les amateurs d'art ne peuvent pas passer à
Louveciennes sans aller voir la tombe d'Élisabeth
Vigée Le Brun au cimetière des Arches. Tous
ceux qui admirent l'œuvre de cette artiste connaissent
la touchante épitaphe «Ici enfin je repose»
gravée sur la pierre.
Élisabeth Vigée Le Brun découvre Louveciennes
en 1786, à 31 ans, à l'occasion de son premier
portrait de madame du Barry. Elle y reviendra jusqu'en septembre
1789. Elle fuit la France révolutionnaire le 6 octobre
suivant. Son exil durera douze ans.
Radiée de la liste des émigrés, elle
passe à Paris cette même année, mais repart
en Angleterre et en Suisse. Elle rentre définitivement
en France en 1809 et achète une maison de campagne
à Louveciennes. Hormis lors de la présence des
soldats pillards en 1814 et 1815, sa vie va s'écouler
paisiblement entre son appartement parisien et son village
de prédilection (visites de ses amis, peintures, promenades,
jardinage, etc.).
En 1821, elle offrira à son village la seule toile
religieuse qu'elle ait peinte : sainte Geneviève
gardant ses moutons. Le peintre donna à la sainte les
traits de sa fille Julie, morte deux ans plus tôt.
En 1841, sa santé se détériore. Élisabeth
Vigée Le Brun s'éteint à 86 ans le 30
mars 1842 à son domicile parisien.
Elle est enterrée dans l'ancien cimetière paroissial
de Louveciennes. En 1880, le cimetière est transféré
sur un terrain près de l'aqueduc et deviendra le cimetière
des Arches.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|

Tombe d'Élisabeth Vigée Le Brun au cimetière
des Arches. |
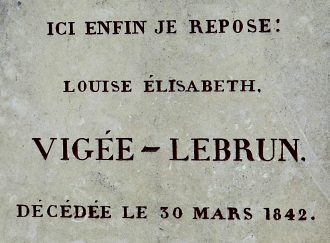
Épitaphe de la tombe d'Élisabeth Vigée
Le Brun : «Ici enfin je repose». |
|

Gravure de la partie haute de la tombe d'Élisabeth Vigée Le Brun
: une palette de peinture sur un socle.
Le gravé central, éclairé par le soleil,
est entouré d'une couronne à feuillage. |
|
Le
cimetière des Arches et l'aqueduc (2/2).
---»» Le cimetière des
Arches longe une belle réalisation architecturale
de la fin du XVIIe siècle : l'aqueduc qui permettait
de faire passer l'eau depuis Marly jusqu'au château
de Versailles.
Le système global de l'acheminement de l'eau
était assez simple : une machine pompait l'eau
de la Seine et la faisait remonter de plus de 170 mètres
dans un bassin situé sur la colline de Louveciennes,
appelée Tour du Levant. Ensuite, elle s'écoulait
le long de l'aqueduc selon une faible pente jusqu'à
son extrémité sud-ouest, appelée
Tour du Couchant. Cependant, on était loin d'être
arrivés à Versailles
!
Or le roi Louis XIV ne veut pas voir gâcher la
perspective de la grande allée qui conduit au
château de Marly (aujourd'hui route de Versailles).
Donc l'eau, au moyen d'un siphon, s'écoulera
depuis la Tour du Couchant dans des conduites souterraines
qui longeront le chemin des carrosses.
C'est à Jules Hardouin-Mansart que le roi confie
le dessin de cet ouvrage construit de 1682 à
1684 avec de la pierre extraite des carrières
de Saint-Leu près de Creil. L'aqueduc possède
36 arches ; sa longueur est de 643 mètres.
Les propriétaires expulsés furent indemnisés.
Notons un fait divers : l'aqueduc, prenant place sur
les hauteurs de Louveciennes, vint à couper le
vent d'un moulin ! C'était la mort assurée
pour la petite entreprise de la veuve du meunier qui
officiait là. Le roi eut pitié de ses
larmes. En 1688, il paya le déplacement du moulin
dans un endroit plus éventé aux environs
de Marly.
En 1870-71, la Tour du Levant servit de poste d'observation
aux Prussiens. Le roi Guillaume Ier et Bismarck la gravirent
pendant les combats près du Mont Valérien.
Lors du siège de Paris, une pièce d'artillerie
y fut même installée.
En 1866, l'aqueduc est mis hors service, remplacé
par des conduites souterraines. Il est classé au titre
des monuments historiques en 1953.
Source : Louveciennes
mon village de Jacques et Monique Laÿ, 1989.
|
|
|

Le cimetière des Arches, vue partielle.
La tombe d'Élisabeth Vigée Le Brun est au centre de
l'image.
|
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |
|

La façade occidentale de l'église Saint-Martin
(XIXe siècle). |

Ensemble néogothique de la porte occidentale (fin du
XIXe siècle). |
|

Deux têtes sculptées à la base de
l'archivolte.
XIXe siècle. |
 |
|

L'église Saint-Martin vue depuis le chevet.
Le clocher néo-roman de la fin du XIXe siècle
est soutenu par
quatre piles massives qui délimitent le chœur. |
|
|
| Au XIXe siècle,
l'architecte a orné la porte avec les bas-reliefs
d'un chevalier médiéval en armure et de
sa dame. |
|
|

L'église vue depuis le côté nord. |
|
Architecture
extérieure (2/2).
---»» Le clocher, bien
assis sur quatre piliers massifs qui, à l'intérieur
de l'édifice, délimitent le chœur,
n'est pas le premier non plus. Une gravure du XVIIe
siècle montre un clocher élancé.
Mais, à la fin du XVIIIe, un autre clocher avait
pris sa place. Il avait la forme d'une lanterne avec
«huit potelets en bois supportant une coupole
par l'intermédiaire d'un entablement percé
d'orifices circulaires», écrivent Jacques
et Monique Laÿ. Au début du XIXe, éprouvé
par les tempêtes, il avait fait son temps. En
1833, un nouveau clocher, qui était en fait un
rafistolage du précédent, lui succéda.
Beaucoup le trouvèrent laid. Victorien Sardou,
qui habitait Marly, le décrivit comme un «hideux
pigeonnier».
On pensa dès lors à le remplacer. En 1868,
l'architecte diocésain, conscient que les quatre
piliers massifs qui le soutenaient bouchaient la vue
des fidèles, proposa un clocher au-dessus de
la façade ouest et un amincissement des piliers.
Ce projet coûteux fut rejeté.
Il fallait pourtant un nouveau clocher. À force
d'appels et de souscriptions, la mairie parvint à
réunir assez de fonds pour lancer la construction,
dans les années 1890, d'un clocher en harmonie
avec l'ensemble roman. C'est le clocher actuel.
|
|
 |
 |
| Bas-reliefs de têtes humaines sur le chevet du XIIe
siècle. |
|
 |
|
|
Architecture
extérieure.
Comme la photo ci-dessus le montre et comme
le signalent Jacques et Monique Laÿ dans leur ouvrage
Louveciennes mon village, on a peut-être,
dans les temps reculés, créé un
terre-plein pour donner un peu de surplomb à
l'édifice sacré. On voit clairement que
l'endroit est en pente descendante (ce qui est le cas
aussi derrière l'église).
Si la façade
moderne, assez fade, a été décriée
au XIXe siècle, l'église n'en garde pas
moins un chevet
plat très ancien (XIe siècle) de style
roman, renforcé de quatre contreforts à
ressauts. L'observateur attentif pourra même y
trouver deux
petites têtes humaines romanes sculptées
dans l'arcature qui surplombe les trois baies axiales.
Ce chevet n'est pas le premier en date. Dans la succession
des édifices qui ont vraisemblablement été
érigés sur ce terre-plein, Jacques et
Monique Laÿ rappellent qu'il y a eu auparavant
un ancien chevet qui comportait une abside semi-circulaire.
Les fouilles ont montré l'existence de trois
saillies sur sa périphérie, probablement
des contreforts. Cette abside était donc de type
carolingien. Elle serait située à l'heure
actuelle au sein de l'arrière-chœur.
---»» Suite 2/2
à gauche.
|
|

Dans les temps médiévaux, il est possible qu'on
ait créé un terre-plein
pour asseoir le caractère sacré de l'édifice
car le terrain est en pente descendante. |
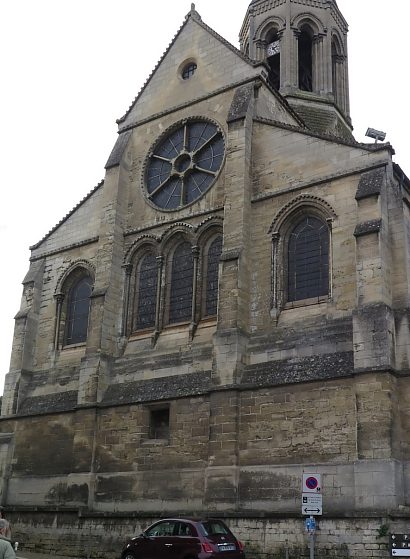
La façade orientale de l'église est la plus ancienne
(XIe ou XIIe siècle).
Sa consolidation est obtenue par quatre contreforts à
ressauts. |
«««---
Arcature romane sur le chevet (XIe ou XIIe siècle).
Les deux têtes humaines sont indiquées par
des flèches. |
|
|
| LA NEF DE L'ÉGLISE
SAINT-MARTIN |
|

Vue de la nef depuis le coin sud-ouest.
Les quatre piliers massifs qui délimitent le chœur
(et supportent le clocher) coupent l'église en deux. |
|
Architecture
intérieure.
Cette architecture n'est pas banale. Il est
rare de voir l'espace intérieur d'une église
à ce point découpé en zones presque
indépendantes, séparées par des
piliers larges et massifs, en l'occurrence ceux qui
délimitent le chœur.
L'église étant «orientée»,
la nef est à l'ouest. Cette nef et ses bas-côtés
ont été restaurés (voire refaits),
toujours dans le style roman, sans que l'on sache exactement
à quel siècle.
Un point peu banal est à souligner dans la nef
: il y a, au sud, deux arcades avec un pilier médian
et, au nord, trois arcades et deux piliers. Ce que la
photo ci-dessus montre clairement.
Dans la nef, l'élévation sud reçoit
une belle suite d'arcades romanes alors que l'élévation
nord reste nue.
Les chapiteaux à feuillage, assez simples, sont
eux aussi de style roman. Jacques et Monique Laÿ
les rattachent au début du XIIe siècle
en rappelant que «au commencement du XIIe siècle
on constate chez les artistes une volonté affirmée
de rompre avec les traditions monastiques». Ces
traditions se concrétisaient par une imitation
des sculptures romaines ou byzantines au décor
riche.
Les bas-côtés sont voûtés
d'ogives de part et d'autre du chœur.
Dans la nef, cependant, ils reçoivent une charpente
en berceau. Les amorcements d'ogives (photo ci-dessous)
montrent qu'il ne devait pas en être ainsi dans
les plans prévus.
Voir la description du chœur
et de l'arrière-chœur
plus bas.
L'ensemble de l'église dégage un indiscutable
aspect roman. Pourtant les historiens restent dans l'indécision
pour fixer des dates de restaurations ou de réaménagements.
|
|
 |
| Chapiteaux romans des piliers de la
nef. |
|
 |
|

Amorcements d'ogives dans le bas-côté sud.
On observe les mêmes amorcements dans le bas-côté
nord. |
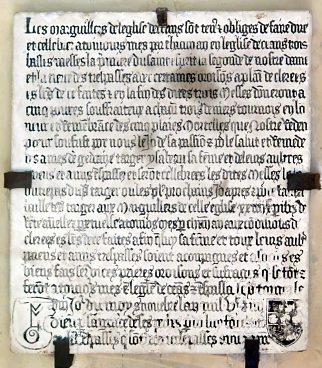
Plaque de «fondation» sur le mur occidental. |
|
«««---
Les amorcements d'ogives.
La photo ci-contre montre des
amorcements d'ogives, autrement dit des
débuts de retombées d'ogives
: un architecte avait prévu, au nord
et au sud, de bâtir des collatéraux
voûtés d'ogives. À la
place, on ne voit qu'une charpente en berceau.
Que s'est-il passé dans l'église pour que
les plans, ou du moins une partie, aient
avorté ? Un manque de fonds ? Et vers quelle
époque ? Les archives sont muettes à ce
sujet.
|
|
|
|
|
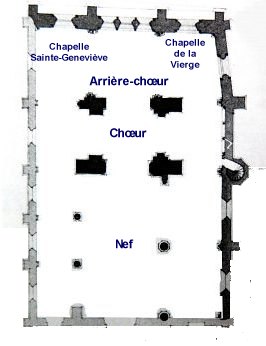
Plan de l'église Saint-Martin.
La voûte de la nef n'est portée que par trois piliers.
Les quatre piles massives qui délimitent le chœur
et soutiennent le clocher sont du XIIe siècle. |
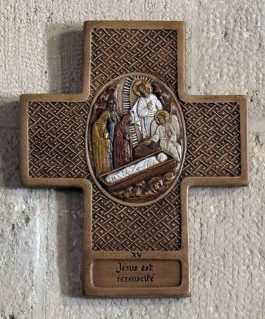
Chemin de croix, station XV : Jésus est ressuscité. |
|
«««---
Plaque de fondation (1/2).
Deux plaques de «fondation» sont
exposées sur le mur ouest de l'église.
Elles relatent chacune une donation faite avant le décès
du donateur au profit d'une œuvre de piété
ou de bienfaisance. En échange, le bénéficiaire
devait la plupart du temps faire dire des messes.
Dans la plaque ci-contre, Gervais Targer, décédé
le 8 novembre 1504, donne à perpétuité
aux marguilliers de l'église Saint-Martin une
rente annuelle de vingt-quatre sols parisi.
En échange, ceux-ci doivent faire célébrer,
le 8 novembre de chaque année, trois messes basses
(au Saint-Esprit, à Notre-Dame et aux Trépassés)
pour le salut de Gervais Targer et de son épouse
Ysabeau.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|
|

Vue de la nef depuis le coin nord-ouest.
Au premier plan (c'est-à-dire au nord), deux piles soutiennent
la voûte en berceau du vaisseau central.
À l'arrière-plan (c'est-à-dire au sud), une seule
pile soutient cette voûte
L'élévation sud est ornée d'une arcature de style roman, alors que
l'élévation nord est nue. |

«Le Pressoir mystique»
Tableau anonyme estimé de la première moitié du
XVIIe siècle. |
|
Le
pressoir mystique.
Ce thème iconographique apparaît au XIVe
siècle, se développe au XVe et disparaît
peu à peu au XVIIIe.
Jésus, écrasé par le poids de la
croix, foule des grappes de raisin. Le sang qui coule
de ses blessures se mêle au vin. C'est l'illustration
que la vie, ou du moins un aliment de vie, naît
du sacrifice du Christ.
Lors de la Réforme, catholiques et protestants
s'accorderont sur la puissance de cette image. Les premiers
y verront le rôle fondamental de l'Église
dans le salut de l'humanité ; les seconds, l'immédiateté
de la Rédemption des hommes par le Christ. Source
: panneau d'information dans l'église.
On pourra se reporter à un autre style de pressoir
mystique : celui du vitrail de Léonard Gontier, daté
du début du XVIIe siècle, à la cathédrale
Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes.
Le Christ y est allongé et reçoit le vin
qui coule d'un cep de vigne où ont pris place
les apôtres.
|
|
|
|
Plaque de fondation (2/2).
---»» À l'issue de ces
messes, ils donneront quinze deniers à cinq pauvres
souffreteux (trois deniers à chacun) «EN
REMEMBRANCE DES CINQ PLAIES MORTELLES QUE NOTRE REDEMPTEUR
SOUFFRIT POUR NOUS LE JOUR DE SA PASSION (...)»
La plupart du temps, ces donations en échange
de messes étaient couchées sur parchemin.
Toutes les archives des paroisses en contiennent. Leur
nombre et leur spécificité conduisaient
parfois les marguilliers des fabriques à un vrai
casse-tête !
Jacques et Monique Laÿ, dans Louveciennes mon
village, indiquent que, à la fin du XIXe
siècle, la fabrique de Saint-Martin se voyait
obligée de faire dire cent douze messes basses
par an, «presque autant de messes chantées
et deux services pour lesquels il faut au moins deux
chantres... de quoi s'arracher les cheveux !»
Avec le temps, toutes ces obligations sont tombées
dans l'oubli.
|
|

Statue de saint Antoine de Padoue
XIXe siècle ? |

Le bas-côté nord, voûté d'ogives, débouche
sur la chapelle Sainte-Geneviève. |
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |
|

Vue du chœur depuis l'entrée.
Le mobilier (autel de messe et ambon) est contemporain.
Seul le vitrail ornant la lancette de gauche, au-dessus de l'arcature
du fond, est ancien. |

Allégorie de la Cène sur le soubassement de l'autel
de messe. |

Chapiteaux néo-romans du XIXe siècle dans le pilier
sud-ouest. |

Le pilier sud-est du chœur est orné de deux consoles
du XIIe siècle en face du bas-côté. |
|
|
Le
chœur de l'église Saint-Martin.
Le chœur est un endroit «enclavé».
Situé entre les quatre piliers massifs qui soutiennent
le clocher, il semble réfugié dans un
cocon. Les piles, partie la plus ancienne de l'édifice
avec le chevet, remontent au XIIe siècle. Certaines
ont été refaites au XIXe.
Elles sont ornées de sculptures à feuillages,
de têtes humaines ou de masques. Ces sculptures
sont estimées du XIIe siècle et relèvent
de l'art roman. Au XIXe siècle, des chapiteaux
néo-romans ont été ajoutés
sur la pile sud-ouest.
Que la vue du chœur soit obstruée par les
piles massives contrariait visiblement certains fidèles.
Ainsi, en 1868, quand on voulut changer le clocher qui
datait de 1833, l'architecte diocésain suggéra
carrément de le supprimer, d'en construire un
nouveau au-dessus de l'entrée et... d'amincir
les quatre piliers. Les fidèles pourraient enfin
voir le chœur.
La Commission des Beaux Arts rejeta totalement cette
idée coûteuse. Ce qu'avec le recul on ne
peut qu'approuver : à elles seules les piles
massives sont un morceau d'Histoire.
|
|

Le chœur est enchâssé dans quatre piliers massifs
du XIIe siècle.
Dans la partie droite, le pilier sud-ouest est orné de
deux chapiteaux néo-romans du XIXe siècle. |

Console avec tête humaine du XIIe siècle
sur le pilier sud-est. |

Chapiteau néo-roman du XIXe siècle
sur le pilier sud-ouest. |
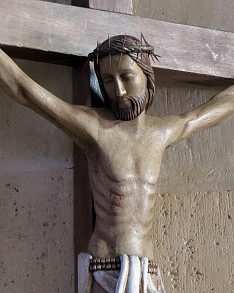 |
Christ en croix, détail.
Pile sud-est du chœur. |

Console avec tête humaine du XIIe siècle
sur le pilier nord-est. |

L'aigle et le taureau du tétramorphe
sur l'ambon contemporain. |

Le dieu gaulois Ogmi est repris dans ce chapiteau
néo-roman du XIXe siècle. |
|
|
| |
 |
|
 |
|
| Consoles romanes ornant
le pilier sud-est du chœur. |
|
| L'ARRIÈRE-CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |
|

L'arrière-chœur et ses vitraux du XIXe siècle.
À gauche, la chapelle Sainte-Geneviève reçoit
l'ancien maître-autel de l'église situé jadis
contre le chevet, là où l'on voit la crèche de
Noël.
Au second niveau, au nord et au sud, on peut voir un ancien triforium. |

Statue de sainte Marthe.
XVIIe siècle.
Chapelle Sainte-Geneviève. |
|
|
L'arrière-choeur.
On peut considérer ce vaste espace
comme la réunion des extrémités
des bas-côtés nord et sud (avec chacun
son autel latéral) et de la partie orientale
du chœur.
Pour l'esthétique architecturale et la facilité
de la présentation, on peut aussi le qualifier
d'«arrière-chœur».
La partie centrale du chevet est creusée d'une
grande niche qui était anciennement obstruée
par le maître-autel. Celui-ci est actuellement
l'autel Sainte-Geneviève (à gauche sur
la photo ci-dessus).
Le visiteur portera utilement son regard vers les deux
piscines
creusées dans la pierre du chevet, vraisemblablement
vers les XIe-XIIe siècles.
Les deux statues-colonnes du roi
Salomon et de la reine
de Saba sont des moulages en plâtre de sculptures
originales initialement dans le portail de l'église
Notre-Dame à Corbeil. Ces sculptures sont maintenant
au Louvre.
|
|

Voûte de l'arrière-chœur avec l'arcature néo-romane
et la rose du XIXe siècle. |
|
Les
vitraux.
Le XIXe siècle a vu le remplacement
des verres blancs (qui dataient vraisemblablement
du XVIIe) par des verrières figurées.
Une seule verrière est ancienne : celle qui orne
la
baie de gauche (baie 1) au sein des trois
baies axiales. Ces trois baies illustrent la vie
de saint Martin.
Cette verrière ancienne pourrait remonter
à l'année 1200, en tout cas être
datée du XIIIe siècle. Son panneau
du bas illustre la rencontre fameuse entre Martin
à cheval et le mendiant.
Au XIXe siècle, les ateliers sollicités
pour créer les verrières ont respecté
le style médiéval de cette baie.
Parmi ces ateliers, on note : celui de Didron
Aîné, auteur en 1856 de la rose axiale,
donnée ci-dessous ; celui de Bonnot qui
a réalisé les vitraux de la vie
de saint Fiacre et de la
vie saint Laurent.
Les deux baies axiales modernes (qui complètent
la baie
médiévale) sont indiquées
par le Patrimoine des Communes des Yvelines
(Flohic éditions) comme sortant de l'atelier
Paul Moutier à Saint-Germain-en-Laye. L'ouvrage
Louveciennes mon village indique, quant
à lui, que sa composition est due à
«l'atelier Chatel et Fialex, élèves
à la manufacture royale de Sèvres.»
Il faut préciser : François Fialex
(1818-1886) quitte la manufacture de Sèvres
en 1840 pour créer son atelier à
Mayet, près du Mans. René Chatel
est son cartonnier.
|
|

La clé de voûte de la partie centrale de l'arrière-chœur
est ornée d'une tête humaine qui regarde
le chœur. |
|
|
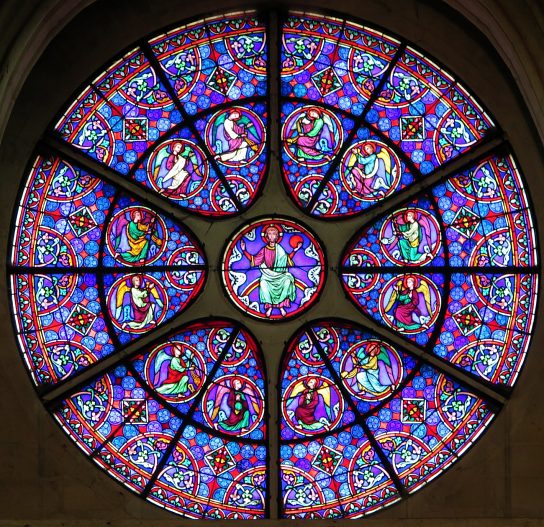
Rose du chevet : Jésus en majesté est accompagné d'anges en
prière.
Atelier Didron Aîné, 1856. |

Autel de la Vierge dans la partie sud de l'arrière-chœur. |
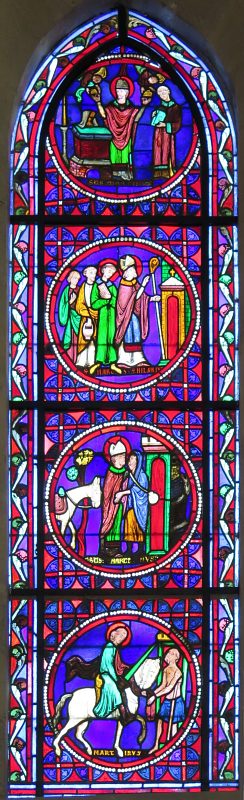
Baie 1 : Vie de Saint Martin.
Vitrail du XIIIe siècle, restauré au XIXe. |
|
Baie
1 : la vie de saint Martin.
Daté des XIIe-XIIIe siècles, c'est
le seul vitrail ancien de l'église.
Lecture de bas en haut.
Médaillon 4:
«Martin descendu de sa chaire
prend le pas sur les frères prêcheurs»,
lit-on dans Louveciennes mon village à
la description de ce vitrail.
Ce ne peut être qu'une allégorie : Martin
vivait au IVe siècle et l'ordre des frères
prêcheurs (les Dominicains) a été
créé au XIIIe siècle.
Médaillon 3 :
Martin se tient derrière saint Hilaire, évêque
de Poitiers
dont il est devenu le disciple. Ce dernier bénit
le monastère de Ligugé. C'est là
que Martin se retirera.
Médaillon 2 :
Martin guérit un lépreux par un baiser.
Médaillon 1 :
Martin, sur un cheval blanc, coupe
la moitié de son manteau et la donne à
un mendiant.
(Épisode fondateur du mythe de saint Martin.)
|
|
|
Les
vendangeurs ---»»»
François Fialex & René Chatel
ont été formés à la Manufacture
de Sèvres.
Fialex a créé un atelier de verrerie à
Mayet, près du Mans. Chatel sera son cartonnier.
On leur doit quelques-uns des vitraux de l'église
Saint-Romain
à Sèvres.
|
|
|
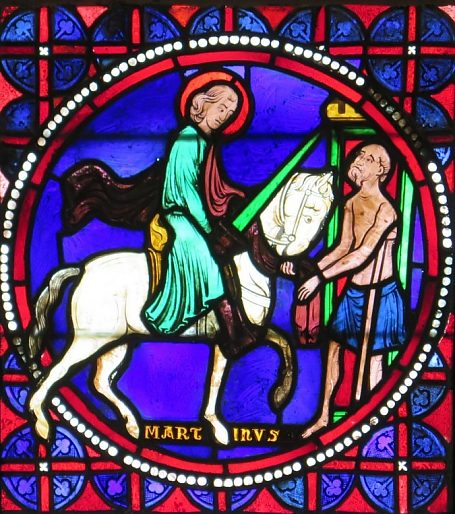
Vitrail de la vie de saint Martin, détail : Martin coupe
son manteau
Panneau du XIIIe siècle restauré au XIXe. |

Vitrail central du chevet, détail : Les vendangeurs.
Composition de l'atelier de François Fialex au XIXe siècle. |
|

L'arrière-chœur avec le bas-côté nord (à
droite sur la photo) et l'entrée du chœur
Les deux grandes statues-colonnes, le roi Salomon et la reine de Saba,
sont des moulages en plâtre. |

Statue moderne de la Vierge à l'Enfant, détail.
Autel de la Vierge. |
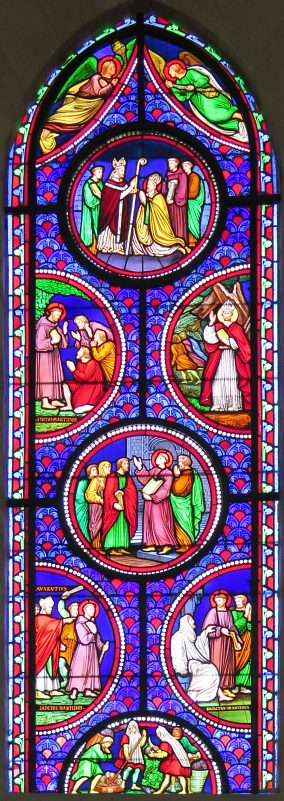 |
|

Vitrail de la Vie de Marie :
Naissance, Annonciation, Apothéose.
Vitrail posé en 1900, atelier inconnu. |

Statue du roi Salomon, détail.
|
«««---
Vie de Saint Martin
Atelier François Fialex au Mans.
Fin du XIXe siècle.
|
|
|

Vitrail de la vie de saint Martin, détail :
Martin évêque guérit un lépreux
XIIIe siècle. |
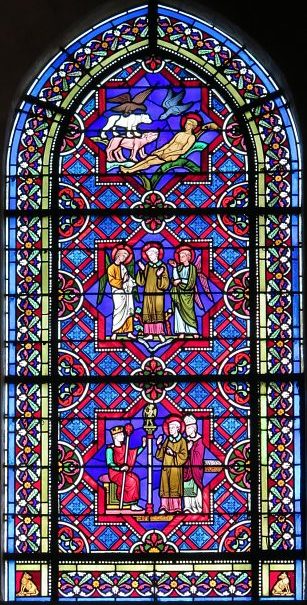
Vitrail du XIXe siècle : Vie de saint Vincent. |
|
Vitrail
de vie de saint Vincent (XIXe siècle).
Panneau du bas : Dacien, envoyé
par l'empereur Dioclétien, est en charge
de la région de Valence. Il somme Valère,
évêque de la ville, et son élève
Laurent de sacrifier aux idoles. Laurent refuse
d'un geste ferme ; Valère, prudent, se
cache derrière lui.
Panneau médian : Valère a
été exilé ; Vincent est harcelé
par Dacien pour abjurer, supplices à l'appui
; deux anges soutiennent Vincent.
Panneau supérieur : le corps de
Vincent supplicié est laissé dans
la forêt ; un aigle veille sur lui pour
que les bêtes sauvages ne le dévorent
pas.
|
|
|
|
«««---
Vitrail de la vie de saint Martin (XIXe siècle).
Ce vitrail, situé dans l'axe central,
a été offert par la confrérie des
vignerons. Il a été composé par
l'atelier de François Fialex situé au
Mans. Le cartonnier est René Chatel.
Demi-médaillon du bas : allégorie
des vendanges.
Demi-médaillons verticaux du bas : Auxence,
évêque arien de Milan, chasse Martin :
Martin ressuscite un mort.
Médaillon plein du bas : Martin explique
aux adeptes de l'ancienne religion qu'ils sont dans
l'erreur.
Demi-médaillon vertical du haut à gauche
: des gens demandent à Martin d'être instruits
des secrets de l'Évangile ; celui-ci les repousse
car leur esprit est fermé à son contenu.
Demi-médaillon vertical du haut à droite
: un arbre sacré païen est abattu par ordre
de Martin ; les paysans, furieux, exigent qu'il reste
dessous, mais l'arbre tombe de l'autre côté
; les paysans s'enfuient, effrayés.
Médaillon plein du haut : Martin est sacré
évêque de Tours
en 371.
|
|
|
|
|

Piscines géminées dans la chapelle Sainte-Geneviève.
Quel était donc le rôle exact de chacune de ces deux
cuvettes ? Mystère. |
|
Les piscines
du chevet.
La piscine est une petite cuvette creusée
dans la pierre près d'un autel. Après avoir
touché les espèces sacramentelles, le prêtre
doit se laver les mains. L'eau usagée est jetée
dans un lieu sacré. Le prêtre peut alors se retourner
vers les fidèles.
L'église Saint-Martin compte une piscine double dans
la chapelle Sainte-Geneviève (partie nord du chevet)
et une autre à la droite de la niche axiale (photo
ci-dessous), une niche qui accueillait donc un autel.
L'évacuation de l'eau usagée est toute simple.
Elle passe dans l'orifice de la cuvette et sort par la bouche
de la sculpture en forme de tête humaine située
plus bas. Ensuite elle se déverse dans la terre entre
deux dalles au sol. Avec le temps, les changements ou aménagements
de dallages au sol ont effacé les traces.
La présence de piscines géminées est
étonnante. Comme le suggère l'ouvrage Louveciennes
mon village, y avait-il une piscine pour purifier le calice
et une autre pour se laver les mains ? Ce qui soulignerait
l'importance, restée mystérieuse, de cet autel
latéral affublé de deux piscines.
On ne connaît pas la date de construction exacte des parties
les plus anciennes de l'église actuelle. Cependant la présence
des piscines en donne une idée. Jacques et Monique Laÿ;, dans
Louveciennes mon village, placent ainsi cette construction
au XIe siècle, au plus tard au XIIe siècle. «Ces piscines,
écrivent-ils, se rencontraient alors dans les chapelles des
églises cathédrales et conventuelles, plus rarement dans les
églises paroissiales.» Ce qui, pour certains, renforce l'hypothèse
d'un ensemble de bâtiments conventuels à Louveciennes, voire
carrément d'un monastère. Une hypothèse corroborée par la
présence de caves dans le sous-sol immédiat.
|
|
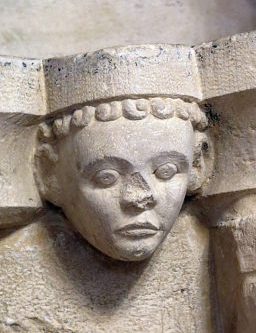
Piscines géminées : tête humaine en bas-relief
ornant le petit espace séparant les deux piscines. |

Piscines géminées : tête humaine en bas-relief.
L'eau usagée s'écoulait par la bouche. |

Piscine à côté de la niche axiale.
L'eau usagée s'écoulait par la bouche de la tête
humaine (donnée ci-dessous). |
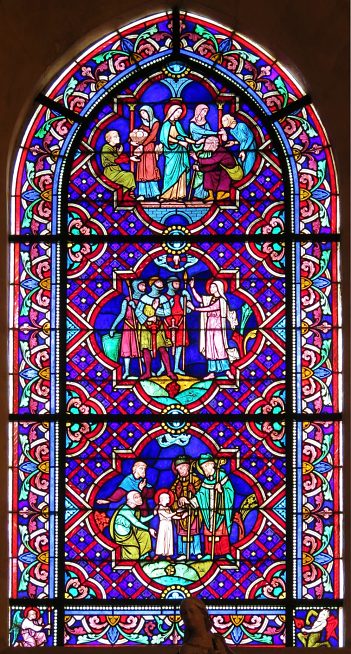
Vie de sainte Geneviève.
Vitrail de la fin du XIXe siècle, atelier inconnu.
|
Vitrail
de la vie de sainte Geneviève (XIXe siècle).
Panneau du bas : saint Germain d'Auxerre
passe à Nanterre et salut la petite Geneviève
et ses parents.
Panneau médian : en 451, Geneviève arrête
Attila devant Paris.
Panneau supérieur : Paris étant assiégée,
Geneviève nourrit les pauvres de la ville avec les
victuailles qu'elle a rapportées sur des bateaux malgré
le siège.
|
|

Piscine à un seul bassin : tête humaine en bas-relief.
L'eau usagée s'écoulait par la bouche. |

La reine de Saba, détail. |
|

Vie de saint Laurent.
Vitrail de l'atelier Bonnot posé en 1897.
|
Vitrail
de la vie de saint Vincent (XIXe siècle).
Panneau du bas : L'empereur romain Dèce
somme Laurent, en charge de la gestion des biens de l'Église,
de lui livrer tous les biens. Laurent refuse ; un soldat l'entraîne.
Panneau médian : devant l'envoyé de Dèce,
Laurent distribue les biens de l'Église aux pauvres.
Panneau supérieur : Dèce, rendu furieux
par cette distribution, condamne Laurent à être
rôti sur un gril.
|
|

Vue d'ensemble de l'église depuis l'arrière-chœur.
Les piliers massifs qui soutiennent le clocher limitent la vue au
seul chœur. |
Documentation : «Louveciennes mon village»
de Jacques et Monique Laÿ, 1989
+ «Le Patrimoine des Communes des Yvelines, Flohic Éditions,
2000
+ «Dictionnaire des églises de France», Éditions
Robert Laffont, 1968
+ Base Mérimée
+ documents affichés dans l'église. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|