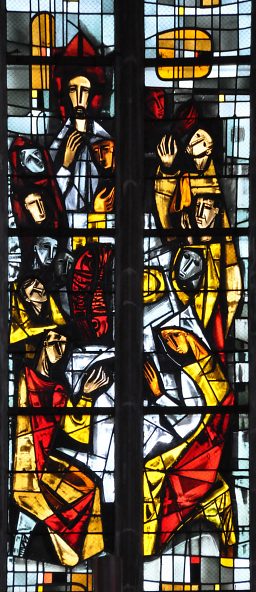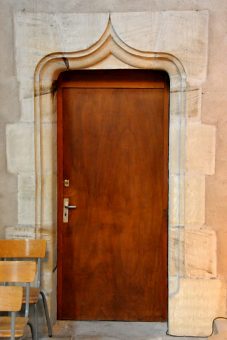|
|
 |
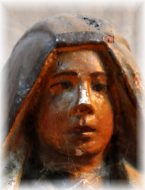 |
En Lorraine, Châtel-sur-Moselle est une
petite ville, au nord d'Épinal,
très riche en Histoire. Les ruines de son ancien et impressionnant
château occupent
une partie non négligeable de la superficie de la ville. Depuis
1972, des chantiers de fouilles s'y activent. Au niveau religieux,
ce château a très tôt possédé une chapelle castrale - qui sera d'ailleurs
détruite à l'explosif, avec l'ensemble de la forteresse, sur ordre
de Louis XIV durant l'hiver 1670-1671.
La ville, qui était, à l'image du château, protégée par une enceinte
scandée de tours (voir la tapisserie de 1580 plus
bas), possédait une église dès la seconde moitié du XVe siècle.
Sa construction date du règne de Thiébaut IX, comte de Neufchâtel
dont le dynamisme sut enrichir la cité. Elle est peut-être due aux
largesses du fils de Thiébaut, Antoine, qui était évêque de Toul.
Si l'on en croit l'historienne Marie-Claire Burnand dans son ouvrage
Lorraine gothique, elle faisait à l'époque office de chapelle
castrale ; elle est devenue depuis église paroissiale. On a peu
d'informations sur cet édifice religieux. On sait seulement que
ses vitraux ont été soufflés lors de bombardements en 1940 et 1944.
À présent, il est embelli de vitraux contemporains.
L'architecture de l'église est du style gothique flamboyant de type
lorrain. À ce titre, Saint-Laurent fait partie du groupe
très riche des églises flamboyantes des Vosges.
|
 |

La nef et le chœur de l'église Saint-Laurent. |

Vue d'ensemble extérieure. |
|
|
|
|
Le château.
Le premier, à la fin du XIe siècle, n'est qu'une construction
modeste, bâtie sur un rocher, avec donjon et bâtiments annexes.
Il est en la possession d'une branche cadette de la maison
de Lorraine, les comtes de Vaudémont. Les fouilles
l'ont mis en évidence dès 1979. Il s'étend aux XIIIe et XIVe
siècles avec une nouvelle enceinte vers l'est et le sud, une
salle de garde et une galerie des Archers. C'est aussi l'époque
où Châtel passe aux mains de la puissante famille des Neufchâtel-Bourgogne
et connaît une prospérité considérable : la ville contrôle
la vallée de la Moselle et le passage vers les salines de
la Seille. Elle possède huilerie, moulin, fonderie, teintureries,
tanneries et une fabrique de verre à vitrail. Le château domine
la ville ; son enceinte est flanquée de douze tours et dotée
de deux porteries. Une seconde enceinte (sauf au sud) vient
encore le fortifier contre l'artillerie. Châtel sortira vainqueur
des deux sièges établis par son ennemi intime, le duc de Lorraine
et de Bar. Allié à la Bourgogne, le château servira de base
pour les campagnes de Charles le Téméraire dans les années
1460-1470. Il passe dans les mains du duc de Lorraine en 1544.
Les armées du roi de France l'assiégeront neuf fois entre
1634 et 1670, année où il sera pris et détruit à l'explosif.
Source : Lorraine gothique
de Marie-Claire Burnand, édition Picard.
|
|

Maquette de l'ancien château.
Il est présenté ici dans son extension maximale.
(Maquette présentée dans la salle d'accueil du chantier archéologique.) |

Le clocher de Saint-Laurent
et le chantier archéologique au premier plan.
Les fouilles ont dégagé les soubassements de murs. |

Une vue du chantier archéologique. |

Maquette de l'ancien château.
Toute cette partie a été rasée à l'explosif durant l'hiver 1670-1671. |
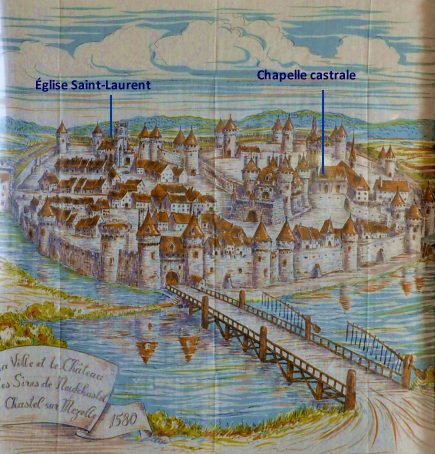
Vue ancienne du château sur une tapisserie de 1580.
Il ne faut pas confondre l'église Saint-Laurent, située dans la ville,
avec l'ancienne chapelle castrale située dans l'enceinte du château.. |

Les ruines de la tour de la Chapelle vues depuis le quai Jean
Jaurès. |
|
Les
ruines actuelles. Le château ayant été rasé,
sur l'ordre de Louis XIV, durant l'hiver 1670-1671,
il ne reste d'appréciable que le soubassement de quelques
tours, comme la tour de la Chapelle ci-dessus. Tout
le reste a été remblayé par les habitants - toujours
sur ordre - afin de faire disparaître les vestiges.
À présent, pour essayer de faire revivre le passé,
il faut tout déblayer. Depuis 1972, des chantiers bénévoles
internationaux se sont mis au travail. C'est une tâche
colossale tant la forteresse est vaste et possède de
parties en sous-sol. L'association du Vieux Châtel s'efforce
de dynamiser les fouilles en organisant des ateliers
et des stages de formation ainsi qu'en accueillant des
classes de patrimoine. La fête des Médiévales en Lorraine
se présente comme le point culminant de cette dynamique.
|
|
|
| LA NEF DE L'ÉGLISE
SAINT-LAURENT |
|

La nef et le bas-côté nord. |
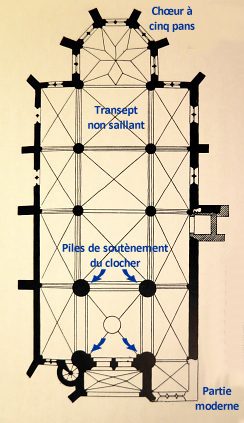
Plan de l'église Saint-Laurent. |

Christ en croix dans la nef. |

Le visage de la Vierge dans la Piéta. |
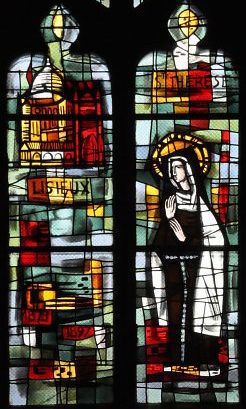
Vitrail : Sainte Thérèse de Lisieux. |
|
|
Architecture
interne. Avec trois travées et un transept
non saillant, l'église Saint-Laurent de Châtel-sur-Moselle
possède un style très homogène. Sa longueur hors-tout
est de 34 mètres. L'élévation est à deux niveaux avec
une rangée de petites fenêtres au second niveau qui
reçoivent des vitraux à figures géométriques. Dès son
entrée, l'observateur remarque qu'il n'y a pas de corniche
pour séparer les deux parties de l'élévation, ce qui
accroît visuellement la hauteur de la nef. On se reportera
à l'église Saints-Calixte-et-Julien
de la petite ville voisine de Nomexy pour voir un édifice
assez semblable, mais avec une corniche qui coupe en
deux l'élévation.
La voûte quadripartite de Saint-Laurent retombe en pénétration
dans les piles, selon un mouvement très élégant et à
peine perceptible. Il faut vraiment être devant (cf
la photo ci-dessus au premier plan) pour voir l'engagement
discret des piles de la nef dans l'élévation. Il n'y
a aucun chapiteau, la pénétration en palmier est partout
de rigueur, dans la nef et les bas-côtés. L'intrados
des arcades reste simple, contrairement à celui de l'église
de Nomexy qui est riche de plusieurs rouleaux.
Dans l'avant-nef, on remarque la présence de quatre
grosses piles, nécessaires pour soutenir le poids du
clocher. L'architecte de l'époque a pris soin de les
faire déborder sur la nef afin de respecter l'alignement
des bas-côtés.
Le chœur
de Saint-Laurent est à cinq pans. Il est éclairé par
cinq baies embellies de vitraux et séparées par des
faisceaux de colonnettes. La voûte du chœur, en étoile,
est remarquable. À son sujet, on lit dans une
note affichée dans l'église : «C'est l'étoile des Rois
Mages, évocation de l'Abbaye de Lieu Croissant ou des
Trois Rois, près de l'Isle sur le Doubs, sépulture des
sires de Neufchastel.»
Sources : 1) Lorraine
gothique de Marie-Claire Burnand, édition Picard
; 2) note affichée dans l'église.
|
|

Vitrail : La Sainte Famille, détail. |

Statue de sainte Anne (XVIe siècle). |

Vitrail : Saint Vincent de Paul. |
|

La voûte quadripartite de la nef. |

Piéta du XVIe siècle. |

|
| Inscriptions
du nom des fidèles sur les bancs. |
|
 |
|

Vitrail : La Nativité. |

Vitrail : La Vierge avec deux anges. |
|
|

Vitrail : Saint Laurent, détail. |

La nef, le chœur et le bas-côté sud. |
| LE CHŒUR DE L'ÉGLISE
SAINT-LAURENT |
|

Le chœur et les absidioles vus depuis le bas-côté sud. |
|
Le transept passe devant
les deux autels qui terminent les bas-côtés. Fait peu courant
dans la région : il est très marqué (le niveau de l'arcade
dépasse nettement celui des voûtes des bas-côtés) et très
lumineux. Quatre vitraux l'éclairent, disposés sur trois côtés.
|
|

Autel de l'absidiole nord. |

La Mort de saint François-Xavier
dans le soubassement de l'autel de l'absidiole sud. |

Le chœur et ses cinq baies (dont trois sont visibles de face). |

Porte et sculptures néogothiques dans le chœur. |

Cette vue du chœur, de biais, met en relief les pans de côté. |

L'orgue du chœur date de l'an 2000. |
|
|

La nef de l'église Saint-Laurent vue du chœur. |
Documentation : Lorraine gothique de Marie-Claire
Burnand, édition Picard
+ note affichée dans l'église. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|



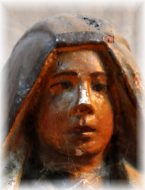







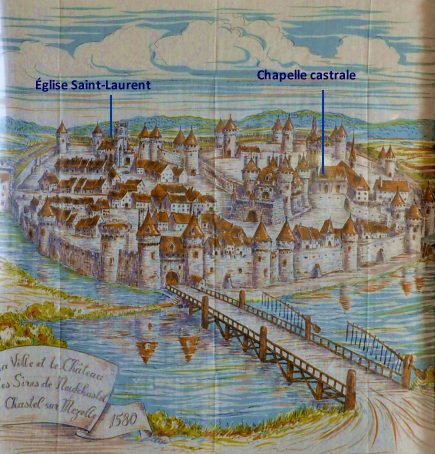









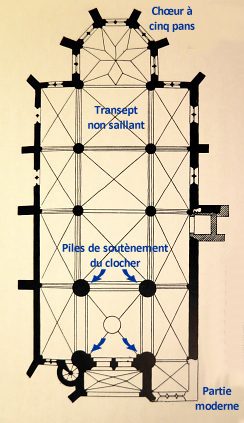


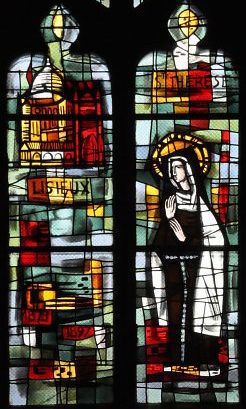















 La Dormition dans le soubassement de l'autel de l'absidiole
nord (œuvre du XIXe siècle).
La Dormition dans le soubassement de l'autel de l'absidiole
nord (œuvre du XIXe siècle).