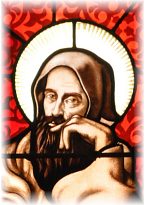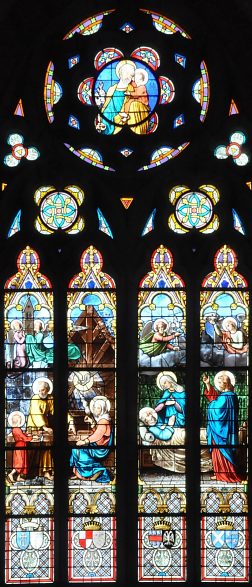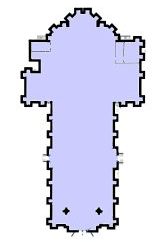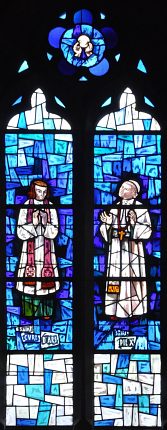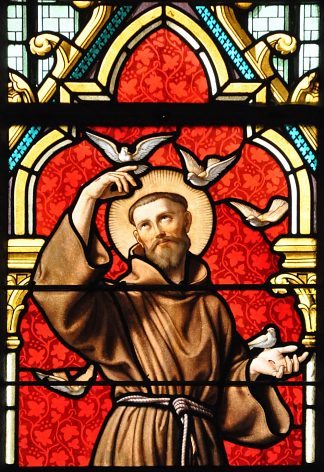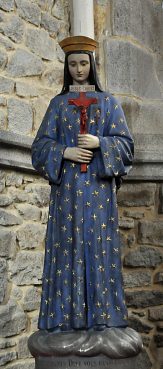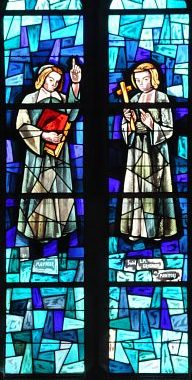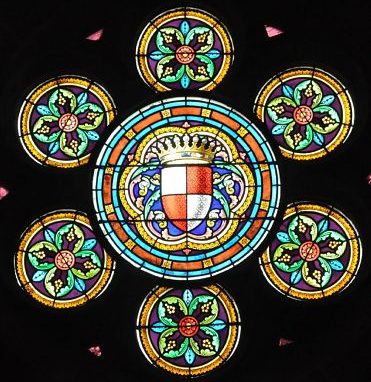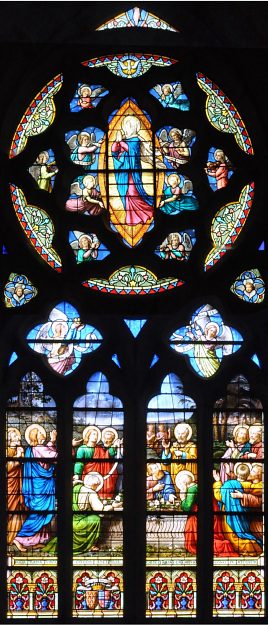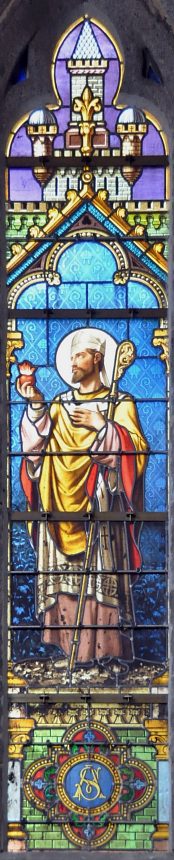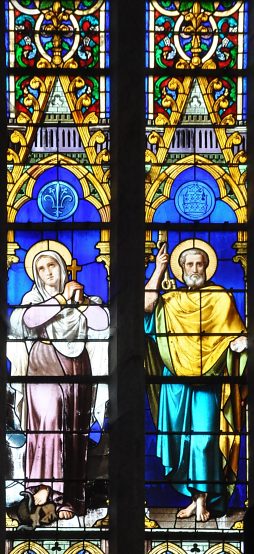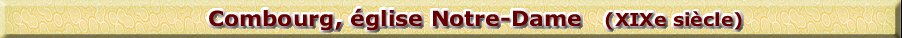 |
 |
L'église Notre-Dame de Combourg
est en pierre de granit, ce qui lui confère par endroits
un cachet «vieilles pierres», assez surprenant pour
un édifice qui accuse à peine cent cinquante ans.
Sa construction, qui a pris vingt ans, s'est opérée
en deux phases. En 1859, l'architecte Charles Langlois (1811-1896)
fait ériger la nef et la tour. Arthur Regnault (1838-1932)
prendra la suite en bâtissant le transept et l'abside. L'église
de Combourg, d'un style néogothique très classique,
en impose par sa taille : 70 mètres de long sur 21 de large.
Le clocher, quant à lui, a une hauteur de 50 mètres.
Les nombreux vitraux de l'église ont deux origines. Ceux
de la fin du XIXe siècle, de l'atelier parisien de Claudius
Lavergne, sont conformes à l'art du vitrail de cette époque.
On notera toutefois le grand vitrail-tableau du transept sud illustrant
l'Assomption
de la Vierge, ainsi que la grande
verrière de l'abside, malheureusement bouchée
en partie par le pignon du retable. Les autres vitraux datent du
XXe siècle. Ils sont signés Robert Briand, de Rennes.
La griffe très moderne de cet artiste (qui n'est d'ailleurs
pas des plus heureuses sur les visages), porte à penser qu'il
s'agit de la seconde moitié du XXe siècle. Cette page
vous propose un grand nombre de verrières de l'église.
À l'entrée, le visiteur peut admirer des éléments
assez rares : des bénitiers
de granit du XIIe siècle et deux fonts
baptismaux en pierre des XIVe et XVe siècles. Enfin,
une chapelle absidiale abrite une châsse avec des reliques
de saint
Gilduin (non donnée dans cette page), diacre qui est
par ailleurs représenté dans plusieurs statues de
l'église.
|
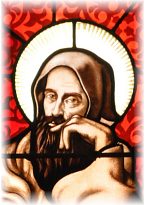 |

Vue d'ensemble de la nef de l'église Notre-Dame de Combourg. |

L'église est longue de 70 mètres. Son clocher
culmine à 50 mètres. |
 |
|

Le chevet et les absidioles de l'église Notre-Dame. |

L'église au milieu des maisons vue depuis le château.
|
«««---
À GAUCHE
Les côtés latéraux (ici celui
au nord) abritent
une série de vitraux à grands personnages. |
À DROITE
---»»»
L'archange saint Michel écrasant le démon
avec son bouclier
Atelier de Claudius Lavergne, années 1880. |
|
|

Le baptistère est illuminé par une
verrière
d'un baptême réalisée par
l'atelier Robert Briand, XXe siècle. |

Bénitier de granit du XIIe siècle |
|

La nef vue du transept avec le bas-côté
nord. |

Une tête d'homme sculptée dans
le granit
Pilier dans l'avant-nef |

Une tête de femme
au-dessus d'un pilier du transept sud. |
|

Les piliers de l'avant-nef et ceux du transept
affichent, au sein de leurs chapiteaux, une
tête d'homme ou de femme. |
À
DROITE ---»»»

Statue de saint Roch.

Dans l'église Notre-Dame de Combourg,
comme
souvent dans les églises bâties
à la fin du XIXe siècle,
on trouve beaucoup de statues de saints
et de
saintes en plâtre, typiques de
l'art saint-sulpicien.
Voir l'encadré sur cet art à
l'église Saint-Sulpice
de Paris. |
|
|
|
|
|
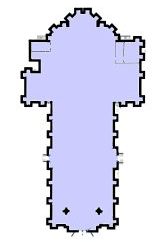
Plan de l'église.
Les deux chapelles absidiales font
un peu disparaître le dessin
traditionnel de la croix latine. |
 |
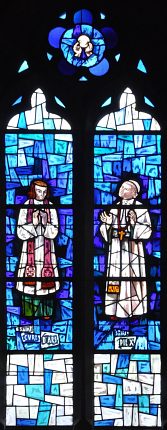
Le Curé d'Ars et saint Pie X
Atelier Robert Briand, XXe siècle. |
 |
|

Un des impressionnants fonts baptismaux
en pierre des XIVe et XVe siècles. |

Chapiteaux d'un pilier du transept nord avec une tête
d'homme. |
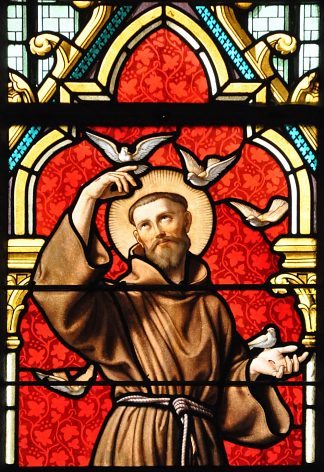
Saint François d'Assise
Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne, années
1880. |
|

Le Christ en croix dans la nef. |

Une étape du Chemin de croix. |

Une tête d'homme
au-dessus d'un pilier du transept nord. |
|

«Et il poursuivait son chemin tout à la joie»
Détail de la verrière du baptistère.
Atelier Robert Briand, XXe siècle. |

Élévations nord. |
|
Architecture
de la nef. On voit dans la photo ci-dessus
que la série d'arcades qui scande la nef est
dominée par une corniche horizontale en très
légère saillie. Celle-ci reçoit
les retombées de la voûte sur des petits
chapiteaux à motifs floraux. Le choix de l'architecte
Charles Langlois a été de séparer
l'élévation de la nef en deux parties,
mais en se contentant d'un trait assez léger.
|
|
|

Le bas-côté sud et sa belle rangée de vitraux
des XIXe et XXe siècles.
Sur le bas-côté nord, la rosace au-dessus de la porte
affiche le blason des seigneurs de Combourg. Voir plus
bas. |

Confessionnal du XIXe siècle. |
|
Saint-Gilduin
est le patron des pèlerins de Chartres et des
émigrés bretons. Il naquit vers 1052-1054,
dans une famille de la noblesse bretonne. Son père
était le premier seigneur de Dol et de Combourg.
Son grand-oncle paternel, Junguenée, était
l'archevêque de Dol. Voulant être clerc,
Gilduin refusa de se marier. D'après les sources,
il aurait fait des études à l'école
épiscopale de Dol (ce qui n'est guère
surprenant pour le fils d'un seigneur local). Il fut
donc reçu moine et tonsuré. À une
époque où la simonie et le nicolaïsme
ravageaient l'Église, sa conduite exemplaire
attira l'attention. C'est pourquoi le successeur de
Junguenée à l'archevêché
de Dol, Juthaël, le nomma chanoine de sa cathédrale,
puis diacre.
En 1073, le moine Hildebrand arrive sur le trône
papal et prend le nom de Grégoire VII.
Il lance le vaste mouvement qui va bouleverser l'Église,
la séparer du pouvoir laïc et mettre un
terme aux pratiques les plus scandaleuses de ses clercs.
Ce mouvement va rester dans l'Histoire sous le nom de
«réforme grégorienne». En
fait, cette réforme était déjà
dans les esprits avant 1073, tant les excès,
trop voyants, révoltaient bien des serviteurs
de l'Église. Et c'est au pape Léon
IX, élu en 1049, que l'on doit le travail
de sensibilisation des consciences sur la nécessité
d'une réforme. De fait, l'étau s'était
resserré peu à peu sur le relâchement
éhonté de certains prélats, tout
comme sur l'empiétement du pouvoir laïc
sur le clergé. En 1059, le pape s'était
réservé la nomination des cardinaux ;
l'empereur n'y avait plus sa part. À partir de
1073, Grégoire VII lance l'offensive à
coups de décrets et de propositions pour rendre
l'Église plus morale et indépendante des
souverains. Il condamne notamment les charges ecclésiastiques
obtenues grâce à un titre de noblesse.
Cette réforme en profondeur va
--»» 2/2
|
|

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et sainte
Jeanne d'Arc
Détail d'un vitrail de l'atelier Robert Briand, XXe siècle. |
|

Saint Gilduin
Détail d'un vitrail de l'atelier
Claudius Lavergne, années 1880. |

La Multiplication des pains
Vitrail de l'atelier Robert Briand, XXe siècle. |

Armoiries dans une rose du XIXe siècle |
|
|
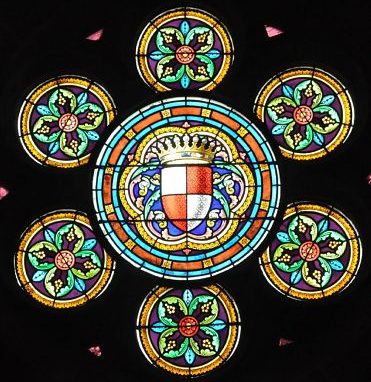
Rose du bas-côté nord avec le blason des seigneurs
de Combourg
surmonté d'une couronne comtale.
(Atelier Claudius Lavergne, années 1880). |
|
Saint
Gilduin 2/2.
--»» s'étaler sur deux
siècles.
À Dol, on savait ce qu'était le relâchement
éhonté d'un prélat. En 1068, un
dénommé Johonnée avait succédé
à Juthaël à l'archevêché.
On accusait ce diable d'homme d'avoir acheté
sa charge (simonie) ; on le voyait vivre dans le luxe
et se servir des biens de l'Église en faveur
de ses propres enfants (nicolaïsme). Les Dolois
étaient scandalisés. Mais l'appui de Guillaume
le Conquérant envers celui qu'ils surnommaient
l'«Archiloup» les paralysait quelque peu.
Ils essayèrent néanmoins de le faire destituer.
Sans résultat. Alors ils le chassèrent
par la force. Le prélat se réfugia près
du Mont Saint Michel où, nous disent les sources,
il continua ses œuvres de prédation dans
la région. En 1076, enfin, la procédure
de destitution pour simonie le priva officiellement
de sa chaise épiscopale. Dol devait donc élire
un nouvel archevêque.
Le choix se porta aussitôt sur un saint homme
: Gilduin. Arguant de son jeune âge (moins de
25 ans) et, bien sûr, de son indignité,
il refusa la charge. Insister ne servit à rien.
On décida donc d'en référer à
Grégoire VII en personne. Une délégation
partit pour Rome, avec dans ses rangs Gilduin et un
dénommé Even, abbé de la paroisse
Sainte-Melaine à Rennes, regardé comme
un sage.
Devant le pape, Gilduin rappela son jeune âge,
son indignité et présenta un argument
très actuel : en étant élu, il
devrait son élection au fait qu'il était
le fils du seigneur de Dol et de Combourg. Ce qui violait
l'un des récents décrets de Grégoire
VII : ne pas devoir une charge épiscopale à
un titre de noblesse. Alors autoriser une dérogation?
Gilduin avait réponse à tout : le faire
si peu de temps après la mise en application
du décret ôterait toute crédibilité
à la volonté papale de réforme.
Le pape se rangea à son avis et lui demanda de
désigner lui-même son successeur. Après
consultation des délégués, le jeune
diacre choisit Even, qui fut donc consacré archevêque
de Dol par le pape le 27 septembre 1076.
Quittant Rome, Gilduin partit en pèlerinage à
Chartres. Il fit étape au château du Puiset
où résidait sa famille maternelle. En
route il fut saisi de fièvre. Au Puiset, sa famille
le soigna, mais rien n'y fit. Il demanda quand même
à aller prier à Chartres, auprès
des reliques de la tunique de la Vierge Marie. On l'y
transporta et il fut hébergé au monastère
de Saint-Père-en-Vallée à Chartres,
lieu où s'élève aujourd'hui l'église
Saint-Pierre.
C'est là qu'il mourut le 27 janvier 1077. Son
corps fut inhumé dans l'église du monastère.
Source : panneaux sur la vie de
saint Gilduin dans l'église.
|
|
|
| LE TRANSEPT ET
SES VITRAUX-TABLEAUX DU XIXe SIÈCLE |
|

Le transept, très saillant, de l'église Notre-Dame donne
ici sur le beau vitrail de l'Assomption,
atelier Claudius Lavergne, années 1880. |

La chaire à prêcher du XIXe siècle ne sert plus.
Elle a été reléguée au fond du transept
nord. |

Sainte Bernadette et sainte Maria Goretti
Détail d'un vitrail de l'atelier Robert Briand, XXe siècle.
|

La Sainte Famille
Atelier Claudius Lavergne, années 1880. |
|

La cuve de la chaire à prêcher
est ornée des symboles du Tétramorphe.
Ici, le lion de Marc et le taureau de Luc. |

Le tympan du vitrail de l'Assomption accueille
une très belle Vierge Marie entourée d'anges
Atelier Claudius Lavergne, années 1880.
On pourra voir aussi le vitrail de René Échappé,
d'une facture
inférieure, à l'église Notre-Dame
de Vitré. |
|
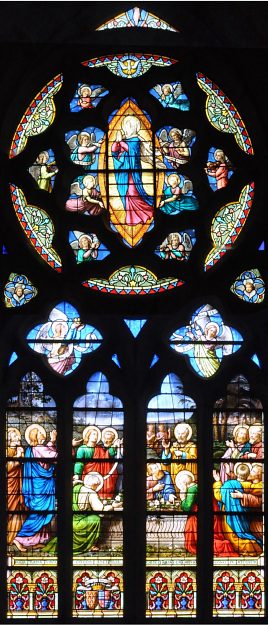
Vitrail L'Assomption dans le transept sud
Atelier Claudius Lavergne, années 1880. |
|
L'Assomption
de la Vierge. Dans le vitrail ci-dessus,
on voit les apôtres quelque peu intrigués
par le tombeau vide. Ce vitrail est-il inspiré
du tableau de peintre maniériste italien du XVIe siècle,
Taddeo Zuccaro ou du vitrail du XVIe siècle
de Louis Pinaigrier sur le même sujet, visible
à la cathédrale Saint-Étienne
de Bourges? Louis Pinaigrier s'est d'ailleurs inspiré
lui-même de l'œuvre de Taddeo Zuccaro.
|
|
|
|

Vitrail-tableau sur quatre lancettes de l'Assomption de la Vierge.
Atelier Claudius Lavergne et ses fils, années 1880.
|
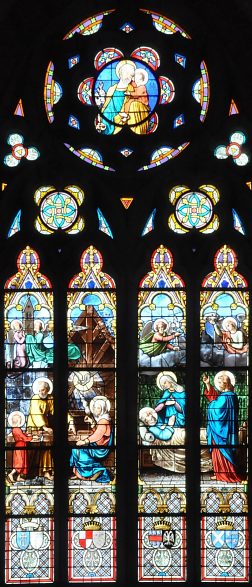
|

Panneau avec deux blasons
dans le soubassement
du vitrail de la vie de Joseph.
Atelier Claudius Lavergne et ses fils, 1883. |

La Vierge et son fils
dans le chœur.
Art saint-sulpicien.
Voir l'encadré sur l'art
saint-sulpicien à
l'église Saint-Sulpice
de Paris. |

Sainte Clotilde
accompagnée de saint Clodoald.
Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne,
années 1880. |
«««---
À GAUCHE
Deux scènes de la vie de Joseph :
la Sainte Famille et la Mort de Joseph
Vitrail-tableau dans le croisillon
nord du transept.
Atelier Claudius Lavergne et ses fils, 1883
.
Ce vitrail-tableau est enrichi dans son soubassement de quatre
très beaux panneaux portant blasons. |
|
| LES CHAPELLES
ABSIDIALES ET LEURS VITRAUX |
|

La chapelle absidiale nord Saint-Gilduin et le chœur. |

Statue moderne de saint Gilduin
dans l'absidiole nord. |

Saint Gilduin
dans l'absidiole nord. |
|
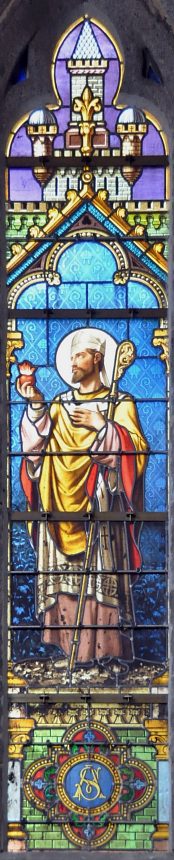
Saint Augustin
dans la verrière
de la chapelle Saint-Giduin.
Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne, années
1880. |

Sainte Marguerite couronnée
par l'Enfant Jésus.
Verrière de l'absidiole sud.
Claudius Lavergne, années 1880. |

Saint Ignace de Loyola
Verrière de l'absidiole nord.
Claudius Lavergne, années 1880. |
À DROITE
---»»»
Chapelle absidiale nord
dédiée à saint Gilduin. |
|
|
|

L'autel en pierre de granit dans l'absidiole nord. |

Pierres tombales du comte Christian de Chateaubriand (†1889)
et de sa seconde épouse Antoinette de la Rochetaillée.
Absidiole nord. |

Chapelle absidiale sud. |
 |
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE COMBOURG |
|

Le chœur et l'autel de messe de l'église Notre-Dame. |

Le grand retable du XIXe siècle dans l'abside. |

Jésus et la Samaritaine
Bas-relief du retable (XIXe siècle). |
|

La Déploration du Christ (XIXe siècle)
Bas-relief du soubassement du retable. |

Le Couronnement de la Vierge
Vitrail central de l'abside.
Atelier Claudius Lavergne, années 1880.
À DROITE ---»»»
La clé de voûte du chœur porte
les lettres «IHS», monogramme représentant
le Christ. |
|

Un ange du retable. |
 |
|
|

Vue d'ensemble des vitraux de l'abside.
Il s'en dégagerait presque une atmosphère un peu féerique
si le retable et l'orgue ne bouchaient la vue. |

Saint Louis dans le chœur.
Détail d'un vitrail de l'atelier Claudius Lavergne,
années 1880. |

Nid d'hirondelle sur la façade occidentale.
Pourquoi avoir construit cet étrange poste
d'observation comme dans l'ancien temps?
Et pour qui? |

Armoiries dans un vitrail
de l'atelier Claudius Lavergne, années 1880. |
|
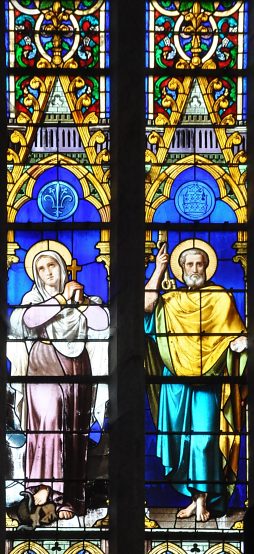
Sainte Marguerite et saint Pierre dans le chœur
Vitrail de l'atelier Claudius Lavergne, années 1880. |
 |
|

La nef vue de derrière le maître-autel. |

Statue de saint Gilduin. |

Saint Louis et Saint Jean
Atelier Claudius Lavergne, années 1880. |
«««---
À GAUCHE
Armoiries avec écusson à fleurs de lys (Claudius Lavergne,
années 1880). |
|
|

La nef vue depuis le chœur. |
Documentation : Panneaux affichés dans
l'église et panneau extérieur. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |