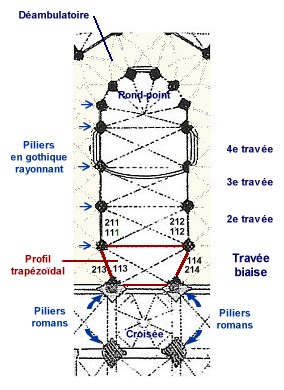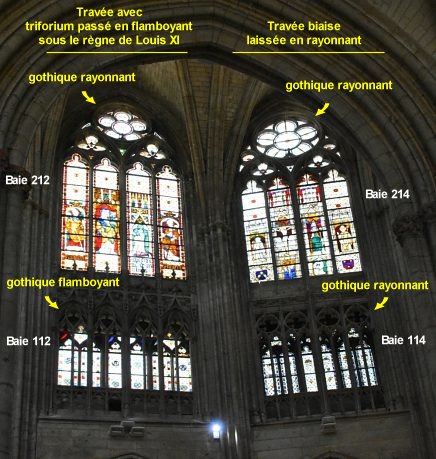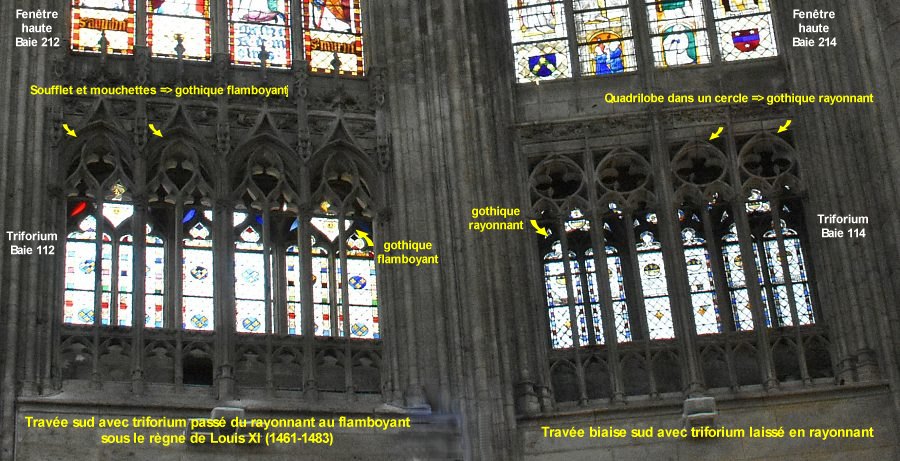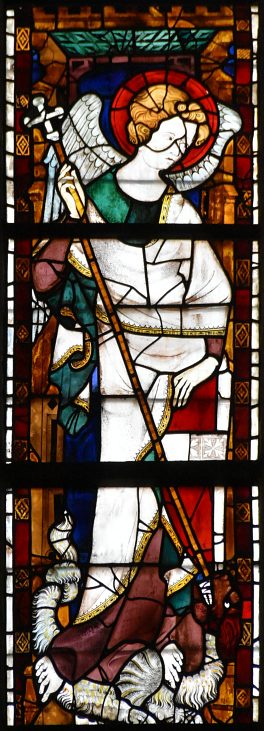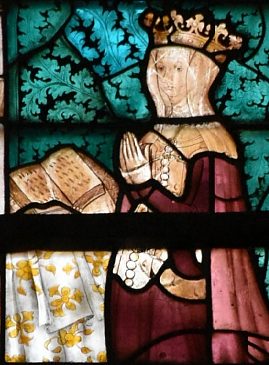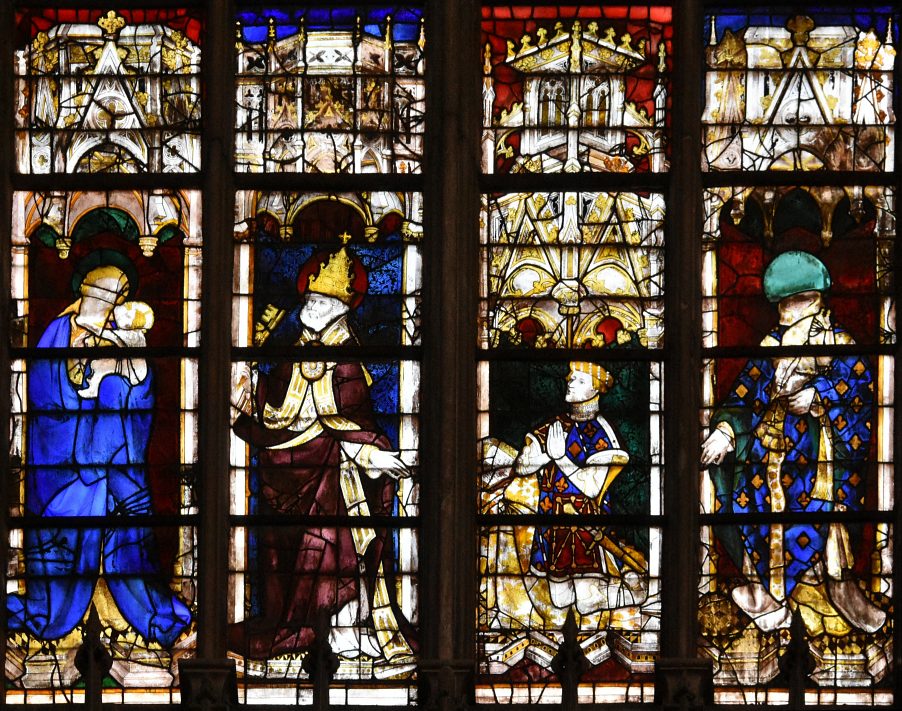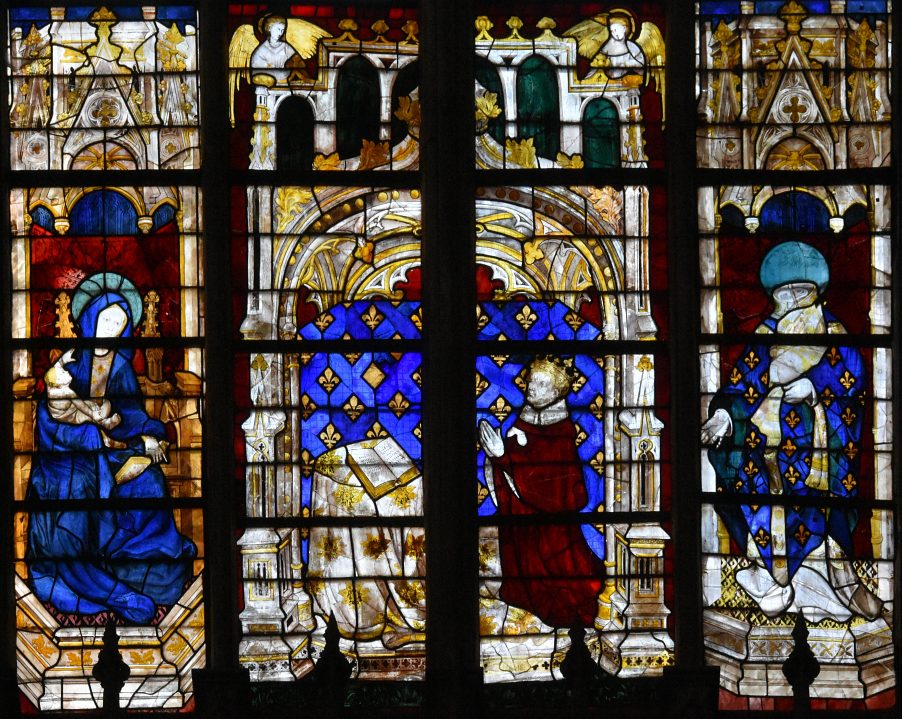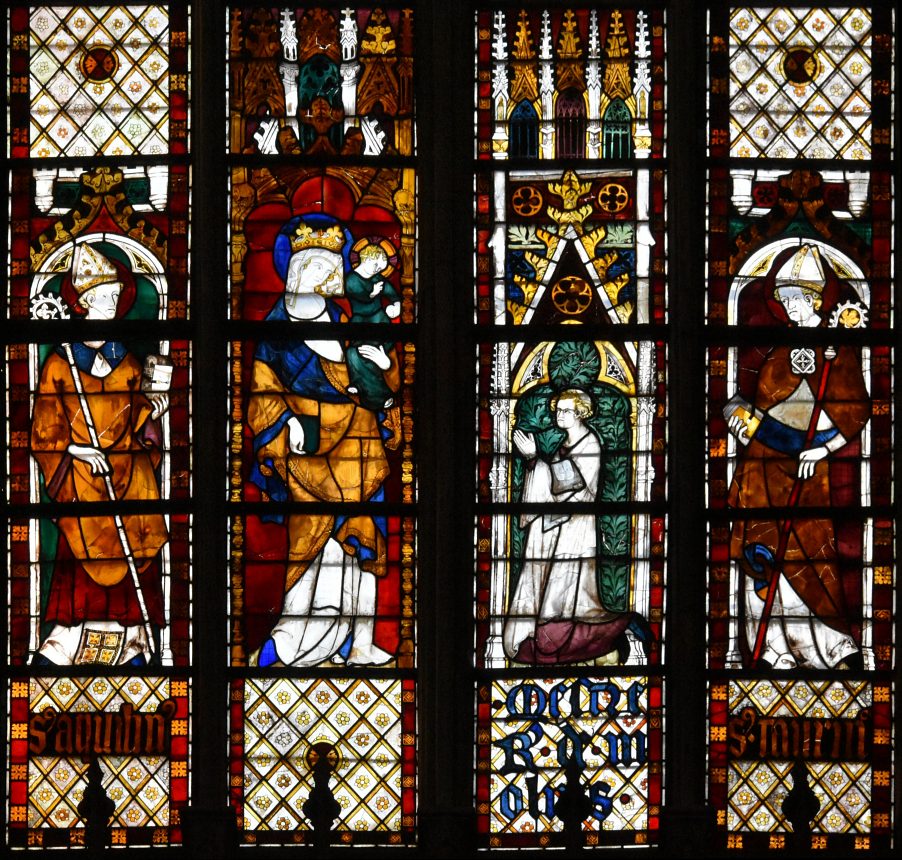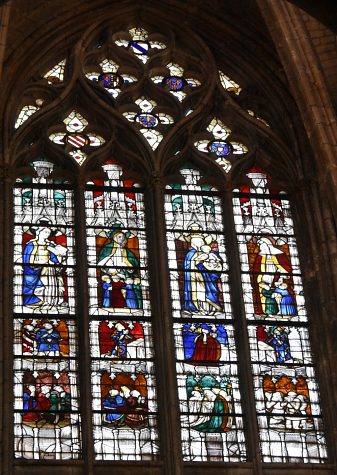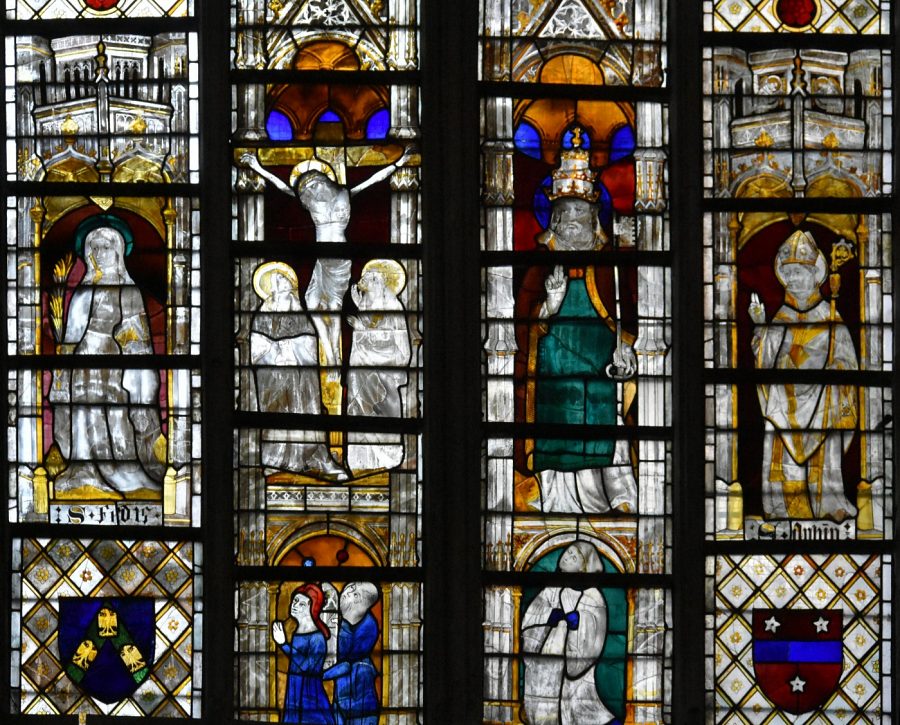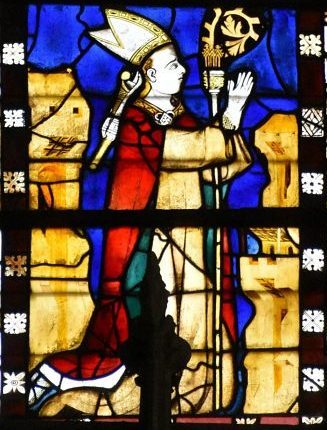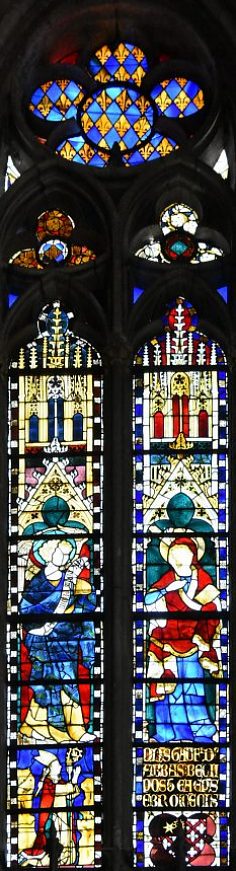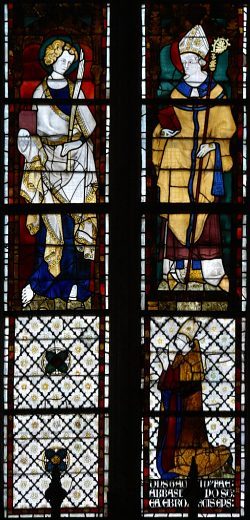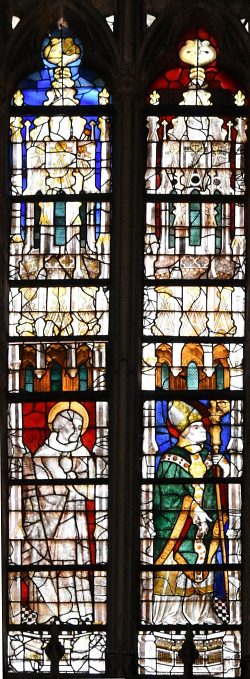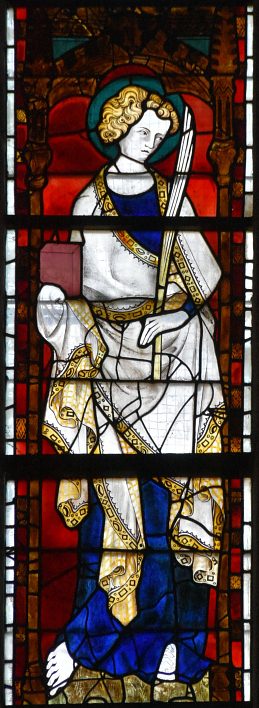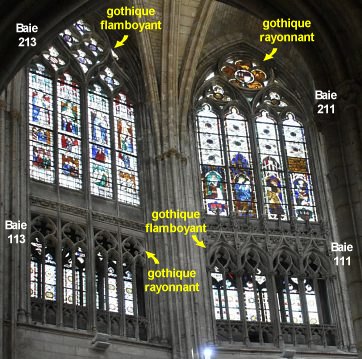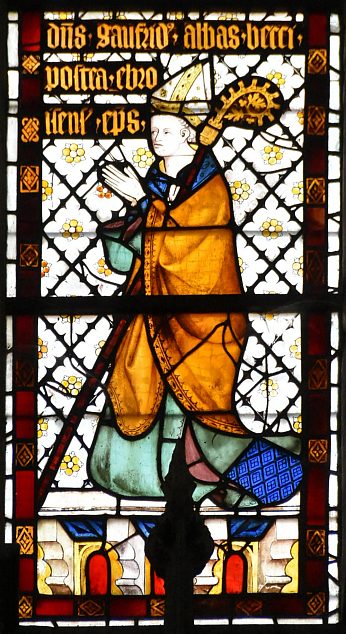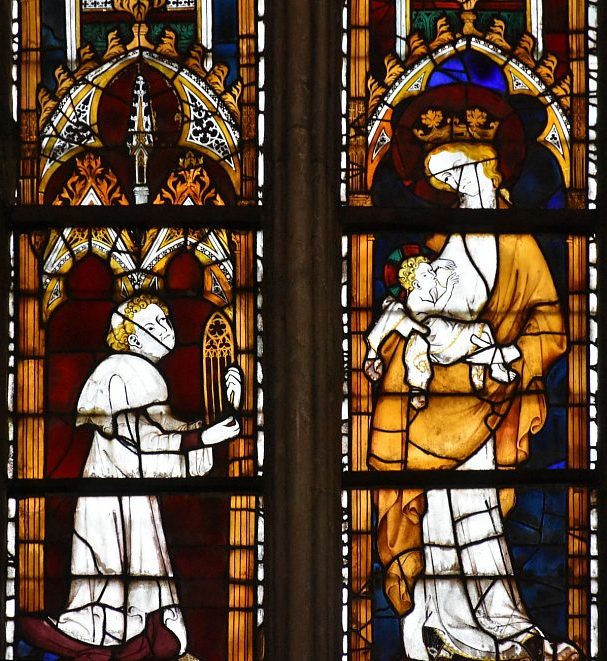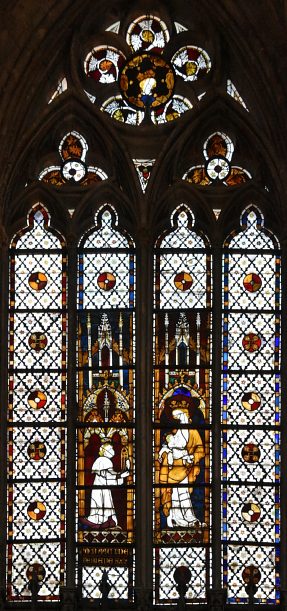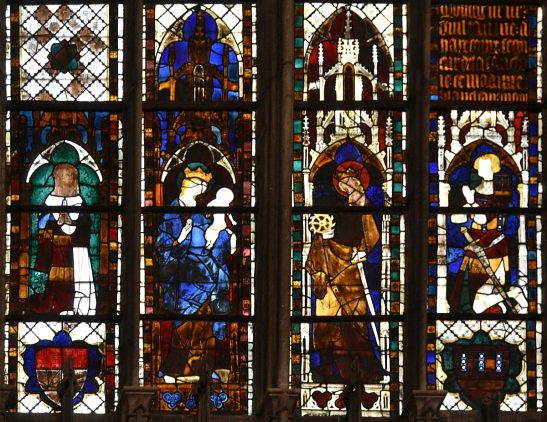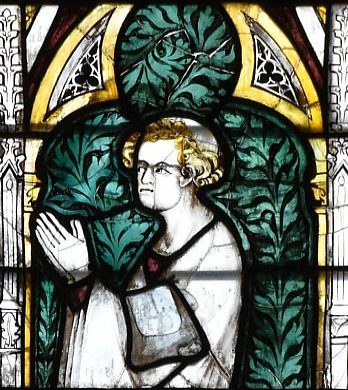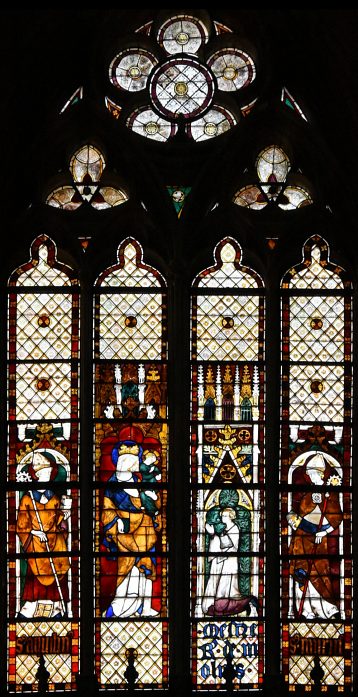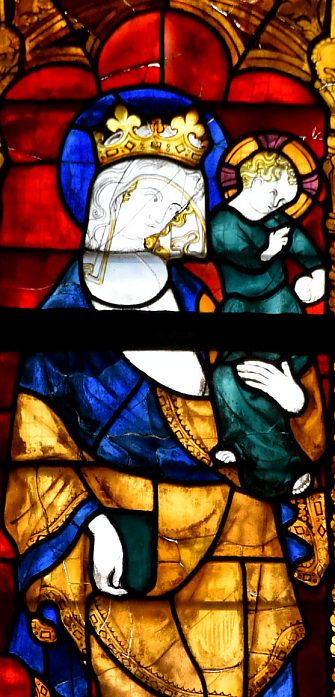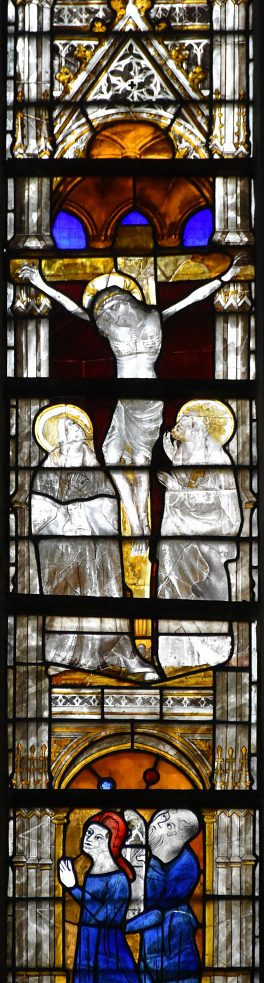|
|
 |
 |
LE
CHŒUR ET SES VERRIÈRES HAUTES
|
 |
|
Cette page expose l'architecture du chœur
et détaille les vitraux des hautes fenêtres. Certains d'entre
eux sont célèbres comme celui des Trois
Marie dans la baie 213. Le visiteur prendra certainement plaisir
à admirer cet ensemble de vitraux. Les historiens l'ont assez
souligné : le chœur de Notre-Dame d'Évreux offre
presque un historique complet du vitrail des années 1330
jusqu'au début du XVe siècle. Cette page essaie d'en rendre compte.
Pour ce qui est du mobilier, le chœur étant fermé
par des grilles
et des stalles,
et l'autel étant nu, il y a peu à voir. Le seul intérêt
réside dans les grandes piles de style gothique rayonnant qui remontent
au XIIIe siècle.
Qu'y a-t-il d'intéressant dans l'élévation
? Le chœur de la cathédrale Notre-Dame date de la fin
du XIIIe et du tout début du XIVe. Mais l'abandon du style
gothique rayonnant au profit du flamboyant s'est traduit au XVe
siècle par des travaux qui ont laissé quelques traces. Ce
point architectural est développé plus
bas.
|

Vue d'ensemble du chœur de la cathédrale (achevé avant 1310).
À droite, dans le déambulatoire : la chapelle
du trésor.
On remarquera le pavage au sol. Il date de 1785 et a suscité l'ire
de l'historien Louis Réau dans son Histoire du vandalisme (voir
plus bas). |
|
Architecture
du chœur.
Le chœur (appelé aussi sanctuaire) de la
cathédrale Notre-Dame est un espace clos, dont
la construction a commencé dès la fin
des travaux de la nef
(vers 1260) et qui s'est achevée avant 1310.
Les grilles et les stalles qui font barrière
interdisent d'y pénétrer, mais le visiteur
a toujours le loisir d'y observer l'architecture.
Le style est ici le gothique rayonnant avec un
triforium flamboyant. L'élévation
du chœur est à trois niveaux : grandes arcades
en tiers point (le point se rétrécit dans
l'abside) ; triforium vitré ; puis grandes fenêtres.
La photo ci-dessus montre l'impression générale
de verticalité de l'ensemble. Aucun élément
horizontal ne vient, par son volume, casser cette impression
dûment étudiée par l'architecte
: 1) la mince moulure qui souligne la naissance du triforium
n'attire pas l'œil ; 2) aucun chapiteau ne vient
casser l'élan des colonnettes qui s'élèvent
depuis le sol jusqu'à la retombée des
ogives ; 3) les liserés floraux qui ornent le
faisceau de colonnettes sont trop fins et situés
trop haut pour menacer l'impression de verticalité.
En regardant le chœur, l'œil ne peut être
que satisfait par l'application du principe de bonnes
proportions, un concept crucial dans la mentalité
médiévale : le triforium, étage
le moins étendu, agit comme un ruban de pierre
ajouré qui viendrait décorer une élévation
d'un seul bloc, tel un étroit galon cousu au
milieu d'une bande de tissu. Imagine-t-on ce que donnerait
l'élévation si le triforium avait la hauteur
des fenêtres hautes, et les fenêtres hautes
la hauteur du triforium ? Au-delà des problèmes
de solidité de la construction, la répartition
paraîtrait totalement déséquilibrée.
La curiosité de l'élévation repose
dans sa première travée, dit «travée
biaise» en raison de sa forme trapézoïdale
(voir le
plan du chœur donné ci-dessous). Les
travées du chœur gothique étant plus
larges que celles de la nef et de la croisée
romanes, il fallait rattraper la différence pour
joindre les piliers de la croisée aux piliers
du chœur. Conséquence : en regardant le
chœur depuis la chapelle axiale (voir photo),
on a la nette impression que le chœur se referme
sur lui-même.
On notera que le maître-autel fait office d'autel
de messe. Comme il n'y a aucun retable dans le sanctuaire,
le célébrant peut tout à fait dire
la messe selon les règles de Vatican II.
Voir plus
bas les modifications intervenues sur le triforium.
Source : La cathédrale
d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise
Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.
|
|
 |
|
|
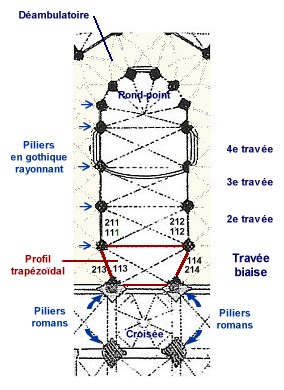
Plan du chœur de la cathédrale Notre-Dame.
Les travées du chœur sont plus larges que celles de la
nef.
La «travée biaise» assure donc le lien entre les
piles
du sanctuaire et celles de la croisée du transept. |

Le maître-autel (qui est aussi l'autel de messe) vu depuis la
chapelle axiale.
Le rétrécissement des arcades dans la «travée
biaise» est ici bien visible. |

La grille de la clôture du sanctuaire face à la nef (années
1747-1750).

|
Le vandalisme
d'avant la Révolution.
Dans son ouvrage Histoire du vandalisme, l'historien
Louis Réau nous apprend que, jadis, la cathédrale
Notre-Dame était riche en dalles tumulaires et monuments
consacrés aux évêques d'Évreux.
Malheureusement, le XVIIIe siècle voulait du neuf,
de la clarté pour les vitraux et ne manifestait aucun
souci pour le patrimoine, une notion qui ne prendra réellement
forme qu'au siècle suivant.
Louis Réau écrit : «En 1794, le chapitre
fit paver à neuf les nefs : ce qui nécessita
l'enlèvement des dalles gravées qu'on utilisa
comme matériaux.» Un Ébroïcien contemporain,
relate Louis Réau, a pu écrire que certaines
d'entre elles, qui furent sciées sans ménagement,
étaient très belles.
Ce qui est à nos yeux modernes du vandalisme continua
l'année suivante avec le pavage du chœur. Décidée
et payée par Mgr François de Narbonne, évêque
d'Évreux, qui sortit douze mille livres de sa cassette,
cette «regrettable libéralité, écrit
l'historien, entraîna la disparition des tombeaux de
plusieurs de ses prédécesseurs.»
Source : Histoire du vandalisme
par Louis Réau, Robert Laffont, 1994.
|
|
|

Le chœur, de style rayonnant, est ceinturé par une série
d'arcades en tiers-point.
On remarque que l'autel n'est adossé à aucun retable. |
|
Les verrières
des grandes fenêtres du chœur.
Ces fenêtres ont été vitrées approximativement
entre les années 1325 et 1340, celles de l'abside
étant les dernières à l'être.
Seuls les trois-quarts sont parvenus jusqu'à nous.
Dans le quart restant, les verrières, déposées
et reposées à plusieurs reprises, sont un peu
postérieures aux autres. Les verrières des baies
213 et
214 de
la travée biaise sont évidemment plus tardives
puisque la liaison entre le transept et le chœur date
du XVe siècle.
Des changements de goût, associés à l'apparition
de nouvelles formes architecturales, ont affecté l'aspect
des vitraux à partir du milieu du XIIIe siècle
en privilégiant la lumière (voir en page
1 les hautes fenêtres de la nef). Mais les hautes
verrières du chœur, créées dans
la première moitié du XIVe, suivent une mode
encore nouvelle, issue des progrès de l'industrie
du verre. C'est en fait une vraie révolution technique
qui touche l'univers du vitrail entre 1310 et 1320.
Au XIVe siècle, les vitreries claires sont traitées
différemment car la qualité du verre s'est améliorée.
Il est maintenant plus fin, et le blanc est plus nacré.
On voit ainsi des séries de losanges rehaussés
de jaune d'argent (verrière de la baie 208).
La gamme chromatique s'accroît. Le rouge et le bleu
de l'âge roman sont enrichis de teintes adoucies donnant
des bleus clairs, des violets, des verts obtenus par des touches
de jaune d'argent sur du bleu. Les niches s'étoffent,
souvent surmontées d'une haute et savante architecture.
Dans ces hautes verrières du chœur, la Vierge
à l'Enfant est très présente, souvent
associée à des saints. Par chance, il s'y trouve
aussi un élément bien utile : le donateur. Il
suffit alors aux historiens de puiser dans les biographies
de ces généreux mécènes pour établir
une chronologie de la pose des verrières et évaluer
les modifications du goût sur une longue période.
Le chœur de Notre-Dame d'Évreux offre presque
un historique complet du vitrail des années 1330 jusqu'au
début du XVe siècle.
Source : La cathédrale
d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise
Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.
|
|

Verrière de la baie 109.
Vers 1380 et 3e quart du XVe siècle.
Comme toutes les verrières du triforium du chœur, elle
reçoit une série d'écus armoriés,
notamment ceux de la maison d'Évreux-Navarre.
Ces verrières sont surtout étudiées par les historiens
spécialistes
des généalogies au sein de la noblesse normande au Moyen Âge. |

Le chœur de la cathédrale et son élévation
absidiale.
Baie 200 : le
vitrail sans le tympan ---»»»
La Vierge et saint Jean-Baptiste.
Vers 1330-1333. |
|
| BAIE
AXIALE 200 - (1330-1333) |
|
 |
|
|
|

Baie 202, détail : le Couronnement
de la Vierge.
1335. |
|
|
Baie
202.
Comme en baie 201,
la verrière de la baie 202 a été
offerte par l'évêque d'Évreux
Geoffroy Faë. Datée de
1335, elle présente le Couronnement
de la Vierge par un ange, celui-ci volant
juste au-dessus de la couronne qu'il dépose.
Marie est assise en face du Christ. La verrière,
peu restaurée, affiche, en son bas,
le donateur en prière, agenouillé
en face d'un écu à ses armes,
surmonté du texte de la donation.
On remarquera, dans les verrières
200,
201
et 202, que le donateur n'est jamais situé
sous la Vierge, mais toujours sous son vis-à-vis
(le Christ, un ange ou un saint). Était-ce
une règle à respecter ?
Source : Corpus
Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,
CNRS Éditions, 2000.
|
|
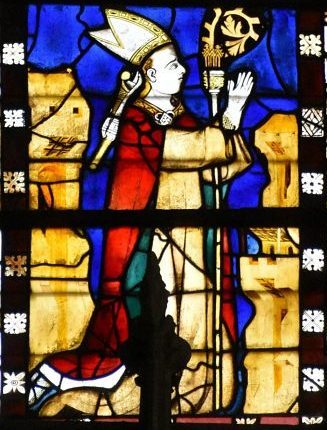
Baie 201, détail : l'évêque Geoffroy Faë,
donateur, est en prière.
Vers 1335 et début du XVe siècle. |
Baie
201 : l'Annonciation ---»»»
Vers 1335 et début du XVe siècle. |
|
|
|
|
|
Baie
200.
La baie axiale présente, sous de modestes dais, une Vierge à l'Enfant face à saint Jean-Baptiste.
Datée de 1330-1333, la verrière a été offerte par Jean du Prat,
moine dominicain, maître de théologie à
l'université de Paris, évêque d'Évreux
de 1329 à 1333, année où il abandonne
son évêché pour terminer sa vie dans un monastère de son ordre.
Au-dessus : deux saynètes illustrant la Crucifixion
et la Résurrection. Au niveau inférieur,
le donateur est en prière devant un petit édicule.
Ses armoiries sont affichées dans le panneau opposé. Le texte latin indique la donation.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,
2000.
|
|
| BAIE 201
- (Vers 1335 + XVe siècle) |
|
|
Baie
201.
Vers 1335 et début du XVe siècle.
La verrière, ci-dessous, a été
offerte par Geoffroy Faë, ancien abbé
du Bec-Hellouin et évêque d'Évreux
de 1335 à 1340. Elle représente une Annonciation.
À l'image de la baie 200,
le donateur figure au bas de la verrière, agenouillé
et en prière devant «une cathèdre
de style italiénisant» [Corpus Vitrearum].
En face de lui : un écu portant ses armoiries,
surmonté du texte de la donation.
À noter que le tympan, refait au début
du XVe siècle, accueille le lys de France.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,
2000.
|
|
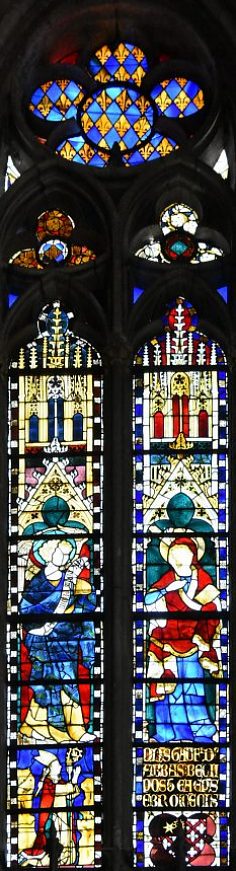 |
|

Le triforium ajouré et les hautes verrières du chœur.
Ici, l'abside et le côté nord.
Style gothique rayonnant pour les hautes verrières, style gothique
flamboyant pour le triforium (voir l'encadré
plus bas). |
| BAIE 203
- (Vers 1408-1415) |
|

Baie 203, partie principale : le donateur Thibaut de
Malestroit devant la Vierge à l'Enfant.
Vers 1408-1415.
(La largeur de la bande noire centrale a été réduite
pour l'insertion dans la page.) |
|
|
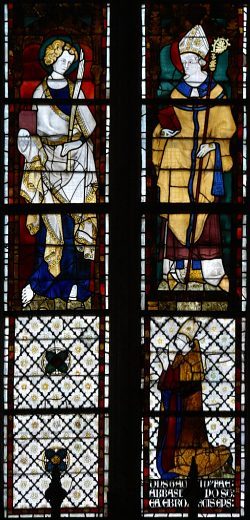
Baie 204 : la verrière (sans le tympan
du XIXe siècle).
Vers 1335. |
| BAIE
205 - (Vers 1408-1415) |
|
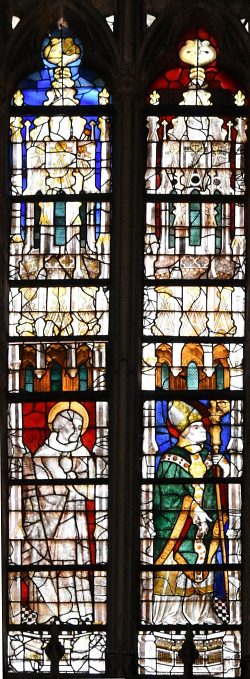
Baie 205 : la verrière sans le tympan.
Vers 1408-1418. |
|
|
Baie
204.
Datée vers 1335, la verrière de
cette baie a été offerte par Geoffroy
Faë. Les lancettes sont peintes de deux
saints debout sous des arcatures réduites
: saint Jean l'Évangéliste et le
saint archevêque Martin de Tours.
Saint Jean (ci-contre à droite) porte un
livre dans sa main droite cachée sous un
voile de son manteau (selon la mode antique).
De l'autre main, il tient une palme. Celle de
son martyre ? Le Corpus Vitrearum évoque
la palme de la seconde Annonciation à la
Vierge (l'annonce de sa mort prochaine).
Dans la partie basse, le donateur Geoffroy Faë
est présenté de profil dans un panneau
restauré.
Source : Corpus
Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,
CNRS Éditions, 2000.
|
|
| BAIE
205 - (Vers 1408-1415) |
|

Baie 205 : un saint évêque resté
mystérieux.
Saint Taurin? Saint Thibaut de Thann?
Vers 1408-1418. |
Baie 205,
détail ---»»»
Saint Thibaut de Marly, abbé du Breuil-Benoît
près de Marcilly-sur-Eure.
Vers 1408-1418. |
|
|
Baie
205.
La verrière de cette baie est à
rapprocher de celle de la baie 203.
Réalisée vers 1408-1415 et offerte,
comme cette dernière, par l'évêque
de Cornouailles Thibaut de Malestroit,
elle présente deux saints sous de hauts
dais.
Le saint de gauche, est resté mystérieux.
Est-ce saint Taurin? Est-ce saint Thibaut de Thann,
patron du donateur? Le saint de droite, tout de
vert vêtu, est saint Thibaut de Marly, moine
cistercien et abbé de Breuil-Benoist, près
de Marcilly-sur-Eure.
On remarquera l'ornementation précieuse
des deux manteaux... avec une pensée pour
le peintre anonyme qui savait très bien
que personne, depuis le sol, ne pourrait admirer
son travail.
Source : Corpus
Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,
CNRS Éditions, 2000.
|
|
Baie 205,
détail : ---»»»
l'ornementation de la robe
du saint mystérieux.
Vers 1408-1418. |
|
|
|
|
Baie
203.
Vers 1408-1415. La verrière de la baie 203 (donnée
ci-contre) a été réalisée
environ soixante-dix ans après les verrières
200,
201,
202
et 204.
On constate que le donateur a trouvé qu'il méritait
mieux qu'un petit panneau dans le bas de la verrière
! Cette fois, il est de la même taille que la
Vierge à l'Enfant qui se tient en face de lui,
mais il est agenouillé. Il s'agit de Thibaut
de Malestroit, évêque de Cornouailles,
mort en 1408.
Les deux personnages sont peints sous des dais élevés.
Les dais sont coupés dans la photo ci-contre,
mais des dais similaires sont visibles dans la baie
205,
offerte également par Thibaut de Malestroit et
qui fait la paire avec la baie 203.
Dans cette verrière de la baie 203, le donateur
est vêtu d'une chape brodée à ses
armes (que reprend l'écu situé au-dessous
de lui - non donné ici).
À noter qu'une partie de la lancette gauche a
été restaurée, en particulier le
visage de l'évêque Thibaut.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éd,
2000.
|
|
|
|
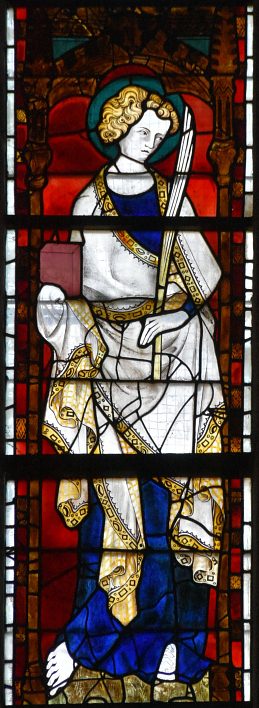
Baie 204, détail : saint Jean l'Évangéliste.
Vers 1335. |

Baie 204, détail : l'archevêque
saint Martin de Tours.
Vers 1335. |

Baie 204, détail : le donateur
Geoffroy Faë.
Vers 1335. |
|
| BAIE 205
- (Vers 1408-1415) |
|
 |
 |
|

Vue des parties hautes du chœur : le triforium ajouré,
les hautes verrières et la voûte.
Ici, l'abside et le côté sud.
Style gothique rayonnant pour les hautes verrières, style gothique
flamboyant pour le triforium (voir l'encadré
ci-dessous à gauche). |
|
Architecture
: qu'y a-t-il d'intéressant dans l'élévation
du chœur (1/2) ?
Sous le règne de Louis XI (1461-1483), l'église,
à part le portail
nord, est achevée. Cependant, des mouvements dans
les maçonneries du chœur
suscitent des inquiétudes. La voûte n'est pas
assez soutenue : il faut consolider l'édifice au niveau
du triforium à l'extérieur (donc sur le chevet)
et à l'intérieur.
À l'extérieur, le renfort va se concrétiser
par des arcs-boutants supplémentaires et une unification
des culées (voir page
1). À l'intérieur, la consolidation est
obtenue par l'ajout d'un mur de soutien au niveau de la galerie,
à l'aplomb des piliers. Ces travaux accentuent sans
aucun doute les malfaçons, rendant nécessaire
la réfection du triforium. Tant qu'on y est, on en
profitera pour remplacer l'ornementation de style gothique
rayonnant en style gothique flamboyant qui est maintenant
à la mode..
À lire les ouvrages spécialisés sur la
cathédrale d'Évreux, il n'est pas aisé
de comprendre le déroulement de ces travaux. Le texte
proposé par Annick Gosse-Kischinewski dans La Cathédrale
d'Évreux (Les Colporteurs, 1997) manque de précisions
et l'article rédigé par Yves Bottineau-Fuchs
dans La Haute-Normandie gothique (Picard, 2001) pêche
par son absence de rigueur et son désordre.
Qu'observe-t-on aujourd'hui dans le triforium ? Il est de
style flamboyant dans les parties hautes et basses de la galerie,
à l'exception des baies 113 et 114 situées dans
la travée biaise (voir plan).
Pourquoi ces deux exceptions ?
Posons d'abord les jalons :
1) Comment distinguer le style roman du style flamboyant (et
donc être à même de différencier
les époques) ? Il faut regarder la forme sommitale
des arcatures. Un trèfle à quatre feuilles (ou
un trilobe) dans un cercle, c'est du rayonnant ; des soufflets
et des mouchettes imitant les flammes d'une bougie, c'est
du flamboyant. Cette différence se constate dans la
partie haute du triforium (photo ci-dessous) : flamboyant
dans la baie 112 ; rayonnant dans la baie 114. Les grandes
fenêtres du chœur
ont un remplage de tympan de style roman. Le chœur de
la cathédrale
Saint-Pierre de Beauvais, achevé vers 1270, donne,
lui aussi, un très bel exemple de ce gothique rayonnant.
2) Lorsque le réseau flamboyant possède des
quatre-feuilles, il est considéré comme antérieur
au flamboyant ne possédant que des soufflets et des
mouchettes.
3) Les bras du transept s'étalant sur deux travées,
il faut distinguer la travée proche de la croisée
de celle qui inclut le pignon. On appellera la première
la travée-croisée ; la seconde, la travée-pignon.
On aura donc les travées-croisée nord
et sud et les travées-pignons nord et sud.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|
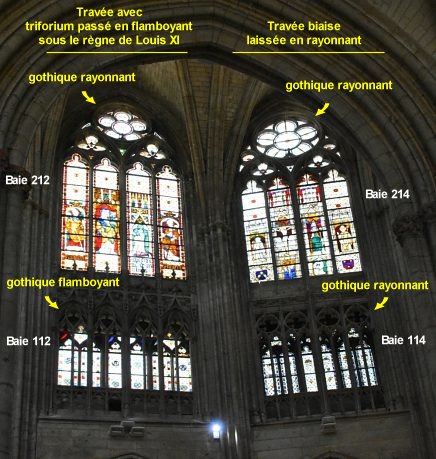
Détail de l'élévation sud du chœur.
Triforium : baies 112 et 114 ;
Hautes fenêtres : baies 212
et 214. |
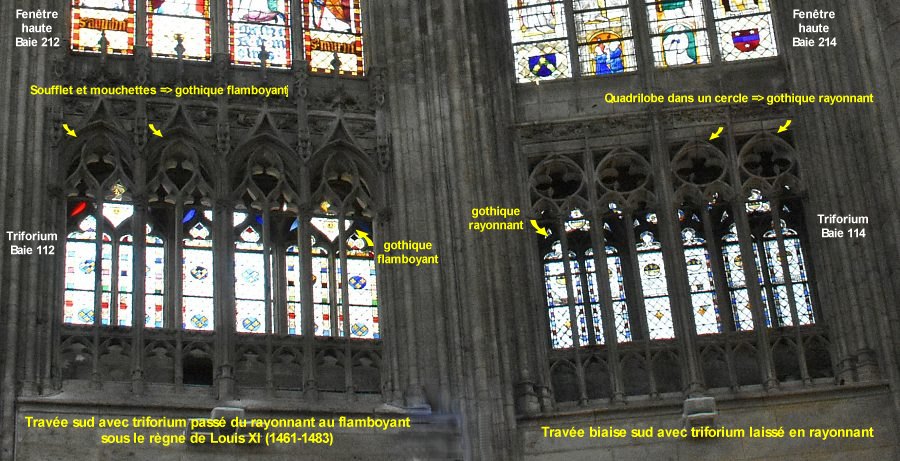
L'élévation sud du chœur : le triforium et les verrières
112 et 114.
Voir plus haut
l'analyse proposée sur l'élévation du chœur
et les modifications du triforium. |
| LE TRIFORIUM FLAMBOYANT
DU XVe SIÈCLE |
|
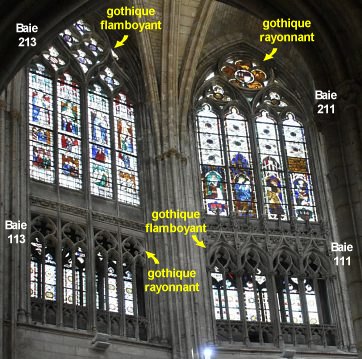
Le gothique rayonnant et le gothique flamboyant :
l'élévation nord sur les verrières 113-213
et 111-211. |
|
Le
triforium flamboyant (photo à droite ---»»)
Il est rare de voir une pareille profusion de sculptures
à cette hauteur-là dans une cathédrale
gothique. Pour goûter à l'exubérance
de ce triforium, il faut une paire de jumelles ou un
téléobjectif. Depuis le sol, on aperçoit
une vague dentelle de pierre très étoffée,
mais il est impossible d'en voir les détails.
Les sources datent ce triforium de la fin du règne
de Louis XI (1461-1483), voire juste après sa
mort, en tout cas avant l'an 1500.
Pourtant, il est tentant de l'attribuer à l'époque
de Louis XII (1498-1515), voire à Jean Cossart
(qui va intervenir un peu plus tard sur la façade
nord de la cathédrale et y implanter un gothique
flamboyant de toute beauté). C'est ce qu'a fait
l'historien Louis Régnier en 1907 dans une étude
sur le triforium de Notre-Dame d'Évreux. Annick
Gosse-Kischinewski, qui le mentionne, rejette cette
possibilité à cause du manque d'arguments.
En effet, Louis Régnier se contente de «similitudes
de détails dans la forme des accolades»
entre le portail nord et le triforium. C'est peu.
Source : La cathédrale
d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise
Gatouillat, Les Colporteurs, 1997.
|
|

Une travée du triforium flamboyant dans le chœur (fin
du XVe siècle). |
|

L'ornementation flamboyante (et luxuriante) du triforium du
chœur.
Le triforium est daté de la fin du règne de Louis
XI (1461-1483).
L'architecte qui a créé cette décoration
de soufflets, de gâbles, de pinacles et de choux frisés
n'est pas connu. |
|
Architecture
: qu'y a-t-il d'intéressant dans l'élévation
du chœur (2/2) ?
---»» Partons de l'époque où
le chœur
est achevé, tout comme la travée biaise
et les deux travées-croisées. Le tout
en style gothique rayonnant. Les comparaisons entre
les travées du triforium et celles des hautes
fenêtres au niveau du transept et de la travée
biaise conduisent à la chronologie suivante :
1) Avant 1450, dans les travées-croisées,
trois travées de triforium sont refaites : les
deux au nord ; et, dans le bras
sud, celle qui est à l'ouest (contre la nef).
La modification se fait en gothique flamboyant, mais
avec des soufflets à quatre-feuilles.
2) Sous le règne de Louis XI, vers 1470, le tympan
de la baie 216, située dans la travée-croisée
sud-est, passe en gothique flamboyant (avec soufflets-mouchettes),
alors que le triforium reste roman.
3) À la fin du règne de Louis XI (1461-1483),
le triforium du chœur
passe à son tour en gothique flamboyant sauf
dans la travée biaise, côté sud
(baie 114). Cette exception est donnée par les
historiens comme la concrétisation d'un souci
de continuité du chœur vers le transept.
4) Toujours à la fin du règne du Louis
XI, on achève le bras sud du transept (travée-pignon
et pignon) en gothique flamboyant pour le triforium
et les fenêtres hautes.
5) Fin du XVe siècle, les fenêtres hautes
de la travée-croisée nord sont refaites
en gothique flamboyant. Vraisemblablement, il en va
de même pour la fenêtre haute de la travée
biaise nord (baie 213), mais son triforium reste en
gothique rayonnant.
6) Fin du XVe siècle et début du XVIe
(avant 1517), la travée-croisée nord et
le pignon nord sont érigés par Jean Cossart
en un style totalement flamboyant.
Résultat dans le chœur :
1) Tous les tympans des fenêtres hautes sont restés
en gothique rayonnant, à l'exception du tympan
de la fenêtre haute de la travée biaise
nord (baie 213).
2) Tout le triforium est passé en gothique flamboyant
(avec soufflets-mouchettes) sauf dans la travée
biaise où il est resté rayonnant (baies
114 et 115).
Conclusion : qu'y a-t-il d'intéressant à
observer dans l'élévation du chœur
? La travée biaise et ses deux curiosités
: un triforium rayonnant (au nord et au sud) et un
remplage flamboyant dans le tympan de la fenêtre
haute au nord.
Le visiteur pourra comparer les styles avec celui des
travées voisines. Ces détails sont indiqués
dans les photos jointes.
Sources : 1) La cathédrale
d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski et Françoise
Gatouillat, Les Colporteurs, 1997 ; 2) Haute-Normandie
gothique d'Yves Bottineau-Fuchs, Éditions
Picard, 2001.
|
|
|
|
|
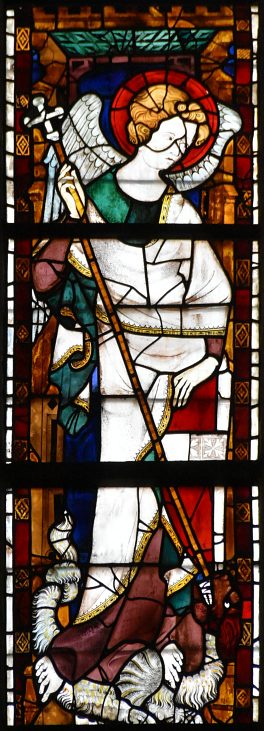
Baie 206, détail :
l'archange saint Michel terrassant le démon.
Original plafond à caissons au-dessus de l'archange. |
 |
|
Baie
206 (datée vers 1335).
La verrière de cette baie a été
offerte par Geoffroy Faë, évêque
d'Évreux de 1335 à 1340.
L'archange saint Michel terrassant le démon fait
face à saint Maur représenté en
moine tonsuré tenant sa crosse et un livre. L'archange
est dessiné devant des contreforts vus en perspective
et sous un original plafond plat et caissonné
vert.
L'évêque donateur est peint agenouillé,
en prière, sur un fond de vitrerie incolore.
Le donateur à gauche est un panneau rapporté
d'une autre verrière datée du deuxième
quart du XVe siècle.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,
2000.
|
|
|
|
«««--- Verrière
de la baie 206 sans le tympan.
Vers 1335.
|
|
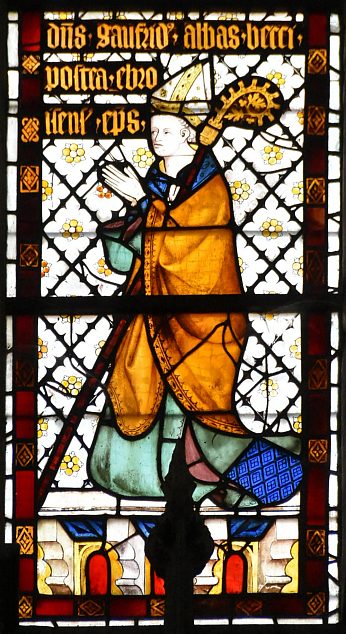
Baie 206, détail : l'évêque donateur
Geoffroy Faë.
Vers 1335.
|
|

Vue d'ensemble du chœur avec son orgue. |
| BAIE 207
- (Vers 1325-1330) |
|
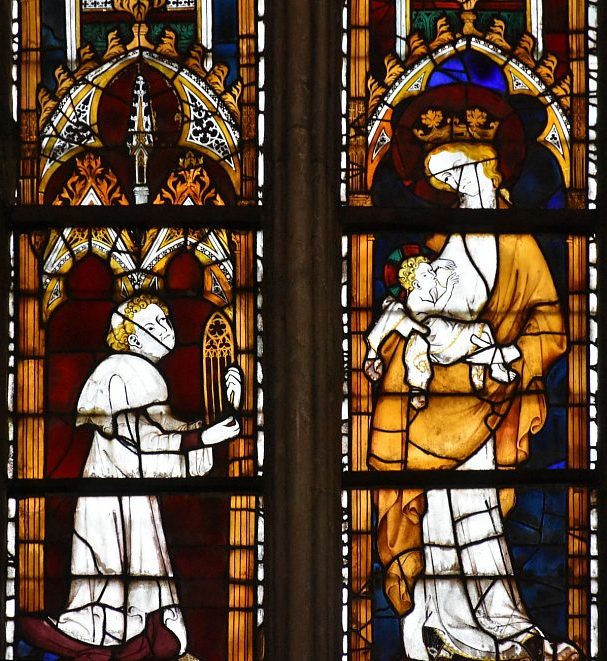
Baie 207, détail : Raoul de Ferrières et
la Vierge à l'Enfant allaitant.
Vers 1325-1330. |

Baie 207, détail : le tympan.
Vers 1325-1330. |
|
| BAIE 207
- (Vers 1325-1330) |
|
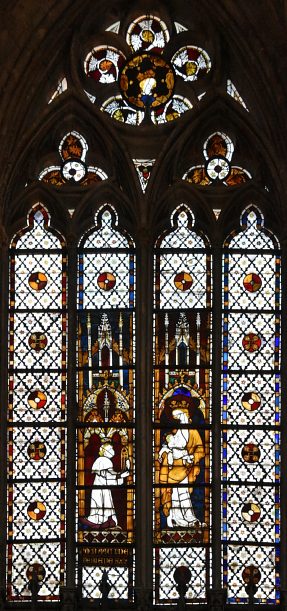
Verrière de la baie 207.
Tympan et lancettes centrales : vers 1325-1330.
Les deux lancettes externes sont modernes. |
|
Baie
207.
Réalisée vers 1325-1330, c'est l'une des
plus anciennes verrières de la cathédrale
avec la baie 211.
Seuls nous en restent les deux lancettes centrales et
le tympan. Les lancettes externes sont modernes.
La verrière a été offerte par le
chanoine Raoul de Ferrières († avant
1329). Le donateur est agenouillé et donne la
maquette de sa verrière à la Vierge debout
et qui allaite l'Enfant.
Conformément à la pratique, les figures
sont peintes en grisaille et jaune d'argent sur verre
blanc. Le manteau de la Vierge et son nimbe sont teints
dans la masse, comme le nimbe de l'Enfant. La Vierge
adopte la célèbre position du «déhanchement
XIIIe siècle».
On remarquera que les fonds colorés ne sont pas
damassés. La différence des tailles des
personnages est compensée par un dais plus riche
du côté du donateur.
Autrefois, les lancettes de saint Pierre et de Pierre
de Mortain, actuellement dans la baie 209,
étaient comprises dans cette vitrerie. Déposée
en 1939, celle-ci a été reposée
en 1955, dépouillée de ces deux lancettes.
L'époque aime l'architecture. C'est ce que note
Françoise Gatouillat à propos de l'oculus
central du tympan (qui est bien conservé). Le
peintre a simulé, dans un hexalogue redenté,
la continuation du réseau de pierre de style
gothique rayonnant (photo ci-dessous à gauche).
La verrière de la baie 207 a suscité l'enthousiasme
de Louis Grodecki. Son ouvrage Le Moyen Âge
retrouvé contient son article très
érudit sur les verrières d'Évreux.
Après une analyse des vitraux du chœur de
la cathédrale, du contenu de leur arrière-plan
et de la comparaison avec l'art de la miniature, il
conclut que ces vitraux «participent à
un mouvement général, à cette "inquiétude
de la troisième dimension" que l'influence
de Giotto et des Siennois propage, pendant la première
moitié du XIVe siècle à travers
l'Europe.»
Il poursuit : «Quant au style des figures, il
n'est pas, dans tous ces vitraux, homogène. On
doit mettre à part le "portrait" de
Raoul de Ferrières et l'admirable Vierge à
l'Enfant de cette fenêtre. (...) Cette silhouette
fléchie sur une jambe - ce qui entraîne
un balancement harmonieux des hanches et des épaules
- cette présentation ondoyante, de trois quarts,
cette asymétrie accusée du visage, nous
les retrouvons comme des formules fixes et "maniérées",
dans le Bréviaire de Belleville, dans les 'Heures
Rothschild', etc. La technique elle-même concourt
à faciliter les comparaisons avec la miniature.
Le modelé de grisaille est pratiquement absent,
tant il est discret et léger ; c'est par le trait
seul, qui souligne les sourcils, les yeux, les lignes
du nez et de la bouche, que le visage est caractérisé
et rendu expressif. Les adjonctions de jaune à
l'argent dans les chevelures ne valent point par leur
tache colorée et font penser à la technique
des miniaturistes, qui dessinent souvent les contours
des visages en traits colorés. Une atmosphère
d'infinie préciosité se dégage de ce travail, à laquelle
contribuent l'expression de la Vierge, la douceur et
l'élégance du geste de l'Enfant.»
Sources : 1) Corpus
Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS
Éditions, 2000 ; 2) Le Moyen Âge retrouvé
de Louis Grodecki, Flammarion, 1991, article :
Les verrières d'Évreux ; 3) La
cathédrale d'Évreux d'Annick Gosse-Kischinewski
et Françoise Gatouillat.
|
|
|
| BAIE 208
- (Vers 1325-1330 et 1390-1400) |
|

Baie 208, détail : Assomption de la Vierge célébrée
par des anges. Dans le panneau de droite : la reine Blanche de Navarre.
Vers 1325-1330 et 1390-1400. |
|
Baie 208.
Vers 1325-1330 et 1390-1400. Cette verrière recomposée
est une Assomption de la Vierge entourée de onze petits
anges, dessinés au jaune d'argent sur un fond blanc,
telle qu'on peut le voir dans la deuxième lancette
ci-dessus.
La Vierge est entourée, dans les lancettes de droite
et de gauche, par «six anges musiciens et thuriféraires,
écrit le Corpus Vitrearum, plongeant des nuées
pour encadrer le sujet principal, détourés sur
le fond de vitrerie.» En fait, ces six anges dégagent
une impression étrange. Les deux corps colorés
qui pendent au-dessous de chacun d'eux font croire que les
anges sont agrippés à un animal, voire qu'ils
sont complètement affalés dessus ! L'effet obtenu
n'est pas très heureux. Au-dessous de la Vierge, un
septième ange joue de l'orgue positif. Les fonds en
losanges rehaussés de fleurs jaune d'or correspondent
à la nouvelle mode qui envahit l'univers du vitrail
à partir des années 1320 (voir plus
haut).
Dans la quatrième lancette, une reine est agenouillée
à côté d'un prie-Dieu, devant un joli
fond damassé. L'écu placé sous le panneau
(non donné ici) indique qu'il s'agit de la reine Blanche
de Navarre, sœur de Charles II le Mauvais, comte
d'Évreux. Blanche s'est mariée en 1349 au roi
Philippe VI de Valois qui venait de perdre sa première
épouse, Jeanne de Bourgogne. Blanche de Navarre décède
en 1398. Ces panneaux appartenaient au groupe des «Verrières
royales» réalisées pour la nef.
La verrière 208 a été recomposée
en 1955 et restaurée en 1988 par l'atelier Tisserand.
Le Corpus Vitrearum précise, en conséquence,
que la tête de la reine est moderne, à l'exception
d'un fragment. Source : Corpus
Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,
2000.
|
|

Baie 208, détail : la Vierge de l'Assomption.
Vers 1325-1330 et 1390-1400.
|
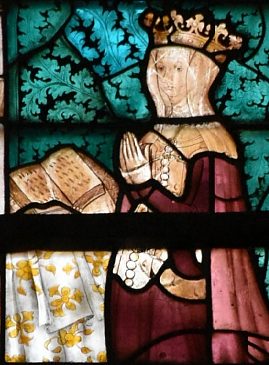
Baie 208, détail : la reine Blanche de Navarre en prière.
Vers 1325-1330 et 1390-1400.
La tête de la reine est moderne, à l'exception
d'un fragment [Corpus Vitrearum]. |
| BAIE 209
- (Vers 1390-1400) |
|
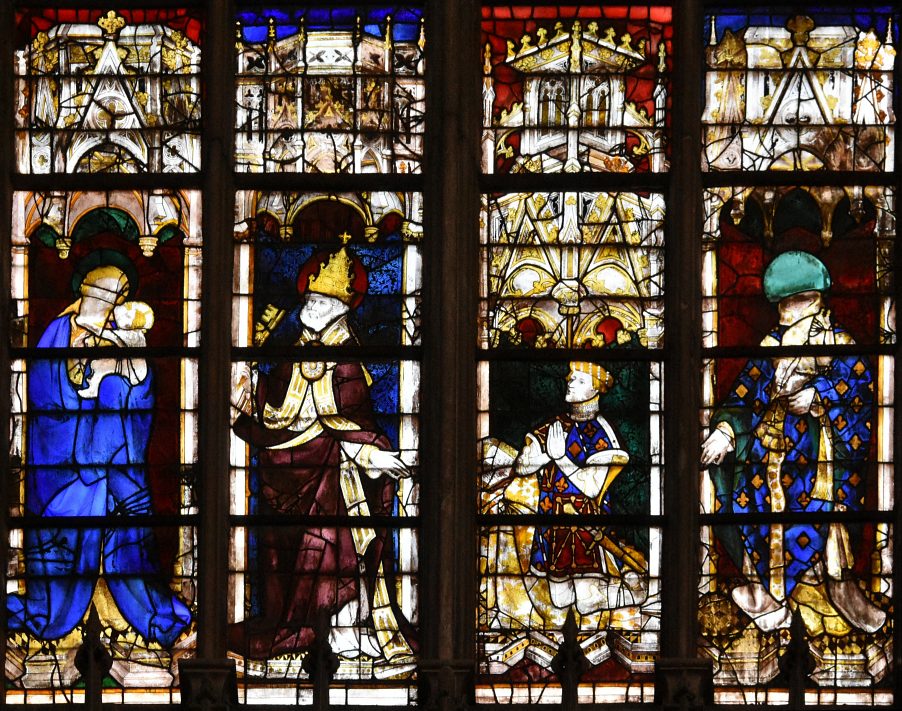
Baie 209, détail : le comte de Mortain est présenté
à la Vierge par saint Pierre et saint Denis.
Vers 1390-1400. |
|
Baie
209.
Vers 1390-1400. La verrière de cette baie est
une «Verrière royale» recomposée.
Le point central en est le comte de Mortain, Pierre
de Navarre. La troisième lancette le montre
agenouillé à côté d'un prie-Dieu
en cotte armoriée d'Évreux-Navarre. Il
est présenté à la Vierge, debout
dans la première lancette, par saint Pierre et
saint Denys. Saint Pierre tient la clé du Paradis
et porte la tiare pontificale. Saint Denys porte son
chef sous le bras. Les dais sont finement tracés
au jaune d'argent, en particulier celui qui coiffe le
comte de Mortain.
Cette verrière a été recomposée
par Jean-Jacques Gruber en 1953. Elle est peu restaurée
(1893 dans ses parties principales).
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,
2000.
|
|
| BAIE 210
- (Vers 1390-1400) |
|

Baie 210, détail : le roi Charles VI le
Fol en prière devant la Vierge.
«Verrière royale» recomposée.
Vers 1390-1400. |

Baie 210, détail : le motif du damas du
prie-Dieu de Charles VI. |
|
|
Baie
210.
Vers 1390-1400.
La verrière de cette baie est une «Verrière
royale» recomposée du roi de France Charles
VI. Le roi est présenté au centre devant
une table qui sert de prie-Dieu. La table est recouverte
d'un tissu damassé.
L'arrière-plan est un drap d'honneur fleurdelisé
où l'on repère quelques fleurs de lys
montées en chef-d'œuvre. La scène
est surmontée d'une voûte ogivale surmontée
d'une série d'arcades et de deux anges.
Le roi est présenté à la Vierge
par saint Denis (qui tient son chef sous le bras). Ce
dernier est dessiné avec le même carton
que le saint Denis de la baie 209
(ci-dessus).
Les niches qui abritent la Vierge et saint Denis sont
similaires et dessinées au jaune d'argent sur
fond blanc. La différence d'aspect entre les
deux tient à l'altération prononcée
de la peinture.
Comme celle de la baie 207,
cette verrière est une recomposition, entreprise
depuis 1845, à partir de panneaux déplacés.
Le roi Charles VI se trouvait initialement dans les
hautes fenêtres de la nef, en baie 132, sous une
rose aux armes de France.
Le vitrail a été restauré vers
1890, puis recomposé et restauré par J.J.
Gruber en 1955. Enfin, endommagé par un orage
de grêle de 1983, il a été restauré
par l'atelier Tisserand en 1990. Source : Corpus
Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie, CNRS
Éditions, 2000.
|
|
|

Baie 209, détail : le donateur Pierre de Navarre,
comte de Mortain, en prière.
Vers 1390-1400.
Les panneaux de Pierre de Mortain et de Charles VI (baie 210 ci-dessous)
ont été réalisés par le même atelier
: le damas du drap
de leurs prie-Dieu est identique.
Le même pochoir a donc été utilisé. |
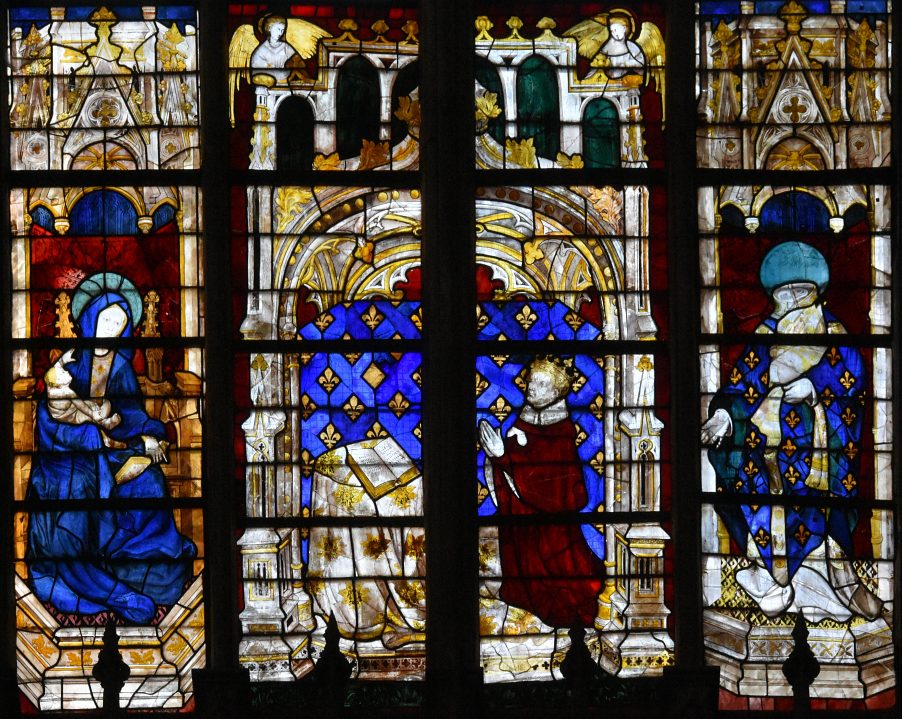
Baie 210, détail : le roi Charles VI est présenté
à la Vierge par saint Denis.
Vers 1390-1400.
Le damas du drap qui recouvre le prie-Dieu de Charles VI est identique
à celui
qu'on voit, plus
haut, au prie-Dieu de Pierre de Navarre, comte de Mortain. |
| BAIE 211
- (Vers 1325-1327) |
|
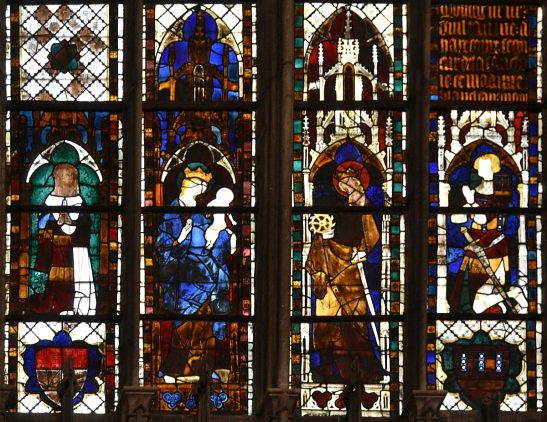
Baie 211 : Guillaume d'Harcourt et sa femme entourent
la Vierge et sainte Catherine.
Vers 1325-1327. |
|
Baie
211 (2/2).
---»» Dans la partie haute de cette baie
211, les deux niches centrales débordent, par un haut
dais, sur la quatrième rangée, alors que celles des
deux donateurs sont coupées, d'un côté,
par l'inscription de donation et, de l'autre, par une
modeste vitrerie losangée.
Dans la partie basse, les écus armoriés représentent
les armes des donateurs.
Selon le Corpus Vitrearum, la verrière est bien
conservée et peu restaurée.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions, 2000.
|
|

Baie 211, détail : Blanche d'Avaugour.
Vers 1325-1327. |

Baie 211, détail : sainte Catherine d'Alexandrie.
Vers 1325-1327. |
|
|
Baie
211 (1/2).
Vers 1325-1327.
C'est l'une des plus anciennes verrières du chœur.
Guillaume d'Harcourt, seigneur de la Saussaye,
grand sénéchal de France, est agenouillé,
en prière et légèrement de biais
(ci-contre dans la quatrième lancette), tandis
que son épouse Blanche d'Avaugour est
représentée dans la même position,
mais de face, dans la première.
Le couple encadre une Vierge à l'Enfant et sainte
Catherine d'Alexandrie, toutes deux hanchées.
La sainte est reconnaissable à la roue et à
l'épée de son supplice.
Les deux visages en gros plan, donnés ci-dessous
à gauche, montrent un décor floral dans
des fonds de niches damassés. L'historienne Françoise
Gatouillat précise qu'on a là un «premier
exemple d'un décor qui aura dans le vitrail une
particulière longévité».
L'exemple ci-dessous, tiré de la baie 212 est
postérieur de quelques années. Il montre
un damas du même style, mais plus sophistiqué.
---»» Suite 2/2
à gauche.
|
|
| BAIE 212
- (Vers 1335-1340) |
|
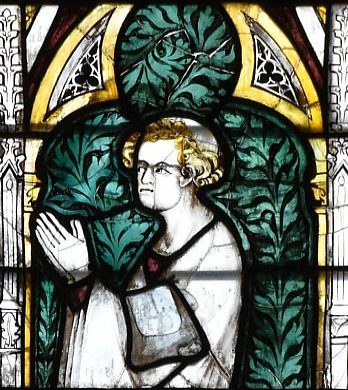
Baie 212, détail : le donateur Regnault de Molins,
chanoine de la cathédrale Notre-Dame.
Vers 1335-1340. |
|
| BAIE 212
- (Vers 1335-1340) |
|
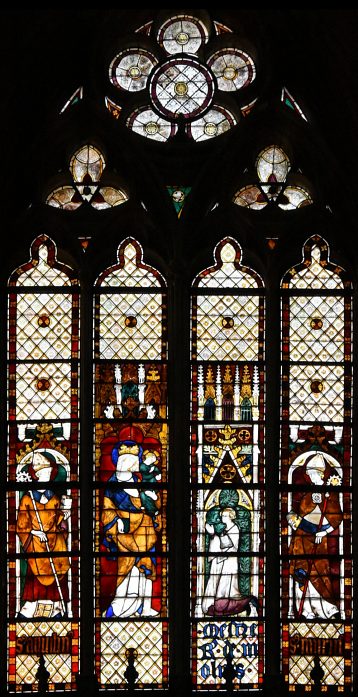 |
|
Baie
212.
Vers 1335-1340.
Les deux lancettes centrales sont d'origine. Regnault
de Molins, donateur et chanoine à Évreux,
se tient agenouillé, en prière, devant
un ample décor floral (ci-dessus à droite).
Devant lui, la Vierge à l'Enfant, dont les traits
du visage réjouiraient l'historien Louis Grodecki
(voir plus
haut), le regarde avec attention, tout comme l'Enfant
qu'elle porte sur son bras gauche. La posture dynamique
de la Vierge est obtenue par le «déhanchement
XIIIe siècle», bien visible dans les quatre
lancettes complètes données en grande
taille ci-dessous.
Dans les lancettes externes, saint Taurin et saint Aquilin
accompagnent la scène centrale, coiffés
par des dais très modestes.
La Vierge et Regnault de Molins bénéficient
de hauts dais avec pinacles parce que la verrière
a été recomposée. Avant 1939, les
saints Laurent et Vincent de l'actuelle baie 130
(verrière haute de la nef) occupaient la place
de Taurin et d'Aquilin. Mais leur dais s'étalant
sur deux rangées, l'atelier chargé de
la recomposition en 1953 a choisi, à juste titre,
de ne pas les replacer en baie 212.
Cette verrière a été endommagée
par la grêle en 1983 et restaurée par l'atelier
Tisserand en 1992.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,
2000.
|
«««---
Verrière de la baie 212.
Vers 1335-1340.
Baie 212, détail ---»»»
La Vierge à l'Enfant. |
|
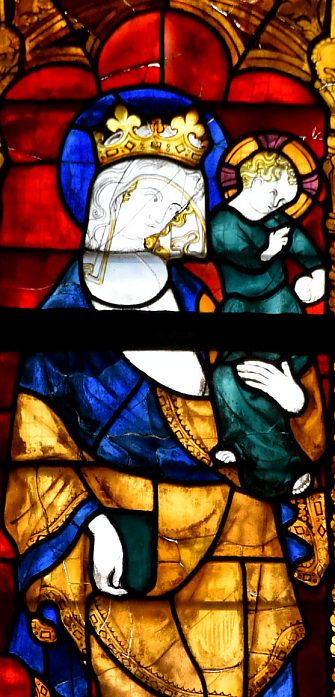 |
|
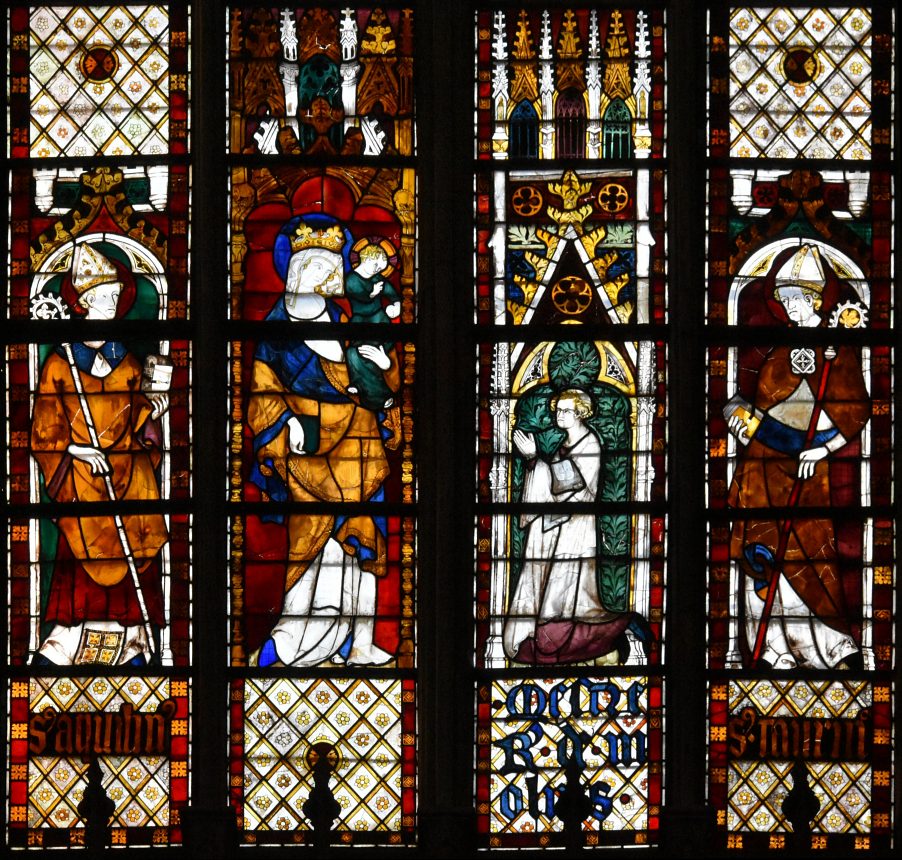
Baie 212, détail : Regnault de Molins est agenouillé
devant la Vierge. Saint Aquilin et saint Taurin les entourent.
On remarquera le «déhanchement XIIIe siècle»
de la Vierge à l'Enfant. |
| BAIE 213
- VERRIÈRE DES TROIS MARIE (Vers 1450) |
|
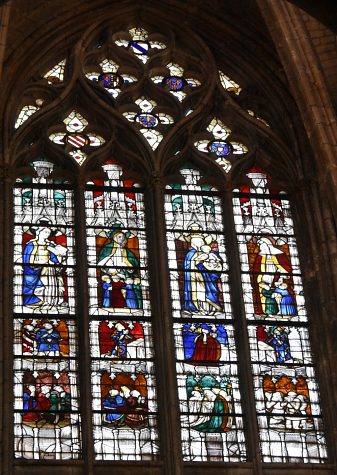
Verrière de la baie 213 : les Trois Marie.
Vers 1450. |
|
Baie 213
- la verrière des Trois Marie.
La baie 213 abrite une verrière dite historique, l'une
des plus célèbres de la cathédrale Notre-Dame.
Réalisée aux alentours de 1450, elle a été
offerte par Pierre de Brézé et Robert
de Floques, tous deux vainqueurs de la bataille de Formigny
en 1450 qui entraîna la perte de la Normandie par les
Anglais. Les deux hommes de guerre offrirent cette verrière
pour célébrer l'arrivée dans la cathédrale
des reliques de Marie Salomé et Marie Jacobé,
sœurs de la Vierge. Ces reliques furent incluses dans
le Trésor.
Le vitrail comprend douze saynètes. Dans chacune, un
fond architectural de gâbles, de frontons, de pinacles
et d'arcs-boutants, dessiné sur du verre blanc, reçoit
une niche colorée où prennent place deux catégories
de personnages :
- Marie-Madeleine et les Trois Marie (la Vierge
et ses deux sœurs), toutes représentées debout ;
- les donateurs, leurs familles et les représentants
des pouvoirs spirituel et temporel, tous agenouillés, les
mains jointes et les têtes levées vers les saintes
(voir plus
bas).
Dans la rangée supérieure figurent (voir ci-dessous)
: Marie-Madeleine (qui tient un livre et un coffret à
onguents) ; Marie Salomé (tête restaurée)
avec ses quatre fils ; la Vierge à l'Enfant couronnée
; Marie Jacobé (dite aussi Marie Cléophas) et
ses deux fils.
Dans la rangée médiane : les deux donateurs
en cottes armoriées ; le roi Louis XI en cotte aux
armes du Dauphiné ; le pape Eugène IV ; le roi
Charles VII.
Dans la rangée du bas : les membres des familles de
Floques et de Brézé dans les deux niches de
gauche ; Guillaume de Floques, évêque d'Évreux
(et père du donateur Pierre de Floques) accompagné
du doyen du chapitre Robert Cybole et de Jean de Rouen, abbé
du Bec jusqu'en 1452 ; trois hommes d'armes dans le panneau
de droite.
Dans le tympan (que l'on voit ci-contre) : les armes du roi,
du pape, de la reine Marie d'Anjou, du dauphin et des deux
donateurs.
La verrière est décrite comme peu restaurée
par le Corpus Vitrearum.
Remarque : les visages de Marie-Madeleine, de la Vierge et
de Marie Jacobé n'ont pas été restaurés).
Donnés en gros plan plus
bas, ils retiennent l'attention par leur étonnant
graphisme. Taillés en quelques coups de traits rapides,
ils sont à l'évidence de la même main
et l'on ne peut pas dire qu'ils soient beaux ! Que s'est-il
donc passé dans l'atelier des peintres verriers pour
aboutir à un résultat de cette nature ? A-t-on
désigné un débutant pour faire le visage
de ces personnages qui, placés de toute façon
dans les fenêtres hautes, ne se verraient pas ? Ou a-t-on
renoncé - pour la même raison - à reprendre
des tracés jugés insuffisants ?
En matière de Vierge Marie, la cathédrale d'Évreux
propose beaucoup mieux. Dans la chapelle des Saints-Évêques
d'Évreux, en baie 27,
un verrier doué a réussi, par quelques traits
adroits, à tracer un visage de jeune femme tout à
fait séduisant.
Source : Corpus Vitrearum,
les vitraux de Haute-Normandie, CNRS Éditions,
2000.
|
|

Baie 213, partie principale.
De gauche à droite : Marie-Madeleine et les trois Marie : Marie
Salomé, la Vierge et Marie Jacobé.
Vers 1450. |

Baie 213, détail : la Vierge à l'Enfant.
Vers 1450. |

Baie 213, détail : sainte Marie-Madeleine tenant un livre
et un coffret à onguents.
Vers 1450. |
|

Baie 213, détail : Marie Jacobé et ses deux fils.
Vers 1450.
Les visages de ces trois jeunes femmes ne sont pas ce qu'on fait
de mieux.
À l'opposé, voir le beau visage de la Vierge en baie 27
dans la chapelle des Saints-Évêques d'Évreux dans
le déambulatoire.
|

Baie 213, détail : les donateurs, leurs familles et
les représentants des pouvoirs spirituel et temporel.
En haut, de gauche à droite : les deux donateurs ; le futur Louis
XI (sa cotte est aux armes du Dauphiné) ;
le pape Eugène IV ; le roi Charles VII.
Vers 1450. |

Baie 213, détail : les deux donateurs en cottes armoriées,
Pierre de Brézé et Robert de Floques.
Vers 1450. |

Baie 213, détail : des membres des familles de Floques et de
Brézé.
Vers 1450. |
| BAIE 214
- (2e quart du XIVe siècle et 1er quart du XVe) |
|

Verrière de la baie 214.
2e quart du XIVe siècle et 1er quart du XVe. |

Baie 214, dé : saint Aubin.
1er quart du XVe siècle.
Baie 214, détail
: le Calvaire et deux donateurs. ---»»»
2e quart du XIVe siècle. |
|
|
Baie
214 (1/2).
La verrière de cette baie est une recomposition.
On y trouve un Calvaire et trois saints. Les deux personnages
des extrémités, sainte Foy et l'évêque
saint Aubin, sont donnés du 1er quart du XVe siècle
par le Corpus Vitrearum. La part du jaune d'argent
y est importante, notamment sur saint Aubin (donné en
gros plan ci-dessus).
---»» Suite 2/2
à droite.
|
|

Baie 214, détail : Sainte Foy
1er quart du XVe siècle. |
|
Baie
214 (2/2).
---»» Le Calvaire (ci-dessus à
droite) retient l'attention : les deux personnages
au pied de la croix (donnés en gros plan
ci-dessous) s'écartent un peu de la tradition
évangélique. La jeune femme semble
bien ne pas être la Vierge, mais Marie-Madeleine
peinte avec une belle chevelure d'or et des mains
crispées. Des larmes coulent de ses yeux.
Quant à saint Jean, il est représenté
avec des cheveux blonds et une barbe de la même
teinte, ce qui est fort rare.
Un couple de donateur (en remploi) figure sous
le Calvaire.
Dans la troisième lancette, saint Pierre
est coiffé de la tiare pontificale. Il
bénit d'une main et ,de l'autre, tient
une clé du Paradis à la taille démesurée.
Un chanoine donateur est peint au-dessous de lui
avec un nom inscrit : ROBERT LE
SESNE. Ce personnage a été
très restauré. Sa tête est
moderne.
Cette verrière a été endommagée
par la grêle en 1983, puis restaurée
en 1992-1993 par l'atelier Tisserand.
Source : Corpus
Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie,
CNRS Éditions, 2000.
|
|
|
|
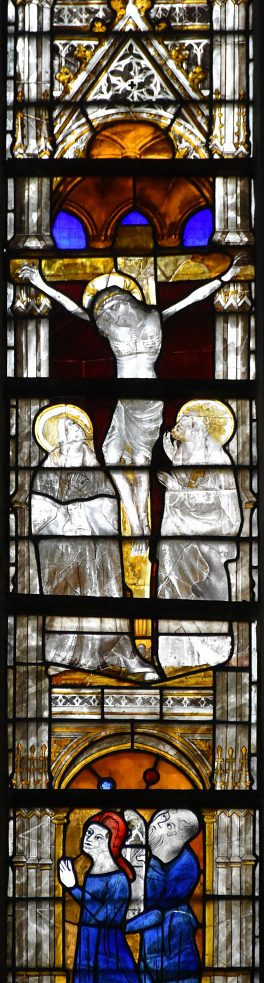 |

Baie 214, détail : saint Pierre (2e quart du XIVe
siècle). |
|

Baie 214, détail : sainte Marie-Madeleine et saint Jean,
barbu, au pied de la croix.
2e quart du XIVe siècle.
On remarquera l'utilisation du jaune
d'argent pour les deux chevelures, la barbe de saint Jean et
pour la croix afin que celle-ci se différencie nettement du
corps de Jésus. |
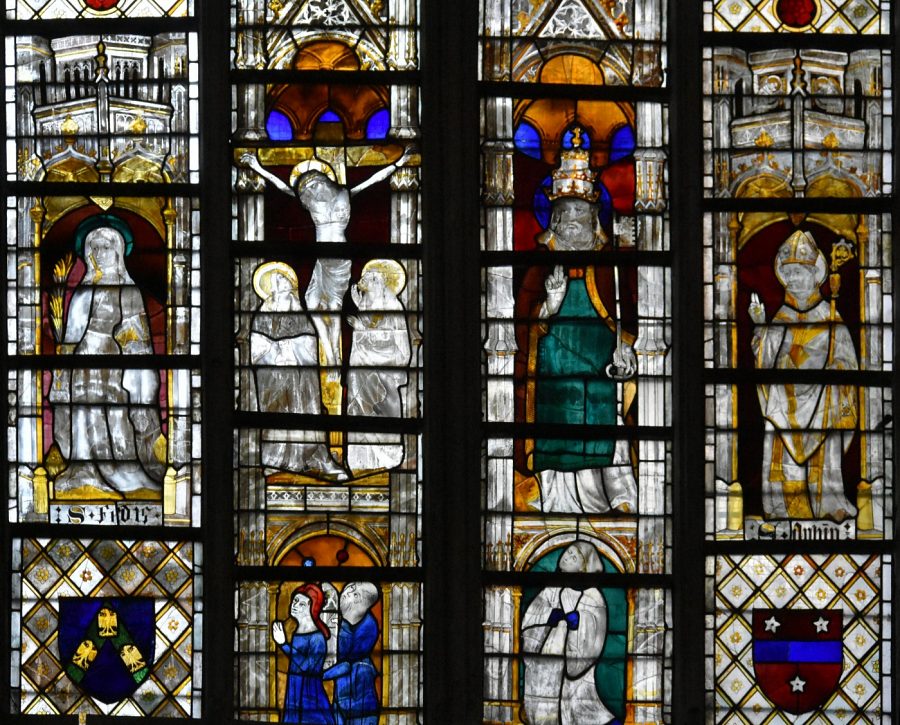
Baie 214 : sainte Foy, Calvaire, saint Pierre et saint Aubin.
2e quart du XIVe siècle et 1er quart du XVe. |
 |
Documentation
: Livret et panneaux dans la cathédrale
+ «Congrès archéologique de France, Évrecin,
Lieuvin, Pays d'Ouche», Société française
d'archéologie, Paris 1984
+ «Congrès archéologique de France tenu à
Évreux en 1889», article Émile Travers
+ «La cathédrale d'Évreux» d'Annick Gosse-Kischinewski
et Françoise Gatouillat, Les Colporteurs, 1997
+ «Haute-Normandie gothique» d'Yves Bottineau-Fuchs, Éditions
Picard, 2001
+ «Les plus belles cathédrales de France» de l'abbé
J.-J. Bourassé, Alfred Mame et Fils Éditeurs, 1880
+ «L'architecture normande au Moyen Âge», Presses
Universitaires de Caen, éditions Charles Corlet, 1997
+ «Évreux, la légende des pierres» d'Annick
Gosse-Kischinewski, Froment Glatigny Éditeurs, 1988
+ «Corpus Vitrearum, les vitraux de Haute-Normandie»,
CNRS Éditions, 2000
+ «Le vitrail du Triomphe de la Vierge d'Évreux et Louis
XI» de Gary B. Blumenshine, Annales de Normandie, 40e année
n° 3-4
+ «Le Vitrail Français», éditions
Mondes, 1958
+ «Le Moyen Âge retrouvé» de Louis
Grodecki, Flammarion, 1991, article : Les verrières d'Évreux. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|