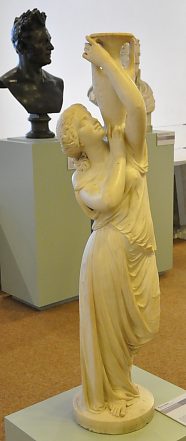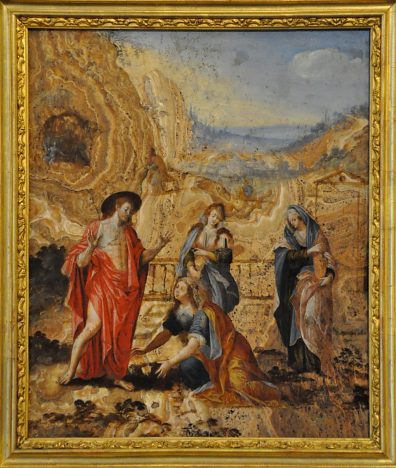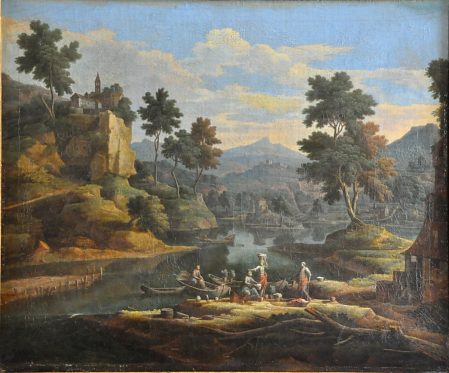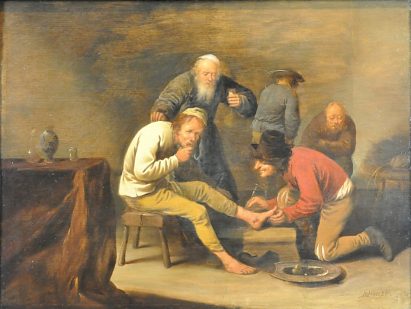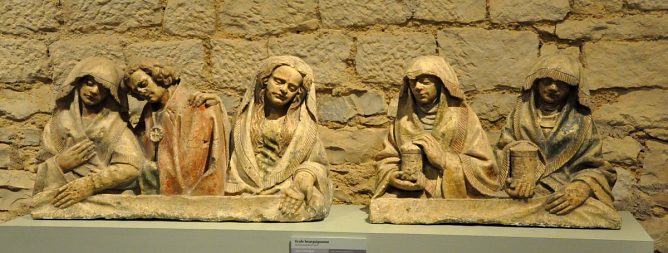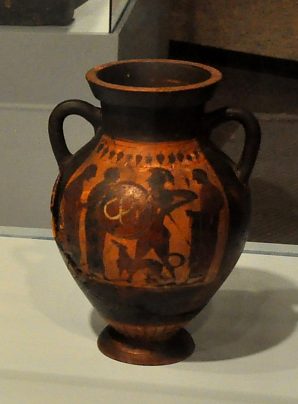|
|
 |
 |
Le musée des Beaux-Arts de Dole
a été fondé en 1821. Il a démarré
avec des peintures et des sculptures venant essentiellement de donations.
Puis, aux alentours de 1900, une section archéologique est
venue s'ajouter. D'abord installé dans l'ancien collège
des Jésuites, le musée a pris place en 1980 dans le
Pavillon des officiers. Ce bâtiment, construit par Antoine-Louis
Attiret entre 1763 et 1768, profite d'une belle façade ornée
de trophées d'armes.
Le musée se partage en trois niveaux : au sous-sol,
l'archéologie et le monde médiéval ; à
l'étage, les collections d'art ancien (XVIe au XIXe siècle)
; enfin l'«art» contemporain au-dessus. L'art ancien
est la partie la plus importante du musée. Dole
a été la capitale de la Comté jusqu'en 1678
: le fonds ancien s'en ressent et le musée gratifie les visiteurs
de quelques fort belles toiles. Ceux qui aiment l'Histoire pourront
y admirer deux
tableaux de Martin des Gobelins illustrant les sièges
de Gray
et de Besançon
menés par Louis XIV pendant la guerre de Hollande.
Cette page présente quelques extraits des œuvres en
art ancien et de l'époque médiévale exposées
dans le musée.
|
 |

|

Le premier étage du musée est consacré aux collections
d'art ancien (XVIe au XIXe siècle).
«««--- À GAUCHE
La façade du Pavillon des officiers où est située l'entrée
du musée, rue des Arènes à Dole.
Le Pavillon date du XVIIIe siècle. La façade est ornée
de deux grands trophées d'armes. |

Le musée des Beaux-Arts de Dole
forme deux ailes d'architecture (XVIIIe siècle). |

«La belle Athénienne», marbre
François-Marie Rosset (1743-1824).
|

«Prométhée enchaîné au rocher»
Jean-Pierre-Victor Huguenin (1802-1860). |

Une vue du premier étage. |

«Scènes de la Passion du Christ»
École de Leyde d'après Albrecht Dürer (premier tiers du
XVIe siècle)
Huile sur bois, vers 1530.
Voir un agrandissement plus
bas. |
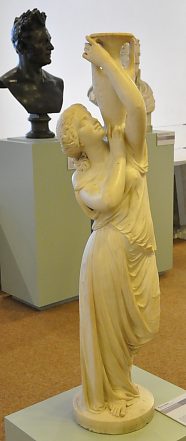
«Jeune fille portant un vase»
Marbre, 1857
Pierre Loison (1816 ou 1821 - 1886). |
|

«L'Adoration des mages»
Pieter Brueghel le Jeune (1564-1638)
Huile sur toile, vers 1615-1620. |
|
|

«Le Serment d'amitié»
Napoléon Fourquet (1807-deuxième moitié du XIXe siècle)
Moulage en plâtre. |

«Scènes de la Passion du Christ», détail
École de Leyde d'après Albrecht Dürer (premier tiers du XVIe siècle)
Huile sur bois, vers 1530. |

«La Mise au tombeau»
Maître du triptyque d'Autun, XVIe siècle
Huile sur bois, vers 1525-1530.
On remarquera, au premier plan, les armoiries des commanditaires
(la famille de la Magdeleine),
ainsi que la présence, sur la gauche, d'un bénédictin
en coule, vraisemblablement don Jean de la Magdeleine. |

«La Mise au tombeau», détail
Maître du triptyque d'Autun, XVIe siècle
Huile sur bois, vers 1525-1530. |
|

«Milon de Crotone»
Marbre de Jean-Pierre-Victor Huguenin (1802-1860)
d'après Pierre Puget (1620-1694). |

«Mars et Vénus»
Albâtre et bois, École malinoise, vers 1580. |
|
|
TABLEAUX DE SCÈNES
MYTHOLOGIQUES ET BIBLIQUES
|
|

Une salle du premier étage avec tableaux de paysages et de scènes
historiques. |

«Le sacrifice de Polyxène au pied du tombeau d'Achille»
Giovanni Battista Pittoni (1687-1767), huile sur toile. |
|
«Le
sacrifice de Polyxène au pied du tombeau d'Achille»
fait référence à une scène
de l'Iliade. Après la chute de Troie et
la fureur de Pyrrhus sur les vaincus, le fantôme
d'Achille, père de Pyrrhus, vient réclamer
le sacrifice de Polyxène, fille de Priam
et d'Hécube. La scène représente
Polyxène, en face de Pyrrhus, prête
à mourir de la main de son bourreau.
Dans sa pièce Andromaque, Jean Racine
fait un rappel de cette scène au IVe acte,
lorsque Hermione, excédée par Pyrrhus
qui a violé son serment de l'épouser,
l'abreuve de reproches. (Pyrrhus va épouser
Andromaque, une «ennemie», une phrygienne.)
Le génie de Racine a su placer dans la
bouche de la bouillante Hermione un récit
au second degré et qui se termine par une
question très ironique. Dans sa réplique,
Pyrrhus (dont Racine s'applique à faire
un imbécile) montrera qu'il a tout pris
au premier degré :
|
|
Du vieux père d'Hector
la valeur abattue
Au pied de sa famille, expirante à sa vue,
Tandis que dans son sein votre bras enfoncé
Cherche un reste de sang que l'âge avait
glacé ;
Dans des ruisseaux de sang Troie ardente plongée,
De votre propre main Polyxène égorgée
Aux yeux de tous les Grecs indignés contre
vous,
Que peut-on refuser à ces généreux
coups?
|
|
Racine, Andromaque,
acte IV, scène V.
|
|
|

«Suzanne et les vieillards»
Albâtre et bois, École malinoise, XVIe siècle.
(Au-dessus et à droite) |
|
Suzanne
et les vieillards est un thème de
l'Ancien Testament abondamment illustré par les
artistes. Il est fréquent de le voir en peinture.
Le musée des Beaux-Arts de Dole en propose une
illustration en albâtre. Voir l'histoire de «Suzanne
et les vieillards» à la page du musée
Magnin à Dijon.
|
|
|

«Angélique attachée au rocher»
Jules Machard (1839-1900), huile sur toile, 1869.
Ce peintre fut Grand prix de Rome en 1865. |
|
Une note du musée
nous apprend qu'Angélique
est un personnage de la poésie épique
italienne. Sorcière dans un roman de Boiardo
(1441-1494), elle devient princesse orientale dans la
suite du roman écrite par l'Arioste (1474-1533).
Elle est persécutée par les hommes parce
qu'elle les dédaigne alors que son charme les
rend tous amoureux d'elle. L'épisode peint par
Jules Machard rappelle Andromède attachée
au rocher et délivrée par Persée.
Ici, Angélique, qui a été attachée
au rocher par les habitants de l'île d'Ebua, doit
être dévorée par un monstre marin.
Elle sera délivrée par Roger, un preux
chevalier.
|
|
 |
|

«L'évanouissement d'Esther devant Assuérus»
Isaac Fisches (1677-1705)
Huile sur toile, fin du XVIIe siècle
C'est la seule peinture de ce peintre allemand dans les musées
français. |

«Junon sollicitant les enfers»
Toile attribuée à Jean Tengnagel (1584 ou 1585-1635)
Huile sur toile, premier tiers du XVIIe siècle . |
|
La toile «Junon
sollicitant les enfers» est du XVIIe
siècle. Elle en est surprenante. On la croirait
presque sortie de l'atelier de Salvador Dali ! Pourtant
une note du musée nous apprend qu'elle «s'inscrit
au sein d'une tradition picturale nordique cultivant
l'étrangeté». Son auteur, Jean Tengnagel,
était actif à Amsterdam. Avec d'autres,
ce peintre voulait renouveler le genre historique en
s'opposant au style maniériste. Bible, mythologie
et histoire antique leur servaient d'inspiration.
La toile illustre un passage des Métamorphoses
d'Ovide. Jupiter et Sémélé ont
engendré le jeune Bacchus qui a trouvé
refuge chez le roi d'Orchomène en Béotie.
Junon, furieuse de jalousie, descend aux enfers pour
réclamer l'appui des forces chtoniennes et ainsi
assouvir sa vengeance. Sur la toile, on reconnaît
Cerbère, le chien à trois têtes,
et les trois furies : Alecto, Mégère et
Tisiphoné. Tout ce petit monde garde jalousement
l'entrée des enfers.
|
|

«Les Hébreux en captivité»
Isidore Pils (1813-1875)
Huile sur toile. |
|

«Le sacrifice de Mucius Scaevola»
Toile attribuée à Giovanni Battista Beinaschi (1636-1688)
Huile sur toile, vers 1640-1650. |
|
Le romain Mucius
Scaevola fait irruption dans le camp étrusque
pour assassiner le roi Porsenna. Par méprise,
il tue un garde et est arrêté. Pour se
punir, il laisse brûler devant le roi sa main
qui a failli. Impressionné, celui-ci lui rendra
la liberté.
|
|

«L'évanouissement d'Esther devant Assuérus», détail. |

«La Mort de Didon»
Simon Vouet (1590-1649), huile sur toile, vers 1642. |
|
La toile «La
Mort de Didon» est l'une des plus importantes
du musée. Elle illustre un épisode fameux
de l'Énéide : brisée par le départ
d'Énée, Didon, reine de Carthage, va se
donner la mort. Toutes les caractéristiques du
style de Simon Vouet se retrouvent dans cette toile
: les couleurs, les formes, les modelés des chairs,
la grâce des visages féminins. Elle appartient
à la période phare de l'artiste : il est
Premier peintre de Louis XIII et porte sur ses épaules
le renouveau de la vie artistique parisienne.
|
|
|

«L'évanouissement d'Atalide»
Charles Antoine Coypel (1694-1752)
Huile sur toile, 1750. |

«Blanche de Castille montrant à saint Louis la Religion, la
Foi et le Piété»
Atelier de Jean Jouvenet
Le tableau original de Jean Jouvenet a disparu. Ce tableau est
une réplique de son atelier. |
|
«Judith
et sa servante». La toile à droite
est énigmatique. Elle a été découverte
dans les réserves de l'ancien musée des
Beaux-Arts en 1974. On en ignore l'auteur, mais une
note du musée nous apprend que les érudits
situent son origine en Bohème, peut-être
même à Prague au début du XVIIe
siècle. Quoi qu'il en soit, la scène dégage
un érotisme certain et affiche les traits du
maniérisme, très en vogue parmi les artistes
de la cour de Rodolphe II de Habsbourg, petit-fils de
Charles Quint. Ces artistes venaient des Pays-Bas, d'Allemagne
et de Suisse.
La scène du tableau dépeint Judith avec
sa servante Abra, se préparant à rencontrer
Holopherne pour le séduire et le tuer. L'armée
du roi assyrien Nabuchodonosor assiège la ville
juive de Béthulie. Holopherne est à sa
tête. Judith, une jeune veuve, se pare de tous
ses atours pour mieux captiver Holopherne. Les deux
femmes s'introduisent dans le camp assyrien avec des
jarres de vin. Séduit par la beauté de
Judith, Holopherne se laisse enivrer pendant le repas.
Durant la nuit, Judith et Abra décapiteront leur
victime et reviendront au matin à Béthulie,
avec sa tête.
|
|
|

«L'évanouissement d'Atalide», les visages d'Atalide et de Zatime
Charles Antoine Coypel, 1750. |
|
«L'évanouissement
d'Atalide» est une fort belle
toile qui mérite de voir les visages des
jeunes femmes en gros plan. La scène est
tirée de la tragédie de Racine,
Bajazet. Bajazet et Atalide s'aiment secrètement,
mais Roxane, la sultane, a des vues sur Bajazet.
On peut dire que la pièce se résume
à la question que se pose Roxane : Atalide
aime-t-elle Bajazet? Roxane a reçu une
lettre du sultan Amurat lui demandant de mettre
à mort Bajazet. Ce qu'elle n'hésitera
pas à faire par jalousie envers Atalide.
Voyant Atalide s'évanouir, la sultane comprend.
Du visage féroce de Roxane jaillissent
les vers de Racine (acte IV, scène 3) :
|
Allez,
conduisez-la dans la chambre prochaine ;
Mais au moins observez ses regards,
ses discours,
Tout ce qui convaincra leurs perfides
amours. |
|
Le grand amateur de
théâtre qu'était Coypel a
conçu son tableau comme une scène
de théâtre : un rideau majestueux
et une gestuelle étudiée.
|
|
|

«L'évanouissement d'Atalide», le visage de Roxane
Charles Antoine Coypel, 1750. |

«Judith et sa servante»
Anonyme, début ou première moitié du XVIIe siècle, Prague
(?) |
|
|
TABLEAUX DE SCÈNES
HISTORIQUES
|
|

«Le Siège de Gray en février 1674»
Pierre-Denis Martin, dit Martin des Gobelins (1673-1742)
Huile sur toile, première moitié du XVIIIe siècle
Louis XIV était absent au siège de Gray. La toile n'a
d'autre but que de mettre en valeur le roi avec ses généraux. |
|
La guerre
en Franche-Comté, les sièges de Gray et de Besançon.
Ne pouvant se défaire de la concurrence économique
hollandaise et voulant se débarrasser des Provinces-Unies
qui l'empêchent de récupérer l'héritage
de son beau-père Philippe IV, Louis XIV, poussé
par Louvois, est convaincu que seule l'option militaire est
jouable. Il brise d'abord la Triple Alliance unissant l'Angleterre,
la Suède et la Hollande et s'assure la neutralité
des États allemands. En 1672, Angleterre et France
déclarent la guerre aux Provinces-Unies que l'armée
française envahit aussitôt. La campagne est un
succès. En juin, l'empereur allemand Léopold
Ier rompt sa neutralité et s'engage au côté
des Hollandais. Louis XIV réplique en envoyant Turenne
contre lui. En août 1673 se constitue la grande alliance
de la Haye contre la France, qui associe Provinces-Unies,
Espagne, Autriche et le duc de Lorraine. Pour lui résister,
Louis XIV établit, dès 1674, un front en Alsace.
Mais le roi veut mettre la main sur la Franche-Comté,
terre espagnole. Le maréchal de Luxembourg organise
les sièges de Dole et de Besançon. À
celui de Gray, contrairement à ce que montre le tableau
ci-contre, Louis XIV n'est pas présent. Après
vingt-sept jours de siège, Besançon tombe le
22 mai. Au traité de Nimègue (1678), la France
gardera définitivement la Franche-Comté. Les
Dolois sont fort mécontents de passer dans le giron
français car Louis XIV a décidé de transférer
la capitale de la Comté de Dole à Besançon.
Exit le Parlement et l'Université. Les fortifications
sont détruites. Les grandes familles partent vivre
à Besançon qui sera fortifiée par Vauban.
Source : «Louis XIV»
de François Bluche, éditions Fayard.
|
|

«Le Siège de Gray en février 1674», détail.
Pierre-Denis Martin, dit Martin des Gobelins (1673-1742). |

«Le Siège de Besançon en mai 1674»
Pierre-Denis Martin, dit Pierre des Gobelins (1673-1742)
Huile sur toile, première moitié du XVIIIe siècle. |

«L'attaque de Dole par les Prussiens le 21 janvier 1871»
Eugène Chalon (1829-1911), huile sur toile, 1889
La note du musée indique que ce tableau respecte en tout point
la vérité historique. |

Vitrines d'objets d'art
Le musée des Beaux-Arts de Dole compte très peu d'objets
de collection. |

«La Grande galerie des statues»
Anonyme d'après Giovanni Battista Pinanesi (1720-1778)
Huile sur toile, 1752. |
|
«La
Grande galerie des statues» est une interprétation
picturale d'un recueil de planches d'architecture. La
composition représentée s'appelle une
vedute : un mélange d'éléments
architecturaux réels ou imaginaires. Le vedute
était très prisé en Italie vers
le milieu du XVIIIe siècle.
|
|
|

«Saint Louis en prière»
Jean-Charles-Nicaise Perrin (1754-1831)
Huile sur toile, 1789. |
|
«Saint
Louis en prière». Dans ce tableau
inspiré de celui de Charles Le Brun, le peintre
Perrin simplifie l'arrière-plan par des nuages
et une chapelle dans la pénombre alors que Le
Brun avait inclus trois angelots sur un fond de draperies.
La représentation de saint Louis en prière
est un thème que l'on rencontre souvent dans
les églises comme toiles originales ou copies.
On y voit le roi s'incliner soit sur le crucifix, soit
sur la couronne d'épines.
Le tableau de Leduc (1831), visible à l'église
Saint-Paul-Saint-Louis
à Paris, est presque une copie de celui de Charles
Le Brun. L'église Saint-Eustache,
quant à elle, en propose un qui est anonyme et
qui doit être une copie.
|
|
|

Portrait de Charles le Téméraire
Anonyme d'après Rogier van der Weyden. |

Portrait de Jean sans Peur
Anonyme d'après Jan van Eyck
(vers 1390-1441). |
|
|
|

«Clair de lune sur la mer»
d'après Claude-Joseph Vernet. |

«Le torrent»
attribué à Jean-Louis Demarne (1744-1829)
Huile sur toile, vers 1785. |

«Paysage animé»
Étienne Allegrain (1644-1736)
Huile sur toile, vers 1700-1710. |

Vue du premier étage du musée de Dole. |
|

«Paysage avec ruines»
École française
Huile sur toile, milieu du XVIIIe siècle. |

«Le Concert champêtre»
Frans Wouters (1612 ou 1614-1659)
Huile sur toile, 1754. |
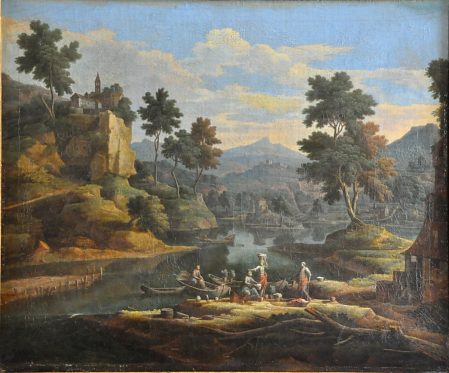
«Paysage animé»
Étienne Allegrain (1644-1736)
Huile sur toile, vers 1700-1710. |

«Ruines imaginaires»
Attribué à Jean-Denis Attiret (1702-1768)
Huile sur toile. |
|
 |

«Portrait de jeune femme accompagnée d'une vieille femme»
Huile sur toile, milieu du XVIIIe siècle.
Copie d'un original de Jean Raoux conservé
au musée des Beaux-Arts de Marseille.

«««---
À GAUCHE
«Portrait de femme et enfant»
École de Fontainebleau, Huile sur bois, XVIe siècle. |
|

«Portrait de madame de Sillery et de son fils»
Attribué à Pierre Mignard (1612-1695)
Huile sur toile, vers 1670-1675.
L'attribution à Pierre Mignard est toujours sujette à
caution
au sein des spécialistes du portrait sous Louis XIV. |

«Portrait de jeune femme accompagnée d'une vieille femme», détail.
Huile sur toile, milieu du XVIIIe siècle. |
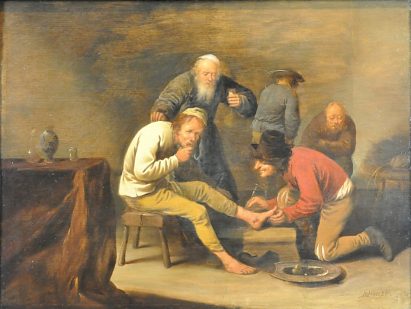
«Le chirurgien du village»
Pieter Jansz Quast (1606-1647)
Huile sur bois, vers 1635-1640. |

«Le roi boit» (scène de cabaret à la mode flamande)
François Dorbay, actif au XVIIIe siècle
Huile sur toile, 1749. |
|
|
SOUS-SOL : ARCHÉOLOGIE
ET SCULPTURE MÉDIÊVALE
|
|

La grande salle médiévale au sous-sol du musée. |

Saint Pierre, École française
Pierre, XVIIe siècle. |

|
|
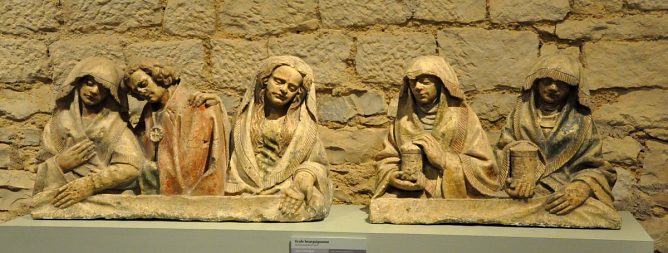
«Mise au tombeau»
École bourguignonne, seconde moitié du XVe siècle. |

«Piéta, Vierge aux lapins»
Atelier dolois, Pierre XVe siècle.
«««---
Saint Vincent
École française
Pierre polychrome, fin du XVIe siècle. |
|

Saint Antoine
École bourguignonne
Pierre polychrome, 2e moitié du XVe siècle. |

Pallas
attribuée à Claude Arnoux, dit Lulier
(vers 1510-1580) |
|

Cheminée Renaissance
Marbre polychrome, 1565
Cette très belle cheminée vient de la maison d'un
professeur de médecine de Besançon.
Les huit bas-reliefs en albâtre illustrent des personnages
de l'Ancien Testament et les quatre évangélistes. |

«La Mise au tombeau», atelier dolois
Bois polychrome, XVIe siècle. |

La grande salle médiévale au sous-sol du musée. |
|

La salle de la préhistoire au sous-sol. |

Buste de déesse romaine au diadème.
Pièce trouvée dans le Jura en 1718. |

Coupe étrusque à figures rouges
Atelier de Caere-Cerveteri
Seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. |
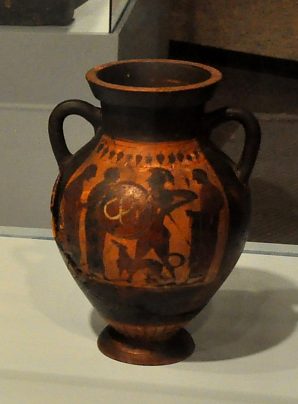
Amphore attique «à tableaux» à figures noires
Seconde moitié du IVe siècle avant J.-C. |
|
Documentation : panneaux affichés à
côté de chaque œuvre et dépliant sur le musée. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|