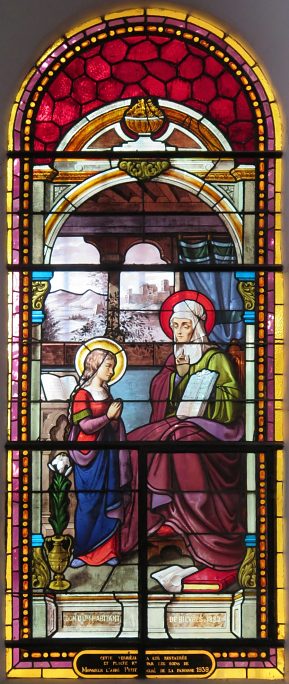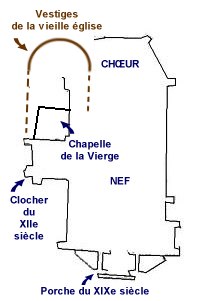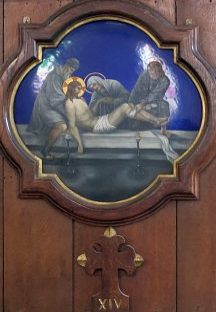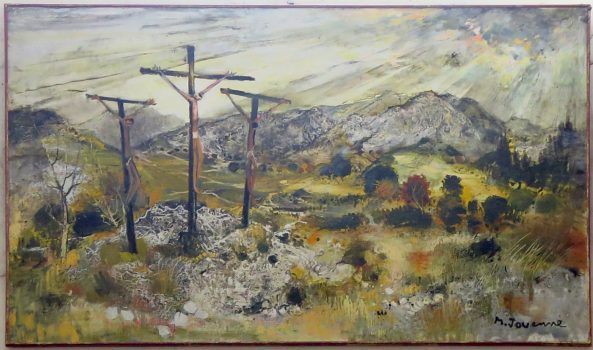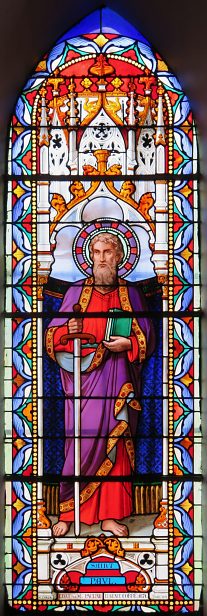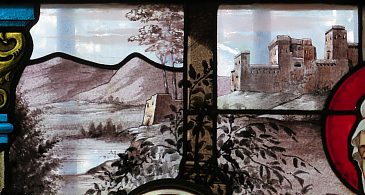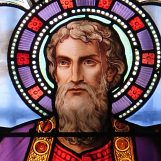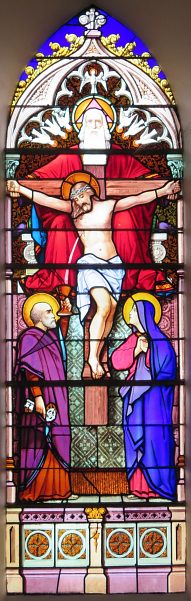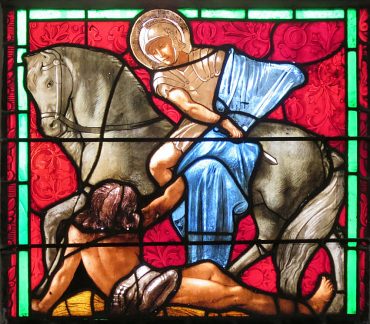|
|
 |
 |
Une seigneurie existait à Bièvres
au XIIe siècle. Le château possédait une chapelle,
centre d'une paroisse. Au cours de ce même siècle,
Louis VI réunit la paroisse au domaine royal. En 1377, la
seigneurie est vendue à Pierre de Chevreuse, conseiller financier
de Charles V. C'est probablement à cette époque qu'une
nouvelle église a été construite à côté
de la précédente et réutilisant son clocher,
la population étant évaluée à cinq cents
habitants.
Cette église du XIVe siècle sort très dégradée
de la guerre de Cent Ans. Comme dans les villages voisins, le nombre
de feux (familles) a énormément chuté : d'une
centaine au début de la guerre, il est réduit à
trois en 1459.
Toutefois, dès la fin du XVe siècle, selon les rapports
d'inspection de l'époque, l'église semble pour l'essentiel
réparée, voire agrandie, relate Michèle Brossard
dans la brochure sur l'église éditée par les
Archives Vivantes. Toiture et charpente sont refaites vers 1507-1509.
Le clocher est surhaussé. Le financement des travaux vient
très probablement de la famille de Chevreuse, toujours propriétaire
de la seigneurie. Après vente et héritage, Charles
de Dormans devient le nouveau seigneur de Bièvres et, pour
ce fief, prête hommage au roi François Ier en 1542.
Bièvres changera encore de seigneur en 1689 et 1712. La Révolution
confisquera tout.
Notons que la brochure de l'Inventaire Général sur
le canton de Bièvres mentionne que l'église Saint-Martin
a été relevée de ses ruines en 1570 après
un incendie. C'est sans doute pourquoi elle est en général
présentée comme un édifice du XVIe siècle.
Lors de ses recherches dans les archives, Michèle Brossard
n'a trouvé aucune trace de ces faits.
À la Révolution, l'église resta propriété
de la commune et servit de lieu d'assemblée. Mais le culte
fut maintenu jusqu'à la Terreur de 1793, le curé ayant
prêté serment à la Constitution. En 1795, ce
dernier reprit possession de son église.
Pendant l'occupation prussienne, l'édifice est fermé
au culte, puis sert d'écurie à quinze mille Saxons
arrivés à Bièvres. «Les aumoniers catholiques
bavarois, écrit Michèle Brossard, faisaient les offices
sur un autel portatif devant la croix de pierre sur la place de
l'église.»
À la fin du XIXe siècle, des legs et de nombreux dons
permettent la restauration de l'édifice avec l'installation
de vitraux et
de tableaux. Une chapelle
de la Vierge et une sacristie (depuis démolie) sont ajoutées
vers 1875. Façade et porche sont également refaits.
Enfin, en 1965, à la suite du Concile Vatican II, le curé
en fonction dépouille l'église d'une bonne partie
de ses ornements, ce qui aboutit à l'édifice actuel.
La dédicace de l'église semble poser question. Les
archives montrent qu'elle est dédiée à saint
Martin depuis le XVe siècle. Mais une plaque dans le chœur
indique qu'elle a été dédiée le 2 juillet
1536 «sous les vocables des saints martyrs Laurent et Priest».
De sorte que l'église a en fait trois saints patrons, chacun
figuré dans un vitrail.
|
 |

L'église Saint-Martin de Bièvres vue depuis l'entrée.
Les ornementations de la charpente
constituent une curiosité rare en Ile-de-France. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |
|

La façade de l'église est une reconstruction du XIXe siècle.
Le clocher, dont la partie basse remonte au XIIe sècle ou au
début du XIIIe,
est indépendant de l'église bâtie au XIVe siècle. |

Cloche sur le toit. |
|
Architecture
extérieure.
Le clocher est indépendant de l'église.
Sa partie basse remonte au XIIe siècle ou au
début du XIIIe. L'édifice, probablement
construit au XIVe, présente une façade
restaurée vers la fin du XIXe.
Avec elle, un nouveau porche, plus simple que le précédent
qui datait du XVIe, a été bâti selon
la mode Renaissance. Sur la façade, le trio de
fenêtres, qui abrite des vitraux en grisaille,
est surmonté d'un étonnant remplage gothique
percé d'une horloge.
Cette horloge, installée en 1859, remplace la
précédente qui était située
sur le clocher. (L'irrégularité de la
pierre sous la double fenêtre au nord, trahit
son ancienne présence.) ---»» suite
ci-contre.
|
|
|

Le côté nord de l'église.
Le beffroi à cloches a été bâti en
1755. |
|
---»»
À propos de la nouvelle horloge,
Michèle Brossard souligne avec humour un extrait
d'une délibération du Conseil municipal
en 1859 : elle «sera placée sur la face
de l'église au-dessus du portail et ne permettra
plus aux ouvriers de confondre les heures de travail
et de repos» !
L'église possède quatre cloches : trois
dans le clocher ; la quatrième, sur le toit de
l'église, est reliée au mécanisme
de l'horloge. L'installer dans le clocher n'était
pas possible car ce dernier est trop éloigné
de la façade.
Source : Église
Saint-Martin de Bièvres de Michèle
Brossard (collection Archives Vivantes).
|
|
|
| LA NEF DE L'ÉGLISE
SAINT-MARTIN |
|

La nef de l'église Saint-Martin et son élévation sud.
Jusqu'à 1965 et le dépouillement de l'église
après Vatican II, des colonnettes fasciculées encadraient
les bords verticaux des niches, qu'elles reçoivent des vitraux
ou des statues. |
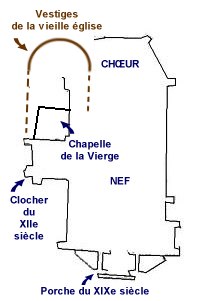
Plan de l'église Saint-Martin. |
|
Architecture
intérieure.
L'église est un vaisseau simple,
d'une seule nef, sans bas-côté ni transept.
Sur le côté nord, la chapelle
de la Vierge a été bâtie vers
1875. Le clocher, qui vient de la construction de l'édifice
du XIIe siècle, est totalement indépendant
du reste.
|
|
|

Le baptistère et sa cuve
en marbre rouge du XVIIIe siècle. |

«Le Baptême du Christ» (posé en 1939).
Vitrail du peintre verrier versaillais Henri Ripeau.
|
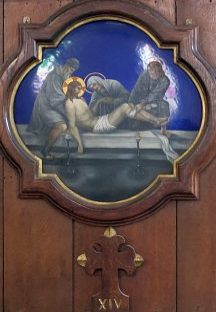
Chemin de croix, station XIV :
Jésus est mis au tombeau. |
|
Le
Chemin de croix.
Il date de la fin du XIXe siècle.
Les dessins sont peints en camaïeu de grisaille
et de sanguine sur des plaques d'émail bleu.
Cette production sulpicienne permettait aux petites
paroisses d'acquérir un Chemin de croix pour
un prix modique.
|
|
|

Une statue de Jeanne d'Arc surmonte la plaque
en mémoire des soldats morts pour la France.
La statue a été offerte à l'église
par les paroissiens en 1914. |

«La Bénédiction de sainte Geneviève par saint Germain»
Tableau de Louise Desnos, 1842.
Ce tableau était initialement à l'église
Saint-Sulpice
à Paris. |
|
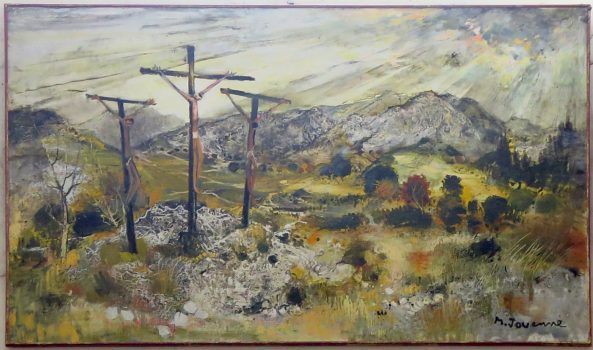
Tableau sur la tribune ouest : «Le Golgotha» par
Michel Jouenne (XXe siècle). |

Une sainte tenant la palme du martyre. |

Saint Fiacre. |
|
Les
vitraux de l'église Saint-Martin.
On ne connaît pas la teneur
des vitraux d'avant le XIXe siècle. Toujours
est-il que la guerre de 1870 et l'occupation prussienne
semblent leur avoir été fatales.
Une première donation intervient dès
1871. Elle aboutit à la pose de quatre
vitraux en 1879, dont les saint Paul et saint
Laurent réalisés par l'atelier parisien
d'Henri Chabin.
En 1882, une nouvelle donation conduit à
la création du vitrail illustrant l'Éducation
de la Vierge sur le côté nord.
En 1887, grâce à un legs, le chœur,
à son tour, s'enrichit de trois verrières
dont l'atelier n'est pas connu : la
Sainte-Trinité, saint
Martin et saint
Priest qui sont les deux saints rattachés
à l'église. Une saynète
orne le bas de chacun de ces deux derniers vitraux.
Enfin, le peintre verrier Henri Ripeau
a réalisé, vers 1900 selon le Patrimoine
des Communes de l'Essonne, le vitrail du Baptême
du Christ. Selon Michèle Brossard,
ce vitrail a été posé en
1939 dans le baptistère.
|
|
|
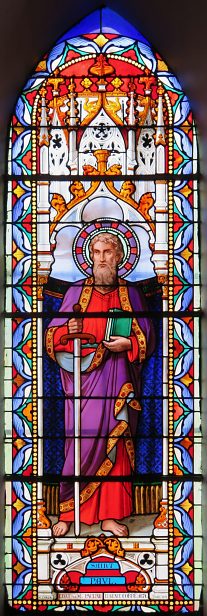
Saint Paul.
Vitrail d'Henri Chabin, Paris, 1879. |
|

L'élévation nord de la nef reçoit l'ancien banc d'œuvre
en bois sculpté du XVIIIe siècle.
Le banc d'œuvre cache l'accès au clocher.
À droite du banc d'œuvre : la chapelle de la Vierge (aussi
dépouillée que la nef).
|
Chapelle de la Vierge ---»»»
Cette chapelle a été construite vers 1875.
Avant la restauration de 1871, son autel était celui
du chœur.
|
|
 |

Vitrail contemporain de l'Annonciation
dans la chapelle de la Vierge.
Atelier inconnu.
Ce vitrail a été acquis en 2019. |
|
Le vitrail de l'Éducation de la
Vierge
(années 1880) contient, en arrière-plan,
un beau paysage en camaïeu de gris. ---»»»
|
|
|

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail.
Chapelle de la Vierge.
La paroisse ne possède aucune information sur ce groupe
sculpté. |
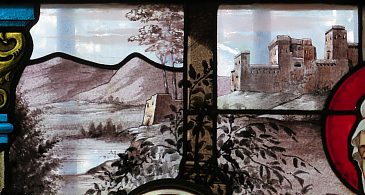 |
|
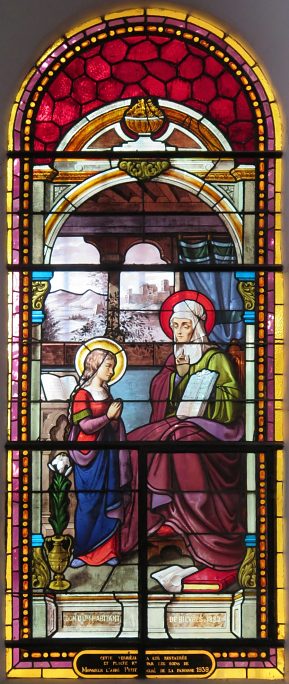
L'Éducation de la Vierge.
Vitrail d'un atelier inconnu.
Ce vitrail a été offert par un paroissien anonyme en
1882. |
|
|

Charpente : poutres 2 à 5.
La poutre 5 ouvre sur le chœur.
Au centre de la poutre 3, deux blasons (surmontés du blason
du Chrisme) portent une croix pattée rouge et une croix pattée
bleue.
Ce serait le blason dédoublé de la communauté
de religieux appelés Mathurins (dévoués à
la libération des captifs). |
|
|

Poutre 2 : tête mi-homme, mi-animal.
Dans les parties centrales des entraits, c'est le seul élément
décoratif sculpté dans la masse. |

Poutre 1 : écussons PFS (Pater, Filius, Spiritus) |
|
La
voûte et la charpente (2/2).
---»» Ces blasons seraient ceux
des différents seigneurs de Bièvres depuis
la Renaissance. Il s'agit donc d'héraldique.
Viennent s'y ajouter trois symboles religieux : IHS
(Iesus Hominum Salvator) ; PFS (Pater, Filius,
Spiritus) et Alpha-Omega. Michèle Brossard
confie que, à l'heure actuelle, l'identification
de ces blasons n'est pas achevée.
Les photos de cette page donnent une bonne idée
de cette ornementation (blasons et engoulants).
Source : Église
Saint-Martin de Bièvres, brochure réalisée
par les Archives Vivantes, rédaction de Michèle
Brossard.

Le puristes pourraient faire remarquer que les sculptures
aux extrémités des entraits (ours, loup,
sanglier) ne sont pas de vrais engoulants. Selon la
définition, la bête imaginaire ou réelle
doit saisir la poutre dans sa gueule, ce qui n'est pas
le cas ici. L'église Saint-Germain
à Rennes
et l'église Notre-Dame
du Roncier à Josselin
en donnent des exemples. Voir la photo plus bas d'un
engoulant de l'église Notre-Dame
du Roncier.
|
|

Poutre 4 : écussons IHS (Iesus Hominum Salvator). |

Poutre 4 : Alpha et Omega. |

Poutre 5 : écussons SP et SM (saint
Martin et saint Priest).
Sur la face tournée vers le sol : à gauche,
l'écusson de Charles de Dormans et,
à droite, celui de son épouse Jeanne de
Marseille.
Ils prêtèrent hommage au roi en 1542 en tant
que seigneur et dame de Bièvres. |
|
|
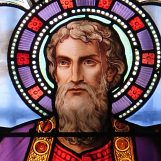
Vitrail de saint Paul, détail.
Atelier Henri Chabin, 1879.
|

Saint Laurent.
Vitrail d'Henri Chabin, Paris, 1879. |
|
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN À BIÈVRES |
|

Le chœur de l'église Saint-Martin est très dépouillé
depuis les directives de Vatican II en 1965.
Au sol, devant le chœur, se trouvent des pierres tombales dont
les inscriptions sont illisibles.
La plaque de la dédicace de l'église aux saints martyrs
Laurent et Priest se trouve à gauche, sous
le vitrail de saint Martin. |
|
Le
chœur.
Le chœur de l'église est particulièrement
dépouillé, mais il ne l'a pas toujours
été. Dans la brochure sur l'église
éditée par les Archives Vivantes,
Michèle Brossard nous apprend que ce dépouillement,
intervenu en 1965, est le résultat des directives
du Concile Vatican II appliquées par le curé
de l'époque, l'abbé Jacques May.
Qu'y avait-il auparavant ? D'anciennes cartes postales
le montrent. Une série de seize sculptures sous
niches néogothiques, réunies par groupes
de quatre, bordait l'abside. On y voyait quatorze saints
auxiliateurs auxquels avaient été ajoutées
les statues des saints Benoît et Jean de Matha
«à cause des Bénédictines
du Val Profond et des Mathurins», lit-on dans
un rapport de l'époque cité par Michèle
Brossard.
Une grille en fer forgé, qui servait de table
de communion, a également disparu. Il n'en subsiste
plus que les extrémités. Même chose
pour les stalles de bois le long de l'abside. Il ne
reste que des panneaux au-delà de la grille de
communion. L'ambon d'avant 1965, quant à lui,
était orné d'une tapisserie. Et un autel
de pierre avec soubassement sculpté et retable,
datant des années 1880, se dressait au milieu
du sanctuaire. L'abbé May le remplaça
par un entourage en verre.
De l'avis général, confie Michèle
Brossard, l'aspect artistique de ce chœur était
d'un grand effet.
On peut regretter que le curé de l'époque
ait fait table rase d'un ensemble qui, au vu des cartes
postales anciennes conservées, dégageait
une beauté certaine. Nul doute que cette atmosphère
créait une envie de réflexion et de prière.
La beauté est une composante essentielle de l'aspect
artistique du catholicisme et du décor de toute
église. Voir le développement proposé
sur ce thème à propos du chœur de
l'église
Saint-Germain à Rennes.
|
|
 |
|

Saint Martin, 1887.
Vitrail du chœur.
Atelier inconnu. |
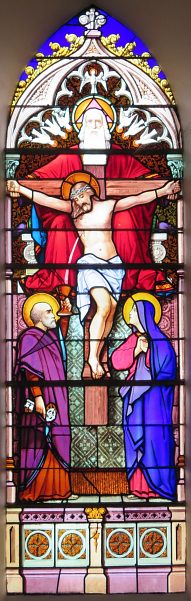
La Sainte Trinité, 1887.
Saint Pierre accompagne la Vierge
au pied de la croix.
Vitrail du chœur. Atelier inconnu. |

Saint Priest, 1887.
Vitrail du chœur.
Atelier inconnu. |
|
La
décollation de l'évêque Priest.
Ce saint, aussi appelé Prix, Pregt,
Projet ou Preject n'est pas très connu. La
Légende dorée de Jacques de Voragine
ne fait pas mention de lui. La célèbre
Vie des saints de l'abbé Godescard, au
XIXe siècle, ne dit rien non plus à son
sujet.
Dans sa brochure sur l'église, Michèle
Brossard donne quelques indications extraites d'une
Vie des saints, publiée au XIXe siècle,
dont elle ne donne malheureusement pas l'auteur.
Saint Priest est né en Auverge au VIIe siècle,
au cœur de l'époque mérovingienne.
Avant la naissance de l'enfant, sa mère eut une
vision de sa sainteté future. «D'une piété
exemplaire, rapporte Michèle Brossard, il tenta
de ramener la vertu partout où il exerça
son ministère.» Priest devint évêque
d'Auvergne (Clermont ?) contre son gré. Tout
comme Martin qui devint évêque de Tours
en 371, lui aussi contre son gré.
À une époque où les rapports entre
l'Église et les Grands du royaume étaient
très conflictuels, Priest «se heurta aux
seigneurs temporels qui le firent massacrer le 25 janvier
670», écrit Michèle Brossard. Rappelons
que les mérovingiens sont des Francs et que la
violence était pratique courante dans leurs mœurs.
Dans le vitrail ci-dessous, le peintre verrier a dessiné
des seigneurs mérovingiens vêtus d'une
tunique conforme à la représentation historique.
|
|
|
«««--- Christ
en croix dans le chœur.
Aucune documentation n'existe sur cette sculpture qui
paraît ancienne.
|
|
|
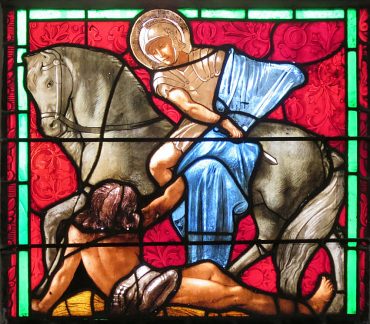
La Charité de saint Martin.
Partie basse d'un vitrail du chœur créé vers
1887.
Martin est vêtu d'une tunique romaine conforme à
sa fonction. |
|
Saint
Martin partageant son manteau.
Ce vitrail de 1887, dont l'atelier est inconnu,
montre un saint Martin dans un habit conforme à
sa fonction d'officier romain.
Le vêtement du saint n'a pas toujours suivi cette
règle logique qui date, en fait, du XIXe siècle.
À la Renaissance, par exemple, on pouvait vêtir
Martin d'une tunique de bourgeois ou de paysan à
la mode de l'époque.
Voir le commentaire proposé à l'église
Saint-Martin
de Jouy-en-Josas.
|
|
|

La Décollation de saint Priest.
Partie basse d'un vitrail du chœur créé vers 1887. |

L'église Saint-Martin à Bièvres vue depuis le
chœur. |
Documentation : «Église Saint-Martin
de Bièvres», brochure réalisée par les
Archives Vivantes, rédaction de Michèle Brossard (sans
date de parution)
+ «Le Patrimoine des Communes de l'Essonne», Flohic Éditions,
2001
+ «Canton de Bièvres, Essonne», collection Images
du Patrimoine. Inventaire Général. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|