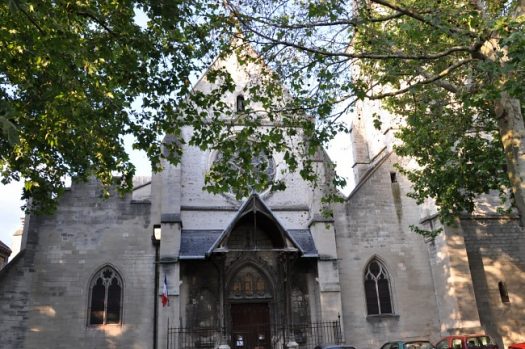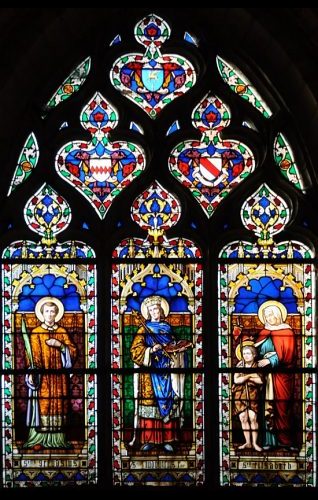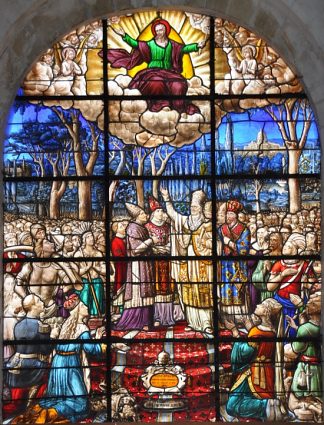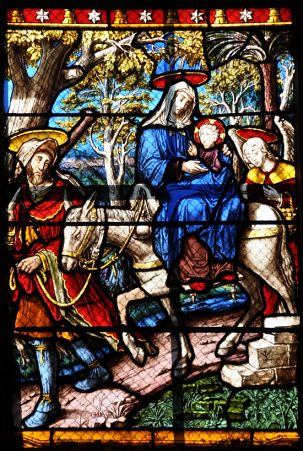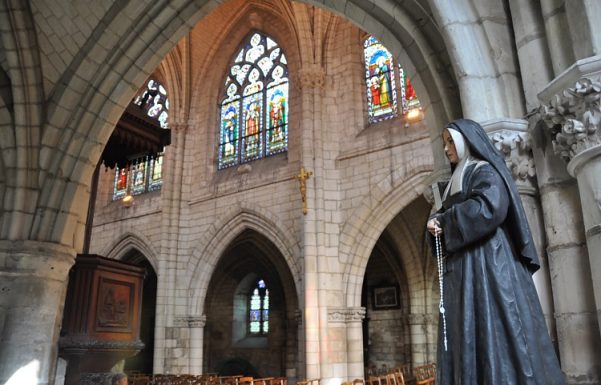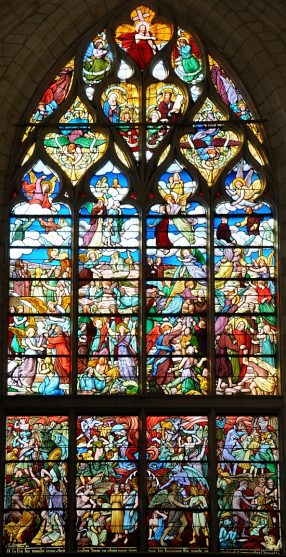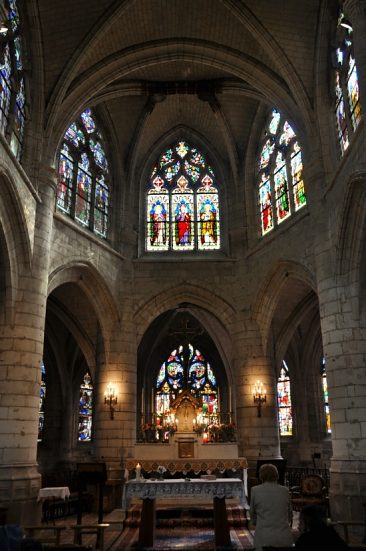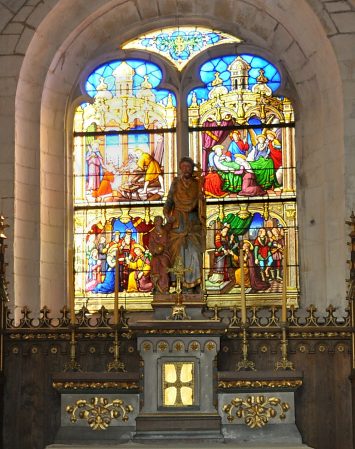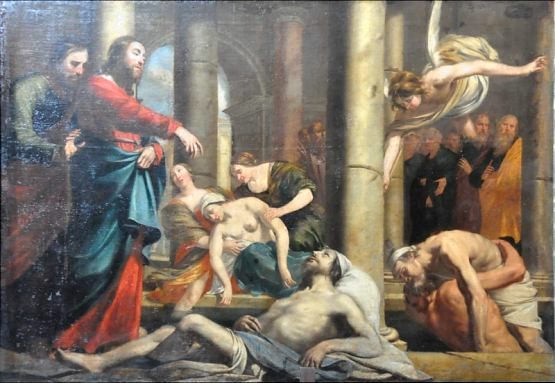|
 |
L'église Saint-Rémi est
l'une des plus anciennes de Troyes. D'après certaines sources,
elle existait déjà au XIe siècle - à
l'extérieur des murs de la ville. Elle n'est englobée
dans la cité qu'au XIIIe siècle et presque entièrement
reconstruite au XIVe. De cette première époque il
ne reste que la nef et la base de son curieux clocher tors. Jusqu'à
la Révolution, les chroniques font état de sa magnifique
verrière due au maître Linard Gontier.
La fougue révolutionnaire va dépouiller l'église
: vitraux et mobilier disparaissent. Les cloches sont envoyées
à Paris. Elles y seront fondues et transformées en
canons. Le XIXe siècle et la prise de conscience naissante
de l'importance du patrimoine vont l'enrichir à nouveau.
On lui attribue des toiles de Jacques De Létin (né
sur la paroisse au XVIIe siècle et baptisé à
l'église) ; une importante série de vitraux historiés
est mise en place à partir du Second Empire.
De par son clocher, l'aspect extérieur de Saint-Rémi
ne fait pas très ancien, comme peut le faire Saint-Nizier
par exemple. Néanmoins, certains la regardent comme la plus
belle église de Troyes. Par son foisonnement de vitraux,
de tableaux, par ses vieilles pierres médiévales dont
les restaurations ont su respecter l'aspect, elle dégage
une atmosphère singulière de beauté et de recueillement.
Sa taille moyenne aide, d'ailleurs, à créer cette
très agréable sensation de bouillonnement artistique
et culturel.
|
|

La nef de l'église Saint-Rémi date du XIVe siècle.
Le chœur est du XVIe siècle. La chaire à prêcher,
sur la droite, est d'époque Louis XIII. |
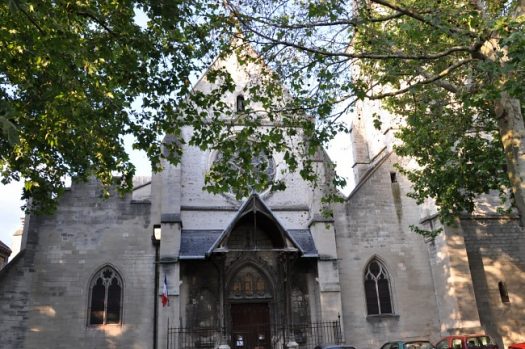
La façade date du XIVe siècle.
Elle a été remaniée au XIXe. |

Vue d'ensemble de l'église avec son curieux clocher tors
Selon une inscription dans son flanc sud, la construction
de la tour du clocher a commencé en 1386. |

Le chevet et
ses chapelles latérales |

Cadran d'horloge à une seule aiguille sur la tour du clocher.
La fresque est de 1772.
À droite, saint Rémi. À gauche, sainte Célinie,
sa mère. |
 |

Le célèbre escargot à tête de chien
sur
la partie gauche de l'archivolte du portail |

Colombe sur la partie
droite de l'archivolte du portail |

Vieillard portant un phylactère
dans le coin gauche de la porte |
«««---
À GAUCHE
Le portail de l'église Saint-Rémy remonte au XVe
siècle |
|

Élévations dans la nef, côté gauche
Le style de Saint-Rémi est du gothique classique
Les vitraux de la nef comprennent chacun trois lancettes à
personnages. Ils ont été réalisés par
l'atelier Florence ---»»»
À droite, saint Gélase, saint Louis et sainte Élisabeth
(fin XIXe siècle). Cliquez sur le vitrail. |
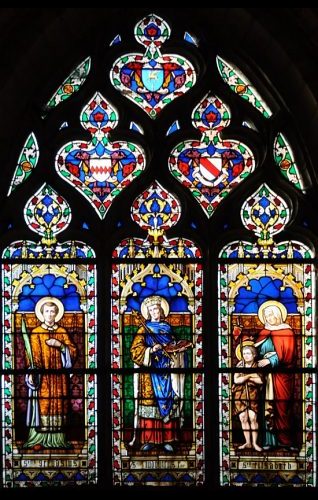 |
|
|

Chapelle du Sacré Cœur
Elle est enrichie de toiles de Jacques de Létin
et de panneaux Renaissance en grisaille. |

Vitrail «Les Noces de Cana»
Atelier Vincent-Larcher, XIXe siècle
Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |

«Jésus chez Marthe et Marie de Béthanie»
(XVIe-XVIIe siècle)
Marthe demande à sa sœur Marie de venir aider au service
de la table, mais Jésus s'interpose : le service de Dieu prime
tous les autres!
Voir le tableau de Jacques de Létin à l'église
Sainte-Madeleine
à
Troyes et les commentaires sur cet épisode du Nouveau Testament |

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)
dans la chapelle du Sacré Cœur
Épisode de la vie de saint Rémy
Le saint offre à Clovis, vêtu en romain, une gourde
qui ne se désemplit jamais. |

Vitrail dans l'oculus de la chapelle du Sacré Cœur
Moïse montre les tables de la Loi à son retour de
la montagne
XIXe siècle, atelier non indiqué
|

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle), détail
Clovis reçoit de Saint Rémy une gourde
qui ne se désemplit jamais. |
|
Les écrits rapportent
que, jusqu'à la Révolution, l'église
Saint-Rémy disposait de vitraux
dus à l'artiste troyen Linard Gontier, comme
l'église Saint-Martin-ès-Vignes,
au nord de Troyes. Les révolutionnaires ayant
brisé toutes ces créations médiévales,
on décida au début du XIXe siècle,
pour les remplacer, de ne pas privilégier un
style uniforme de vitraux en ne s'adressant qu'à
un seul atelier, mais au contraire d'exposer une large
gamme des possibilités de l'époque en
confiant les cartons à cinq ateliers différents.
On fit aussi appel au pastiche en imitant le style des
XIIIe, XIVe et XVe siècles. Furent ainsi sollicités
les ateliers Didron, celui de Florence (ex Lobin), devenu
plus tard l'atelier JP Florence-Heinrich, celui de Vincent-Larcher
et enfin celui de Champigneulle.
|
|
|

Les panneaux Renaissance en grisaille
dans la chapelle du Sacré Cœur
|

Tableau «L'Annonciation» de Jacques de Létin (XVIIe siècle)
Chapelle du Sacré Cœur |
|

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)
L'Annonciation |

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)
Vie de saint Rémy
Le saint fait jaillir du vin d'un tonneau vide.
|

Panneau Renaissance en grisaille (XVIe siècle)
Vie de saint Rémy
Le meunier revient trouver saint Rémy |
|
|
Deux des panneaux en grisaille
ci-dessus illustrent la vie de saint
Rémy. Dans la Légende dorée,
Jacques de Voragine nous en donne la clé.
Pour le premier panneau, on lit dans l'histoire de «saint
Rémi, évêque et confesseur» ce court
texte traduit par Teodor de Wyzewa, aux éditions Diane
de Selliers : «Ayant été un jour reçu
dans la maison d'une dame et apprenant que celle-ci n'avait
plus de vin, saint Rémi entra dans sa cave, fit un
signe de croix sur le tonneau ; et voici que le vin en jaillit
en telle abondance que toute la cave s'en trouva inondée.»
Le deuxième panneau trouve sa source dans l'histoire
qui relate la «Translation de saint Rémi».
On sait que Clovis fut baptisé dans la foi chrétienne
par ce
|
saint. Un jour, le roi lui dit
qu'il allait faire la sieste et que, à son réveil,
il lui donnerait pour son église tout le terrain qu'il
aura pu parcourir. Le saint se mit en marche. Mais sur le
terrain, il y avait un meunier qui tenait son moulin. Et le
meunier refusait que le saint le traversât. Et il s'obstinait
dans son refus de ne pas partager son moulin. Saint Rémi
parti, la roue du moulin se mit à tourner en sens contraire.
Impressionné par ce prodige, le meunier rappela le
saint (scène du panneau) et lui proposa de partager
son moulin. Sur quoi Rémi lui déclara qu'il
n'appartiendrait désormais plus à personne.
En effet, la terre s'ouvrit aussitôt et engloutit le
moulin. Source : «La Légende Dorée»
de Jacques de Voragine, éditions Diane de Selliers.
|
|

Le sanctuaire depuis le déambulatoire |

Saint Michel Archange terrassant le démon (XVIIe siècle) |

|

Le bas-côté droit offre un exemple très séduisant
du charme des vieilles pierres.
«««--- À GAUCHE, Vitrail «La Sainte
Vierge au Rosaire»
Atelier Édouard-Amédée Didron (fin XIXe siècle)
Cliquez sur le vitrail pour l'afficher en gros plan. |
|
|

Chapelle absidiale Saint-Joseph
De face, l'important vitrail montrant Pie IX proclamant saint Joseph
patron de l'Église Universelle
Voir un autre vitrail sur le même peint par Jean Clamens (1894)
à l'église Saint-Joseph
d'Angers. |
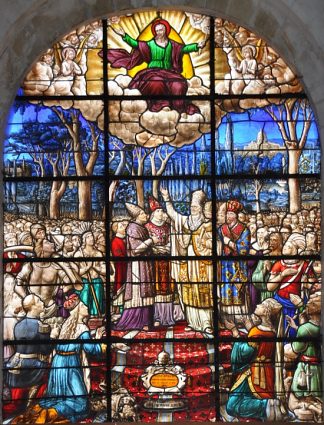
«Pie IX proclamant saint Joseph patron de l'Église Universelle»,
1870
Atelier Vincent-Larcher. Cliquer sur le vitrail. |

Panneau polychrome : «L'Adoration des mages»
Peinture sur bois (Renaissance, XVIe siècle), chapelle
Saint-Joseph |
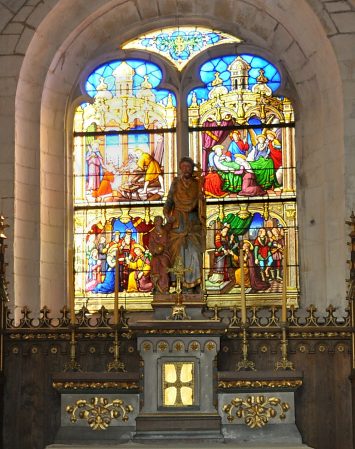
L'autel Saint-Joseph devant un vitrail consacré à
la vie de Joseph
dans la chapelle du même nom |
|
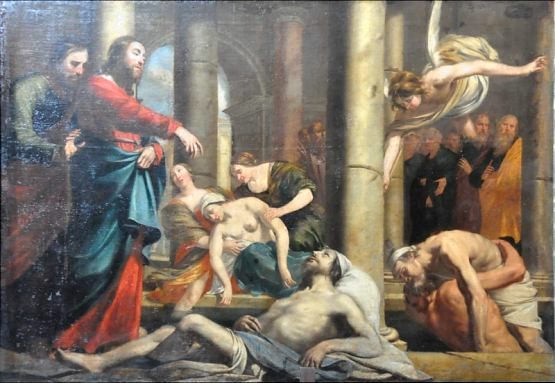
Tableau «Le Christ à la piscine probatique»
Jacques de Létin (XVIIe siècle)
À DROITE --- »»»
Panneau polychrome : «La Naissance de la Vierge»
Peinture sur bois (Renaissance, XVIe siècle), chapelle
Saint-Joseph |

|
|
|
|
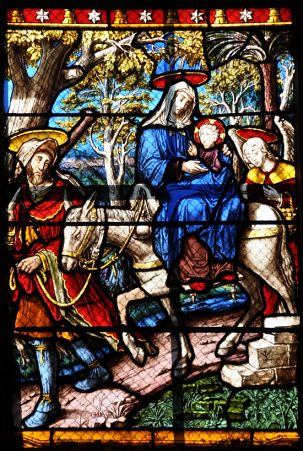
|

Chapelle latérale Saint-Frobert
Elle comprend des panneaux peints des XVIe et XVIIe siècles
et des œuvres de Jacques de Létin
«««--- À GAUCHE, Vitrail «La Fuite
en Egypte», Atelier Vincent-Larcher (fin XIXe siècle)
Le renouveau du vitrail à la fin du XIXe s'exprime par des
décors très travaillés. Cliquez sur le vitrail. |
|
|

Le déambulatoire de Saint-Rémi date du XVIe siècle.
L'église Saint-Pierre
de Dreux offre aussi un magnifique déambulatoire cerné
de vitraux historiés.
À DROITE, Vitrail de l'Enfant prodigue, détail ---»»»
Atelier JP Florence Heinrich, Tours 1904 .Cliquez sur le vitrail pour
l'afficher en gros plan. |

|

Vitrail Notre-Dame des Victoires - Atelier Didron, 1838
L'année de création est donnée dans l'inscription
du bas. |

Avec ses trois beaux vitraux historiés, la chapelle de la Vierge
présente une atmosphère féérique. |
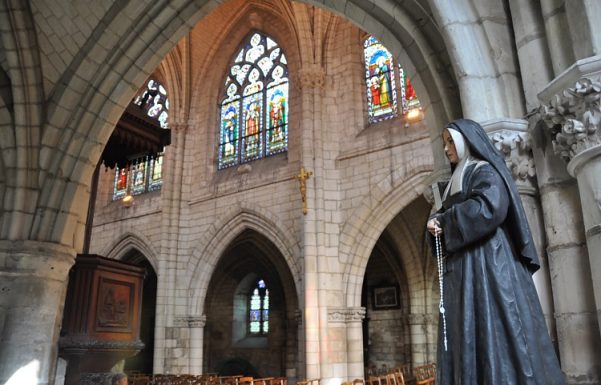
Élévations droites de la nef : colonnettes en forte
saillie et arcades en arc brisé |
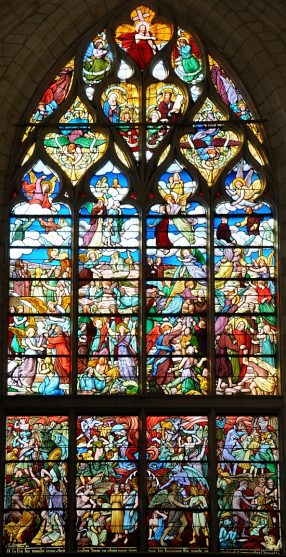
Vitrail «Le Jugement dernier», atelier Champigneulle (fin
XIXe) |
|
Les vitraux
de Saint-Rémi sont tous issus des ateliers
peintres verriers français du XIXe siècle. Malgré
une touche artistique propre à chaque atelier, ils
reflètent tous ce que les historiens appellent le renouveau
de l'art du vitrail à la fin du XIXe siècle
: ils comportent des scènes pleines d'expression enrichies
d'une palette de couleurs chatoyantes. Le vitrail de la Fuite
en Égypte en donne une illustration. L'atelier
Vincent-Larcher a signé un grand vitrail historié
: «Pie IX
proclamant saint Joseph patron de l'Église Universelle»
dans la chapelle Saint-Joseph. Le maître-verrier Champigneulle
n'a réalisé qu'une seule verrière pour
Saint-Rémi : le très foisonnant «Jugement
dernier» donné ci-contre et sa série de
diables dans les panneaux inférieurs. Le célèbre
atelier d'Édouard-Amédée Didron
a réalisé deux types de verrières : des
verrières style XIXe (La
Sainte Vierge au Rosaire) et d'autres avec la touche médiévale.
Enfin l'atelier de Florence et ses associés (Lobin
et Heinrich) a été très prolifique
: les grands
vitraux à personnages de la nef ainsi que des vitraux
des chapelles du déambulatoire et certains des bas-côtés.
|
|

Vitrail «Le Jugement dernier, l'enfer et les sept péchés
capitaux »
Atelier Champigneulle (fin du XIXe siècle) |
|
Dans le
vitrail du Jugement dernier de l'atelier Champigneulle,
les auteurs du carton ont laissé leur imagination créer
des diables à profusion... Les péchés
capitaux sont inscrits sur le corps ou sur les ailes des diables.
Détail intéressant : dans son ouvrage «Vocabulaire
illustré de l'ornement» aux éditions Eyrolles,
Evelyne Thomas rappelle que, dans l'iconographie chrétienne,
à partir du XIIIe siècle, les ailes des anges
sont couvertes de plumes tandis que
|
celles des êtres démoniaques
sont membraneuses, comme chez les chauve-souris. On peut remarquer
que l'atelier Champigneulle n'a pas tenu compte de cette règle
puisqu'au moins deux démons dans le vitrail ont des
ailes portant des plumes. C'est notamment le cas de celui
du centre : ce diable se saisit d'un homme qui est vraisemblablement
un assassin puisqu'il tient un poignard dans sa main droite.
|
|
|

Le chœur de l'église Saint-Rémi date du XVIe
siècle. Il a été remanié au XIXe siècle.
|
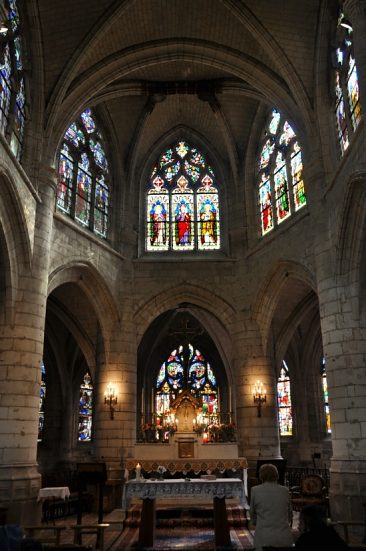
Le chœur et l'abside de Saint-Rémi
À DROITE, Scènes de l'Histoire Sainte (Abraham et Moïse)
dans un vitrail de la nef
Atelier Florence (fin XIXe siècle) ---»»»
Cliquez sur le vitrail pour l'afficher dans sa totalité. |

L'orgue de tribune et les parties hautes avec les vitraux à
personnages de l'atelier Florence |

|

Vitrail «Scènes de la vie de Saint Louis» |

Partie haute de la nef et ses vitraux à trois lancettes à
personnages (atelier Florence) |
À DROITE ---»»»
Détail du vitrail du Sacré-Cœur
dans le transept sud
Atelier Florence (ex Lobin) |
|
«««---
Les vitraux des scènes de la vie de saint Louis
ont visiblement été créés
à partir des mêmes cartons que ceux du
chœur de la cathédrale Saint-Louis
de Blois (panneaux Mansourah
et Couronne
d'épines). Le vitrail de gauche de la rangée
inférieure illustre le vœu
de saint Louis.
|
|
 |
|

La nef et l'orgue de tribune (qui date de 1853) vus depuis le chœur. |
Documentation : «Troyes en Champagne»
de Didier Guy et Patrick Dupré, ISBN 2-913052-24-6 et article
«Saint-Rémy de Troyes» de Wikipédia |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |