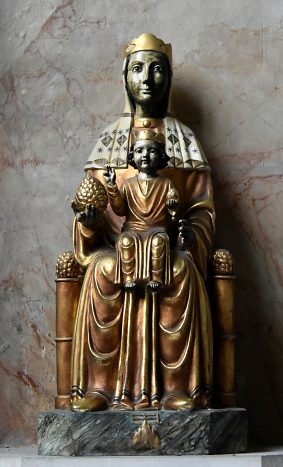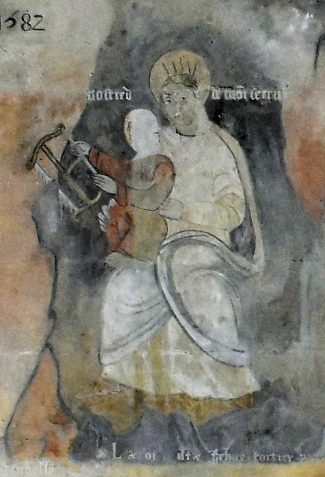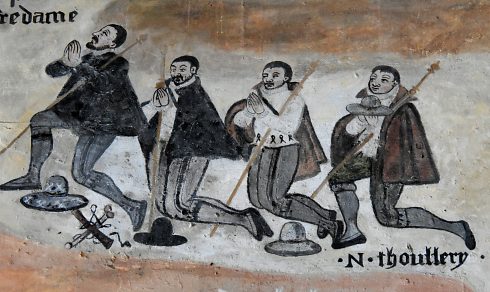|
|
 |
 |
L'église Saint-Jacques
et Saint-Christophe offre l'exemple d'un édifice cultuel
bâti exclusivement avec les dons des habitants de la
ville. Ni le clergé ni les seigneurs locaux n'ont participé
à son financement. Et la construction aura pris deux
cent cinquante ans... Au début du XIIe siècle,
il y avait à Houdan deux églises : Saint-Jacques-le-Majeur
et Saint-Jean. La première datait du XIe siècle
et se trouvait à l'emplacement de l 'église
actuelle ; la seconde a disparu. Un troisième petit
édifice, la chapelle Saint-Matthieu, a été
détruit en 1860 pour permettre l'arrivée du
chemin de fer.
Au tout début du XVIe siècle, la ville de Houdan
décide de reconstruire l'église Saint-Jacques.
Grâce au commerce du grain, les marchands se sont enrichis
et les dons affluent. Sans oublier que le vicaire général
de Chartres,
évêché dont dépend Houdan, a accordé
quarante jours d'indulgence aux marguillers et à tous
les fidèles qui donneront pour l'église et son
ornementation. En 1510, le patronyme de saint Christophe est
venu s'ajouter à celui de saint Jacques.
Les historiens situent le démarrage des travaux entre
1525 et 1540 : d'abord la façade, puis la nef jusqu'au
transept, de l'ouest vers l'est. Le style retenu est bien
sûr celui de l'époque, à savoir le gothique
flamboyant. En 1545 commence l'élévation du
chœur
où l'on voit un début d'influence du style Renaissance
avec des chapiteaux
à grotesques et à têtes humaines dans
les piliers est du transept. Puis, en 1561, on façonne
les terrasses des chapelles
rayonnantes, des chapelles qui ne seront d'ailleurs terminées
que vers 1610. Cinquante années pour les bâtir.
Est-ce la conséquence des guerres de Religion qui frappent
le Royaume, qui refroidissent le commerce et qui assèchent
les bourses ? Quoi qu'il en soit, le style architectural est
cette fois clairement le style Renaissance avec son retour
à l'antique : colonnes carrées surmontées
d'un bandeau en forte saillie ; absence de chapiteaux ; clés
pendantes et, à l'extérieur, colonnes
cylindriques séparant les chapelles. Notons qu'en
1633 la voûte
du chœur s'effondre. La nouvelle ne sera achevée
qu'en 1647. En 1672, on note l'installation du retable
du chœur et du maître-autel, œuvres de Thomas
Rousseau, menuisier à Houdan.
En 1712, on reconstruit la voûte de la nef, on refait
certains piliers et le mur qui termine le transept au nord.
Remarquons que le transept de l'église ne possède
pas de croisillon au nord et que le clocher reste inachevé,
sans doute par manque de fonds. Louis-Alexandre Clicquot commence
la construction de ses grandes
orgues en 1734. Mobilier et ornementation suivent : banc
d'œuvre et chaire à prêcher en 1744, stalles
du chœur et lutrin en 1747.
Sous la Révolution, début juin 1794, l'église
Saint-Jacques est transformée en temple de la Raison.
Le linteau supérieur de sa façade possède
à ce titre une très rare inscription à
l'Être suprême (voir plus
bas). Mais tout prend fin avec la chute de Robespierre.
Au XIXe siècle, on met en place de nouvelles cloches
et un orgue de chœur (ce qui va conduire au délaissement
de l'orgue Clicquot
qui ne reprendra vie qu'en 1972).
L'église Saint-Jacques et Saint-Christophe a été
classée Monument historique en 1840. Avec une construction
qui s'étale sur trois siècles, du XVIe au XVIIIe,
elle illustre la transition du gothique flamboyant au style
Renaissance. Longue de 50 mètres, avec un intérieur
assez dépouillé, elle n'en vaut pas moins la
visite pour sa juxtaposition des différents styles
artistiques, ses élévations gothiques, son déambulatoire
Renaissance et son beau retable du maître-autel daté
de 1672. On mentionnera aussi une fresque de 1582 dans la
chapelle rayonnante dédiée à Notre-Dame
de Montserrat.
La verrière
a compté quelques œuvres du XVIe siècle.
Malheureusement, il n'en reste plus aujourd'hui que des fragments
insérés dans des matrices losangées en
verre blanc. Cette page en donne de nombreux extraits. On
pourra regarder aussi avec intérêt le grand vitrail
peu banal de 1862, situé dans la chapelle Sainte-Célestine.
Offert par Étienne Flèche en ex voto de sa guérison,
il s'y est fait représenter avec sa famille sous les
traits de saints et saintes.
|
 |
|

Vue générale de la nef avec son aspect gothique flamboyant.
Les vitraux en verre blanc assurent à l'église une exceptionnelle
luminosité.
La chaire à prêcher date de 1744, le retable du chœur
de 1672. |

L'église Saint-Jacques vue depuis le sommet du donjon. |

L'église Saint-Jacques vue depuis la campagne au sud
de la ville. |
|

La façade occidentale.
Les personnages des voussures ont été consciencieusement
martelés à la Révolution.
Seul subsiste, intact, un buste
de femme à la droite de l'horloge. |
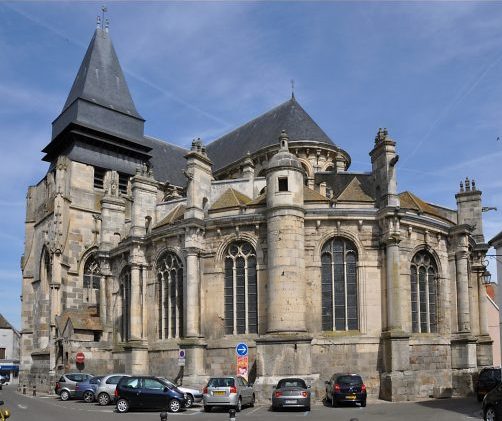
Le chevet Renaissance de l'église Saint-Jacques.

|
La
façade occidentale. Du XVIe siècle,
de style gothique flamboyant, elle devait être
fort belle jadis avec ses statues nichées entre
consoles et dais.
Sous la Révolution, en juin 1794, l'église
de Houdan fut transformée en temple de la Raison.
Au-dessus du portail, le linteau supérieur porte
l'inscription assez rare : «LE PEUPLE FRANÇAIS
RECONNOÎT L'EXISTENCE DE L'ÊTRE SUPRÊME
ET DE L'IMMORTALITÉ DE L'ÂME». Le
culte de l'Être suprême ne dura que cinquante
jours : tout s'arrêta avec la chute de Robespierre,
le 10 Thermidor de l'an II (28 juillet 1794).
Même s'il se trouvait quelques Houdanais zélés
à cette époque, la ville n'eut guère
à souffrir des exactions sanguinaires de la Révolution.
On note seulement que toutes les têtes des personnages
ornant l'archivolte furent martelées. De plus,
la ville, grande place marchande de la Beauce, reçut
à plusieurs reprises les injonctions de la Convention
d'envoyer du blé à la capitale.
Les vantaux
de bois de la double porte sont remarquables : la partie
supérieure, sculptée, date de la Renaissance.
Notons enfin qu'un beau buste
de femme, haut perché, subsiste, intact.
|
|
|

«LE PEUPLE FRANÇAIS RECONNOÎT
L'EXISTENCE DE L'ÊTRE SUPRÊME
ET DE L'IMMORTALITÉ DE L'ÂME»
Cette inscription sur le linteau supérieur de la façade
a été peinte sous la Terreur. |
|
|

Le portail de style gothique flamboyant de l'église Saint-Jacques.
Première moitié du XVIe siècle. |

Sculpture du portail : animal fantastique dans une frise florale. |

Détail d'un dais de style gothique flamboyant dans le
portail.
La méticulosité des scuptures ne peut que faire
regretter
les dégradations de l'époque révolutionnaire. |

Frise avec animal et pampres
sur le côté du portail. |
|

Détail des voussures de l'archivolte du portail. |

Un personnage sans tête dans une voussure de l'archivolte
du portail. |

Détail des voussures de l'archivolte du portail.
À gauche, le personnage saisit de sa main les plis de
sa robe.
Les détails de ce qui reste de cette sculpture
sont la marque de sculpteurs de haut niveau. |
|
 |
 Partie supérieure du vantail gauche.
Partie supérieure du vantail gauche.
Les vantaux sont consacrés aux Saints patrons de l'église
: saint Jacques et saint Christophe.
La partie supérieure des vantaux de bois sculpté
est d'époque Renaissance.

«««--- Saint Christophe porte l'Enfant sur
ses épaules.
Saint Jacques le Majeur tient son bâton de pèlerin
---»»» |
 |
|
 Le côté nord de l'église. Le transept n'a
pas de de croisillon au nord.
Le côté nord de l'église. Le transept n'a
pas de de croisillon au nord.
|
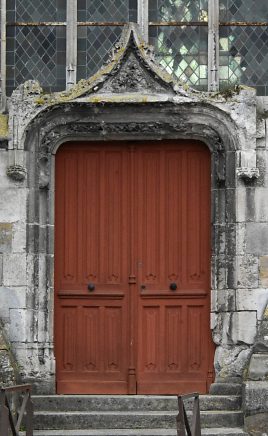 La porte du côté nord comporte voussure et accolade.
La porte du côté nord comporte voussure et accolade. |
|

STYLE GOTHIQUE FLAMBOYANT
Identité des remplages en tiers point au premier niveau, différentiation
au second. |

STYLE RENAISSANCE
Baies en plein cintre, simplification du dessin du remplage, colonnes
monocylindriques séparant les chapelles. |
| LA NEF DE SAINT-JACQUES
ET SAINT-CHRISTOPHE |
|

La nef et le bas-côté nord.
La chaire à prêcher, œuvre de Pierre Fillastre,
a été achetée en 1744. |
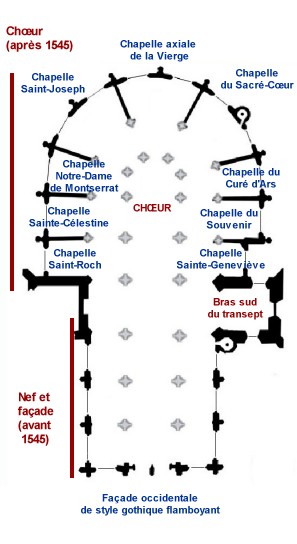
Plan de l'église Saint-Jacques et Saint-Christophe |

Élévation sud de la nef (sur deux niveaux) vue
depuis le transept. |
|
Architecture
intérieure.
La longueur de Saint-Jacques-le-Majeur est de 50 mètres.
On voit, sur le plan à gauche, que le chœur
occupe la plus grande partie de l'édifice comme
si tout avait été fait pour favoriser
la déambulation des fidèles autour des
reliques... qui n'ont jamais existé ici. Notons
quand même que l'église était une
étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Le chœur affiche 28 mètres de large contre
17 pour la nef. Quant à la voûte, elle
s'élève, de manière uniforme sur
toute sa longueur, à 19 mètres.
La construction semble avoir commencé en 1525
par la nef qui est de style gothique flamboyant : arcades
en tiers point avec intrados à moulure multiple
; absence de chapiteaux, mais retombées en pénétration
sur les piles. Une mince corniche peu saillante sépare
les deux niveaux de l'élévation. Le gothique
flamboyant s'observe aussi dans le remplage des
baies dont le dessin est identique au premier niveau.
Au second, il diffère dans chaque fenêtre,
tout en adoptant une forme très simple.
Le couvrement de l'église est voûté
d'ogives, mais l'influence de la Renaissance se voit
dès le transept avec la présence de clés
pendantes. Trois photos
les donnent en gros plan. On en trouve d'autres dans
la voûte
du chœur. Les chapiteaux
du transept (qui se situent si haut qu'il faut un téléobjectif
ou une paire de jumelles pour les observer vraiment)
marquent aussi l'entrée dans la Renaissance :
ils sont riches de grotesques et de têtes humaines.
Enfin, le remplage des baies
des chapelles rayonnantes a totalement abandonné
le style flamboyant.
En s'étalant sur plus de deux siècles,
la construction de Saint-Jacques-le-Majeur offre l'image
d'une église illustrant une transition douce
du style gothique vers le style Renaissance.
|
|
|

La voûte de l'église vue en grand angle. |

Une travée de la nef avec un vitrail typique de l'église
Saint-Jacques :
un réemploi de vitraux du XVIe siècle dans une
baie en verre blanc.
Ici, la baie 14 avec les saints Roch et Sébastien. |

Baie 13, détail : la Vierge de l'Annonciation.
Le tympan de cette baie reçoit une
recomposition du XXe siècle. |
|
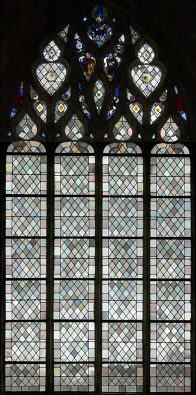
Baie 15 : vue d'ensemble. |
|
Les
vitraux de Saint-Jacques Le Majeur.
Même s'il n'y a jamais beaucoup de vitraux Renaissance
dans l'église, ce qui nous en reste n'est malheureusement
plus qu'à l'état de fragments, disséminés
dans des verrières losangées dont on donne
un exemple ci-contre à gauche. Ce travail de
réintégration de l'ancien dans le moderne
date de 1972.
Seule la baie axiale (baie
100) garde un semblant de vitrail d'origine. Datée
de 1633, elle a cependant été très
restaurée. On y voit une Annonciation et saint
Jacques le Majeur debout avec son bâton.
Dans la nef, les baies 14,
19
et 20
sont les seules dont les lancettes abritent des fragments
Renaissance (qu'on retrouve aussi dans le tympan d'ailleurs).
La lancette centrale de la baie 19 n'abrite qu'un ange
de petite taille, mais il est de très bonne facture.
Dans les baies 13, 15
et 17,
c'est exclusivement dans le tympan que l'on voit les
fragments du XVIe siècle, parfois au milieu d'angelots
créés au XXe siècle.
De l'époque Renaissance, le vitrail le plus intéressant
est sans conteste celui de la baie 14
: il montre un saint Roch appuyé sur sa canne
et un saint Sébastien couronné par deux
anges. Notons encore, dans les mouchettes de la baie
19,
deux fragments d'une Résurrection des morts et,
au second niveau de la nef, dans la baie 116,
les restes de ce qui pourrait être une Apparition
du Christ à saint Hubert.
Dans le déambulatoire, la chapelle Sainte-Célestine
accueille une très grande et belle verrière
de 1862 offerte par Étienne Flèche en
remerciement de sa guérison. Le donateur s'y
est fait représenter avec sa famille. Pour être
complet, la baie 7 de la chapelle Notre-Dame-de-Montserrat
reçoit elle aussi un petit fragment du XVIe siècle,
mais il est totalement illisible.
Le livre sur Houdan édité par le Syndicat
d'Initiatives de la ville en 1982 écrit que les
verrières ont toujours été une
cause de soucis pour la Fabrique. Plus grave encore
: «Les verrières tombent, peut-on y lire,
et les entrepreneurs renoncent à en assurer l'entretien
et les réparations.» En 1752, pour diminuer
les coûts, les marguilliers décidèrent
de murer la moitié inférieure des grandes
fenêtres de la nef. Une situation qui se prolongea
jusqu'en... 1968.
|
|
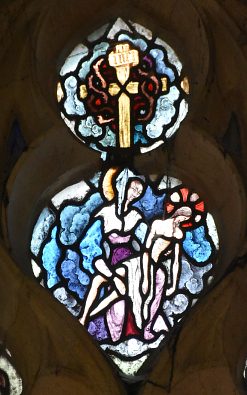
Baie 13, détail : Piéta du XXe siècle
dans le tympan. |
|
| BAIE 14 - SAINT
ROCH ET SAINT SÉBASTIEN |
|

Baie 14 - Totalité des fragments du XVIe siècle
À gauche, saint Jacques le Majeur ; à droite, saint
Sébastien couronné par les anges.
Au centre, deux colonnettes de réemplois de petits fragments
Renaissance.
La partie supérieure de la baie 14 est constituée de
créations du XXe siècle à thème floral.
Elle n'est pas donnée dans cette page. |
|
|
| BAIE 15
- TYMPAN RENAISSANCE |
|
| BAIE 116
- FRAGMENT RENAISSANCE |
|

Baie 15 : Fragments de vitraux du XVI siècle restaurés
dans le tympan :
Saint Jacques le Majeur (ou saint Roch), le roi David
et un personnage non identifié.
|

Baie 15, détail : le roi David
XVIe siècle. |

Baie 116 : fragment du XVIe siècle.
Reste d'une Apparition du Christ à saint Hubert ? |
|
| CLÉS PENDANTES
DE LA NEF ET DES BAS-CÔTÉS |
|

|

Le gothique flamboyant de la nef et des bas-côtés
s'orne de
très belles clés pendantes de style Renaissance.
Leur besoin de restauration nuit à leur éclat.
|
 |
|
| BAIE 17 - TYMPAN
RENAISSANCE |
|

Le bas-côté sud. La voûte est ornée de clés
pendantes.
À l'arrière-plan, l'entrée dans le déambulatoire. |
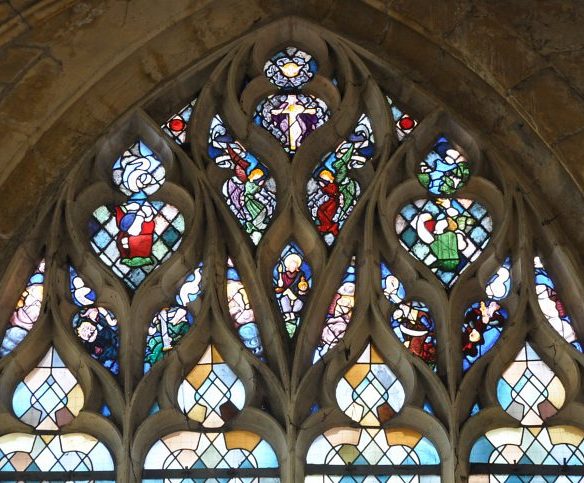
Baie 17, détail du tympan : Dieu le Père
et les quatre prophètes qui l'entourent sont du XVIe
siècle.
La partie haute (Trinité souffrante et deux anges) est
du XXe siècle. |
|
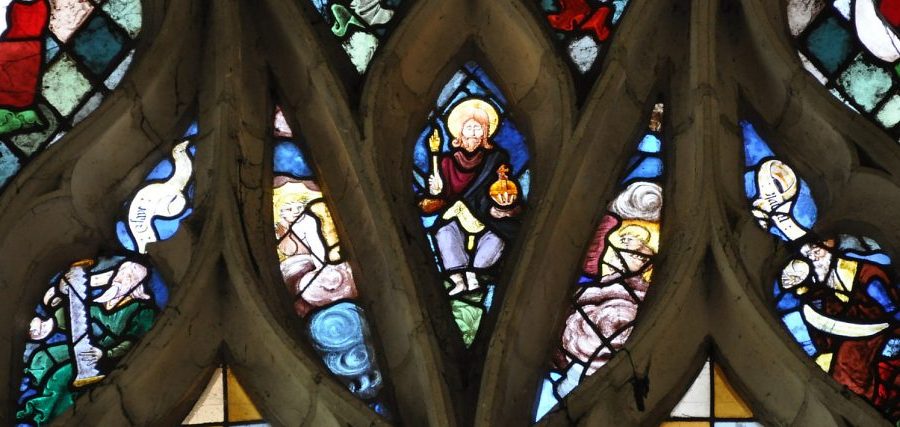
Baie 17, détail du tympan : Dieu le Père, deux
angelots et deux des quatre prophètes qui l'entourent.
XVIe siècle. |
|
|
| BAIE 19 - FRAGMENTS
RENAISSANCE |
|

Baie 19 : le tympan (XVIe siècle et XXe siècle). |

Le Martyre de saint Étienne
Auteur inconnu, XVIIe siècle ?
|
Baie
19, tympan.
Les quatre fragments d'une Résurrection
des morts (sur fond blanc) sont du milieu du XVIe siècle.
Le Christ des deux soufflets supérieurs et les
anges des mouchettes du bas (tous sur fond bleu) sont
du XXe siècle.
|
|
|

Baie 19, détail : Magnifique grisaille d'un ange dans
la lancette centrale.
Milieu du XVIe siècle. |

Baie 19, détail du tympan : deux scènes de résurrection
dans des mouchettes.
Milieu du XVIe siècle. |
| BAIE 20 - QUATRE
FRAGMENTS RENAISSANCE |
|
 |

Le bas-côté sud et sa verrière occidentale
(baie 20). |
 |
|
Baie
20. Dans sa lancette centrale, cette baie
abrite quatre fragments du XVIe siècle assemblés
en «macédoine» et donnés à
droite et à gauche, ci-contre.
Dans son tympan figure l'Agneau
pascal accompagné par deux anges tenant les
instruments de la Passion, le tout également
du XVIe siècle.
Source : Corpus Vitrearum.
|
|
|
«««--- Baie
20, détails ---»»»
Fragments de vitraux du XVIe siècle
disposés en «macédoine».
|
|
|
|
|

La nef et son élévation sud vues du chœur.
Au premier plan, les deux piles qui ouvrent sur le transept
sont ornées de chapiteaux Renaissance.
Perchés très haut, il faut une paire de jumelles
pour en observer les ornements.
Sur la gauche de la photo : le croisillon sud du transept. |

Baie 20, détail du tympan :
Un ange portant les instruments de la Passion.
XVIe siècle. |
|
| LA CROISÉE
DU TRANSEPT ET SES CHAPITEAUX RENAISSANCE |
|
|
|

Le transept vu en grand angle depuis le croisillon sud. |
 Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest
de la croisée.
Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest
de la croisée. |

Chapiteau sud-est avec l'inscription : «1545». |
|
|

Voûte de la croisée et du bas-côté
sud dans le transept.
Notez les clés pendantes au sommet des ogives. |

Clé pendante à la croisée du transept. |
|

Tableau d'une Piéta d'un auteur inconnu (XVIIIe
siècle ?)
Autel de Notre-Dame des Sept Douleurs dans le transept. |

Autel du XVIe siècle
dans le croisillon sud du transept. |

Voûte en étoile du clocher dans le bras sud
du transept.
L'orifice pour le passage des cordes est orné de
quatre clés pendantes. |
|
|
| LE CHŒUR
DE SAINT-JACQUES ET SAINT-CHRISTOPHE |
|

Le chœur et son retable Renaissance.
On remarque que les piliers à l'arrière-plan, avec leur
large entablement, sont différents des autres.
Leur construction est postérieure et les goûts ont changé. |
|
|
|
|

L'abside avec sa voûte Renaissance. Le vitrail de
la baie 100 est daté de l'année 1633. |

Clé pendante dans la première travée
du chœur. |

Clé pendante à l'abside. |
|

«L'Adoration des mages»
Médaillon anonyme du XVIIe siècle dans le
retable du chœur. |
|
|

Baie axiale (n° 100) : Annonciation et saint Jacques
le Majeur
Année 1633. |
|
|

Baie 100, détail : l'Annonciation (1633). |

Baie 100, détail : Saint Jacques le Majeur (1633).
Le voyageur se tient devant un beau paysage avec maisons et
lac, |
|

L'Ange de l'Annonciation, détail
1633. |

La Vierge de l'Annonciation, détail.
1633. |
|

Peinture Renaissance sur un pilier du chœur. |

Le Christ en croix au-dessus du retable du chœur. |

«Le Baptême du Christ»
Médaillon anonyme du XVIIe siècle dans le retable
du chœur. |
|
«««---
Peinture Renaissance.
Sous cette peinture est inscrit en caractères
gothiques :
|
Rappelons qu'à
cette époque un povre correspond
à un concept très précis
: c'est une personne qui ne peut subvenir à
ses besoins. Ce qui veut dire essentiellement
les malades, les estropiés (souvent par
faits de guerre), les vieillards et les veuves
avec enfants.
Un homme en pleine santé n'est jamais un
povre.
Voir l'encadré proposé sur la pauvreté
à la fin du Moyen Âge à propos
d'un vitrail Renaissance de la cathédrale
de Bourges.
|
| |
Il
ne appartient à nul hom
Tant soit il maistre ou
Grand Seigneur
se mettre au desus
du povre. |
|
|
|
| LE DÉAMBULATOIRE
ET LES CHAPELLES RAYONNANTES |
|

La chapelle rayonnante Saint-Roch et le déambulatoire nord.
Déambulatoire et chapelles rayonnantes sont de style Renaissance.
Sur tous les croisements d'ogives, les clés pendantes sont
de règle. |
|
|

Voûte de la chapelle Saint-Joseph. |

Voûte de la chapelle de la Vierge. |
|
| CHAPELLE RAYONNANTE
SAINTE-CÉLESTINE |
|
 Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.
Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.
On remarquera, sur la voûte, la croix peinte ornée
de bas-reliefs dorés. |

Croix peinte ornée de bas-reliefs sur la voûte
de la chapelle Sainte-Célestine. |

Saint Matthieu et l'Ange (XVIIe siècle)
Bas-relief sur la voûte de la chapelle Sainte-Célestine. |
|
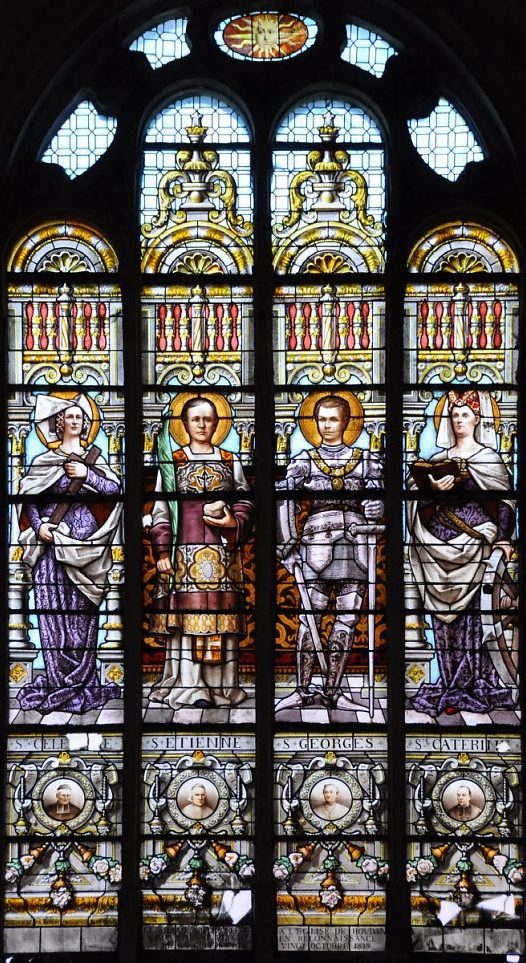
Cette grande verrière date de 1862.
Le donateur, Étienne Flèche, s'y est fait
représenter avec sa famille sous
les traits de sainte Célestine, saint Étienne,
saint Georges et sainte Catherine.
L'inscription du bas en donne l'origine :
« CE VITRAIL A ÉTÉ OFFERT À
L'ÉGLISE DE HOUDAN
PAR ÉTIENNE FLÈCHE EN RECONNAISSANCE
DE SA GUÉRISON DU VINGT OCTOBRE 1839». |

|
 |
Le Père
céleste et, saint Jean (XVIIe siècle)
Bas-reliefs sur la voûte de la chapelle Sainte-Célestine.
|
|
|
| CHAPELLE RAYONNANTE
NOTRE-DAME DE MONTSERRAT |
|

Chapelle rayonnante Notre-Dame de Montserrat dans le déambulatoire
nord
et sa fresque de 1582. |
|
La
fresque du pèlerinage de Monserrat.
Cette vaste peinture murale, datée de 1582,
a été redécouverte en 1949, cachée
sous un badigeon jaune, et remise en état
en 1956. Elle s'étale sur 4,60 mètres
de long et 4,10 mètres de haut. Composée
de deux Vierges à l'Enfant, d'architecture
et d'une multitude de personnages, elle représente
le pèlerinage d’une trentaine de Houdanais à Notre-Dame
de Montserrat (Catalogne) au XVIe siècle.
Ces gens entreprirent le voyage pour demander
à la Vierge de faire cesser l'épidémie
de peste qui sévissait dans leur région.
Survenue à Paris en août 1578 et
aggravée par une épidémie
de coqueluche, la peste s'était propagée
tout autour de la capitale à la suite de
l'exil précipité des Parisiens vers
leurs demeures de l'Ile-de-France (quand ils en
avaient une). Le virus voyagea avec eux. En quelques
courtes années, il fit des dizaines de
milliers de morts.
Au centre du dessin se tient, assise, une Vierge
à l'Enfant. C'est la copie du sceau
des moines du XVIe siècle, lit-on dans
le livre sur Houdan édité par le
Syndicat d'Initiatives en 1982. La seule différence
est que, sur le sceau, l'Enfant se tient sur le
genou gauche de Marie. On remarquera que la couronne
de la Vierge est en dents de scie et que l'Enfant-Jésus
tient lui-même une scie, rappels de l'étymologie
de Monserrat (Mont scié). Une autre
Vierge à l'Enfant, aux contours plus précis,
mais incolore, se trouve sur la droite du dessin.
Appelée Notre
Dame de la Roche, elle veut rappeler la découverte
à Montserrat de la statue de la Vierge
dans l'anfractuosité d'un rocher.
La fresque est assez étonnante dans la
personnalisation des participants car les noms
sont écrits. Sans doute peut-on aussi compter
sur la ressemblance des visages. On y voit des
marchands et des artisans, des cordonniers et
des tourneurs, mais aucun notable ni seigneur
de la contrée.
Les historiens ne connaissent pas avec certitude
la raison du choix de Montserrat. L'église
Saint-Jacques d'Houdan était une étape
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
(et l'est toujours). Alors pourquoi ne pas aller
à Compostelle ? Pourquoi ne pas aller
au Mont-Saint-Michel, plus proche et très
fréquenté ? Le livre du Syndicat
d'Initiatives Houdan, son histoire, ses monuments,
sa vie dans le passé apporte des éléments
de réponse.
Il y aurait deux explications : l'une bretonne
; l'autre normande. Après les calamités
de la guerre de Cent Ans, Houdan et sa contrée
sont dépeuplés. Les ducs de Bretagne
(qui ont la haute main sur la région) font
alors venir des populations de l'Armorique. Au
début du XVIe siècle, on arrive
ainsi à une estimation de 4000 Houdanais.
Ce qui fait de la ville, pour l'époque,
une cité importante. Les Bretons sont arrivés
avec leurs us et coutumes, notamment leur dévotion
à Notre-Dame de Montserrat. Cette dévotion
tire sa source de l'intense prédication
menée en Bretagne par saint Vincent Ferrier
au XIVe siècle. L'espagnol Vincent Ferrier,
originaire de Valence, développa le culte
de Notre-Dame partout où il passa.
L'explication normande est à rattacher
aux confréries de Charité. Ces associations
avaient pour but premier d'assurer l'ensevelissement
des morts (évidemment nombreux en période
de peste) et de prier pour leur salut. Aux marches
de la Normandie, à Évreux
précisément, il y avait une chapelle
dédiée à Notre Dame de Montserrat.
Et vraisemblablement une confrérie lui
était liée. Or des liens particuliers
existaient entre Évreux
et Houdan. Par exemple, un péage avait
été créé à
l'entrée de Houdan pour assurer l'entretien
des tombeaux des Monfort dans la cathédrale
d'Évreux. Mais c'est davantage dans
le commerce que florissait la relation entre les
deux villes : les fabricants de draps de la région
d'Évreux
et d'Elbeuf s'approvisionnaient en toison de mouton
à Houdan. De plus, une main d'œuvre
agricole descendait chaque année de cette
marche de Normandie pour prendre part aux moissons
et au rouissage du chanvre.
À cette époque, à Houdan,
il y avait un bâtiment que l'on appelait
«la maison de la Charité».
Les historiens locaux en déduisent l'existence,
dans la ville, d'une confrérie de Charité.
Et c'est elle qui aurait eu l'idée du pèlerinage
à Montserrat : le lieu était à
la mode à Houdan (par le biais des anciens
Bretons comme on l'a vu plus haut) et le voyage,
long et pénible, pouvait être associé
à une pénitence. Enfin, sur place,
on obtiendrait, de la part du monastère,
l'investiture d'une confrérie de Montserrat
qui allait être créée à
Houdan au retour des pèlerins.
En 1982, cinq Houdanais refirent le pèlerinage
à pied en 45 jours. Ils en rapportèrent
la «Morenata», la statue d'une Vierge
noire présentant l'Enfant, donnée
ci-contre.
Source : Houdan,
son histoire, ses monuments, sa vie dans le passé,
ouvrage édité par le Syndicat d'Initiatives
de Houdan, 1982.
|
|
|
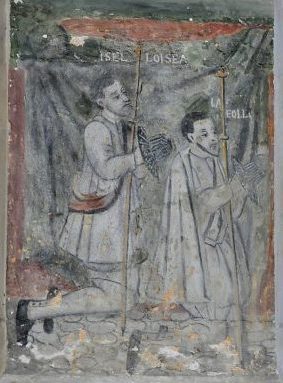 Deux pèlerins en prière dans la chapelle
Deux pèlerins en prière dans la chapelle
Notre-Dame de Montserrat (fresque de 1582). |
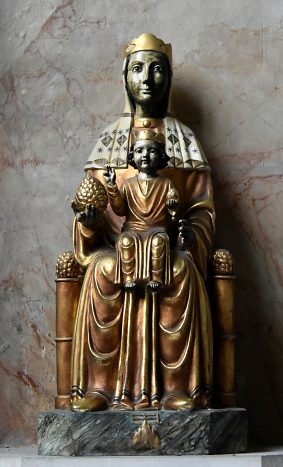
La «Morenata» : Vierge noire rapportée de Monserrat
en 1982. |

Deux pèlerins dans la fresque de 1582. |
|
|

Le pèlerinage de 1582 en Catalogne est représenté
sur le mur de la chapelle de Notre-Dame de Montserrat. |
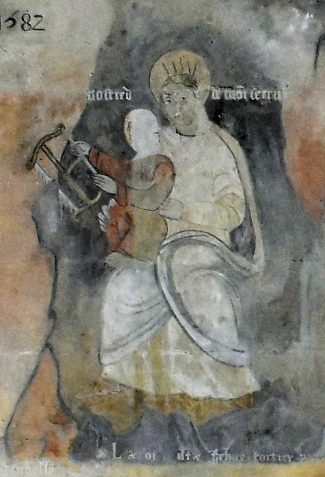
La Vierge de Monserrat est au centre de la composition.
L'Enfant-Jésus tient une scie (rappelant l'origine «Mont
scié»). |
|

Quatre pèlerins en prière dans la chapelle Notre-Dame
de Montserrat.
D'après la date indiquée, ce dessin a été
rajouté en 1596 sur le mur gouttereau de la chapelle. |

Notre Dame de la Roche
sur la partie droite du dessin. |
|
|
|

Chapelle Sainte-Geneviève dans le déambulatoire sud. |

Visage de la Vierge ou d'une sainte (XVIIIe siècle?)
dans un tableau d'une chapelle du déambulatoire, détail. |

La rose occidentale, détail. |
|
|
L'orgue
Clicquot. Les célèbres grandes
orgues de Saint-Jacques ont été construites
en 1734 par Louis-Alexandre Clicquot, facteur d'orgues
du roi. Les archives de la paroisse conservent toujours
l'acte original du marché passé entre
la fabrique et le facteur d'orgues. L'instrument commandé
possédait 21 jeux et coûta 3200 livres
à la fabrique. Cette somme devait être
payée en trois fois. D'abord, mille livres le
1er septembre 1734, puis encore mille à la fête
de Pâques 1735 - à la condition toutefois
que l'instrument «raisonne» (terme utilisé
dans le contrat). De son côté, Clicquot
s'engageait à avoir terminé le tout dix-huit
mois plus tard. Le contrat prévoyait de s'en
remettre au jugement d'experts nommés par le
curé de Saint-Jacques et les marguillers de la
fabrique. Si l'orgue était reçu comme
parfait et achevé, le troisième paiement
de 1200 livres serait versé six mois après
cet avis de bonne fin.
La construction commença dans les normes et Clicquot
reçut ses deux premiers paiements. Ce qui veut
dire que, à Pâques 1735, l'instrument «raisonnait».
Mais, en 1738, il n'était toujours pas achevé.
La fabrique, qui ne plaisantait pas, porta l'affaire
en Justice. Clicquot perdit le procès et fut
en plus condamné à en payer les frais.
La construction du buffet se retrouva aussi devant les
tribunaux. Elle avait été confiée
au maître menuisier de Houdan, Robert Lisant.
Mais, outre le paiement contractuel, celui-ci exigea
425 livres supplémentaires parce qu'il avait
dû bâtir un escalier et des colonnes non
prévus au devis. Pour la fabrique, ces éléments
allaient de soi et n'avaient pas à être
inscrits au devis. La Justice donna gain de cause au
menuisier. Ces tracasseries retardèrent la réception
de l'orgue qui n'eut lieu qu'en avril 1739. On se servait
pourtant de l'instrument depuis Pâques 1735...
Le premier organiste, un certain Nicolas Simon, venait
de Picardie. Quelques termes de son contrat méritent
d'être cités : il reçut 200 livres
d'appointement annuel avec exemption de taille et de
capitation, ainsi que la suppression de l'obligation
de loger les gens de guerre. Après lui, trois
autres se succédèrent. On sait que, en
1772, l'organiste en place (un quatrième) s'appelait
Saint-Clerc. Il était marchand mercier et, cette
année-là, reçut 300 livres pour
ses bons services. Fait notable : c'est grâce
à lui que la Révolution épargna
les grandes orgues de Clicquot. Saint-Clerc plaida habilement
que l'orgue était un instrument de valeur et
qu'il fallait le conserver pour la postérité.
Il eut la chance d'être écouté.
Le musicien reprit son poste en 1795, jouant bénévolement.
Ce n'est qu'en 1802 que la fabrique recommença
à le rétribuer. L'organiste assura sa
charge jusqu'à sa mort survenue en 1818. Ensuite,
ce sont deux femmes qui se succédèrent
au poste de titulaire des orgues.
L'orgue subit une première restauration en 1772.
Exécutée par un facteur rouennais, celle-ci
n'eut aucune incidence sur la structure de l'instrument
qui ne fut en rien modifiée. En 1819, madame
Imbaut, l'organiste titulaire, suscita une nouvelle
restauration et en chargea une de ses relations, le
facteur Momigny de Châteaudun. Mais, en 1873,
le contexte musical de l'église se modifia complètement
: le chœur de Saint-Jacques reçut un orgue
de deux claviers et douze jeux répondant au goût
du XIXe siècle. Conséquence : l'orgue
de tribune fut délaissé et, au début
du XXe siècle, il était devenu pratiquement
inutilisable.
En 1931, le curé de l'église, sans doute
chagriné de la décrépitude de l'instrument,
voulut le faire moderniser. Il fit appel au facteur
Jules Boissier de Dijon qui, malheureusement, avait
«la réputation d'avoir massacré
plusieurs orgues historiques», lit-on dans la
note affichée dans l'église. Coup du sort
providentiel, le curé décéda peu
après et les travaux purent être énergiquement
interrompus. Les successeurs à la cure connaissaient
la réputation de Boissier. La situation était
donc gelée. «Les tuyaux restèrent
entassés en vrac sur la tribune», lit-on
encore dans la note.
Après 1945, les Monuments historiques lancèrent
la restauration des vitraux, ce qui conduisit la municipalité
à relancer l'idée de rétablir les
grandes orgues dans leur splendeur passée. On
prit avis, on délibéra. Finalement, la
tâche, qui se révélait ardue, fut
confiée à des connaisseurs : Robert et
Jean Loup Boisseau, facteurs d'orgue à Poitiers,
spécialistes de Clicquot et chargés, entre
autres, de l'entretien des grandes orgues de la cathédrale
Saint-Pierre à Poitiers
et de celles de la cathédrale
Notre-Dame à Paris. Cette restauration suscita
un grand enthousiasme parmi les Houdanais et des souscriptions
furent organisées. L'Administration des Beaux
Arts n'apporta aucune aide. Enfin, en 1972, en présence
de madame Georges Pompidou, le nouvel instrument résonna
comme il l'avait fait au XVIIIe siècle.
Les orgues de Saint-Jacques suscitèrent aussitôt
l'engouement des organistes dans le monde entier. Non
seulement ses qualités avaient été
reconnues comme exceptionnelles dès les années
1750, non seulement l'instrument avait été
construit en réutilisant du matériel issu
de l'orgue Desenclos Carouge, datant de 1667, de la
chapelle de la Charité à Paris, mais les
restaurateurs des années 1960 avaient scrupuleusement
respecté l'authenticité de l'instrument,
refusant de céder à la mode de l'époque
qui voulait qu'on modernisât les orgues de manière
à y jouer les partitions modernes.
Les orgues Clicquot de Saint-Jacques comptent parmi
les orgues les plus anciennes de France. Elles utilisent
une excellente mécanique ancienne qui permet
de réaliser des prouesses inaccessibles aux instruments
modernes. On lit dans la note de l'église : «Houdan
est un des rares endroits où l'on peut exécuter
et entendre la musique d'orgue des 17e et 18e siècles
comme pouvaient le faire les gens qui vivaient à
cette époque. (...) Dans le domaine sonore proprement
dit, l'orgue a gardé le diapason ancien et est
accordé, comme à l'origine, au tempérament
inégal.»
Source : note affichée
dans l'église.
|
|

L'orgue de Cliquot est daté de 1739.
Le buffet d'orgue a été créé par
le menuisier houdanais Robert Lisant. |

«Christ de pitié», tableau d'un auteur anonyme,
XVIIIe siècle ? |
|

La nef de Saint-Jacques-le-Majeur vue du maître-autel. |
Documentation : Panneaux affichés dans
la nef
+ «Houdan, son histoire, ses monuments, sa vie dans le passé»,
édité par le Syndicat d'Initiatives de Houdan, 1982
+ «Les vitraux de Paris, de la Région Parisienne, de
la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais», CORPUS VITREARUM, éditions
du CNRS, 1978
+ site Internet de la paroisse Saint-Jacques. |
|









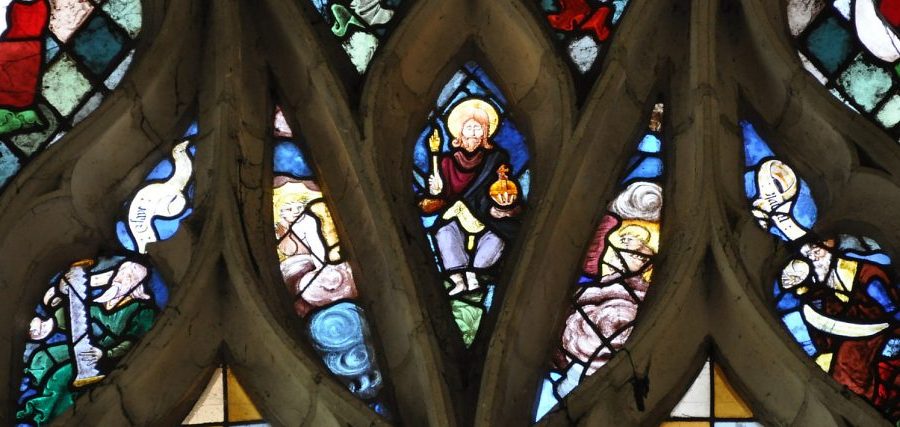










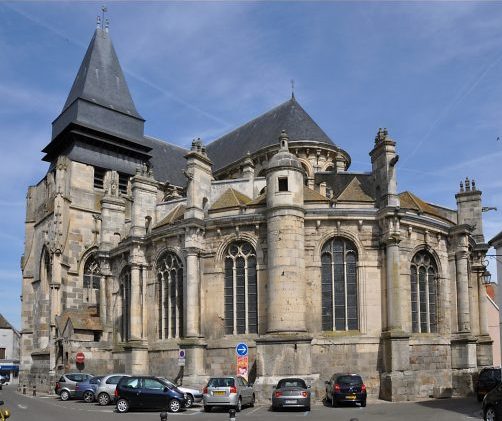











 Partie supérieure du vantail gauche.
Partie supérieure du vantail gauche.
 Le côté nord de l'église. Le transept n'a
pas de de croisillon au nord.
Le côté nord de l'église. Le transept n'a
pas de de croisillon au nord. 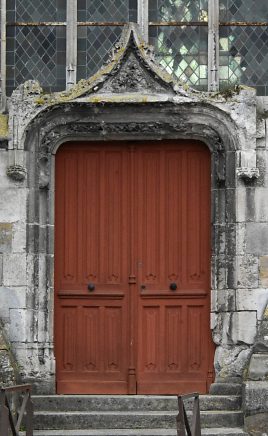 La porte du côté nord comporte voussure et accolade.
La porte du côté nord comporte voussure et accolade.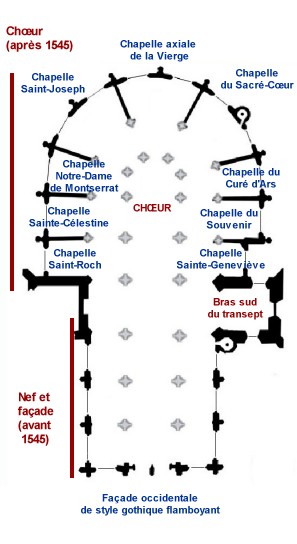




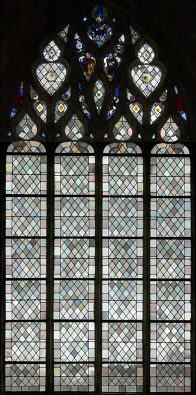
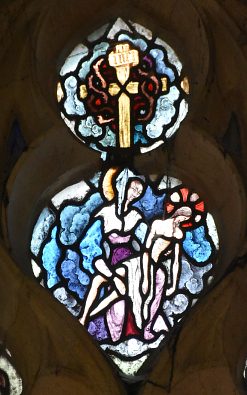
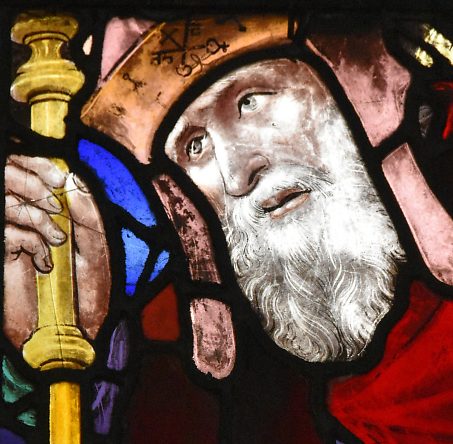
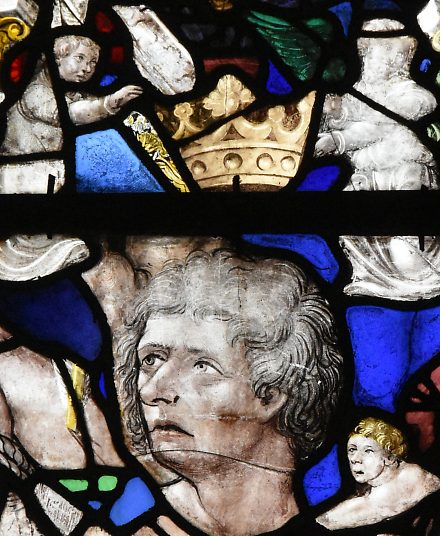







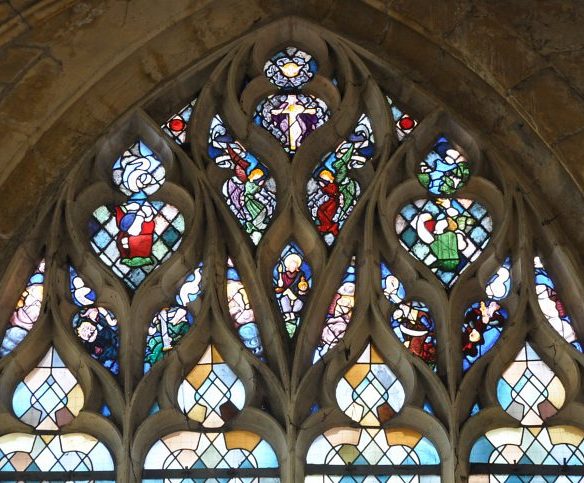
















 Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest
de la croisée.
Un ange tenant un phylactère sur la pile sud-ouest
de la croisée. 











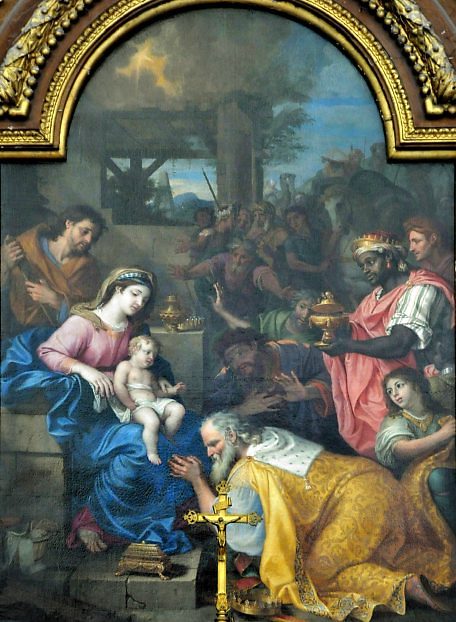




















 Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.
Chapelle rayonnante Sainte-Célestine avec son retable.

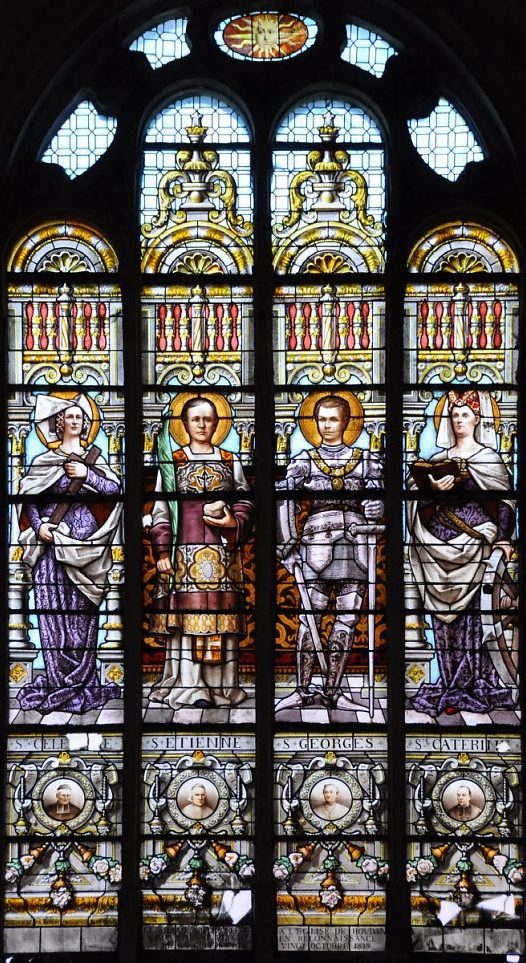



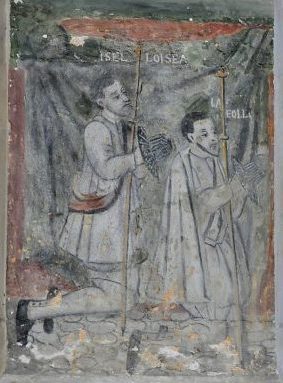 Deux pèlerins en prière dans la chapelle
Deux pèlerins en prière dans la chapelle