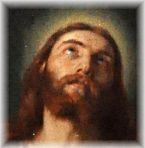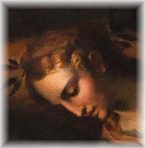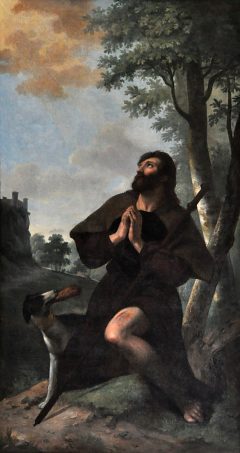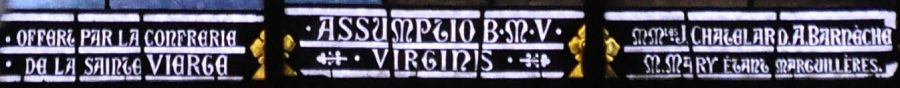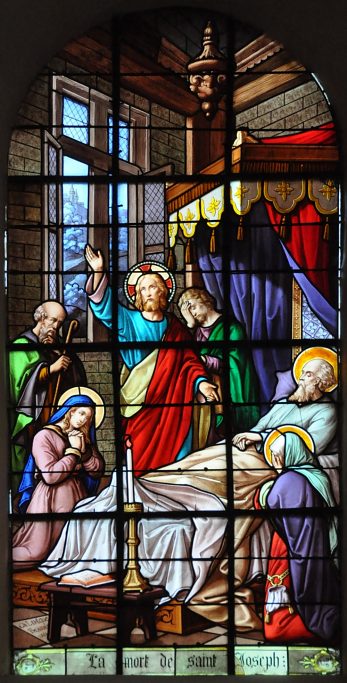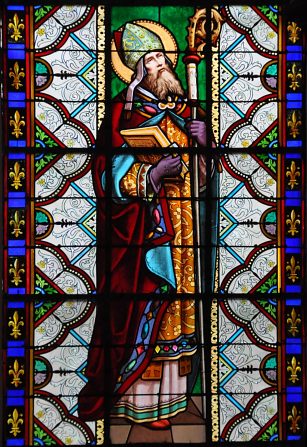|
|
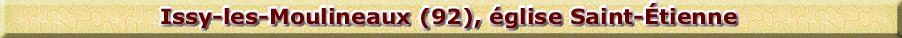 |
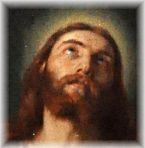 |
Le passé le plus reculé
de l'église d'Issy-les-Moulineaux
est présenté comme une légende : le premier
lieu de culte chrétien dans la commune aurait été
construit à l'emplacement d'un temple païen dédié
à la déesse Isis. Plus sérieusement, c'est
un texte du XIe siècle qui fait pour la première fois
mention d'un édifice cultuel. Selon Alain Erlande dans le
Dictionnaire des églises de France, cet édifice
aurait été agrandi, voire entièrement rebâti
en 1336.
L'église actuelle date de 1634, mais n'a été
bénie qu'en 1661. Elle a grandement souffert de l'artillerie
lors des combats de la Commune en 1871, notamment le clocher. Issy
est en effet une porte d'entrée dans Paris et l'endroit où
l'enceinte est le moins robuste.
L'édifice est de taille moyenne : longueur de 35 mètres
et largeur de 16. Son intérieur est assez simple : trois
vaisseaux séparés par une suite d'arcades. En revanche,
il offre une impressionnante galerie de tableaux
religieux (copies ou originaux), principalement du XIXe siècle.
À noter également que toutes les fenêtres reçoivent
des vitraux
historiés.
|
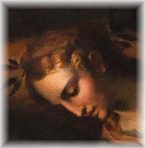 |

La nef vue depuis l'entrée de l'église.
Longueur : 35 mètres ; largeur : 16 mètres. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |
|

L'église Saint-Étienne a été érigée
à partir de 1634 et bénie en 1661. |

Le portail est du XVIIe siècle..
La sculpture du tympan date de la fin du XIXe siècle. |
|
Tympan
de l'ancienne église d'Issy (2/2).
---»» Pour confirmer l'hypothèse du tétramorphe, on
pourra se référer au portail méridional de la cathédrale
Saint-Étienne à Bourges.
Ce portail, daté aux alentours de 1160, offre l'exemple
d'un imposant tétramorphe entourant le Christ, placé
là encore dans une mandorle. On y retrouve l'Homme de
Matthieu et l'aigle de Jean dans la moitié supérieure,
à gauche et à droite, comme sur l'ancien tympan de l'église
Saint-Étienne d'Issy.
|
|
|

Bas-reliefs du XVIIe siècle sur les vantaux de chêne
du portail. |
|
Architecture
extérieure.
Cette architecture est assez banale. L'église
est «orientée» (son chœur est
dirigé vers l'est). Seul le bas-côté
sud est accessible aux piétons. Une partie de
l'édifice, dont le clocher, a dû être
refaite après les combats destructeurs de la
Commune en 1871. «Les flancs, sans grand caractère,
sont faits de moellonage, les cintres des fenêtres
et les contreforts sont seuls de pierres de taille»,
écrit Alain Erlande en 1968 dans Le Dictionnaire
des églises de France.
Le portail central mérite une description. Il
est encadré de deux pilastres cannelés
et surmonté d'un fronton triangulaire abritant
un Chrisme. Le tympan, exécuté à
la fin du XIXe siècle, est marqué des
lettres entrecroisées S et E du
saint dédicataire.
|
|

Tympan de l'ancienne église d'Issy érigée au XIe
siècle. |
|
Tympan
de l'ancienne église d'Issy (1/2).
Le très beau bas-relief, donné ci-dessus,
est exposé dans le bas-côté nord
de l'église. Les historiens le rattachent au
portail de l'église d'Issy bâtie au XIe
siècle et transformée en 1336.
Cette sculpture a été retrouvée
dans le jardin du presbytère en 1849, amputée
de sa partie inférieure. Dans une mandorle entourée
de deux anges, le Christ bénissant trône
en majesté. L'ange de droite est clairement accompagné
d'un oiseau. En revanche, la sculpture au-dessous de
l'ange de gauche est très dégradée.
Que représente donc ce bas-relief dégradé
? En 1936, dans Les églises de France, Paris
et la Seine, l'historien George Outardel, s'aidant
d'un article du Bulletin monumental de 1902 signé
de l'abbé P. Barret sur ce fameux tympan, écrit
: «Sous les pieds des anges ont été
figurés deux oiseaux, dans lesquels il faut peut-être
reconnaître deux aigles ; celui de gauche est
extrêmement mutilé.» En 1968, dans
Le Dictionnaire des églises de France
(Éditions Robert Laffont), Alain Erlande, loin
d'y voir un oiseau, associe celui de gauche à
un ange.
Les présentations plus récentes de ce
tympan franchissent enfin le pas : c'est désormais
le tétramorphe qui est évoqué,
autrement dit les symboles des quatre Évangélistes.
Ainsi procède le Patrimoine des Communes des
Hauts-de-Seine (Flohic Éditions) sorti en
1994.
En effet, la composition du tympan s'y prête :
l'Homme ou l'ange de l'Évangéliste Matthieu
serait à gauche ; l'aigle de Jean est à
droite, tous deux portant des auréoles. Le lion
et le taureau, symboles des Évangélistes
Marc et Luc, devaient vraisemblablement se trouver dans
la partie disparue du bas-relief.
Le style de cette œuvre du XIIe siècle est
roman. C'est l'un des tympans les plus anciens de la
région. On remarquera, dans le gros plan ci-dessous,
«la puissante expressivité du visage du
Christ» comme l'écrit l'article du Patrimoine
des Communes des Hauts-de-Seine (Flohic Éditions,
1994). ---»» Suite 2/2
ci-dessous à gauche.
|
|

Tympan de l'ancienne église d'Issy, détail : le
Christ en majesté bénissant. |
|
| ARCHITECTURE INTÉRIEURE
DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |
|

Élévation nord de la nef avec le bas-côté nord.
Tous les vitraux sont figurés et tous les espaces entre les vitraux
des bas-côtés reçoivent un tableau. |
|
Architecture
intérieure.
L'église présente un vaisseau central divisé
en six travées et bordé de vaisseaux latéraux
au nord et au sud. Une suite de colonnes d'ordre dorique reçoit
les arcades qui séparent ces vaisseaux. Comme la photo
ci-dessus le montre, cette architecture, rigoureuse dans sa
simplicité, de teinte beige clair, conduit l'œil
vers le chœur
que des boiseries sombres maintiennent dans une pénombre
respectueuse.
Au second niveau, une série de fenêtres en plein
cintre éclaire la nef. Celles-ci reçoivent des
vitraux de l'atelier Henri Chabin des années 1890 et
des vitraux
des années 1930 de l'atelier d'Émile Brière
à Levallois. On remarque que ces vitraux sont intelligemment
composés : leurs couleurs, presque translucides (notamment
ceux de l'atelier Brière), ne font pas grand obstacle
à la lumière et, de plus, offrent une bonne
surface de teintes très claires.
La nef est couverte par une voûte de bois et plâtre
en berceau dont les poinçons et les entraits sont apparents.
Les bas-côtés, voûtés en berceau
moins élevé que celui de la nef, présentent
à chaque travée une grande fenêtre où
loge un vitrail figuré du XIXe siècle. Ces bas-côtés
se terminent par une absidiole droite.
|
|

Bénitier
XVe ou XVIe siècle.
|

Les Fonts baptismaux
Seconde moitié du XVIIe siècle.
La vasque provient d'une fontaine du château des
Conti, ancien château à Issy, brûlé
lors de la Commune. |
|
Les
vitraux de l'église Saint-Étienne
(1/2).
Tous les vitraux de l'église sont figurés.
Au moins trois ateliers se partagent les œuvres.
Les plus anciennes sont des créations de
l'atelier parisien Henri Chabin et de l'atelier
Charles Levêque à Beauvais
(vitrail de la mort
de Joseph donné à droite). Elles
remontent les unes et les autres aux années
1880. On notera que les styles des ateliers Chabin
et Levêque sont très proches.
Dans les années 1930, le peintre verrier
Émile Brière, successeur
de son père Eugène à la tête
de l'atelier de Levallois, réalise des
vitraux pour le second niveau de la nef.
Le thème iconographique de toutes ces œuvres
est très classique : la Vie de Jésus
; la Vie de Marie, notamment dans le chœur
avec une Annonciation,
une Assomption
et un Couronnement
de la Vierge.
Ce dernier vitrail s'inspire d'un tableau de Pierre-Paul
Prud'hon illustrant l'Assomption de Marie, actuellement
au musée du Louvre (cliquez sur ce lien
pour l'afficher). L'ouvrage Un patrimoine de
lumière 1830-2000 (Éditions
du patrimoine, 2003) précise que ce tableau
a été commandé en 1816 pour
la chapelle des Tuileries, l'artiste s'étant
lui-même inspiré d'une œuvre
de Nicolas Poussin. «Ce tableau eut un tel
succès lors de son exposition en 1819,
ajoute l'ouvrage, qu'il réussit à
rivaliser de popularité avec les Madone
de Raphaël et l'Immaculée Conception
de Murillo.»
---»» Suite 2:/2
à droite.
|
|
«Le Martyre de
saint Barthélemy» ---»»
Atelier ou copie de José de Ribera, XVIIe siècle.
Objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques. |
|
|

«Le Baptême du Christ»
Vitrail dans le baptistère.
XIXe siècle, atelier inconnu. |

|
|

Élévation nord de la nef et bas-côté nord. |
|

«L'Annonciation»
Tableau de Théophile Adolphe Midy, 1869
d'après Giorgio Vasari.
Objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques. |
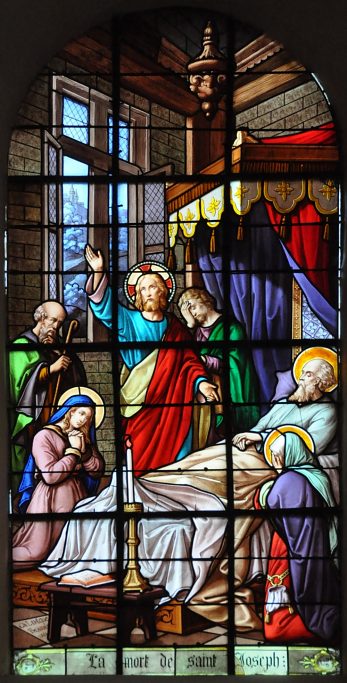
«La Mort de saint Joseph»
Vitrail signé : «Ch. LEVÊque BEAUVAIS 1885» |
|
|
|
| TROIS VITRAUX DES ATELIERS
ÉMILE BRIÈRE À LEVALLOIS (SECOND NIVEAU
DE L'ÉLÉVATION) |
|

«La Flagellation»
Atelier Brière à Levallois, |

«Jésus rencontre sa mère» (station du Chemin de croix).
Atelier Brière à Levallois, 1937. |

«La Résurrection»
Atelier Brière à Levallois, 1935. |

«La Sainte Famille»
Anonyme français d'après Pierre de Cortone.
Milieu du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle. |

«Le Christ au pied de la croix» ou «La Déploration»
Huile sur toile de Michel Marigny (1797-1829). |
|
|
Les
tableaux.
Le visiteur ne peut qu'être étonné
par l'impressionnante succession de tableaux le long
des bas-côtés. Les galeries d'art de ce
genre ne sont en général visibles que
dans les églises importantes et réputées.
Ces tableaux sont des copies ou des originaux. Deux
sont inscrits aux Monuments historiques : L'Annonciation
de Théophile Adolphe Midy (1869) d'après Giorgio Vasari
et Le
Martyre de saint Barthélemy qui serait une copie,
exécutée vers 1628-1630, d'une œuvre de José de Ribeira.
Deux originaux méritent plus qu'un coup d'œil.
D'abord Le
Christ couronné d'épines aussi intitulé
Les
Sept Péchés capitaux bourreaux du Christ, œuvre
de Nicolas Auguste Hesse (1795-1869), auteur de nombreuses
peintures d'églises, prix de Rome en 1818 et
élu à l'Institut en 1863 au fauteuil de
Delacroix. Puis Le
Christ au pied de la croix ou La
Déploration du Christ, une huile sur
toile de Michel Marigny (1797-1829) exposée au Salon
en 1824, acquise par le préfet de la Seine pour l'église
Saint-Vincent-de-Paul à Paris et enfin prêtée à l'église
d'Issy.
Sources : 1) Les Petits
Maîtres de la peinture 1820-1920 aux éditions de
l'Amateur, 2014; 2) Base Palissy.
|
|

«Saint Vincent élevé à la dignité de diacre
par Saint Valère à Saragosse»
Vitrail d'Henri Chabin, Paris. |
|

«Le Songe de Joseph»
Vitrail sans signature.
Joseph apprend par un ange qu'il doit épouser Marie
et prendre soin de l'enfant qu'elle mettra au monde. |

«Saint Fiacre»
Tableau de Jules Henri Véron-Faré, 1872. |
|
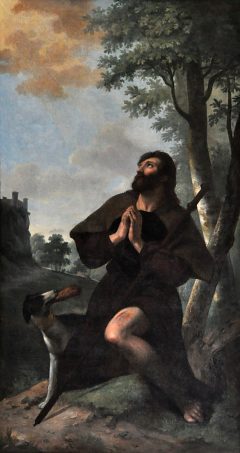
«Saint Roch»
Toile anonyme datée du milieu du XIXe siècle. |

Vue de l'église depuis l'avant-nef et l'entrée du bas-côté nord.
À l'arrière-plan à gauche : l'autel absidial
de la Vierge. |

«Le Christ couronné d'épines»
ou «Les Sept Péchés capitaux bourreaux du Christ», 1839.
Tableau de Nicolas Auguste Hesse (1795-1869). |

«La Pentecôte»
Vitrail non signé (ou atelier Henri Chabin ?) |

«Saint Augustin»
Tableau anonyme d'après Frère André, XVIIIe siècle. |
|
|

«Saint Étienne est nommé diacre par les apôtres»
Vitrail non signé. |

«Saint Étienne avant son martyre»
«Video Coelos Apertos et Jesum»
Formule latine de «Je vois les cieux ouverts et Jésus».
Vitrail non signé. |
|
|
Le
vitrail «Pro Deo Pro Patria».
Ce vitrail, daté de 1920, est une création
de l'atelier beauvaisien de Jules Houille
et de son fils René. Cet atelier s'inscrit
dans la continuité de l'atelier de Charles
Lévêque et Louis Koch, lit-on dans
l'ouvrage Un patrimoine de lumière 1830-2000
(Éditions du patrimoine, 2003).
Le carton du vitrail est dû à M.
Chantrel.
La première guerre mondiale a mis un coup
d'arrêt à la querelle virulente qui
opposait la République et le Clergé
français. Tous s'unirent au sein de l'Union
sacrée proclamée par le Président
Poincaré en 1914. Après la guerre,
de nombreuses familles offrirent aux églises
des vitraux honorant le sacrifice des soldats
au front.
Le vitrail est consacré aux aumôniers
aux armées. La devise Pour Dieu Pour
la Patrie illustre le lien très fort
qui unissait alors la religion catholique et le
devoir patriotique. Au premier plan de la scène,
un poilu, blessé à mort au champ
d'honneur, reçoit l'extrême-onction.
À l'arrière-plan, la cathédrale
Notre-Dame à Reims
dresse sa célèbre architecture que l'artillerie
allemande a pilonnée dès 1914.
L'église Saint-Pierre-Saint-Paul
à Clamart
(92) propose un vitrail
de la Grande Guerre, en style Art déco,
rappelant le souvenir d'un poilu dont le corps
n'a pas pu être retrouvé dans le
chaos du champ de bataille.
|
|
 |
|

«PRO DEO PRO PATRIA»
Vitrail de l'atelier Jules Houille et de son fils René,
Beauvais
1920.
Carton de M. Chantrel.

| «««--- «PRO DEO PRO PATRIA», détail : la cathédrale de Reims. |
|

«L'Ascension»
Vitrail (non signé) dans l'oculus d'un bas-côté. |

«L'Assomption»
Vitrail (non signé) dans l'oculus d'un bas-côté. |
|
|

Le bas-côté nord aboutit à l'autel de la Vierge.
Celui-ci est surmonté du vitrail de l'Assomption
dans l'oculus. |
 |

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail.
Autel de la Vierge. |
|
«««--- «La Présentation du Christ au Temple»
Anonyme français
Seconde moitié du XVIIe siècle.
|
|
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |
|

Le chœur de l'église Saint-Étienne et son retable du XVIIe siècle. |
|
Le chœur
de l'église Saint-Étienne.
Il comprend un retable du XVIIe siècle
bien mis en valeur par les boiseries qui l'entourent et le
tableau du Christ en croix. La pénombre dégagée
par tous ces éléments sombres crée un fort contraste
avec la couleur très claire qui recouvre les murs et
les voûtes de la nef et des bas-côtés. La sacralité du sanctuaire est ainsi soulignée.
Deux statues de saint
Étienne et de saint Vincent sont disposées de part et
d'autre de la toile du Christ en croix. Quatre autres statues
surplombent les boiseries. De gauche à droite : sainte Geneviève,
la Vierge, saint
Jean et saint Denys.
Toutes les statues sont anciennes (XVIIe ou XVIIIe siècle)
à l'exception de celles de saint Augustin et de sainte Geneviève
qui sont du XIXe siècle.
Les vitraux du chœur sont de l'atelier parisien Henri Chabin
(années 1890). Les parties hautes des vitraux illustrent des
épisodes de la Vie de la Vierge : Annonciation,
Assomption
et Couronnement.
Saint Jacques de Compostelle et saint
Augustin prennent place dans la partie basse des deux
vitraux latéraux.
|
|

Un ange adorateur sur le retable, XVIIe siècle, détail. |

Statue de la Vierge au pied de la croix
XVIIe - XVIIIe siècle. |

«Le Christ en croix», 1873.
Copie par Amélie Beaury-Saurel d'une toile de Pierre-Paul
Rubens. |
|

Statue de saint Étienne
XVIIIe siècle. |

Statue de saint Jean apôtre.
XVIIe-XVIIIe siècle. |
«L'Assomption» ---»»»
Vitrail dans le chœur
Atelier Henri Chabin, 1891
d'après une toile de Pierre-Paul Prud'hon. |
|
|

«Le Couronnement de la Vierge»
Vitrail central du chœur.
Atelier Henri Chabin, vers 1891. |
 |
|
|

Un ange adorateur sur le retable, XVIIe siècle. |

«L'Annonciation» dans un vitrail du chœur.
Atelier Henri Chabin, vers 1891. |
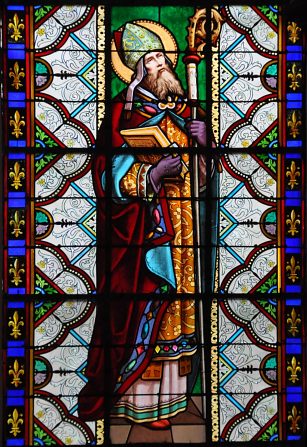
Saint Augustin au bas d'un vitrail du chœur.
Atelier Henri Chabin. |
|
Les
«marguillières».
Ce terme semble rare. Selon l'ouvrage Un patrimoine
de lumière 1830-2000 (Éditions du
patrimoine, 2003), la première fois que ce mot
apparaît dans un vitrail de l'Île-de-France,
c'est en 1846 au bas d'une verrière créée
par l'atelier Fialex au Mans pour l'église Saint-Romain
à Sèvres
(92).
L'ouvrage indique que, chaque année dans cette
commune, trois marguillières étaient élues
pour seconder la présidente de la confrérie
des enfants de Marie. Parmi les trois noms indiqués
sur la verrière,
l'une, Victoire Gérard, est couturière
; une autre, Virginie Gauthier, est la fille d'un marguillier
«ayant la qualité de propriétaire».
À Issy-les-Moulineaux,
comme l'indique l'extrait donné ci-dessous, les
marguillières sont membres de la Confrérie
de la Sainte Vierge. On remarquera la faute d'orthographe
puisqu'il est écrit : «marguillères» sans le second «i».
|
|

Le Père céleste dans la Couronnement de la Vierge. |
|
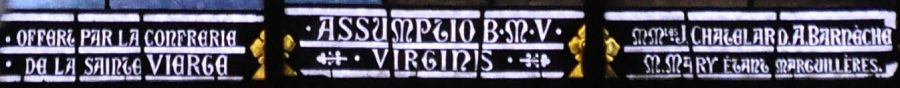
Inscription du vitrail de l'Assomption.
On lit dans la partie droite :
MMes J. CHATELARD. A.BARDÈCHE
M.MARY ÉTART MAGUILLÈRES.
BMV signifie Beata Maria Virgo (Bienheureuse Vierge
Marie) |

La nef vue depuis le chœur.
L'orgue de tribune a été entièrement restauré,
pièce par pièce, en 2011-2013. |
Documentation : «Le Patrimoine des Communes
des Hauts-de-Seine», Flohic Éditions, 1994
+ «Un patrimoine de lumière, 1830-2000», Éditions du patrimoine, 2003
+ «Dictionnaire des églises de France», Éditions Robert Laffont, 1968
+ «Les églises de France, Paris et la Seine», Letouzey et Ané, Paris 1936
+ Documents affichés dans l'église. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|