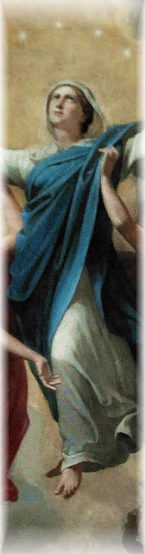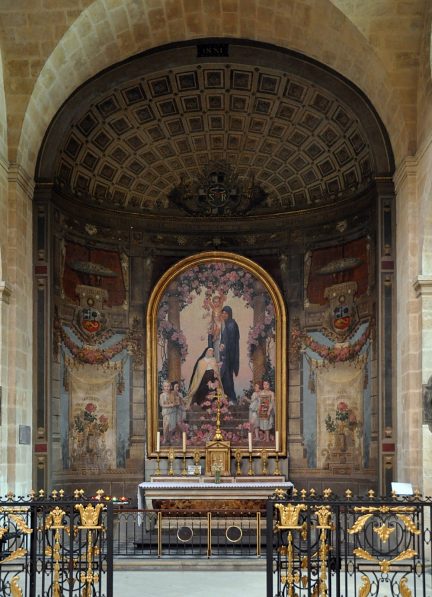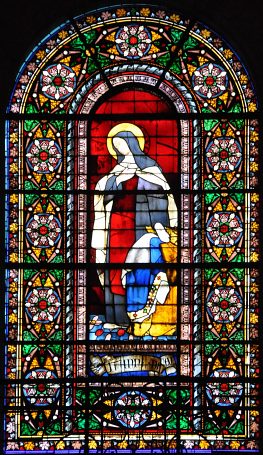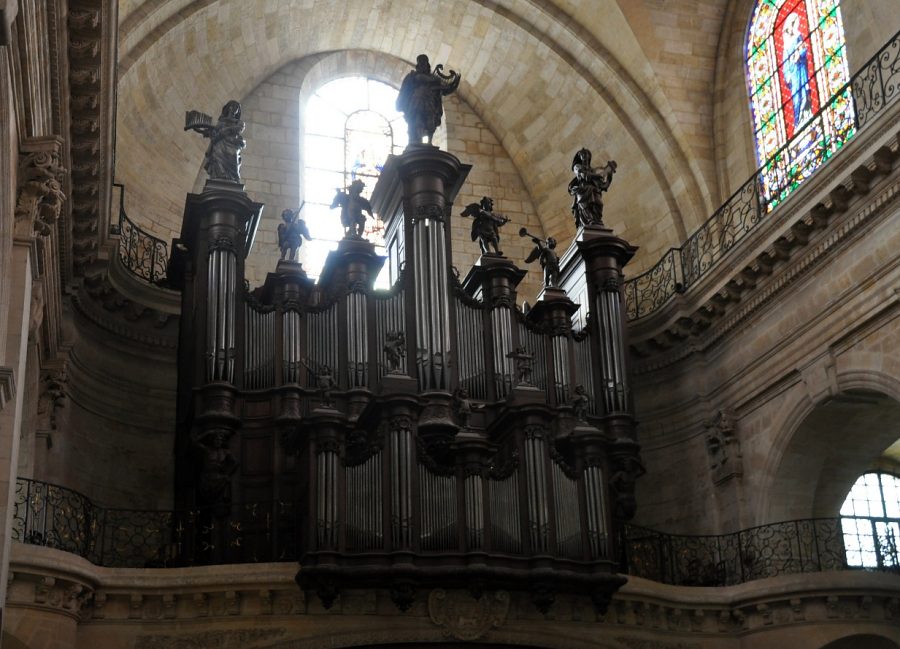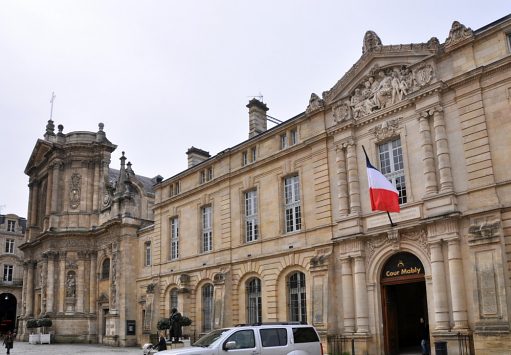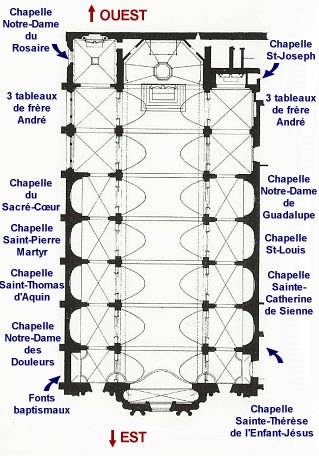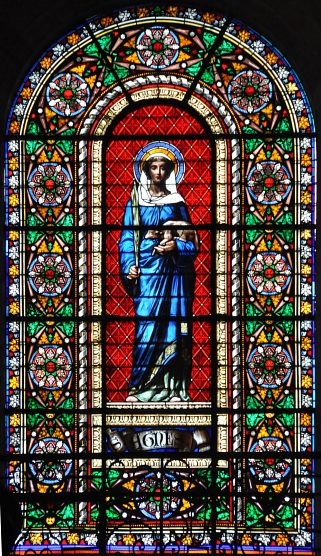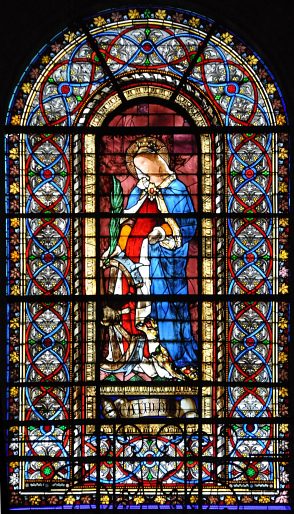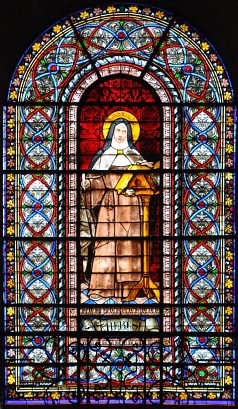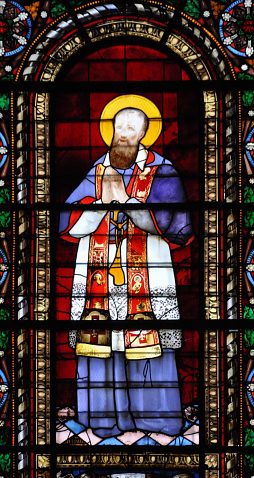|
|
 |
 |
Au XVIIe siècle, après
plusieurs révoltes, Bordeaux
subit la défiance du pouvoir royal. Louis XIV veut museler
cette ville frondeuse, jadis anglaise, en faisant agrandir le château
Tompette car ses canons intimident les insurgés potentiels.
Conséquence : la rancœur sourd dans le cœur des
Bordelais et s'oppose à l'érection de monuments civils
et d'églises. Le clergé séculier, proche du
peuple, souffre avec lui et «a assez à faire pour lutter
péniblement contre l'effondrement continu de ses églises
ogivales», écrit l'abbé Brun dans Les églises
de Bordeaux (1953). Seuls les Jésuites et les ordres
réguliers continuent à construire : les Jésuites,
avec l'église Saint-Paul ; les Chartreux, avec Saint-Bruno
; les Dominicains (aussi appelés Jacobins), avec Notre-Dame.
L'histoire de Notre-Dame commence au XIIIe siècle. Un couvent dominicain
et sa chapelle s'étalent sur un vaste terrain (allées de
Tourny actuelles). En 1678, Louis XIV fait raser le quartier pour
agrandir le château Trompette et dégager ses abords. Un vaste
lot de trois cents maisons est détruit ; avec lui, tout le
couvent des Jacobins. Toutefois, ceux-ci reçoivent l'autorisation
de bâtir un nouveau monastère sur un terrain qu'ils
possèdent non loin. Et qu'ils agrandissent par l'achat d'un
jardin et d'une maison à démolir (où va d'ailleurs
s'élever la nouvelle chapelle).
Les travaux commencent en 1684. L'architecte choisi par les moines
est celui du roi en Guyenne, Pierre Michel, seigneur du Plessy
qui a bien sûr la confiance des Pouvoirs publics. Dans Bordeaux
à l'âge classique (1997), l'historien Christian
Taillard souligne l'importance de ce choix : l'endroit est sensible
et le ministère de la Guerre veille ; il faut donc rassurer
l'Autorité...
À la mort de du Plessy, en 1693, le père dominicain
Jean Fontaine assure le suivi des travaux. En 1700, Louis XIV autorise
la construction de la voûte, mais à la condition que
son épaisseur soit légère : il faut empêcher
l'installation d'un canon qui viendrait renforcer une action séditieuse
(voire tirer sur le château Trompette !). La voûte ne
dépassera donc pas un demi-pied, soit environ 16 centimètres.
La coupole du chœur
s'effondrera partiellement en 1971, sans doute, aux yeux des architectes,
à cause de cette faible épaisseur.
Le financement des travaux est assuré par l'indemnité
due aux religieux pour la destruction de leur précédent
couvent.
Le clocher (presque invisible depuis la place du Chapelet où
donne la façade)
est terminé en 1696 ; l'église, dédicacée
à saint Dominique, est achevée en 1707. La décoration
se fait plus lentement. Pour orner les retables des chapelles, le
frère dominicain Jean
André peint une série de toiles illustrant l'histoire
de l'Ordre.
Pendant la Révolution, l'église devient temple de la Raison, puis
temple de l'Être suprême. Rendue au culte après
le Concordat de 1802, elle fait office, pour un temps, de cathédrale
car Saint-André,
trop dégradée, est impropre au culte. L'église,
devenue, paroissiale, est désormais placée sous le
patronage de Notre-Dame.
En 1874, le peintre Romain Cazes réalisera, pour le chœur,
trois grandes toiles illustrant la vie de la Vierge et, en 1875,
dans la chapelle
Notre-Dame du Rosaire, une Vierge
Marie portée par les anges.
L'Église Notre-Dame, par son architecture et son ornementation,
incarne l'expression religieuse du XVIIIe siècle. Elle demeure,
confie l'abbé Brun, l'édifice religieux le plus intéressant
de l'époque classique.
En 1861, Charles Marionneau, dans sa Description des œuvres
d'art des édifices de Bordeaux, l'oppose à Sainte-Croix.
Elles sont toutes deux des œuvres monastiques, mais «peignent,
écrit-il, des civilisations bien distinctes» : à
Sainte-Croix,
un style un peu brutal, des lignes sévères où
«des sujets, empruntés aux passions les plus vives,
terrifiaient le peuple et devaient paralyser quelquefois le bras
démolisseur d'un Normand» ; à Notre-Dame, avec
ses élégants angelots qui voltigent sur la façade
et sur le tabernacle de l'autel, tout est «grâce mondaine».
Contrairement à l'habitude, le chœur
de l'église Notre-Dame pointe vers l'ouest : l'église
est dite «occidentée». Les termes nord et sud
de cette page correspondent aux orientations liturgiques.
|
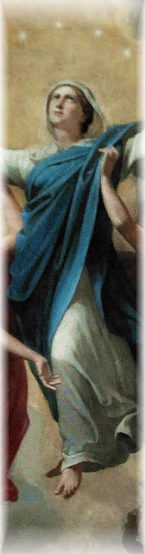 |

La nef et le chœur de Notre-Dame vus depuis l'entrée de l'église.
Avec une nef de 15 mètres de large, l'église a pu faire
office de cathédrale, juste après la Révolution,
quand Saint-André
était impropre au culte. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME |
|

La façade baroque de l'église Notre-Dame comprend deux niveaux
avec statues au premier et médaillons au second. |

Bas-relief d'angelots
terminant l'aile gauche. |
|
La
façade de l'église Notre-Dame (1/2).
L'église Notre-Dame est engoncée dans
les immeubles environnants. Son clocher est pratiquement
invisible ; ses côtés nord et sud ainsi
que son chevet sont inaccessibles. Il reste la façade
qui, en compensation, offre une magnifique ornementation
baroque.
Pour Christian Taillard dans Bordeaux à l'âge
classique (1997), la source d'inspiration de la
façade est claire : il s'agit de celle de la
chapelle du noviciat des jésuites à Paris
(aujourd'hui église
Saint-Paul-Saint-Louis) dans ses deuxième
et troisième niveaux. «Le résultat
est d'une qualité très supérieure
à ce qui avait été jusque-là
réalisé au XVIIe siècle à
Bordeaux»,
écrit l'historien.
Dans la partie centrale, les statues et les colonnes
corinthiennes répondent au bas-relief au-dessus
de la porte. Cette partie se prolonge, au nord et au
sud, par des élévations latérales
en recul, moins ornées. Celles-ci sont terminées
par d'étonnants trophées peuplés
d'angelots (ci-contre, à gauche et à droite)
manipulant les instruments de la liturgie. Ces bas-reliefs
sont peut-être inspirés, écrit l'abbé
Brun dans Les églises de Bordeaux (1953),
des trophées de la chapelle
royale de Versailles.
Fidèle à l'art baroque, la jonction entre
la partie centrale et les ailes se fait par des murs
courbes abritant chacun une niche où loge une
statue. Une large frise
de rinceaux enrichis d'animaux fantastiques surmonte
le premier niveau. Au-dessus d'un entablement en saillie
se dresse le second niveau, limité à la
partie centrale, qui prolonge l'ornementation du premier
dans ses parties planes et courbes.
Le fronton surbaissé qui termine l'élévation
reçoit une très sobre croix (voir la façade
vue de face).
Aux statues et au bas-relief du premier niveau s'associent
les médaillons du second. Le bas-relief au-dessus
de la porte, dû à Jean Berquin, date de
la construction de l'église. Saint Dominique
(ci-dessous) reçoit, des mains de la Vierge,
le chapelet du Rosaire qui prend ici la forme d'une
brassée de roses. À noter que Catherine
de Sienne (qui se joint généralement à
saint Dominique) est absente.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|

Bas-relief au-dessus de la porte : la remise à saint Dominique
du Rosaire (qui prend ici la forme d'une brassée de roses).
Œuvre de Jean Berquin, XVIIe siècle. |
|

Bas-relief d'angelots
terminant l'aile droite. |

Le second niveau de la façade avec son vitrail central dédié
à la Vierge (vitrail donné plus
bas).
Médaillons : à gauche, le pape dominicain saint Pie
V ; à droite, le pape dominicain Benoît XI. |

Saint Augustin
par Edmond Prévost, 1865. |

Saint Jérôme
par Edmond Prévost, 1865. |

La façade baroque de l'église Notre-Dame
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
À l'origine, les niches du premier niveau étaient
vides.
Des statues n'y ont été placées qu'en 1865. |
|

Une grande frise à rinceaux sépare les deux niveaux
de la façade.
On y trouve des animaux fantastiques. |
|
La
façade de l'église Notre-Dame (2/2).
---»» Les statues du premier niveau ne sont
venues habiter les niches - laissées vides jusque-là
- qu'au XIXe siècle : en 1865, le cardinal-archevêque
Donnet demanda au sculpteur bordelais Edmond Prévôt
de ciseler quatre docteurs de l'Église. On a
ainsi de gauche à droite : saint Thomas d'Aquin
; saint
Augustin ; saint
Jérôme et saint Grégoire le
Grand.
Au second niveau, les grandes figures de l'Ordre des
dominicains ornent les médaillons. De gauche
à droite : saint Albert le Grand, évêque
de Ratisbonne ; saint Pie V ; Benoît XI et saint
Antonin, archevêque de Florence. La partie centrale
de ce second niveau reçoit une grande fenêtre
encadrée par une épaisse moulure à
feuillage. Son vitrail de 1860, signé de l'atelier
Hurtel et représentant la Vierge Marie, ne mérite
guère d'éloges (voir plus
bas).
Cette façade baroque dégage une unité
très harmonieuse et produit une impression de
mouvement ascensionnel (sans doute dû à
la seule élévation, au second niveau,
de la partie centrale).
|
|
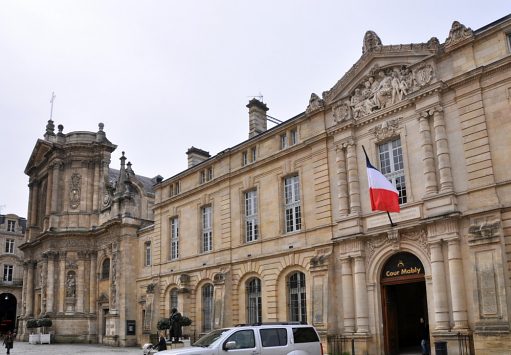
À droite de l'église se trouve la Chambre régionale
des Comptes d'Aquitaine (dans la cour Mably).
Ces bâtiments sont ceux de l'ancien couvent des Dominicains.
Jusque vers 1950, ils abritaient le musée lapidaire et
la Bibliothèque municipale.
En 1886, cette façade a été entièrement
remaniée. |

La porte qui ouvre vers la cour Mably est surmontée d'un
imposant bas-relief (XIXe siècle). |
|
| LA NEF DE L'ÉGLISE
NOTRE-DAME |
|

Élévation de la nef. Ici le côté sud (au
sens liturgique).
Les piliers, grossis de pilastres corinthiens, sont surmontés
d'une large corniche, puis de grandes fenêtres logées
dans les lunettes de la voûte.
La forte lumière apparente qui vient des hautes fenêtres
éclaire la nef. En revanche, les chapelles latérales
sont plongées dans la pénombre (voir le commentaire
sur les vitraux). |

Les balcons de l'avant-nef.
À l'arrière-plan, la chapelle
des Fonts. |

Saint Dominique,
fondateur de l'Ordre des Dominicains en 1216.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |
|
|
Architecture
intérieure.
Longue de 60 mètres, l'église Notre-Dame
illustre à la perfection l'art baroque du XVIIIe
siècle dans son aspect religieux.
L'élévation est à deux niveaux.
En partie basse, les sept arcades sont séparées
par des piliers où sont plaqués des pilastres
corinthiens. En partie haute, des grandes fenêtres
logent dans des lunettes qui percent une voûte
en berceau.
Les deux niveaux de l'élévation sont reliés
par une corniche saillante décorée de
denticules. Elle est surmontée d'un garde-corps
de style Louis XIV qui vient sécuriser une galerie
de circulation.
La nef est bordée d'une suite de chapelles latérales
que les grandes fenêtres, enrichies de vitraux
figurés assez opaques, laissent dans la pénombre.
Notons que l'avant-nef (photo ci-contre à gauche)
est coiffée d'une suite d'élégants
balcons disposés sur des arcs en surplomb et
sur des trompes. Ces balcons prolongent la tribune d'orgue.
|
|

Le Christ en croix au-dessus du banc d'œuvre, détail. |
|
Les
vitraux de l'église (1/3).
Comme les photos de cette page le montrent, les quatorze
vitraux de la nef, au second niveau de l'élévation,
sont extrêmement colorés et opaques.
Illustrant des saints et des martyrs, ce sont des créations
du peintre verrier Émile Thibaud de Clermont-Ferrand
en 1848-1849.
En 1861, Charles Marionneau dans sa Description des
œuvres d'art des édifices de Bordeaux
est très négatif à leur sujet.
Il écrit : «Quatorze fenêtres cintrées
éclairent ou pour mieux dire devraient éclairer
la nef
et les chapelles des bas-côtés, car des
vitraux fortement colorés, que n'admettait pas
le style de l'église, ont tellement assombri
cet édifice, le privent tellement de lumière,
que plusieurs tableaux très remarquables, qui
décorent les chapelles latérales, sont
aujourd'hui complètement annihilés.»
Comment se présentaient les vitraux avant Émile
Thibaud ? Il faut croire qu'ils suivaient les règles
de l'art baroque, c'est-à-dire du verre blanc
orné d'une frange dorée à rinceaux
comme le sont ceux de l'église baroque Saint-Roch
à Paris.
Marionneau ajoute qu'il «repousse» ces vitraux
«comme ayant altéré l'unité
d'un monument dont la construction et l'ameublement
avaient été raisonnés jusque dans
les moindres détails, et qui nous offraient un
type complet de l'architecture religieuse au XVIIIe
siècle.»
---»» Suite 2/3
plus bas.
|
|
|
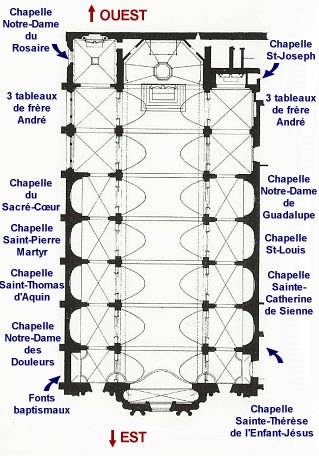
Plan de l'église Notre-Dame. |
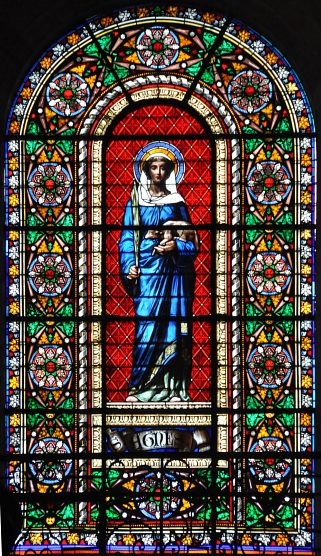
Sainte Agnès.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |
|
|
La
chaire à prêcher.
La chaire de Notre-Dame est regardée comme l'une
des plus belles de Bordeaux.
Datée de 1743, elle est antérieure de
dix ans à celle de la basilique
Saint-Michel qui lui ressemble beaucoup. Ses panneaux
galbés en marbre rouge dans une structure en
acajou ne sont pas enrichis de têtes d'angelots
comme à Saint-Michel.
Pour l'abbé Brun (Les églises de Bordeaux,
1953), cette sobriété la rend plus noble.
En revanche, ce même abbé n'apprécie
pas l'«énorme» abat-voix
qui semble «écraser» la chaire. Illustrant
l'Assomption de Marie, cette sculpture de 1806 est due
au ciseau du sculpteur piémontais Fioranzo Bonino.
Le précédent abat-voix, écrit Charles
Marionneau dans sa Description des œuvres d'art
des édifices de Bordeaux, représentait
saint Thomas d'Aquin. Il a été brisé
à la Révolution. Il ne s'est pas trouvé
à l'époque, explique-t-il, un paroissien
assez subtil pour détourner le fanatisme destructeur
des révolutionnaires et l'empêcher de malfaire.
(La chaire
de Saint-Michel, quant à elle, a subsisté.)
|
|
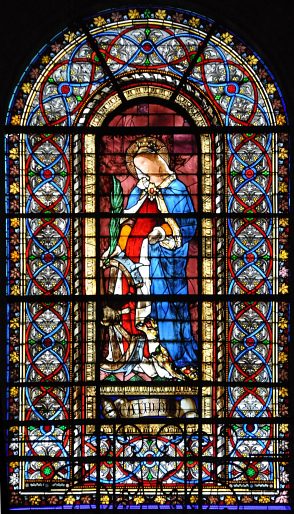
Sainte Catherine d'Alexandrie.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |
|
Les
vitraux de l'église (2/3).
---»» L'historien conclut son analyse avec
une ironie désabusée : «En enlevant
les vitraux incolores que l'architecte dominicain avait
pensé devoir apposer pour ne point nuire aux
œuvres du frère J. André, écrit-il,
et pour se conformer au style de l'époque, le
Conseil de fabrique a suivi l'exemple des anciennes
administrations paroissiales qui faisaient murer des
croisées absidales pour ériger un autel
d'ordre dorique ou corinthien dans une église
du XIIIe siècle.»
En 1953, l'abbé Brun ressasse la même antienne.
Il écrit à son tour : «Il est bien
fâcheux qu'au XIXe siècle, une fabrique
bien intentionnée, mais de peu de goût,
ait dénaturé l'intérieur de l'église
et l'ait plongée dans une déplaisante
obscurité en bouchant les quatorze fenêtres
par des vitraux lourdement colorés (1847-1848).»
---»» Suite 3/3
à droite.
|
|

Saint Vincent de Paul.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |
|

Sainte Élisabeth de Hongrie, détail.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

La chaire à prêcher (1743) est l'une des plus belles de Bordeaux. |

L'abat-voix de la chaire à prêcher représente
l'Assomption de Marie.
Datée de 1806, elle est due au ciseau de Fioranzo
Bonino. |

Saint Louis, détail.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |
|
|
Les
vitraux de l'église (3/3).
---»» Comme Charles Marionneau un siècle
plus tôt, l'abbé Brun leur reproche d'avoir
«rompu l'unité de style sans ajouter à
son cachet.»
On constatera que l'encadrement, très fourni,
des vitraux d'Émile Thibault est de deux types
: des entrelacs rouges, bleus ou blancs, ou bien des
rondelles florales sur un fond à dominante verte.
L'église parisienne de Saint-Vincent
de Paul, construite au XIXe siècle, souffre de cette
même pénombre, mais à un point plus prononcé encore.
|
|

Le banc d'œuvre et les chapelles
latérales sud. |
|
Le
banc d'œuvre.
Il a été réalisé en
1839 sur les dessins de l'architecte bordelais
Pierre-Alexandre Poitevin Le panneau central abrite
un bas-relief de l'Assomption.
Rappelons que le banc d'œuvre est un ensemble
de sièges situés en face de la chaire
et réservés aux membres de la Fabrique
de l'église. Ces paroissiens (appelés
marguilliers), souvent fortunés, gèrent
le temporel de l'église, alors que le Chapitre,
qui rassemble des chanoines, gère l'aspect
religieux (comme l'ordonnance des messes). Colbert
était marguillier de l'église Saint-Germain-des-Prés
à Paris.
|

|
L'Assomption dans le banc
d'œuvre. ---»»»
|
|
 |
|
|
| LES CHAPELLES
LATÉRALES NORD |
|

La chapelle des Fonts et sa magnifique grille.
La grille a été réalisée sous le
Second Empire par le maître serrurier
bordelais Faget. La Fabrique exigea qu'elle fût réalisée à l'imitation
des grilles
du chœur. |

Chapelle nord Saint-Thomas d'Aquin. |
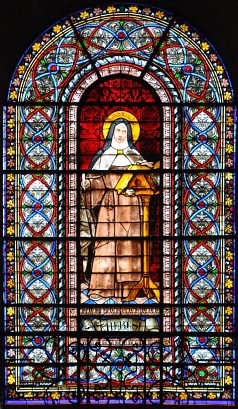
Sainte Thérèse d'Avila.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |

Chapelle nord Saint-Pierre-Martyr.
Le tableau de frère André (1718) représente
Pierre de Vérone, prieur dominicain
du couvent de San Marco à Florence, assassiné
sur la route de Côme à Milan en 1252. |

Sainte Cécile, détail.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |
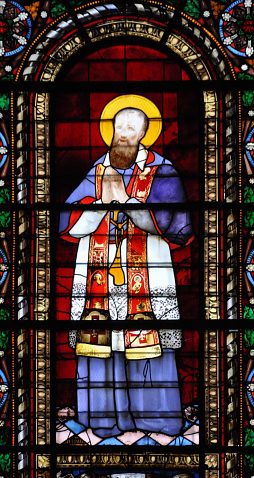
Saint François de Sales, détail.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849. |
|
|

Le Baptême du Christ.
Ronde-bosse au-dessus du portique de la chapelle des Fonts. |

«Les Pèlerins d'Emmaüs»
Daté de 1834, c'est un tableau de Pierre-Alexandre Poitevin,
ancien
architecte de la ville et ancien fabricien de la paroisse. |

«Saint Thomas d'Aquin»
Tableau du frère André, 1714.
Chapelle Saint-Thomas d'Aquin. |

Chapelle nord du Sacré-Cœur. |

«Le Sacré-Cœur»
Tableau de Vincenzo Pasqualoni, vers 1876.
Chapelle
du Sacré-Cœur.
Au premier plan, l'ange de la Charité donne l'Hostie
à un pèlerin agenouillé sur un globe terrestre,
tandis que l'ange de la Foi lui présente le calice. |
|
| LES CHAPELLES
LATÉRALES SUD |
|
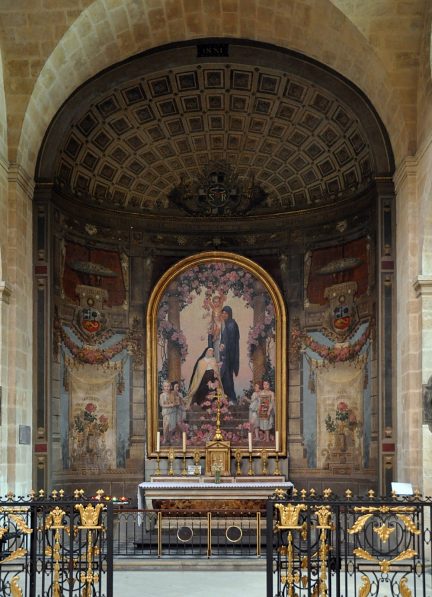
Chapelle latérale sud Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.
Cette chapelle a été créée en 1925, après la canonisation de la carmélite
de Lisieux. |

«Sainte-Thérèse au pied de la Vierge»
Tableau, dans le style Art déco, de François-Maurice Roganneau,
1928.
Roganneau a été Premier grand prix de Rome en 1928.
Chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. |

Chapelle latérale sud Sainte-Catherine de Sienne.
Le tableau de frère André représente la sainte
recevant les stigmates de la Passion. |

Chapelle latérale sud Saint-Louis.
Cette chapelle a reçu sa dédicace
sous le règne de Louis XVIII. |

«Saint Louis adorant la sainte Couronne», 1815.
Tableau de Raymond Quinsac-Monvoisin (1790-1870). |
|
«««---
«Sainte Catherine de Sienne recevant les stigmates».
Ce tableau de frère André date de 1716.
Charles Marionneau en donne l'explication. Après
la messe, Catherine de Sienne s'est retirée dans
un coin de la salle pour y faire son action de grâce.
Trouvant cet acte de piété bien long,
son confesseur et plusieurs de ses compagnes s'approchent
d'elle et la trouvent ravie, la face prosternée
contre terre. Catherine s'agenouille alors et étend
ses bras en forme de croix, sa face jetant un «admirable
éclat». Restant longtemps dans cette posture,
elle finit par tomber évanouie. Revenue à
elle, elle déclare à son confesseur qu'elle
porte sur son corps les sacrés stigmates de Jésus-Christ.
Source : Vies et actions
mémorables des saintes et bienheureuses filles
du premier et tiers-ordre du glorieux patriarche saint
Dominique par le révérend-père
Jean de Saint-Marc, 1636 (cité par Charles Marionneau).
|
|
|

«La Vierge»
Tableau de Louis Eugène Philadelphe Martineau, 1861.
Chapelle Notre-Dame de Guadalupe. |

La chapelle sud Notre-Dame de Guadalupe
a été créée sous le Second Empire.
On notera les remarquables peintures en trompe-l'œil. |
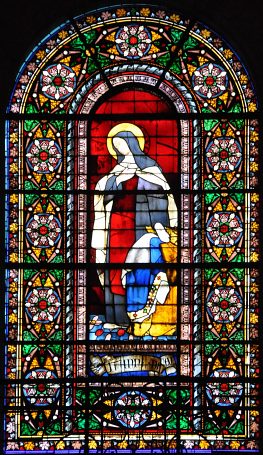
Sainte Jeanne de France.
Vitrail de l'atelier Émile Thibaud, 1848-1849.
|
| SIX TABLEAUX DE
FRÈRE ANDRÉ |
|

Six tableaux de frère André sont situés dans
l'avant-chœur
(trois au nord et trois au sud).
|
|
Frère
André (ou Jean-André).
Ce moine dominicain (1662-1753) est un peintre peu connu.
Entré dans l'Ordre à 17 ans, son talent fut
rapidement reconnu puisque, pour parfaire son art, il fut
envoyé en Italie et reçut, à Rome, les
leçons de Carlo Maratta. À son retour en France,
il devint l'élève du peintre Jean-Baptiste Jouvenet.
«L'humilité religieuse du frère André
a nui beaucoup à sa réputation», écrit
Charles Marionneau en 1861 dans sa Description des œuvres
d'art qui décorent les édifices publics de Bordeaux.
Et il ajoute : «il refusa d'entrer à l'Académie,
sa modestie lui faisant croire que cette dignité ne
concorderait pas avec son état.»
Ses tableaux - toujours à thème religieux -
ont été en grande partie détruits à
la Révolution. L'église Notre-Dame en possède
onze, ce qui est exceptionnel. Neuf sont visibles dans les
bas-côtés.
Frère André n'est certes pas un artiste de premier
plan, mais son œuvre «décèle pourtant,
écrit l'abbé Brun en 1953 dans Les église
de Bordeaux, une main habile, un métier honnête,
un véritable sens de la composition.»
L'examen des tableaux conduit Charles Marionneau à
distinguer deux périodes dans son style : la première,
de 1712 à 1718, quand il subit l'influence des écoles
italiennes au travers de Carlo Maratta ; la seconde, plus
proche de l'école française, englobe les œuvres
exécutées de 1720 à 1751, trahissant
sa proximité avec Jean-Baptiste Jouvenet et Charles
de la Fosse.
Le frère André s'éteint à Paris
en 1753 à l'âge de 91 ans. Il aurait, dit-on,
peint jusqu'aux derniers instants de sa vie.
Les six tableaux regroupés ici (et dont la photo ci-contre
donne une idée de la taille) se trouvent dans les bas-côtés
nord et sud, juste avant les deux chapelles absidiales. Les
autres toiles ornent les chapelles latérales.
|
|

«Sainte Rose de Lima recevant l'Enfant-Jésus»
Tableau de frère André, 1734.
Rose de Lima fut la première sainte du Nouveau Monde et devint
la patronne des jardiniers. |

«Saint Dominique reçoit le Rosaire de l'Enfant-Jésus»
Tableau de frère André, 1712. |

«Sainte Rose de Lima recevant l'Enfant-Jésus»,
détail : la Vierge.
Tableau de frère André, 1734. |
|
«Saint
Pie V : vision de Lépante» de frère
André.
En 1861, à propos de ce tableau, Charles Marionneau,
dans sa Description des œuvres d'art des édifices
de Bordeaux, cite un extrait de la Vie des hommes
illustres de l'ordre de saint Dominique écrite
par le père Touron. On donne ici cet extrait
complet :
«Les anciens auteurs de la vie de ce saint pape
nous apprennent que le jour même de la bataille
[Lépante, le 7 octobre 1571] et la nuit précédente,
il redoubla la ferveur de ses prières pour implorer
les secours du ciel, et commanda qu'on fît la
même chose dans toute la ville, particulièrement
dans l'église de la Minerve, --»»
|
|
|

«Saint Pie V : vision de la victoire de Lépante»
Tableau de frère André, 1733. |

«Saint Pie V : vision de la victoire de Lépante»,
détail.
Tableau de frère André 1733. |
|
---»» où
les fidèles s'assemblaient pour la solennité
du Rosaire ; et que dans le temps du combat, pendant
qu'il traitait de quelques affaires dans son consistoire,
il quitta brusquement les cardinaux, ouvrit la fenêtre,
y demeura quelque temps les yeux élevés
vers le ciel ; et qu'ayant ensuite fermé la fenêtre,
il dit à quelques cardinaux qu'il ne s'agissait
plus de parler d'affaires, mais de rendre grâces
à Dieu pour la victoire qu'il venait d'accorder
aux chrétiens.
«Peu de jours après, un courrier arrivait
à Rome, confirmant la victoire que Pie V avait
annoncée par inspiration divine.»
|
|
|

«L'Annonciation»
Tableau de frère André, 1735. |

«L'Annonciation», détail.
Tableau de frère André, 1735. |

L'avant-chœur et
l'entrée dans le bas-côté sud
(direction prise au sens liturgique).
La série d'œils-de-bœuf a pour effet d'alléger,
de façon très heureuse, la structure de l'édifice,
en
particulier celle des larges bas-côtés. |

«Saint Hyacinthe traversant les eaux du Dniepr»
Tableau de frère André, 1731. |

«Saint Raymond de Pénafort traversant la Méditerranée»
Tableau de frère André, 1732. |
| LE CHŒUR
ET LES DEUX CHAPELLES ABSIDIALES NORD ET SUD |
|

Le chœur baroque et coloré de l'église Notre-Dame est
éclairé
par l'oculus situé en haut de la voûte qui surmonte le
chœur (voir la photo du
haut).
À l'abside, trois toiles de Roman Cazes, datées de 1874
illustrent la vie de la Vierge :
La Présentation au temple ; la
Vierge au pied de la croix ; la
Visitation. |
|
Le
chœur de l'église Notre-Dame.
Le chœur représente le point d'orgue artistique
de l'église. Trois tableaux de Romain Cazes,
datés de 1874, illustrant la Vie de la Vierge,
surplombent une boiserie en courbe d'où se détache,
en avant-plan, un très bel autel réalisé
en 1751 par le sculpteur avignonnais Jean-Baptiste
II Péru. (Son oncle était dominicain
dans la cité pontificale.) L'autel est en marbre
blanc veiné et contient des incrustations de
jaspe de Sicile. Ce maître-autel est regardé
comme l'une des œuvres les plus remarquables de
l'art chrétien du XVIIIe siècle, lit-on
dans le livret sur l'église rédigé
par la paroisse.
Notons que l'abbé Brun, en 1953 dans Les Églises
de Bordeaux, ne donne aucun nom d'artiste ayant
créé cet autel. Avant lui, Charles Marionneau,
en 1861, dans sa Description des œuvres d'art
des édifices de Bordeaux, ne cite nullement
Jean-Baptiste II Péru. Il donne simplement les
noms gravés en différents endroits de
l'œuvre ou qui sont lisibles sur des petites plaques
fixées sur le marbre. On lit ainsi : «Joseph
Besserie et Caldaguez pour la partie purement décorative,
et Antoine Coudert pour la statuaire», écrit
Charles Marionneau. Il s'agit vraisemblablement, souligne
Christian Taillard en 1997 dans Bordeaux à
l'âge classique, des exécutants et
non des concepteurs.
Sur l'autel, deux anges adorateurs, agenouillés
et priant les mains jointes, entourent un groupe d'angelots
qui égrènent un rosaire. «Ils sont
assemblés, écrit l'abbé Brun, avec
un art de la composition vraiment exquis, qui a toute
la délicatesse d'un Boucher ou d'un Fragonard.»
Cet aspect profane dans le sanctuaire d'une chapelle
dominicaine n'a rien d'étonnant. Ce n'est autre,
rappelle Charles Marionneau, que l'expression, «d'une
façon bien vraie», de l'esprit religieux
du XVIIIe siècle à une époque où
règne «en maîtresse absolue, l'école
pompeuse et mythologique des Coustou.»
En 1997, Christian Taillard est plus critique. «Ce
groupe de chérubins, écrit-il, évoque
les amours mutins et insoucieux de Boucher et exprime
une sensibilité religieuse gaie mais bien superficielle.»
Il y voit l'expression d'une «religion de boudoir
des abbés de cour». C'est là, ajoute-t-il,
l'un des deux pôles de la sensibilité religieuse
du XVIIIe siècle, l'autre pôle étant
plus sérieux et sincère.
L'autel de messe (que l'on voit au centre juste derrière
la balustrade qui sert d'autel de communion) est une
ancienne crédence exécutée par
le sculpteur Lamargue en 1837 sur un dessin de l'architecte
Pierre-Alexandre Poitevin.
Au nord et au sud, le chœur est clôturé
par les magnifiques grilles
en fer forgé du maître serrurier bordelais
Jean Moreau. Elles furent achevées en
1781. Charles Marionneau, nous apprend que ces portes
étaient autrefois placées parallèlement
au maître-autel et qu'elles séparaient
le sanctuaire et le chœur des moines. Chacun des
deux portiques est surmonté d'une ronde-bosse
en tôle de fer dorée à l'or fin.
Ces rondes-bosses illustrent l'Ascension
et l'Assomption.
Sur les vantaux, des médaillons ovales sont ornés,
en bas-relief, des évangélistes et de
leurs symboles.
La haute voûte qui surmonte le chœur inonde
de lumière ce bel ensemble baroque grâce
à un oculus placé à son sommet
(voir la photo plus
haut).
|
|

Une élégante ronde-bosse d'angelots, à
la façon de Boucher
et de Fragonard, surmonte le tabernacle du maître-autel. |

L'Assomption de la Vierge surmonte la grille qui ferme le chœur
à gauche. |

«Déposition de croix»
Tableau de Romain Cazes, 1874, à l'abside. |

L'Ascension du Christ surmonte la grille qui ferme le chœur
à droite. |
|
Chapelle
Notre-Dame du Rosaire.
Située à gauche du chœur,
c'est la chapelle absidiale nord au sens liturgique
et sud au sens géographique.
La brochure Église Notre-Dame, Bordeaux
réalisée par la Paroisse indique que cette
chapelle a reçu, en 1885, un nouveau décor
dû en grande partie aux frères Bonnet.
La photo ci-contre à droite en donne un aperçu.
Les anges au-dessus de la niche (ci-dessous) sont l'œuvre
du sculpteur Louis Fournier.
À droite, entre deux revêtements muraux
à dominante rouge, le peintre Romain Cazes a
réalisé en 1875 une Assomption
de la Vierge soutenue par les anges. Huit curés
de la paroisse Notre-Dame ont été inhumés
dans cette chapelle entre 1814 et 1961.
|
|

Statue de la Vierge à l'Enfant.
Chapelle absidiale Notre-Dame du Rosaire. |

«La Vierge portée par les anges»
Tableau de Romain Cazes, 1875. |
|

Le maître-autel en marbre blanc
est l'œuvre de Jean-Baptiste II Péru, 1751.
Au premier plan, l'autel de messe est une ancienne crédence
datée de 1837. |

Deux magnifiques grilles clôturent le chœur au nord et
au sud. Ici, la grille nord (au sens liturgique).
Œuvres du maître serrurier bordelais Jean Moreau
(1781). |

L'Évangéliste Marc et son lion
dans un médaillon de la grille nord.
Œuvre de Jean Moreau, 1781. |

Un ange adorateur sur le maître-autel. |

«La Visitation»
Tableau de Romain Cazes, 1874, à l'abside. |

Le chœur et la grille de clôture à gauche.
Le maître-autel et l'autel de messe sont ici bien distincts. |

La chapelle absidiale nord est dédiée à
Notre-Dame du Rosaire.
Sur le mur, à droite, le tableau de Romain Cazes : La
Vierge portée par les anges. |

La chapelle absidiale sud est dédiée à
saint Joseph. |
|
Chapelle
Saint-Joseph.
C'est la chapelle absidiale située à droite
du chœur.
Elle a été restaurée en 1832.
Dans sa main droite, Joseph tient la règle des
charpentiers ; dans sa main gauche, le lys de l'époux.
L'intrados (difficilement visible) comprend une scène
de la mort de Joseph.
Dans le tympan du retable, le Père céleste
(photo ci-dessous), posant sa main gauche sur l'univers,
donne, de sa main droite, la lumière au monde.
|
|

Tympan du retable de la chapelle saint-Joseph
Le Père céleste bénissant (ou donnant la
lumière au monde).
Sa main gauche est posée sur un globe symbolisant l'univers.
|
|
|
|
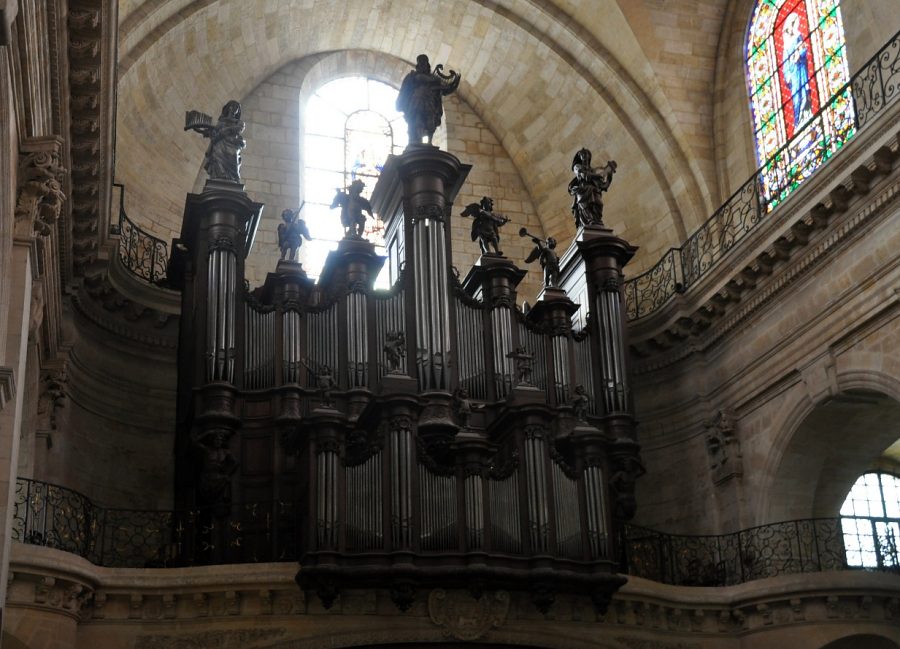
L'orgue de tribune du facteur Schmit (1781) a été reconstruite
par la maison Pesce au début des années 1980.
La tribune se prolonge au nord et au sud par d'élégants
balcons. |
|
L'orgue
de tribune (1/2).
Dès l'église Notre-Dame achevée,
on y place un orgue construit en 1663 par Jean Haou
(ou Haon). L'instrument vient de la chapelle de l'ancien
couvent des Dominicains, rasée, sur ordre de
Louis XIV, avec trois cents maisons pour faire place
nette devant le Château Trompette.
En 1781, le chapitre décide de faire édifier
un nouvel orgue. Un facteur d'orgue itinérant,
un certain Schmit, d'origine allemande, est choisi pour
créer l'instrument qui suivra les règles
les plus modernes.
Le buffet, quant à lui, est conçu et réalisé
par l'atelier de menuiserie et de sculpture que les
Frères Prêcheurs entretenaient dans le
couvent. On a donc l'habitude d'attribuer cette œuvre
au frère Dominique Durel, responsable de l'atelier
à l'époque.
Le roi David, jouant de la harpe, est entouré
de sainte Cécile, patronne des musiciens, et
vraisemblablement de Polymnie, la muse des hymnes sacrés.
Des angelots musiciens se tiennent au sommet de toutes
les autres tourelles. Le chef d'orchestre est un petit
ange dressé sur la tourelle centrale du positif.
Il tient à la main la partition et la baguette
du chef.
---»» Suite 2/2
à droite.
|
|

Polymnie (?) jouant de la lyre
sur la tourelle droite. |

Saint-Cécile
sur la tourelle gauche. |
|

Le roi David sur la tourelle centrale de l'orgue. |

Deux atlantes identiques
soutiennent les tourelles latérales. |
|
L'orgue
de tribune (2/2).
---»» À la Révolution, l'église,
devenue temple de la Raison, puis temple de l'Être
suprême, est utilisée pour les festivités.
L'orgue ne subit aucun dommage.
Différents travaux et ajouts seront réalisés
tout au long du XIXe siècle, mais ils respecteront
tous l'orgue de Schmit.
Au début du XXe siècle, la maison Puget
modifie l'étendue des claviers. Entre 1958 et
1969, le facteur Beuchet-Debierre procède à
une reconstruction majeure : l'orgue s'oriente désormais
vers le style néoclassique.
En 1971, la voûte du chœur
s'effondre partiellement. L'église sera fermée
pendant dix ans. C'est à cette occasion que la
maison Pesce reconstruira l'orgue, mais conservera la
majorité de la tuyauterie existante.
Source : Église
Notre-Dame Bordeaux édité par l'association
Les Amis d'Ars et Fides Bordeaux
|
|
|

Les angelots musiciens sur le buffet de l'orgue.
Au premier plan (sommet de la tourelle centrale du positif), un petit
ange tient dans ses mains la partition et la baguette.
Tous ces personnages ont été ciselés par l'atelier
de menuiserie et de sculpture du couvent des Dominicains au XVIIIe
siècle. |

Sainte Cécile et des angelots musiciens sur le buffet de l'orgue. |

Angelot souffleur de trompette. |

Angelot jouant du violon. |
|

Le vitrail de la façade est consacré à
la Vierge.
Atelier Hutrel, 1860. |
|
Le
vitrail de la façade.
Ce vitrail, daté de 1860, est postérieur
à tous ceux créés par l'atelier
Émile Thibaud (dans les années 1848-1849).
Conformément à la dédicace de l'église
depuis 1802, il est consacré à la Vierge.
On ne peut pas dire que le cartonnier se soit inspiré
d'une madone de Raphaël ! Qui a bien pu servir
de modèle ? Il est rare de trouver un visage
de Marie d'où toute beauté est absente.
Situé derrière l'orgue, il faut examiner
le vitrail avec attention pour percevoir vraiment les
traits de la Vierge.
|
|
|

La nef de l'église Notre-Dame vue depuis le chœur. |
Documentation : «Église Notre-Dame,
Bordeaux», brochure éditée par la Paroisse (Père
Jean Rouet et membres de l'Accueil)
+ «Les églises de Bordeaux» de l'abbé Pierre Brun, éditions
Delmas, 1953
+ «Bordeaux à l'âge classique» de
Christian Taillard, éditions Mollat, 1997
+ «Description des œuvres d'art qui décorent les édifices publics
de Bordeaux» de Charles Marionneau, 1861. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|