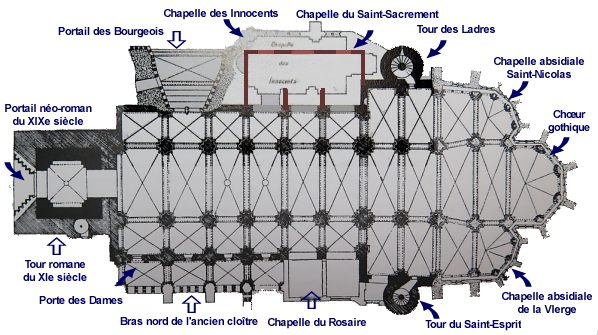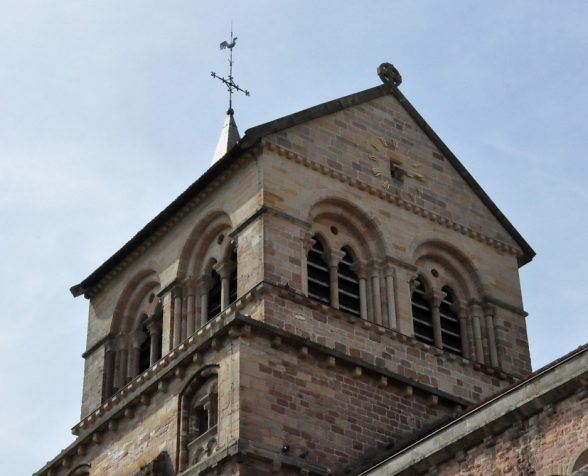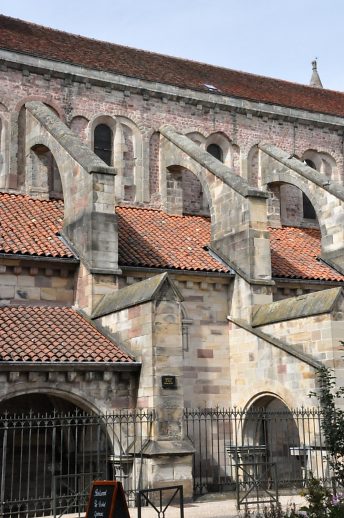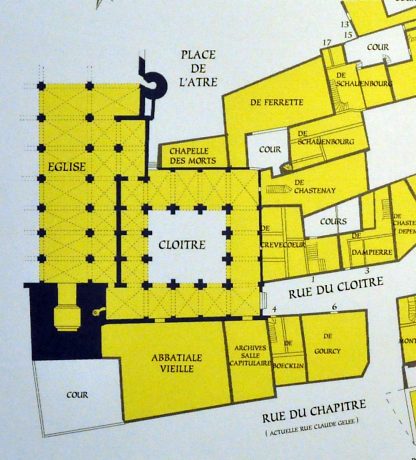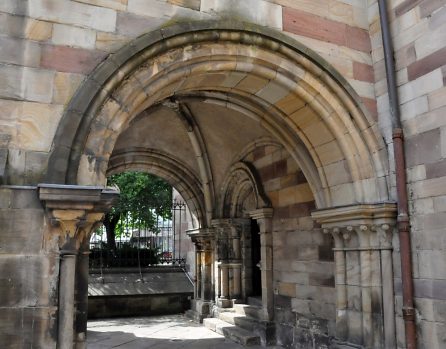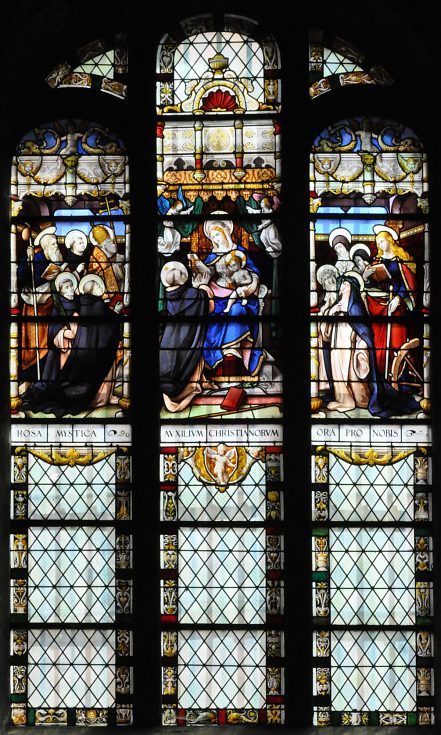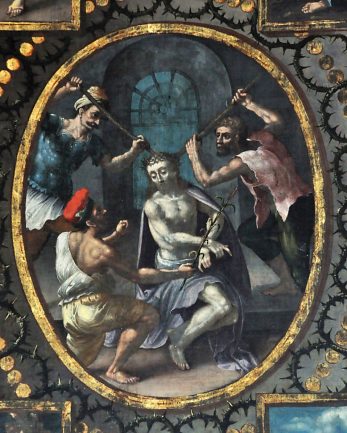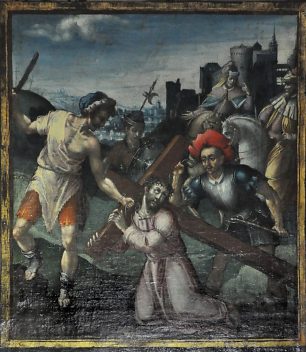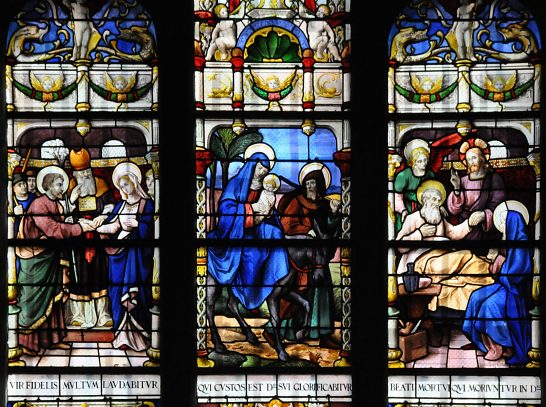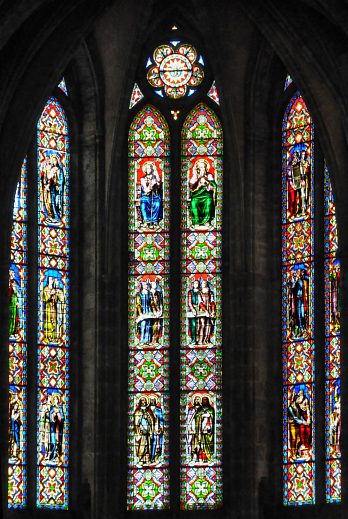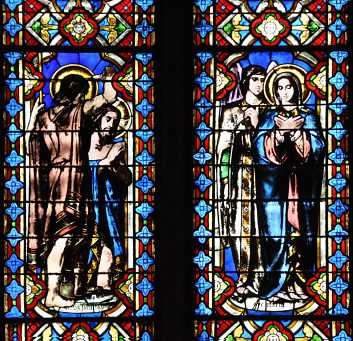|
|
 |
 |
L'histoire de la ville d'Épinal
commence par un château. Érigé au Xe siècle
sur instruction de l'évêque de Metz, Thierry Ier de
Hamelant (964-984), l'édifice dominait la route reliant Metz
à Bâle. À la fin de ce même siècle,
l'évêque fonda, en contrebas de la motte castrale,
un monastère et une église pour le desservir. Vers
983, il fit don des reliques de saint Goëry. L'église
assura alors une double fonction : abbatiale dédiée
à saint Goëry ; paroissiale dédiée à
saint Maurice. Adalbéron, qui succéda à Thierry
à l'évêché de Metz, établit des
clercs dans l'église, puis les remplaça par des moniales,
suivant la règle bénédictine. Saint Goëry
ayant la réputation de soigner le Mal
des Ardents, l'église devint un lieu de pèlerinage
et se révela bientôt trop petite. On bâtit donc
un nouvel édifice qui fut consacré par le pape Léon
IX aux alentours de 1050. Fait habituel à cette époque,
le monastère attirait les femmes de la noblesse... qui entendirent
prendre leurs libertés avec la règle, tout comme dans
le monastère voisin de Remiremont. Bientôt, il n'y
eut plus ni vœux, ni vie commune. Les chanoinesses gardaient
leurs biens personnels, touchaient les revenus du chapitre, habitaient
des maisons particulières et pouvaient même se marier.
Et bien sûr, seules les jeunes filles nobles pouvaient intégrer
le monastère. Lors des offices, les chanoinesses se tenaient
dans des stalles autour de l'autel dédié à
saint Goëry.
Au XIIIe siècle, Épinal
était devenue un bourg prospère grâce au pèlerinage
et aux marchés de la ville. Elle commerçait avec la
Bourgogne et tirait profit des foires de Champagne. (Épinal
comptera 2000 habitants à la fin du Moyen Âge.) La
cité était devenue quasiment indépendante de
l'évêque de Metz. Les bourgeois, conscients de leurs
statuts, firent reconstruire l'église : le style roman fut
transformé en style gothique primitif. C'est peu ou prou
l'édifice que nous voyons aujourd'hui. C'est aussi à
cette époque que l'évêque de Toul, Conrad, voulut
obliger les moniales à suivre la règle bénédictine.
Offusquées, elles en appelèrent au pape en 1294 et
obtinrent gain de cause. Si l'on en croit le vide des sources, rien
ne vint plus troubler l'église et son monastère jusqu'à
la Révolution, qui changea tout. En 1790, le chapitre des
chanoinesses fut supprimé. Par la suite, l'édifice
devint entièrement paroissial.
L'église Saint-Maurice date du XIIIe siècle,
avec néanmoins quelques parties du XIe siècle, comme
la tour occidentale
et l'ossature de la nef.
Elle possède un trait architectural intéressant :
celui de la transition du roman au gothique. On y voit les
deux éléments : arcs en plein cintre et arcs brisés,
petites fenêtres dans la nef et hautes baies gothiques dans
le chœur
et les absidioles,
sans oublier les chapiteaux inspirés par le roman ou le gothique.
Au XIXe siècle, le conservateur du Musée
d'Épinal, Jules Laurent, usa de son influence pour faire
classer Saint-Maurice, dès 1846, sur la liste des Monuments
historiques. À la suite de quoi, le bâtiment subit
d'importants travaux de restauration de 1846 à 1848. La construction
d'un portail néo-roman
à la façade ouest de la tour date de cette époque.
En 1865, la chapelle des Innocents, bâtie au XVIe siècle,
est démolie, remplacée par la chapelle
du Saint-Sacrement. En 1870, ce sont les maisons accolées
au chevet qui
sont détruites et remplacées par une suite de sacristies.
D'autres travaux suivent à la fin du XIXe siècle (clocher,
quasi-réfection du côté
sud après démolition des maisons qui s'y appuyaient,
enfin restauration du portail
des Bourgeois).
En 1933, l'église Saint-Maurice est érigée
en basilique romaine mineure par le pape Pie XI.
|
 |

Vue de la nef et du chœur depuis l'entrée. |

Le chevet de la basilique et le côté nord avec
sa tourelle, dite tour des Ladres érigée au XIIe
siècle..
Les tourelles nord et sud abritent chacune un escalier qui permet,
depuis le transept, d'accéder aux tribunes. |

Plan d'Épinal en 1626 au Musée du Chapitre : l'église
Saint-Maurice au milieu des maisons.
Des habitations sont accolées au soubassement du chevet.
Elles seront remplacées par une suite de sacristies au
XIXe siècle. |
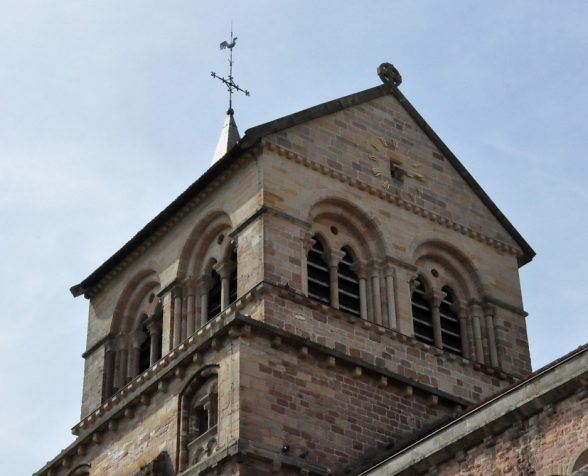
Un beffroi du XIIIe siècle coiffe la tour occidentale
du XIe siècle.
Le clocheton, dont on ne voit que le sommet avec la croix et
la girouette, est très récent (année 1991). |
|

Le clocher du XIe siècle et le portail néo-roman
des années 1840. |

Plan d'Épinal en 1626 au Musée du Chapitre. |

Construit pour venir à bout des problèmes d'humidité
dans la nef,
le portail néo-roman a été ajouté
à la tour dans les années 1840. |

Le Christ Juge au fronton du portail néo-roman du XIXe
siècle. |
|
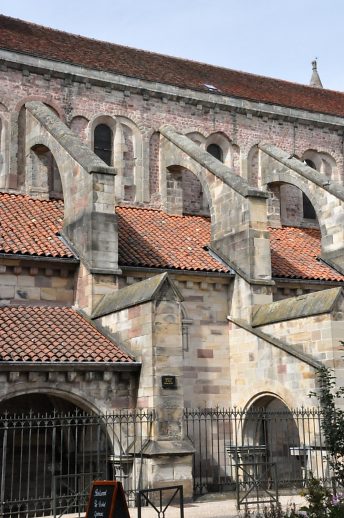
Élévations et arcs-boutants sur le côté
sud.
On remarque, sur le mur gouttereau, les fenêtres romanes
bouchées.
Le côté sud a été refait quasiment
à neuf dans les années 1890. |
À DROITE ---»»»
Au premier niveau : le chemin de ronde dans la partie
haute de la tour.
Au-dessus, le clocher roman. |
|
|
|
Architecture
externe 1/2. Avec ses deux grandes tourelles
nord et sud, la basilique Saint-Maurice, de 68 mètres
de long, possède une apparence très contrastée
et pleine de relief. Une tour très massive, à
plan carré, s'élève à l'ouest.
Elle sera percée en 1846 d'un portail néo-roman
dans le but louable de lutter contre l'humidité
de l'église. Mais, de l'avis des architectes-historiens,
ce portail, œuvre de Jules Laurent, défigure
cette impressionnante tour-beffroi du XIe siècle.
En dehors de la tour, les traces de l'édifice
du XIe siècle sont d'ailleurs bien visibles sur
les murs gouttereaux, au troisième niveau de
la nef : ce sont les fenêtres romanes bouchées
telles qu'on les voit sur la photo ci-contre.
Au XIIIe siècle, selon l'historienne Marie-Claire
Burnand (Lorraine gothique aux éditions
Picard, 1989) la tour primitive a été
recouverte d'une épaisse maçonnerie extérieure.
Elle est donc constituée de deux structures juxtaposées
: l'une romane, l'autre gothique. Dans Lorraine gothique
aux éditions Faton en 2013, l'historienne Suzanne
Braun donne une autre version. Elle écrit que,
à la suite d'un sondage fait dans la tour en
1984, «il est établi que l'actuelle tour
de façade du XIIIe siècle a été
construite en enrobant d'un mur intérieur et
extérieur la tour du XIe siècle, qui en
forme donc le noyau (...)». Ce qui ne semble guère
compatible avec ce qu'elle écrit quelques lignes
plus loin en reprenant à son compte les deux
structures juxtaposées romane et gothique. Un
peu de rigueur ou de précision dans l'information
aurait été bienvenue.
Le chemin de ronde, couvert et ajouré de petites
baies géminées, servait d'abri aux soldats.
Ces baies, de style roman tardif, sont particulièrement
élégantes : un arc en anse de panier vient
coiffer, dans une allure de rouleau protecteur, les
arcs en plein cintre qui dominent les baies géminées.
À cette tour le XIIIe siècle ajouta le
clocher, situé en retrait du chemin de ronde.
Il a été restauré au XIXe siècle.
Enfin, le clocheton, coiffé d'une grande croix,
a été posé en 1991. Le clocher
a ainsi retrouvé son aspect du XVIIe siècle.
Suite ---»»
2/2.
|
|
 |
|

Le chevet et, au soubassement, les sacristies construites au
XIXe siècle.
Sur le côté sud, la tourelle du Saint-Esprit, érigée
au XIIIe siècle, termine le bras sud du transept. |
|
Architecture
externe 2/2. Le portail
des Bourgeois constitue le second élément
architectural majeur de la basilique. Ou du moins ce
qu'il en reste après les mutilations systématiques
entreprises à la Révolution... Il est
daté du troisième quart du XIIIe siècle.
C'était par là que les laïcs rentraient
dans l'église, les chanoinesses se réservant
la belle porte
des Dames sur le côté sud. Il n'y avait
pas de portail occidental.
Un regard sur la photo en gros plan ci-dessous donne
une idée des destructions. Les tympans ont été
martelés méticuleusement et les statues-colonnes
entièrement détruites. Ce saccage «officiel»
fut l'œuvre, en 1793, de deux citoyens envoyés
par la commune. Le mystère demeure pour la statue
de la Vierge à l'Enfant sur le trumeau. Étant
entière, on a longtemps pensé qu'elle
remontait au XIXe siècle. Mais un nettoyage de
1980 a fait apparaître une polychromie, peut-être
ancienne. Comment a-t-elle échappé aux
destructions ? Un paroissien l'a-t-il cachée
chez lui en attendant des jours meilleurs comme pour
la statue de Notre-Dame
la Brune à l'abbatiale Saint-Philibert de
Tournus
?
Ce portail s'ouvre par un arc en plein cintre. Il est
voûté d'ogives ; trois tympans se dégagent
entre leurs retombées. En l'absence de statues,
la frise à feuillages variés est le seul
ornement qui reste dans les élévations
de côté. Des seize statues médiévales
détruites, on a retrouvé dans le parc
du château cinq têtes en pierre et des fragments
de corps. Sur les trois tympans, la trace du contour
des groupes permet une restitution iconographique. Au
centre, le groupe des apôtres, la Dormition de
la Vierge et son Couronnement. Sur le tympan ouest,
on arrive à repérer une trace de la croix
de la Crucifixion. À l'est, rien n'est visible.
Mais une comparaison avec le portail Notre-Dame de la
cathédrale de Metz conduit à penser qu'il
pouvait y avoir un Jugement dernier.
Enfin, si vous visitez Épinal,
ne manquez pas la belle porte
des Dames sur le côté sud et son atmosphère
romane. C'est par là que les chanoinesses, qui
ont eu la haute main sur l'église pendant quatre
siècles, entraient dans l'avant-nef depuis le
cloître.
Sources : 1) Lorraine
gothique de Marie-Claire Burnand, éditions
Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne
Braun, éditions Faton, 2013.
|
|
|

Ces arcades du côté sud faisaient jadis partie
intégrante du cloître. |
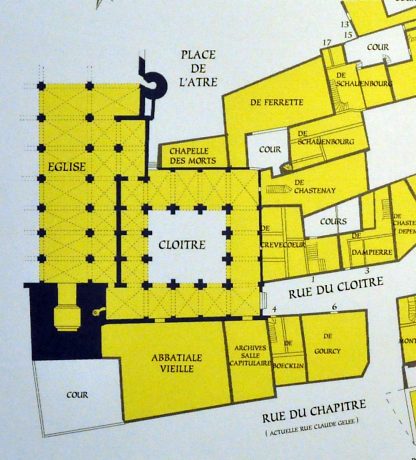
Plan du quartier du chapitre vers 1790 (Musée du Chapitre).
Le cloître a été supprimé en 1797
pour percer une rue.
Seule subsiste la partie nord du cloître, celle qui longe
l'église. |
|
| LE PORTAIL DES
BOURGEOIS (XIIIe SIÈCLE) |
|

Le portail des Bourgeois, sur le côté nord, date du troisième
quart du XIIIe siècle. |
|
|
|
| LA NEF DE LA BASILIQUE
SAINT-MAURICE |
|

Élévations sud dans la nef. Dans la partie gauche, on
voit la chapelle du Rosaire et ses vitraux du XIXe siècle.
La nef allie les éléments romans et gothiques. Nous
sommes dans la période du premier art gothique, une période
de transition architecturale entre les deux styles. |
|
Architecture
de la nef 1/2. Les historiens datent la construction
de la nef des années 1210-1225, époque du premier
art gothique. Constituée de six travées séparées
par des piles massives, elle accuse une hauteur de 14 mètres,
contre 18 à l'abside. Le visiteur est frappé
par le manque de clarté. Les fenêtres étroites
ont encore un aspect roman.
L'élévation est clairement séparée
en trois niveaux par deux cordons peu saillants (photo ci-dessus),
ce qui a pour effet de casser la hauteur et d'accentuer le
manque d'élancement. Le premier niveau est une succession
d'arcades en tiers-point à double-rouleaux massifs.
Le deuxième ouvre sur les combles des bas-côtés
par une suite de baies géminées richement articulées
: cinq élégantes colonnettes baguées
sont coiffées d'une archivolte trilobée. «Le
décor ostentatoire de ces ouvertures n'a d'autre but
que de faire croire à l'existence d'une véritable
tribune», écrit Suzanne Braun (Lorraine gothique
aux éditions Faton, 2013). Il ne s'agit donc ni d'un
triforium ni d'une tribune, mais de simples combles. Ils ont
d'ailleurs été aménagés au début
du XXe siècle avec un plancher recouvrant les voûtes
; les orifices
ont été fermés par du verre moderne.
Le troisième niveau accueille des fenêtres
hautes assez étroites, très ébrasées
et sans moulure. Leurs verrières datent de 1952. --»
ci-dessous
|
|
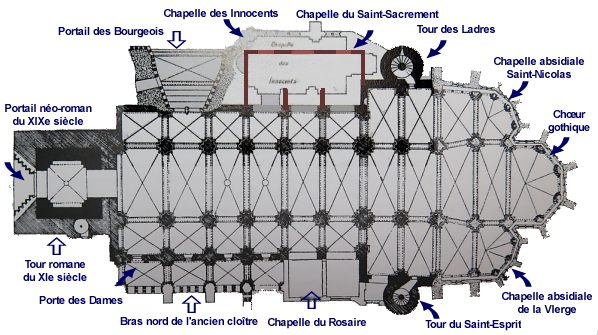
Plan de la basilique.
Longueur totale : 68,15 m ; Largeur (nef et bas-côtés)
: 17,17 m.
La chapelle des Innocents a été détruite en 1865
et remplacée par la chapelle
du Saint-Sacrement. |
|
Architecture
de la nef 2/2. L'élévation,
cassée par les deux bandeaux horizontaux qui
entourent le deuxième niveau, marque la forte
structuration de l'horizontalité. Cet aspect
typique de l'art roman a imprégné le premier
art gothique. Suzanne Braun dans Lorraine gothique
souligne de plus le rôle des piles fasciculées
dans la délimitation, fortement marquée,
de l'espace horizontal dans sa division en travées.
Les tailloirs, qui séparent piles et arcs brisés,
entourent en fait toute la pile : c'est aussi un trait
du premier art gothique. C'est d'ailleurs par le type
des piles (noyau carré entouré de huit
colonnettes engagées) que l'on peut dater la
nef des environs de 1210-1225. D'où la tentation
justifiée de relier la construction de cette
nef avec les quêtes engagées à partir
de 1209 pour la réparation de l'église,
quêtes étendues en 1224 à l'archidiocèse
de Trêves dont dépendait l'évêché
de Toul.
La nef, par ses matériaux, illustre l'appareillage
gothique qui vient coiffer le roman préexistant
du XIe siècle. Ainsi Suzanne Braun fait remarquer
que «seuls les supports, les bandeaux et l'encadrement
des baies sont en pierre de taille ; le reste est en
moellon enduit, qui n'est autre que la maçonnerie
de la nef romane.»
La nef est couverte de six voûtes d'ogives sur
plan barlong. Fait remarquable : les arcs sont
surbaissés, proches de la forme en anse de panier.
Cette déformation vient-elle de la poussée
du voûtement ? L'historienne Marie-Claire Burnand
répond par l'affirmative : les arcs-boutants
extérieurs n'ont pas correctement rempli leur
office ! Au XIXe siècle, on a d'ailleurs jugé
plus sûr d'installer des tirants de fer pour éviter
l'écartement des murs gouttereaux.
Sources : 1) Lorraine
gothique de Marie-Claire Burnand, éditions
Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne
Braun, éditions Faton, 2013.
|
|

Saint Goëry entre sainte Précie et sainte Victorine,
XVIII siècle (tableau anonyme). |
|
|

Les bas-côtés sont voûtés d'ogives
séparées de puissants arcs-doubleaux.
Ici, le bas-coté sud. |

Baie géminée au second niveau de l'élévation.
Elle est somptueusement parée de cinq colonnettes
avec bagues et chapiteaux. |

Statue de saint Maurice,
officier de la Légion thébaine. |
|

Aspect du bas-côté sud.
On remarquera les puissantes piles à chapiteaux à
crochets et leurs très larges tailloirs. |

Élévations du côté sud vue depuis le bas-côté
nord. |

|
|
L'autel
des reliques. La grande châsse
renferme des reliques de saint Goëry, ancien
évêque de Metz, mort au VIIe siècle.
Supposées soigner le Mal
des ardents, elles attirèrent de nombreux
pèlerins. La châsse de droite contient
des reliques de saint Maurice et de ses compagnons
; celle de gauche, des ossements de saint Auger,
qui fut ermite dans les environs d'Épinal.
Source : panneau dans
la nef.
|
|
|

L'agneau pascal dans une clé de voûte. |

La Vierge de Consolation (copie). |
| «««---
L'autel des reliques. |
|
|
Notre-Dame
de Consolation.
L'histoire remonte à 1671 quand des bûcherons
découvrent une petite statue de la Vierge
enchâssée dans un chêne de
la forêt de Jenneson. Ils la portent aux
prêtres d'Épinal,
mais, le lendemain, la statue a regagné
sa place dans le chêne !
Seule solution à adopter devant cet amusant
miracle : construire une chapelle autour du chêne
et créer ainsi un pèlerinage !
Un monastère, bâti lui aussi pour
la circonstance, en assura le contrôle.
Les nombreuses guérisons qui se produisirent
firent surnommer cette statuette de 6 cm Notre-Dame
de Consolation. En 1792, on la transféra
dans la basilique. On peut en voir aujourd'hui
une copie.
Source : Guide de la
France religieuse et mystique de Maurice Colineau,
éditions Tchou.
|
|
|
|

La voûte de la nef vue depuis le chœur.
Les arcs-doubleaux qui séparent les ogives sont surbaissés,
leur forme se rapprochant de l'anse de panier.
Faut-il y voir l'effet de la poussée du voûtement
? |

Le Christ en croix (tableau anonyme). |

Une clé de voûte dans la nef. |
|
| LA CHAPELLE DU
SAINT-SACREMENT |
|

Le bas-côté nord et l'entrée dans la chapelle
du Saint-Sacrement. |

La chapelle du Saint-Sacrement (érigée au XIXe
siècle après la destruction de la chapelle des
Innocents). |
|

Statue de la Vierge, XVe siècle. |

Statue de la Vierge, XVe siècle, détail.. |
|
|
|

La chapelle du Rosaire dans le bas-côté sud. |

Statue de la Vierge à l'Enfant, XVIIe siècle. |

Statue de sainte Anne et de Marie. |
| Pastiche Renaissance
dans le vitrail de la Vie de la Vierge (année 1912)
---»»» |
|
|
|
La
chapelle du Rosaire. Cette chapelle a été
reconstruite en 1618 par l'architecte Yolande de Bassompierre.
Au-dessous se trouve un caveau où étaient
inhumées les abbesses du chapitre. Ce lieu revêt
une certaine importance par son mobilier et ses œuvres
d'art (statues et tableaux). Hormis la très belle
toile anonyme de l'Apparition
de la Vierge à Pierre Fourier, Alix Le Clerc
et aux Dames de la Congrégation Notre-Dame,
toile datée de 1784, on trouve trois tableaux
du début du XVIIe siècle illustrant les
Mystères
joyeux, les
Mystères douloureux et les
Mystères glorieux. Le premier et le troisième
sont l'œuvre d'Étienne Gelée,
le deuxième de Nicolas Belloti. Les trois
œuvres sont datées de l'année 1627.
La peinture de Nicolas Belloti présente un détail
intéressant dans sa description de Jérusalem
en arrière-plan du Portement
de croix. L'artiste s'est en effet inspiré
de la ville d'Épinal et, en particulier, du château
dont il ne reste aujourd'hui que des ruines.
Les vitraux de cette chapelle sont les seuls
de la basilique à être historiés
avec ceux des cinq baies du chœur.
Ils datent de 1912 et sont sortis de l'atelier parisien
d'Emmanuel et Charles Tournel (ils en portent
la signature). Les scènes historiées,
qui occupent la partie supérieure des lancettes,
représentent, pour l'une, la Vierge à
l'Enfant honorée par les saints et les saintes
(photo ci-dessous) et, pour l'autre, trois épisodes
de la Vie de la Vierge (Mariage, Fuite en Égypte
et Mort de Joseph). Ces vitraux imitent en partie le
style Renaissance : le verre cathédrale de la
moitié inférieure des lancettes est orné
de figurines typiques du XVIe siècle (putti,
chevaux, têtes de lion, griffons, vases, fleurs,
etc.).
Source : dépliant disponible
dans la basilique.
|
|
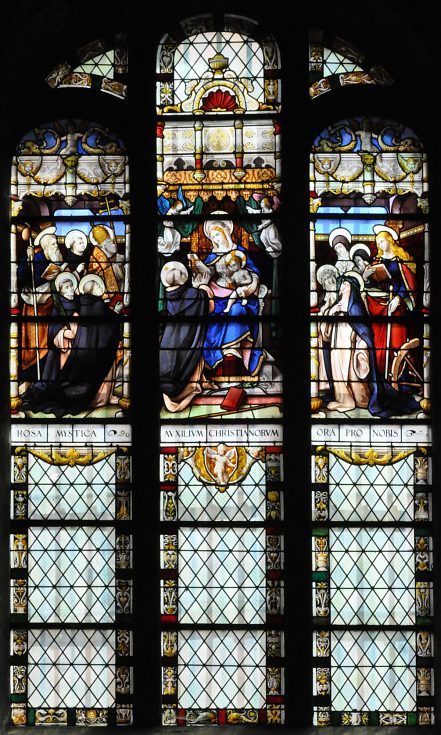
Vitrail «Rosa Mystica» dans la chapelle du Rosaire
(année 1912). |
 |
|

Les tableaux de 1627 dans la chapelle du Rosaire. |

La Vierge de la Nativité (Étienne Gelée). |
|

Tableau «LES MYSTÈRES JOYEUX» d'Étienne
Gelée, 1627 |

Vitrail «Rosa Mystica», lancette droite.
(Marque «Em et Ch Dt Tournel Paris 1912») |
|
|

«LES MYSTÈRES JOYEUX» d'Étienne
Gelée : La Nativité. |

«LES MYSTÈRES DOULOUREUX» de Nicolas
Belloti : la Crucifixion. |
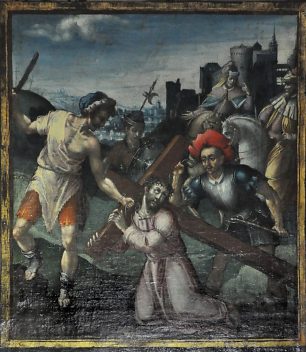
«LES MYSTÈRES DOULOUREUX» de Nicolas
Belloti :
le Portement de croix.
Le château représenté en arrière-plan
est celui d'Épinal au XVIIe siècle. |
|
|
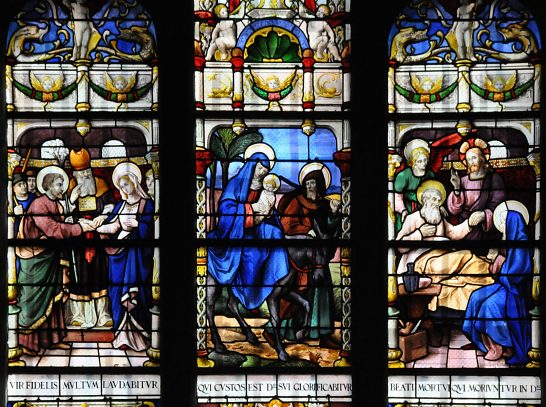
Vitrail de la Vie de la Vierge (partie historiée, 1912).
Les vitraux historiés de la chapelle du Rosaire sont
de l'atelier parisien Emmanuel et Charles Tournel. |

«LES MYSTÈRES GLORIEUX» d'Étienne Gelée
: la Résurrection. |

«LES MYSTÈRES GLORIEUX» d'Étienne Gelée
:
le Couronnement de la Vierge. |
|
| LE SÉPULCRE
DE LA FIN DU XVe SIÈCLE |
|

Le Sépulcre vient de la chapelle Saint-Michel, fondée
en 1479.
Le premier Sépulcre installé dans l'église
a été détruit à la Révolution. |
|

Le Sépulcre : Joseph d'Arimathie.
Le Sépulcre : La Vierge et saint Jean. ---»»» |

Le Sépulcre : Nicodème. |
 |
|

Le Sépulcre (fin du XVe siècle) est logé dans
un réduit près de la tourelle sud. |
| LE TRANSEPT DE
LA BASILIQUE ET SES TRIBUNES |
|
 |

Le bas-côté nord et la tribune
vus depuis l'absidiole nord.
«««--- Le transept nord avec la porte de l'escalier
de la tourelle pour gagner les tribunes.
|
|
Le
transept. Fortement saillant sur les bas-côtés,
le transept est divisé en deux travées.
Il possède deux tribunes, ce qui est exceptionnel
à l'époque gothique. Ces tribunes «perpétuent
l'existence des tribunes romanes», écrit
l'historienne Marie-Claire Burnand dans Lorraine
gothique. À la base de l'élévation
nord et sud de chaque bras subsiste toujours la porte
permettant l'accès à la tribune via la
tourelle (appelée tour
des Ladres au nord et tour
du Saint-Esprit au sud)
Cependant, le facteur architectural le plus marquant,
comme dans la nef, est la présence d'éléments
romans (forme des piliers, arcs en plein cintre,
petites fenêtres) et d'éléments
gothiques (arcs brisés, voûtes d'ogives,
arcs-boutants). Nous sommes dans la période dite
de transition du roman vers le gothique, aux
alentours de 1200. «L'époque 1220-1240
correspond parfaitement au style de cette partie de
l'édifice. C'est le moment des grandes quêtes
organisées pour le chantier de l'église»,
écrit Marie-Claire Burnand. Analyse différente
vingt-ans plus tard : Suzanne Braun, dans Lorraine
gothique aux éditions Faton, se fonde sur
les caractéristiques des chapiteaux du transept
(à crochets et «s'épanouissant en
boules géminées aux angles»). Elle
date ainsi la construction du transept aux environs
de 1275-1290. Ces chapiteaux cohabitent d'ailleurs avec
d'autres chapiteaux inspirés de l'art roman (avec
un entrecroisement de palmettes et de rubans). Ce désaccord
sur les dates ne fait qu'illustrer l'imprécision
des sources.
Il semble que le chantier de construction, en passant
du transept au chœur, a été interrompu.
«Chaque pile, qui fait jonction avec le transept,
présente une nette scission verticale, qui marque
l'interruption du chantier entre ces deux parties»,
écrit l'historienne Suzanne Braun. Pour un œil
non averti, cette interruption est assez difficile à
repérer. On la voit sur la ligne verticale qui
sépare la colonne engagée de la paroi
qui reçoit l'arc-doubleau (voir photo ci-contre).
Sources : 1) Lorraine gothique
de Marie-Claire Burnand, éditions Picard, 1989
; 2) Lorraine gothique de Suzanne Braun, éditions
Faton, 2013.
|
|
| La reprise de la construction
est bien visible sur le pilier nord-est du transept. ---»»» |
|
|

Le transept, la tribune nord et l'autel de messe. |
 |
|
| LE CHŒUR
DE LA BASILIQUE SAINT-MAURICE |
|

Le chœur et la coursière champenoise à la base
des grandes fenêtres (style gothique lorrain fortement imprégné
du style champenois).
Les chanoinesses prenaient place dans des stalles autour du maître-autel
dédié à saint Goëry.
L'autel de messe, au premier plan, était l'autel de la paroisse
dédié à saint Maurice. |
|
Le
chœur. Pour l"historienne Marie-Claire
Burnand (Lorraine gothique chez Picard, 1989),
le chœur a été construit après
le transept, le financement en étant assuré
par les chanoinesses du chapitre. Dans son ouvrage Lorraine
gothique (éditions Faton, 2013), l'historienne
Suzanne Braun donne un avis différent. Certaines
sources, écrit-elle, relatent que les chanoinesses
firent appel aux dons des fidèles en 1242 et
1265. Elle situe ainsi le chantier du chœur entre
1265 et 1280. Comme elle fait remonter la construction
du transept aux environs de 1275-1290 (voir plus
haut), on en déduit que, selon son analyse,
la construction du transept aurait pu démarrer
après celle du chœur. On est donc en plein
désaccord entre historiens, ce qui est la conséquence
naturelle de l'imprécision des textes. On sait
que les études des spécialistes conduisent
souvent à des conclusions opposées, surtout
en matière de datation, quand les sources manquent
ou ne sont pas fiables.
Au sujet de l'imprécision des dates, Marie-Claire
Burnand tient d'ailleurs des propos explicites : «En
1209, on promène le corps de saint Goëry
pour faire des quêtes "pour la réparation
de son église" ; en 1224 l'archevêque
de Trêves étend cette collecte à
tout son archidiocèse. En 1242, puis en 1265,
l'abbesse et le chapitre font appel à la générosité
des fidèles. Il est très vraisemblable
que les deux premières dates correspondent aux
travaux de construction de la nef et les suivantes à
celles de la mise en chantier du chœur, qui dépendait
du chapitre.» Cette opinion, généralement
admise, fait dater le chœur du dernier quart du
XIIIe siècle.
Quoi qu'il en soit, le chœur, fort lumineux, est
marqué par une forte élévation,
typique du gothique lorrrain. Un gothique lorrain qui
se rapproche d'ailleurs du gothique champenois. Jadis,
les chanoinesses prenaient place sur les stalles autour
du maitre-autel dédié à saint Goëry.
Une grille les séparait de l'autel de la paroisse
dédié à saint Maurice. Les cinq
pans du chœur reçoivent des baies à
deux lancettes. Ces baies sont ornées de verrières
créées par la maison Maréchal
de Metz : en 1846 pour les trois pans centraux et
en 1848 pour ceux de côté. Dans les baies
centrales, l'iconographie retenue illustre le Père
Céleste et le Sacré-Cœur accompagnés
d'anges et d'apôtres, puis des scènes de
l'Ancien et du Nouveau Testament (Moïse et les
tables de la Loi, le sacrifice d'Isaac, l'Annonciation,
le Baptême de Jésus, etc.). Sur les côtés,
l'atelier a représenté des personnages
(le Sacré-Cœur, la Vierge, et des saints
et des saintes, souvent en rapport avec l'histoire d'Épinal).
La partie basse de l'abside est ornée d'une suite
d'arcatures trilobées surmontée d'une
galerie de circulation, la fameuse coursière
champenoise. Initialement, il n'y avait aucune protection
pour ceux qui s'engageaient sur la coursière.
Le parapet à motifs tréflés a été
ajouté lors des importants travaux de restauration
des années 1846-1848. Arcatures, coursière
et parapet se poursuivent dans les absidioles nord et
sud.
Sources : 1) Lorraine
gothique de Marie-Claire Burnand, éditions
Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne
Braun, éditions Faton, 2013.
|
|
 |
| Le chœur et son
élévation gothique (dernier quart du XIIIe
siècle). ---»»» |
|
|
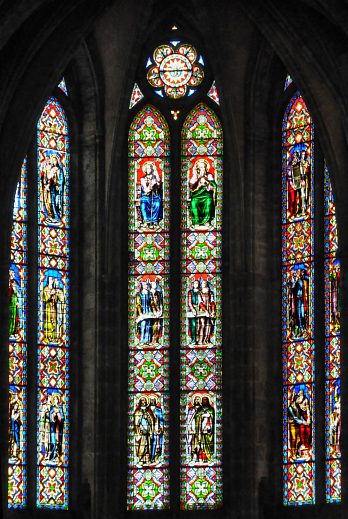
Les trois baies du chœur et leurs verrières.
Atelier Maréchal de Metz, 1846. |

Extrait du vitrail de la baie 3 : la Vierge et saint Joseph.
Atelier Maréchal de Metz, 1848. |
|

Extrait du vitrail de la baie 2 (scènes de l'Ancien Testament).
Atelier Maréchal de Metz, 1846. |
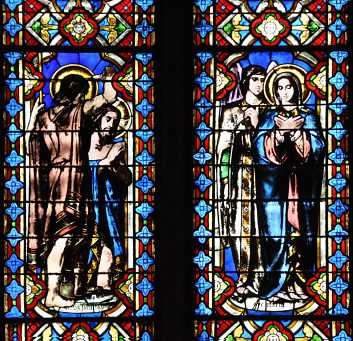
Extrait du vitrail de la baie 1 (scènes du Nouveau Testament).
Atelier Maréchal de Metz, 1846. |

Extrait du vitrail de la baie 2.
Atelier Maréchal de Metz, 1846. |
|

Vitrail de la baie axiale (baie 0).
Atelier Maréchal de Metz, 1846.
En haut : Le Père Céleste et le Sacré-Cœur.
Au-dessus, des anges adorateurs
En bas, des apôtres. |

Extrait du vitrail de la baie 3 : la Vierge et le Christ.
Atelier Maréchal de Metz, 1848. |

Le chœur et, au premier plan, l'autel de messe.
L'église a été consacrée basilique mineure
par le pape Pie XI en 1933.
D'où la présence d'un parasol à bandes rouge
et or, surmonté d'un écusson, contre le pilier nord
du chœur. |
|
|

Le chœur et la chapelle de la Vierge (absidiole sud) vus depuis
le bas-côté sud. |
|
Les
chapelles absidiales. Leur forme est originale
: elles sont plantées de biais, ce qui est bien
visible sur le plan.
Les nervures des ogives accusent aussi un tracé
bizarre. Peut-être est-ce un compromis maladroit
selon l'analyse de Marie-Claire Burnand dans Lorraine
gothique (Picard, 1989), ou bien une construction
fort habile selon Suzanne Braun dans un ouvrage de même
titre (Faton, 2013).
Comme le chœur, elles sont éclairées
par de grandes baies étroites, ornées
des motifs géométriques de leurs verrières
à deux lancettes. La coursière champenoise
et son parapet du XIXe siècle, déjà
vus dans le chœur, poursuivent leur parcours à
leur base. Au premier niveau, la succession d'arcatures
trilobées correspond, dans le chevet, à
une suite de sacristies construites au XIXe siècle
(voir plus
haut). Ces sacristies ont été dénigrées
dès leur construction.
Dans les chapelles, cette succession d'arcatures n'est
interrompue que par deux sobres retables de bois. Y
prennent place une statue du XVIIIe siècle de
saint Nicolas et une ancienne statue de pierre représentant
une Vierge à l'Enfant, appelée Vierge
à la Rose. Cette statue du XIVe siècle
a été volée dans le passé,
lit-on sur une affiche, et restituée par un collectionneur
anglais en 1928.
Sources : 1) Lorraine
gothique de Marie-Claire Burnand, éditions
Picard, 1989 ; 2) Lorraine gothique de Suzanne
Braun, éditions Faton, 2013 ; 3) note affichée
dans les chapelles.
|
|

Le bas-côté nord avec vue sur la chapelle absidiale
Saint-Nicolas. |
 |
|

Chapelle de la Vierge dans l'absidiole sud. |

|

La Vierge à la Rose, détail
XIVe siècle.
«««--- Statue de saint Nicolas,
XVIIIe siècle
dans la chapelle absidiale nord
Saint-Nicolas
|

Le bas-côté nord vu depuis la chapelle Saint-Nicolas. |
«««---
À GAUCHE
L'orgue de tribune est caché dans une baie
ouverte en plein cintre où s'installaient jadis
les hauts dignitaires lors des offices. |
|
|

La nef et l'orgue vus depuis le chœur. |
Documentation : Fascicule La Basilique Saint-Maurice
d'Épinal disponible dans la nef
+ Lorraine gothique de Marie-Claire Burnand, éditions
Picard, 1989
+ Lorraine gothique de Suzanne Braun, éditions Faton,
2013
+ Dictionnaire des églises de France, article sur la
basilique d'Épinal par André Laurent, éditions
Robert Laffont, 1971
+ Guide de la France religieuse et mystique de Maurice Colineau,
éditions Tchou. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|