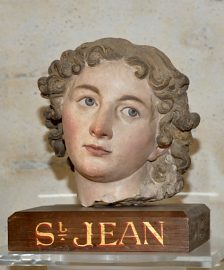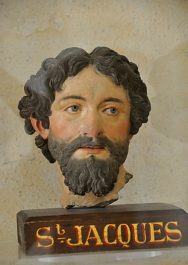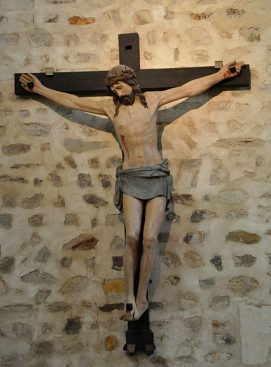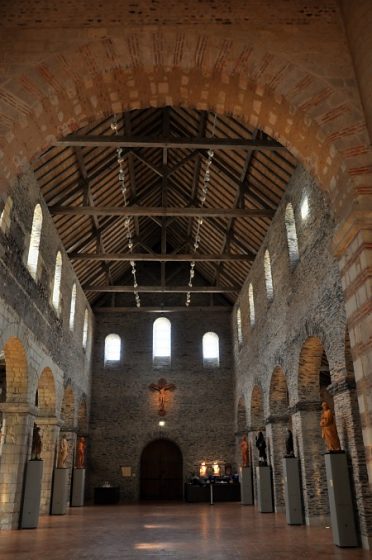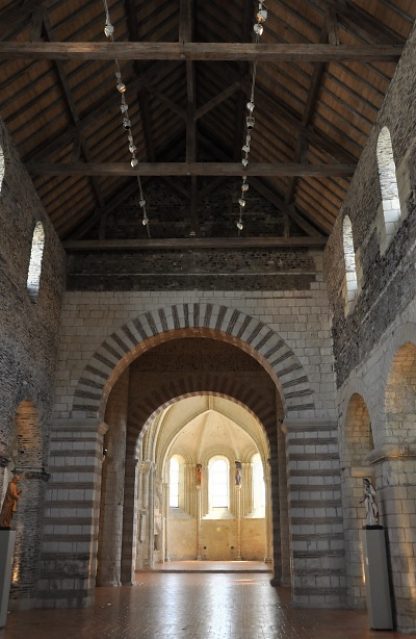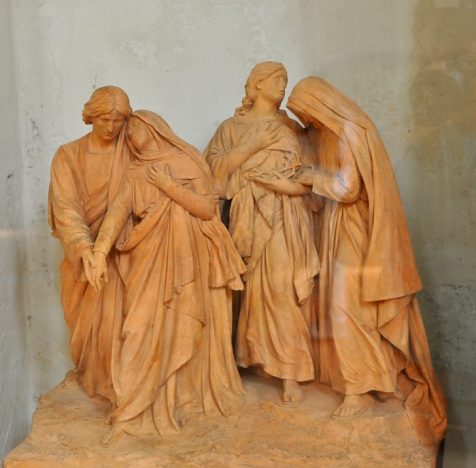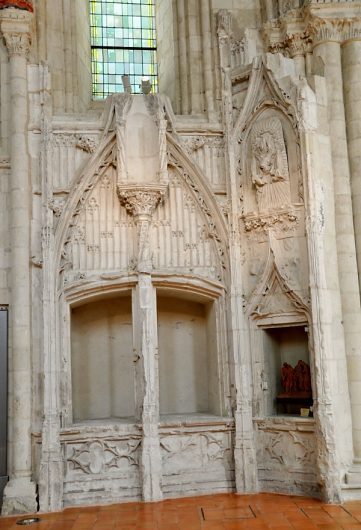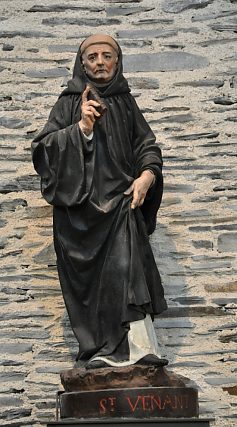|
|
 |
 |
La collégiale Saint-Martin est
la plus ancienne église d'Angers.
À partir du Ve siècle, trois édifices paléochrétiens
vont se succéder et assurer un rôle funéraire,
confirmé aujourd'hui par la découverte de nombreux
sarcophages. Dans le courant du Xe siècle, une grande église
carolingienne est construite, dont il nous reste des éléments
importants : la tour-clocher et les grands arcs massifs de la croisée
du transept avec leur alternance de tuffeau et de brique (photo
ci-dessous). Mais l'édifice se détériore. Au
XIe siècle, le comte Foulques Nerra (987-1040) le remanie
et y installe un service divin assuré par treize chanoines.
Au XIIe, la mode du gothique s'installe : le chœur s'allonge,
une voûte est posée. Le «bon roi René»
(1409-1480) assurera la dernière campagne de restauration-d'embellissement
avant l'époque moderne. À la Révolution,
les chanoines sont chassés, la collégiale est fermée.
Elle devient bibliothèque, magasin de bois de chauffage,
puis siège de l'Administration des tabacs. Sans entretien,
la dégradation arrive très vite : la toiture de la
nef s'effondre en 1828, l'étage supérieur du clocher
est abattu en 1829 ; porche et façade ouest sont détruits
peu après.
Cependant la collégiale attire les passionnés d'histoire
médiévale. Au XIXe siècle, Prosper
Mérimée essaie de s'entremettre. Sans grand succès.
Elle est enfin classée Monument Historique en 1928. Une longue
et savante restauration (1988- 2006) propose aujourd'hui au public
un superbe espace culturel riche de quarante statues angevines.
|
 |

Vue d'ensemble de la collégiale.
Les grands arcs massifs bicolores de la croisée du transept
sont du Xe siècle, le chœur est du XIe siècle.
Les arcades, au centre et à gauche de la photo, sont issues
de la reconstruction de 1a fin du XXe. |

La façade ouest a été reconstruite à l'identique
au XXe siècle.
L'entrée actuelle de la collégiale est cachée par le
panneau publicitaire. |

Transept de la collégiale.
Trois des plus belles statues de la collection : Saint Paul, Vierge
dite de Nozé et Sainte Julie. |
|
Les sculptures
de la Collégiale Saint-Martin. L'histoire
commence avec Monseigneur Henri Pasquier (1844-1927), directeur
de l'École des Hautes Études Saint-Aubin
à Angers. Pendant toute sa vie, ce prélat va
rassembler dans sa maison, située dans l'enceinte de
l'École, de nombreuses œuvres d'art (tableaux,
manuscrits, livres et sculptures) souvent données par
des amis ou des bienfaiteurs. Sa statuaire, bien sûr
religieuse, est presque entièrement du XVIIe siècle.
À sa mort, sa collection reste en place. Une partie
est présentée dans les pièces d'honneur
de sa maison, le reste est remisé dans un réduit.
Il y a quelques années, les choses changèrent
enfin. Pour les restaurer et les exposer au public, l'association
de l'École des Hautes Études Saint-Aubin, propriétaire
des œuvres, a conclu une convention avec le Conseil général
de Maine-et-Loire. L'État a reconnu la qualité
exceptionnelle de ces sculptures qui furent classées
au titre des Monuments historiques en février 2000.
Malgré une légère disparité, ces
sculptures s'unissent par des matériaux communs : pierre
calcaire, terre cuite et bois. La plupart étaient des
éléments de retables, eux-mêmes construits
dans le cadre de la Contre-Réforme, d'où les
amples drapés, les visages expressifs et les poses
pleines de vie qui les caractérisent et les embellissent.
La qualité ici n'est pas un vain mot : les sculptures
ont été créées par les meilleurs
artistes d'Anjou et du Maine. On y retrouve Pierre Biardeau,
Charles Hoyau, Gervais Ier et Gervais II Delabarre.
Catholiques et Protestants s'opposent au Concile de Trente
(réuni trois fois entre 1545 et 1563). La Réforme
refuse le culte des saints et de la Vierge. Pour marquer
|
sa différence, la Contre-réforme
des catholiques va les accentuer. Les saints et les saintes
sont présentés comme des intercesseurs auprès
de Dieu. La Vierge, quant à elle, va bénéficier
d'une dévotion particulière. Retables, autels
et statues se multiplient ; les œuvres d'art abondent
par milliers, parfois des chefs-d'œuvre.
On en donnera ici deux exemples : 1) «La
Vierge s'apprêtant à allaiter l'Enfant»
est une terre cuite achetée en 1900 par Mgr Pasquier
à un marchant angevin. Si l'auteur est anonyme, la
technique est éprouvée : grande maîtrise
des formes et dessin parfait. Les spécialistes détectent,
dans la légère accentuation des lignes, «les
dernières influences du courant maniéristes
dans la seconde moitié du XVIe siècle»
(cf source). 2) «La Vierge dite de Nozé»
(voir photos juste au-dessous) que certains regardent comme
un chef-d'œuvre. Créée pour le couvent
de la Visitation à Angers, la Révolution faillit
lui jouer un mauvais tour. Extirpée de la chapelle
de son couvent, les révolutionnaires, en 1793, la prirent
pour la déesse Raison. Bonnet phygien sur la tête,
elle fut promenée à travers les rues de la ville.
Revenus de leur erreur, ils voulurent la briser, mais elle
fut finalement sauvée et trouva refuge à Nozé,
près d'Écouflant, dans la maison du boucher
de la communauté. C'est là que Mgr Pasquier
la découvrit et l'acheta.
Source : L'église collégiale
Saint-Martin, article : Le
cortège du maniérisme, les quarante sculptures
de la collection de l'École des Hautes Études
Saint-Aubin par Anna Leicher, conservateur délégué
des Antiquités et Objets d'art.
|
|

La maquette de la collégiale
telle qu'elle se présente depuis 2006. |
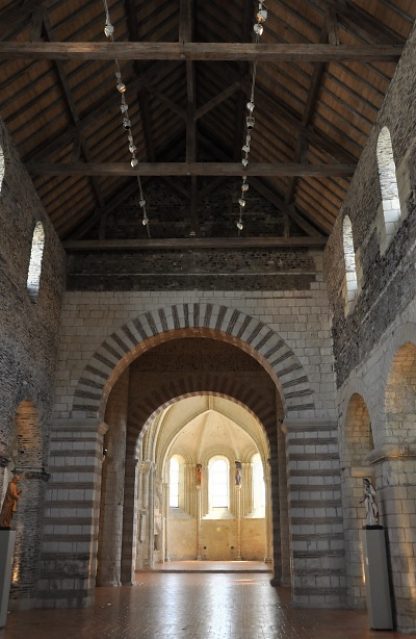
Une partie de la nef et le chœur.
La toiture de la nef date de la restauration (1988-2006). |

Les restaurateurs ont eu la bonne idée de laisser quelques
mètres du sol de la nef à l'état
où il se trouvait lors des fouilles. Le carrelage ocre
du sol de la collégiale est moderne :
il est posé sur la dalle de béton qui a recouvert
le niveau inférieur de l'édifice. |
|

Vierge à l'Enfant dite de Nozé.
Pierre Biardeau, terre cuite polychrome, vers 1660. |

Saint Paul attribué à Pierre Biardeau.
Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

Sainte Julie attribuée à Pierre Biardeau.
Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |
|

Vierge à l'Enfant dite de Nozé.
Pierre Biardeau, terre cuite polychrome,
vers 1660. |

Saint Paul attribué à Pierre Biardeau.
Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

Sainte Julie attribuée à Pierre Biardeau.
Terre cuite polychrome.
Milieu du XVIIe siècle. |
|
|
La Collégiale
Saint-Martin à la Révolution. En
juillet 1789, le chapitre canonial de Saint-Martin comprend
un doyen, un chantre et neuf chanoines. Six d'entre eux ont
rédigé un cahier de doléances cinq mois
plus tôt. À ces dignitaires s'ajoutent les membres
du «bas-chœur», qui sont au service du chapitre.
En novembre 1790, le directoire du district d'Angers annonça
aux chanoines de la Collégiale que le chapitre était
supprimé. Les religieux sont chassés. Un seul
prêta serment à la constitution civile du clergé,
deux seront guillotinés, un autre mourra en prison.
Les autres émigreront ou seront déportés
en Espagne. Certains membres du bas-chœur arriveront
à survivre avec une petite pension.
En janvier 1791, à la suite d'un décret de l'Assemblée
constituante limitant à huit le nombre de paroisses
d'Angers. Exit celle de Saint-Martin qui sera répartie
entre les paroisses voisines. Laissé à l'abandon,
le bâtiment se voit peu après transformé
en bibliothèque publique et doit même héberger
quelque temps un régiment de cavalerie. Bien sûr,
l'endroit n'est pas fait pour entreposer autant de livres
(qui sont surtout issus de communautés religieuses).
L'humidité fait son œuvre. Un pan d'étagères
s'écroule. Les ouvrages giseront par terre jusqu'au
|
transfert de la bibliothèque
à l'évêché en 1798.
La Collégiale est achetée en juillet 1796 par
deux particuliers. Ils ne prendront possession des lieux que
deux ans plus tard lorsqu'elle sera vidée de ses livres.
La chapelle Notre-Dame des Anges sera alors transformée
en buanderie, l'abside servira même d'écurie
après la destruction des consoles gothiques pour ne
pas blesser les chevaux. Le reste du bâtiment devient
magasin de bois de chauffage. Le propriétaire remblaie
les lieux et bouche presque toutes les fenêtres... afin
de payer moins d'impôts! L'humidité redouble
au point que l'édifice sera utilisé par l'administration
des tabacs pendant quarante ans. Évidemment la détérioration
s'accentue. En mars 1828, la toiture de la nef s'effondre
; elle restera à l'état de cour jusqu'à
la fin du XXe siècle. L'étage supérieur
du clocher est abattu l'année suivante. En 1847-1848,
ce sont les restes du cloître qui disparaissent. Peu
après, la partie centrale de la façade ouest
est démolie.
Source : L'église collégiale
Saint-Martin, brochure éditée
par le magazine 303. Article de Daniel Prigent et Jean-Yves
Hunot, archéologues départementaux du Maine-et-Loire.
|
|

Bas-côté nord de la collégiale.
Il donne sur l'absidiole nord : la chapelle Notre-Dame des Anges. |

Vierge à l'Enfant, école angevine, XVIIe siècle (à gauche)
et Vierge à l'Enfant de Charles Hoyau, vers 1640 (à droite). |

Vierge à l'Enfant.
École angevine, terre polychrome, XVIIe siècle. |

Vierge à l'Enfant attribuée à l'atelier de Charles Hoyau.
Terre cuite polychrome, vers 1640. |

Vierge à l'Enfant attribuée à Pierre Biardeau
Terre cuite polychrome, milieu du XVIIe siècle. |
|
|

Vierge à l'Enfant attribuée à l'atelier de Charles Hoyau.
Terre cuite polychrome, vers 1640. |

Élévations dans la nef. |

Sculpture gothique dans la chapelle Notre-Dame des Anges. |
«««---
À GAUCHE
Chapelle Notre-Dame des Anges (absidiole nord)
avec deux sarcophages de la période carolingienne. |
|
|

Sculpture gothique
Chapelle Notre-Dame des Anges. |

Sculpture gothique
Chapelle Notre-Dame des Anges. |
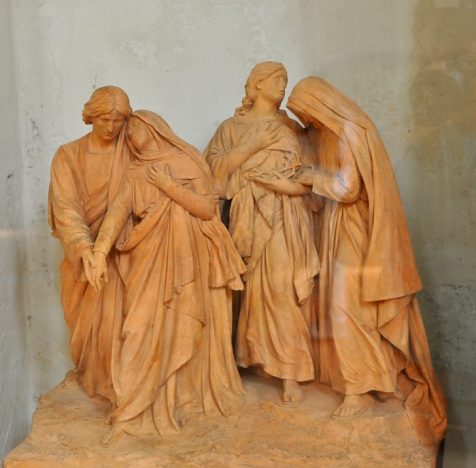
«Déploration du Christ» par F. Escudero,
Terre cuite, 1917. |

Anne et la Vierge
Pierre polychrome, milieu du XVIIe siècle. |

Saint Évêque
Pierre polychrome, XVIIIe siècle. |
|
|

Élévations droites dans la nef.
Les arcades du premier plan (en couleur claire) datent de l'époque
de Foulques Nerra (XIe siècle)
Les deux dernières sur la droite ont été reconstruites
lors de la dernière restauration. |

Saint Jean-Baptiste
Terre cuite, trace de polychromie, école de Hoyau.
Fin XVIe-début XVIIe siècle. |

Saint Sébastien, attribué à Sébastien Leysner
Terre cuite.
Fin du XVIIIe siècle. |
|
Le monde
des défunts. Les fouilles de Saint-Martin
ont livré de nombreuses sépultures mérovingiennes.
D'abord, ce sont des sarcophages en calcaire coquiller ou
en tuffeau, contenant quelques rares objets, parfois du mobilier
; puis des sarcophages d'origine poitevine, avec quelquefois
l'épitaphe du défunt sur la dalle. On y a trouvé
beaucoup de squelettes d'enfants. Et aussi beaucoup de traces
de pathologies osseuses. Les entailles observées sur
les crânes, dues à des coups portés à
l'arme blanche, attestent, sans doute aucun, d'une mort violente.
Source : La Collégiale Saint-Martin
d'Angers, Éditions
Ouest-France.
|
|

L'abside de la période gothique.
Les trois statues-nervures sont des copies (il y en a cinq en
tout). Les originaux ont été vendus au musée
de l'Université de Yale au début du XXe siècle.
Les statues ont été décapitées à
la Révolution. |

Vierge de pitié, pierre polychrome.
Fin du XVe-début du XVIe siècle. |

Vierge de pitié, pierre polychrome.
Fin du XVe-début du XVIe siècle
(détail de l'image de gauche). |
|
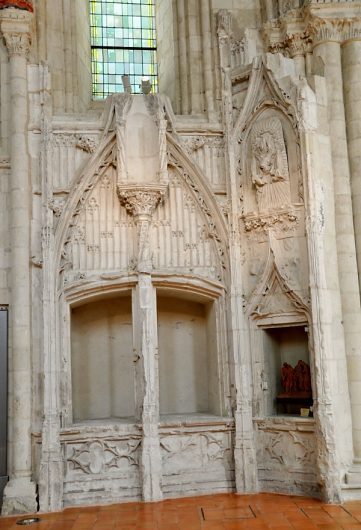
Le sacraire gothique dans le chœur a réussi à
parvenir
jusqu'à nous sans trop de dommages... |

Carreaux de pavement en terre cuite, fin du XIIIe siècle dans
une vitrine.
Ils sont remplacés aujourd'hui par un dallage ocre sur
la dalle de béton. |
|

Panneau «Adoration des bergers».
École angevine ou mancelle, terre cuite polychrome, vers 1700.
|

Chapiteaux gothiques dans le chœur.
Le chœur a connu deux campagnes d'agrandissement à
la période gothique.
Ceux de droite sont de la première période, ceux
de gauche, de la seconde. |
|
|
Prosper
Mérimée et la collégiale Saint-Martin.
Prosper Mérimée passe à Angers
en 1835. Il trouve un monument dégradé, avec
une nef encombrée de fagots de bois. Néanmoins,
il en perçoit les richesses architecturales. Ses démarches
auprès de la municipalité et de l'évêque
pour rendre l'église à sa destination d'origine
n'aboutissent pas. Mérimée revient en mai 1847
en tant qu'inspecteur général des Monuments
historiques. Dans une lettre adressée à son
ami Ludovic Vitet, président de la commission des Monuments
historiques, il écrit :
«L'église Saint-Martin d'Angers vous est bien
connue. Elle n'est pas beaucoup plus ruinée que vous
ne l'avez vue autrefois il y a 7 ou 8 ans. Seulement les fagots
du marchand de bois ont emporté le mortier des piédroits
de la porte en sorte qu'ils sont aujourd'hui horriblement
dentelés. Dans le chœur, une nervure est tombée
et l'arc doubleau a besoin d'être repris. La coupole
a perdu également une de ses nervures. Les transepts
et le collatéral sud, le seul existant, sont couverts
par une voûte en bois, peinte, fort curieuse, mais en
pitoyable état. À tout prendre, ce qui reste
a l'air assez solide et a bonne envie de vivre.
Nous sommes d'abord allés à la Mairie où
nous n'avons trouvé que deux adjoints, l'un médecin,
l'autre épicier, tous deux peu antiquaires, qui nous
ont donné lecture d'une délibération
récente du conseil municipal. Le sens est que le besoin
d'une église nouvelle ne se faisant pas sentir à
Angers, qu'aucune demande n'ayant été formée
par l'autorité ecclésiastique, il n'y a pas
lieu de s'imposer une charge extraordinaire pour l'acquisition
de St-Martin. Nous avons fait de l'éloquence sur le
respect dû aux vieux monuments et nous nous sommes retirés
assez mal satisfaits les uns des autres.
Le lendemain, nous avons vu le maire, M. Giraud. Il nous a
parlé des charges de la ville, des sacrifices qu'elle
doit encore s'imposer pour des besoins de première
nécessité, son pavage, une bonne troupe théâtrale,
etc. Enfin, avec quelque peine, il en est venu à nous
dire que si le gouvernement achetait St-Martin, la ville
|
consentirait peut-être un
jour à l'accepter.»
Le même jour, l'évêque d'Angers,
Mgr Angebault, se montrera retors à la proposition
de la commission de rouvrir la collégiale au culte.
Utiliser Saint-Martin, certes, mais pour le catéchisme,
certainement pas pour en faire «une paroisse ou une
succursale», solution qui se traduirait par la baisse
des revenus de la cathédrale Saint-Maurice! En revanche,
le prélat suggère d'en faire «un édifice
diocésain, pouvant en cette qualité obtenir
des secours du Ministère des Cultes.»
Alors que le marchand de bois propriétaire de la collégiale
a déjà parlé gros sous et démolition,
Prosper Mérimée va quitter Angers
sur cette proposition de l'évêque pour laquelle
celui-ci promet d'écrire au Ministère des Cultes.
Plus loin dans sa lettre, l'inspecteur général
écrit des mots assez piquants :
«Ce qu'il y a de déplorable, c'est que l'on est
en train de bâtir près de St-Martin une église
nouvelle, assez mal située et encore plus mal construite.
Si nous eussions été prévenus à
temps, nous aurions pu obtenir que l'on achetât la ruine
carolingienne au lieu de faire quelque saloperie moderne.»
La «saloperie
moderne» n'est autre que l'actuelle église
néo-gothique Saint-Joseph,
commencée en 1846 à trois cents mètres
de la collégiale !
En juillet 1847, Mérimée écrira une nouvelle
lettre à Ludovic Vitet au sujet de la collégiale
: «Mgr d'Angers m'écrit aujourd'hui qu'il préfère
la destruction de St-Martin à son érection en
paroisse. Ce sont ses propres termes. Je vous montrerai sa
lettre jeudi à l'Académie.»
Le projet de revoir Saint-Martin réaffectée
au culte catholique n'aboutira jamais. Au XXe siècle,
le chœur - alors clôturé - sera transformé
en chapelle. La restauration commencée en 1988 a finalement
trouvé une solution satisfaisante.
Source : La Naissance des Monuments
historiques, la correspondance de Prosper Mérimée
avec Ludovic Vitet (1840-1848),
édité par le Ministère de l'Éducation
nationale, comité des travaux historiques et scientifiques.
|
|
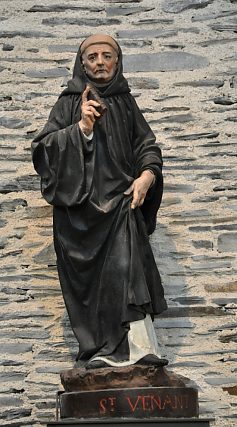
Saint Venant attribué à Christophe et Jacques Saint-Simon
Pierre polychrome, vers 1700. |

La belle voûte lambrissée du roi René au-dessus d'un bras du
transept (XVe siècle).
Le bois est décoré de blasons et de fleurs de
lys.
Mérimée la trouva couverte de peinture lors de
ses visites en 1835 et 1847. Sa restauration, dans les années
1990, fut difficile. |
|

Vierge s'apprêtant à allaiter l'Enfant.
École mancelle, terre cuite, seconde moitié du XVIe siècle. |

Vierge à l'Enfant, pierre polychrome, vers 1360.
Découverte dans les fouilles de la collégiale St-Martin en 1931. |

Sainte Marguerite
Pierre, XVIe siècle
Découverte dans un cimetière voisin de la collégiale Saint-Martin. |

Statues et vieilles pierres dans la nef.
On reconnaît les statues de saint Jean-Baptiste (à droite)
et saint Sébastien (au centre).
À gauche, statue d'un saint prêtre, école angevine
ou mancelle, XVIIe siècle. |

Tête de Christ signée de «Macé»
Il doit s'agir de l'Angevin Édouard-Louis Macé.
Terre cuite, fin du XIXe, début du XXe siècle. |
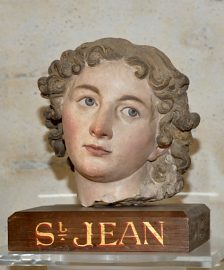
Tête de saint Jean
attribuée à Gervais 1er Delabarre.
Terre cuite polychrome, 1ère moitié du XVIIe siècle
(Sans doute un élément de retable). |

Tête de Christ
attribuée à Gervais 1er Delabarre
Terre cuite polychrome.
Première moitié du XVIIe siècle
(Sans doute un élément de retable). |
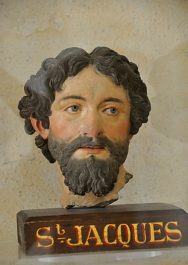
Tête de saint Jacques
attribuée à Gervais 1er Delabarre.
Terre cuite polychrome
Première moitié du XVIIe siècle
(Sans doute un élément de retable). |

Statues et arcades de Foulques Nerra (XIe siècle) sur le côté
droit. |

Tête de Christ signée de «Macé».
Il doit s'agir de l'Angevin Édouard-Louis Macé
Terre cuite, fin du XIXe, début du XXe siècle. |
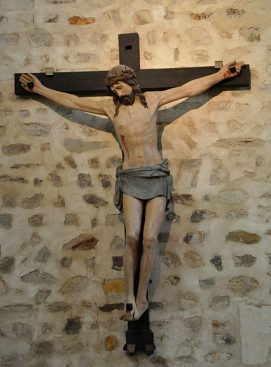
Christ en croix
Bois polychrome, XVIIe siècle. |

Christ en croix
Bois polychrome, XVIe siècle. |
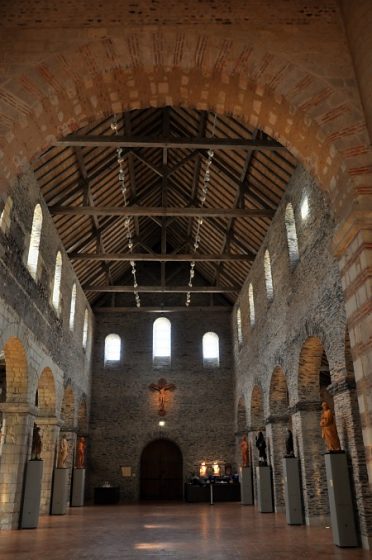
La nef et sa voûte restaurée vues depuis le chœur.
La crypte dévoile les vestiges des premiers édifices
religieux (il y a près
de 2000 ans) dont on voit les bases des maçonneries ---»»» |

Vue de la crypte où sont encore entreposées quelques
tombes mérovingiennes. |

Vue de la crypte.. |
Documentation : «La Collégiale
Saint-Martin d'Angers», Éditions Ouest-France + «L'église
collégiale Saint-Martin», brochure éditée
par le magazine 303 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|