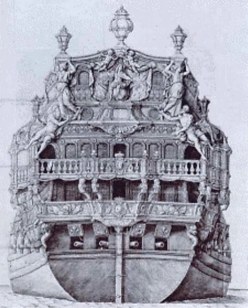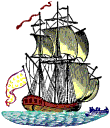|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Astrolabe
Atocha, galion espagnol
Berlin, frégate allemande,
XVIIe siècle
Bretagne, 1766
Caraque Atlantique
Chaloupe armée en
guerre, XIXe siècle
Cocca Veneta
Cogge médiéval
Confiance, Surcouf
Drakkar viking
Endeavour, 1761
Flore, frégate française,
XVIIIe siècle
Golden Hind, Francis
Drake
Louis XV, XVIIIe siècle
Mirage
Ouragan
Polacca Veneziana
Prins Willem, 1649
Protecteur, 1760
Requin, chébec du
XVIIe siècle
Santa Maria, 1492
Soleil Royal, 1669
Souverain des mers, 1638
Valmy, 1847
Yacht Mary, 1660
|
| |
HISTOIRE
NAVALE
Les thèmes liés aux maquettes
: |
| |
Bévéziers,
1690
Charles Ier d'Angleterre, le
Ship Money
Décollage économique
de l'Europe
Décoration navale
française
Dumont d'Urville
Explorations scientifiques
du XIXe siècle
Francis Drake
Frégate française
au XVIIIe siècle
Frégates américaines
au XIXe siècle
Frégates dans les
Marines de guerre
Guerre de Sept Ans
Hanse allemande
Hypothèses sur
Christophe Colomb
Invincible Armada
La Hougue, 1692
La Royale après
la guerre de Sept Ans
La Royale (Restauration, Monarchie
Juillet)
Les Compagnies des Indes
Lutte contre les Barbaresques
Marine française
de 1815 à 1848
Navires viking
Première Marine de
Louis XIV
Règles de la guerre
de course
Suffren
Surcouf
Tourville
Traite négrière
transatlantique
Transport atlantique
(XVIe-XVIIe s.)
Transport des Indes vers
l'Espagne
Venise, XVe et XVIe
siècles
Venise, XVIIIe siècle
Voyages de James Cook
Yachts royaux d'Angleterre
Contact
|
|
|
|
|
|
|
 |

|
|
|
Le Mirage est une synthèse des puissants
vaisseaux trois-ponts d'environ 74 canons sortis des arsenaux du
Royaume de France entre 1660 et 1670. Contrairement aux navires
de guerre construits dans la première moitié du XVIIe siècle, le
Mirage a perdu une partie de la surélévation des superstructures
à la poupe. Cette surélévation était typique d'une époque où un
bâtiment de guerre, destiné au combat rapproché, voire à l'abordage,
devait dominer ses adversaires.
La batterie basse du Mirage est percée à 14 sabords et armée de
canons de 24 livres (parfois de 18 livres en cas de pénurie de 24).
A la proue, on remarque l'absence des sabords de chasse. La deuxième
batterie est armée de canons de 18 livres. Le pont principal constitue
la troisième batterie avec des canons de 8 et 12 livres. Le gaillard
d'avant n'est pas armé alors que le gaillard d'arrière possède 4
canons de 6 livres. Au-dessus, la dunette n'est pas armée non plus.
L'arcasse est forte de 4 canons de chasse, armement traditionnel
sur les vaisseaux de premier rang. Enfin, la présence de trois grands
fanaux à la poupe indique qu'il s'agit d'un vaisseau amiral. La
poupe est somptueusement parée d'ornementations et de sculptures
en ronde-bosse disposées de manière symétrique le long des deux
galeries superposées. La présence de galeries de côté en lieu et
place des bouteilles est typique des vaisseaux de la première Marine
du Roi Soleil.
|
 |
|
|
Un canonnier (médaille de la Monnaie de Paris)

|
|
|
La maquette est en double bordage : un premier
bordage (interne) en camphrier et le deuxième en teck. Au niveau
des première et deuxième batteries, le bordage est en pin. Le modèle
est entièrement construit à la main.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
En 1661, Mazarin meurt. La Marine de
France n'existe pratiquement plus. Seule une vingtaine de vaisseaux
de 16 à 56 canons a pu être sauvée de la ruine. Louis XIV décide
de doter le royaume d'une flotte capable de rivaliser avec les deux
grandes forces navales de l'époque : les Provinces-Unies et l'Angleterre.
En 1666, les constructions, trop lentes, forcent la France à acheter
huit vaisseaux en Hollande et au Danemark. En 1668, le rythme s'accélère
et, en 1671, l'objectif de 120 vaisseaux est atteint. C'est ce que
les historiens appellent la première Marine de Louis XIV.
Cette construction s'est faite sans aucune directive générale et
officielle. A l'époque médiévale, les seigneurs, aidés des entrepreneurs,
se muaient en architectes pour diriger les ouvrages. De 1660 à 1670,
rien n'a changé : les officiers de haut rang sont chargés de donner
les directives aux maîtres charpentiers. Ces directives sont données
en fonction des goûts et du savoir de chacun d'eux. Les officiers
viennent essentiellement des armées de terre, où ils se sont distingués,
et n'ont pas la compétence pour prendre les meilleures décisions.
Abraham Duquesne, lieutenant général des armées navales, est l'un
des rares à savoir de quoi il parle, mais ses avis seront rarement
suivis. Pourtant certains concepts de construction existent : Colbert,
chargé des affaires de la Marine dès 1660, fait part de conseils
précis dans sa correspondance. Cependant il lui est difficile de
lutter contre le poids des habitudes dans les arsenaux.
|
|
|
Jean-Baptiste Colbert, chargé
des Affaires de la Marine en 1660
|
|
|
La poupe du Soleil Royal. Maquette
en construction
|
|
 |
|
 |
En attendant la mise à l'eau de cette
marine, la France importe : d'abord du bois du nord de l'Europe
pour les mâtures, du chanvre de Riga pour les cordages, de la saumure,
du goudron végétal, mais aussi du cuivre et de l'étain (pour le
bronze des canons). Elle importe aussi de la main-d'œuvre pour
ses arsenaux : des charpentiers de Hollande qui enseignent leur
art aux charpentiers français, des fondeurs et des forgerons pour
la confection des canons et des ancres. Heureusement, malgré les
pillages et les destructions qui accompagnèrent les deux Fronde,
le pays n'est pas sans potentiel. A Brest, les Hubac possèdent une
longue expérience dans la construction navale ; à Toulon, plusieurs
maîtres charpentiers exercent sous la direction de Gédéon Rodolphe,
un remarquable constructeur hollandais qui a quitté son pays en
1645, sur les instances de Mazarin, pour s'établir en Provence.
La décoration navale de la première Marine se veut somptueuse. Les
vaisseaux de ligne copient le faste de Versailles. Tout doit concourir
au prestige du Roi. Colbert le rappelle à d'Infreville, intendant
de l'arsenal de Toulon, en 1669 : "Il n'y a rien qui frappe tant
les yeux, ni marque tant la magnificence du Roi que de bien orner
les vaisseaux comme les plus beaux qui aient encore paru à la mer."
Charles Lebrun est désigné pour concevoir les décorations et en
superviser l'exécution. De nombreuses sculptures de style baroque,
parfois teintées de classicisme, embellissent les œuvres mortes
des navires. Les artistes puisent leur inspiration dans le Panthéon
antique : poupes et proues sont ornées de divinités de l'Olympe,
d'animaux symboliques.
Cependant Lebrun, absorbé par la décoration des jardins de Versailles,
est obligé de délaisser les décorations navales. A Toulon, le sculpteur
Girardon, qui a la confiance de Lebrun, est chargé des décors. A
Brest, il faut faire appel à des artistes de la région parisienne.
Evidemment, l'exécution de ces monuments artistiques, bien éloignés
des besoins militaires, prend du temps et coûte cher.
|
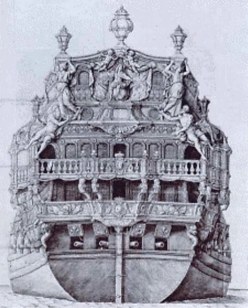 |
|
|
La poupe du Dauphin Royal,
vaisseau achevé en avril 1670 à Toulon. Elle offre un exemple des
décors abondants et parfois surchargés de la première marine de
Louis XIV.
A cette époque, les Anglais ont abandonné les grandes
renommées sur leurs navires et vont s'orienter peu à
peu vers des poupes standardisées.
|
|
La poupe du Mirage. Les décorations
sont en laiton doré.
L'absence de bouteilles est typique des vaisseaux de la première
marine de Louis XIV.
Les trois fanaux à la poupe indiquent qu'il s'agit d'un vaisseau
amiral.
|
 |
|
|
La nouvelle Marine est aussitôt comparée
à ses rivales. Dans l'ensemble, les bâtiments ne portent pas bien
la voile : les œuvres mortes sont trop élevées, l'abondance des
décorations surcharge les vaisseaux et le gaillard d'avant s'avère
parfois pénalisant dans la navigation.
On aboutit ainsi au premier règlement royal du 4 juillet 1670 établissant
le nombre de ponts, l'étagement des logements et les aménagements
du fond de cale ; le gaillard d'avant est interdit sauf sur les
deux plus grosses unités de la flotte (Soleil Royal et Royal Louis).
Ce règlement essaie en outre d'apporter une uniformité dans l'entre-distance
des sabords de la batterie basse. En réalité, ces mesures ne suffisent
pas à remédier aux préoccupations de la construction, d'autant plus
que s'engage une polémique sur la largeur des vaisseaux : celle-ci
doit-elle faire plus ou moins le quart de la longueur? Les constructeurs,
en désaccord, campent sur leur position.
Paraît alors le deuxième règlement royal du 22 mars 1671 qui instaure
officiellement les Conseils de construction. Ceux-ci doivent rassembler
toute l'information possible sur toutes les marines, y compris celle
de France, s'informer de tout ce qui contribue à la bonne ou mauvaise
tenue des vaisseaux à la mer et, enfin, dresser des devis pour les
constructions. D'autre part, le règlement tente d'améliorer la stabilité
sous voile des vaisseaux en réduisant la hauteur entre les ponts,
donc l'élévation des œuvres mortes.
Ce deuxième règlement ne parviendra pas à standardiser la construction
car, à la base, les critères ne sont pas arrêtés. Après la fascination
de Colbert pour la flotte des Provinces-Unies survient, en 1672,
le changement d'alliance : la France se rapproche de l'Angleterre
et part en guerre avec elle contre les Hollandais. Colbert éprouve
alors une vive admiration pour le Marine anglaise. Lors de la jonction
des flottes anglaise et française en juin 1672, peu avant la bataille
de Solebay, les officiers français se livrent à une véritable inspection
des vaisseaux de ligne anglais. Tourville, le futur amiral, aidé
du fils Hubac, se rend notamment à bord du Royal Charles afin d'en
relever les principales mesures! Ces relevés aboutissent à des mémoires
transmis aux Conseils de construction.
De nombreux voyages de dignitaires et commissaires français outre-Manche
viennent enrichir les documents soumis aux Conseils. On remarqua
des différences notables entre les deux Marines. La flotte anglaise
étant regardée comme la plus puissante d'Europe, les charpentiers
français furent montrés du doigt.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
La poupe du Dauphin Royal (vaisseau
du XVIIIe siècle)
maquette d'arsenal (musée de la Marine de Rochefort)
|
|
 |
Louis XIV édicte alors le règlement du
13 septembre 1673 qui fixe les dimensions nécessaires des différents
vaisseaux pour aboutir à une réelle uniformisation. Ce règlement
ne sera guère suivi d'effets. A Brest, les Hubac continuent leur
pratique, notamment en mettant à l'eau des vaisseaux plus larges
qu'ailleurs. Au niveau de la décoration, l'architecture des poupes
est en partie simplifiée ; les sculptures sont allégées. Le retour
des galeries (comme sur le Mirage) est interdit au profit des bouteilles.
A la suite de la campagne du Texel en 1673, une nouvelle polémique
s'engagea : celle de la hauteur du tirant d'eau. On s'aperçut que
les vaisseaux français tiraient cinq pieds de plus que les vaisseaux
hollandais. Colbert exigea un mémoire sur le tirant d'eau de tous
les vaisseaux du roi! Mais la France lutte maintenant contre une
partie de l'Europe coalisée : Provinces-Unies, Espagne et empire
germanique. Les impératifs de la guerre monopolisent toutes les
attentions. Tiraillés entre les exigences du ministre, les contraintes
techniques et le poids indispensable de l'expérience, les maîtres
charpentiers ne respectent pas les règlements royaux. Personne ne
parle plus de standardisation.
|
|
|
La jonction de la flotte française du comte
d'Estrées avec la flotte anglaise du duc d'York quelques jours avant
la bataille de Solebay (7 juin 1672). Tableau de Jan Karel Donatius
van Beecq au musée de la Marine de Paris (photo de l'auteur)
|
|
|
Il faudra attendre l'Ordonnance du 15
avril 1689, après la mort de Colbert et celle de son fils Seignelay,
pour voir un ultime essai de standardisation. Entre-temps, les écoles
de construction navale et de mathématiques se sont implantées ;
la pratique du plan s'est généralisée. L'Ordonnance de 1689 fixe
le cadre de la construction de la deuxième Marine de Louis XIV :
les vaisseaux s'allongent, la puissance de feu s'accroît ; les dimensions
des navires des cinq premiers rangs sont imposées (mais, là encore,
les constructeurs ne les respecteront pas). La deuxième Marine va
subir l'épreuve du feu lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
Après la bataille indécise de Velez-Malaga en 1704, le roi décide
de privilégier la guerre de course. Il met un terme à la construction
des vaisseaux de ligne et plus particulièrement à celle des trois-ponts.
|
 |
Charpentier de marine (médaille de la Monnaie
de Paris)
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|