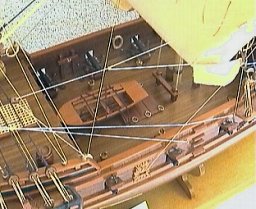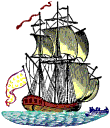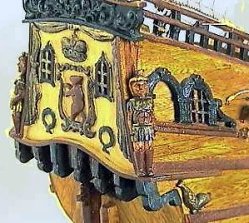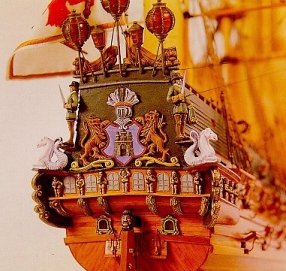|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
Astrolabe
Atocha, galion espagnol
Berlin, frégate allemande,
XVIIe siècle
Bretagne, 1766
Caraque Atlantique
Chaloupe armée en
guerre, XIXe siècle
Cocca Veneta
Cogge médiéval
Confiance, Surcouf
Drakkar viking
Endeavour, 1761
Flore, frégate française,
XVIIIe siècle
Golden Hind, Francis
Drake
Louis XV, XVIIIe siècle
Mirage
Ouragan
Polacca Veneziana
Prins Willem, 1649
Protecteur, 1760
Requin, chébec du
XVIIe siècle
Santa Maria, 1492
Soleil Royal, 1669
Souverain des mers, 1638
Valmy, 1847
Yacht Mary, 1660
|
| |
HISTOIRE
NAVALE
Les thèmes liés aux maquettes
: |
| |
Bévéziers,
1690
Charles Ier d'Angleterre, le
Ship Money
Décollage économique
de l'Europe
Décoration navale
française
Dumont d'Urville
Explorations scientifiques
du XIXe siècle
Francis Drake
Frégate française
au XVIIIe siècle
Frégates américaines
au XIXe siècle
Frégates dans les
Marines de guerre
Guerre de Sept Ans
Hanse allemande
Hypothèses sur
Christophe Colomb
Invincible Armada
La Hougue, 1692
La Royale après
la guerre de Sept Ans
La Royale (Restauration, Monarchie
Juillet)
Les Compagnies des Indes
Lutte contre les Barbaresques
Marine française
de 1815 à 1848
Navires viking
Première Marine de
Louis XIV
Règles de la guerre
de course
Suffren
Surcouf
Tourville
Traite négrière
transatlantique
Transport atlantique
(XVIe-XVIIe s.)
Transport des Indes vers l'Espagne
Venise, XVe et XVIe
siècles
Venise, XVIIIe siècle
Voyages de James Cook
Yachts royaux d'Angleterre
Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aspect général de la frégate
Berlin (au-dessus et à droite). L'emblème de la ville
est représenté sur l'écusson du tableau de
poupe.
|
|
La très belle poupe
du Berlin
(ateliers de Ceuneau Marine)
|
|
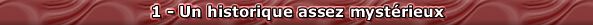
|
|
On sait peu de choses sur la frégate
Berlin bien que des archives en aient conservé les plans jusqu'à
nous. Le vaisseau a été construit aux Pays-Bas pour le compte du
prince Frédéric Guillaume de l'Etat du Brandebourg, dont Berlin
était la capitale.
|
L'aspect général, assez svelte, du navire
le fait ressembler à un galion. Les archives mentionnent quelques
escarmouches : en 1675, il l'emporta sur la frégate française Royal
de Dunkerque et, en 1676, il captura la goélette suédoise Maria.
|
 |
 Le Friesland, le
type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut
Le Friesland, le
type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut
lancé en 1663 et participa à la deuxième guerre anglo-hollandaise
(1665-1667). |
Les navires de ligne resteront dans l'Histoire
navale comme la grande invention des Anglais au XVIIe siècle. La
bataille de Dungeness fut le premier combat naval important de la
première guerre anglo-hollandaise (1652-1654). Le combat, comme
à l'habitude, se déroula en groupes séparés et les Anglais frôlèrent
la catastrophe face à une centaine de vaisseaux hollandais.
Cette défaite servit d'avertissement. Las de l'absence de véritable
tactique sur mer, Georges Monk, général dans les armées terrestres
et responsable de la flotte, décida d'appliquer sur mer les principes
qui lui avaient valu ses succès en Ecosse et en Irlande.
|
 |
|
Monk instaura la tactique de la ligne
de file: tous les bâtiments devaient s'efforcer de rester en ligne
l'un derrière l'autre, dans le sillage du navire de devant et combler
les vides créés par une défection éventuelle. De la sorte, chaque
vaisseau protège la poupe de celui qui le précède et toute l'artillerie
peut être concentrée sur les flancs. La stabilité des vaisseaux
en est améliorée. Mais cette tactique exigeait des équipages entraînés,
un code des signaux, des marins spécialisés.
|
|
|
| Une
autre version de la poupe du Berlin (Ceuneau Marine) |
|

|
|
Au-dessus : la poupe du Friesland, vaisseau
hollandais. Quand ce n'est pas l'emblème de la ville,
c'est celui de l'Etat, membre des Provinces-Unies, qui figure
sur le tableau de poupe.
|
|
A l'extrême gauche : la poupe
du Friedrich Wilhelm, frégate allemande construite
au XVIIe siècle pour protéger le port d'Emden
contre les attaques des vaisseaux français.
|
|
|
La ligne de file fut mise en pratique
dès le combat suivant, celui de Portland, le 28 février 1653. Le
résultat ne fut pas concluant. Néanmoins, les Anglais l'appliquèrent
à nouveau à la bataille suivante, celle de Gabbard Bank, le 12 juin.
Cette fois, ce fut un grand succès. Les Hollandais ne parvinrent
pas à briser le mur de canons érigé par leur adversaire. La ligne
de file allait s'imposer comme la seule tactique navale admissible
dans toutes les marines européennes jusqu'au XIXe siècle. Dans la
pratique, si les deux adversaires l'appliquaient avec la même rigueur,
le combat naval ne pouvait être qu'une partie nulle comme à Ouessant
entre Français et Anglais en 1778.
Pour l'heure, l'apparition de la ligne de file modifia la hiérarchisation
des navires. Auparavant classés selon le tonnage et la taille, ils
allaient l'être désormais selon leur puissance de feu. La ligne
de file se veut rigide, elle exige donc des navires aux forces comparables.
En effet, un bâtiment moins puissant créerait une faiblesse facilement
repérable et attaquable dans la chaîne. Le navire de guerre efficace
prit alors le nom de vaisseau de ligne. Il possédait deux ou trois
ponts, une cinquantaine de canons au minimum, mais il était lourd,
peu maniable et assez lent.
|
|
|
|
| |
Au-dessus : la poupe d'une autre frégate allemande
: le Wappen
von Hamburg. Les armes de la ville figurent sur le tableau
de poupe
|
|
 |
|
|
Dès
la deuxième moitié du XVIIe siècle, il était clair que
le vaisseau de ligne ne pouvait pas remplir toutes les
tâches à la mer. Il fallait concevoir une unité rapide,
aisément manœuvrable, évidemment moins armée. Ce
fut la France qui donna le ton. Colbert chargea les
architectes de définir son profil : la frégate était
née. Elle fut d'abord caractérisée par l'emploi de petits
vaisseaux à deux ponts ou de bâtiments plus modestes,
dénommés "frégates légères". A la fin du XVIIe siècle,
les frégates ne possédaient que 20 à 40 canons, mais,
au siècle suivant, ce nombre passa de 40 à 60. On abandonna
le concept de frégate "légère" pour une frégate plus
"moderne" dont l'artillerie et les dimensions ne cesseront
de croître au cours du siècle.
Les premières frégates furent utilisées pour patrouiller
sur les voies navigables. Puis elles escortèrent les
bâtiments de charge et assistèrent les navires de ligne.
Au XIXe siècle, elles furent les précurseurs des croiseurs
d'aujourd'hui, avec des formes plus légères, un déplacement
moins élevé, bref un carénage plus fragile. Leur rôle
consistait à détruire les navires ennemis endommagés
ou, au contraire, à secourir les navires endommagés
de leur propre flotte.
|

Aspect général du Wappen von Hamburg (ateliers
de Ceuneau Marine) |
|
 |
|
Maquette en teck
de La Flore,
frégate française de la fin du XVIIIe
siècle
|
|
|
La voilure des frégates n'avait
rien de révolutionnaire. Le navire possédait trois mâts
gréés de trois ou quatre voiles carrées, avec une voile
latine ou une brigantine sur l'artimon.
Les frégates se répandirent dans tous les pays européens
et en Amérique. Au XVIIe siècle, les Etats allemands
en firent construire, parfois par les chantiers navals
hollandais. Ce fut le cas du Berlin. Le Friedrich Wilhelm,
dont on donne plusieurs représentations, était une puissante
frégate de 56 canons sortie des chantiers de Pillau.
Elle se consacra à la défense du port d'Emden contre
les attaques des vaisseaux français, puis aux voyages
au long cours vers l'Afrique.
|
|
| |
| |
La proue du Wappen
von Hamburg (Ceuneau Marine) |
|
|
 |
 |
On appelle pavois la partie de la coque
qui se prolonge au-dessus du pont et qui sert de garde-corps. On
remarque sur le Berlin un pavois très haut, percé, sur chaque côté,
de quatre sabords (cinq exactement si l'on rajoute celui disposé
sous le pont du gaillard d'arrière). Ces pavois servaient à la protection
des matelots et plus particulièrement des canonniers lors des affrontements
navals.
Sur la frégate Berlin, le pavois fait partie intégrante du bordé.
Sur d'autres navires, le pavois était simplement constitué d'une
double rangée de filets entre lesquels on amassait les hamacs. Pendant
les combats, la toile des hamacs roulés serrés servait de protection
au personnel du pont contre les tirs de mitraille.
|
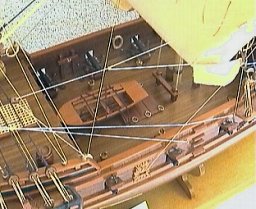 |
|
L'écusson du Wappen von Hamburg en
bois peint
|
Le pont du Berlin avec sa chaloupe
|
 |
|
A côté du tir de mousqueterie, œuvre
de fusiliers adverses groupés ou isolés, le principal danger qui
guettait les hommes sur le pont était les boulets ennemis.
Il y avait les simples boulets : sphères en fer, parfois en plomb
ou en pierre, fondus ou taillés au diamètre de la pièce. Puis, les
anges : deux boulets étaient reliés par une chaîne et s'envolaient
vers le gréement du bâtiment ennemi. Il y avait aussi des projectiles
plus sophistiqués : les grappes de raisin et les boîtes à mitraille.
La grappe de raisin était un assemblage de petits boulets de faible
diamètre dans un sac de toile ficelé. La boîte à mitraille était
un cylindre chargé de balles de fusil pour tuer l'équipage ennemi
à courte distance.
|
 |
|
 |
|
Anges, deux boulets reliés
par une chaîne
|
|
 |
|
|
Grappe de raisin
|
|
 |
L'histoire des combats navals est emplie
de ces matelots ou officiers qui avaient une jambe arrachée par
un boulet ou, pis encore, qui étaient décapités par des "anges".
La puissance des canons, l'arsenal des projectiles transformaient
les affrontements en mer en véritables carnages.
L'amiral Nelson, à Trafalgar, fut mortellement atteint d'une balle
tirée par un fusilier français depuis la hune du Redoutable. Le
lieutenant amiral général hollandais Michel de Ruyter, quant à lui,
fut victime d'un boulet qui l'atteignit grièvement aux jambes, à
la bataille d'Agosta en 1676, face à la flotte française commandée
par Duquesne. De Ruyter mourut de ses blessures une semaine plus
tard.
|
|
|
Boulets
|
|
 |
|
|
Boîte à mitraille
|
Poupe de la frégate Wappen
von Hamburg en acajou, sculptures en bois de cyprès ciré
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
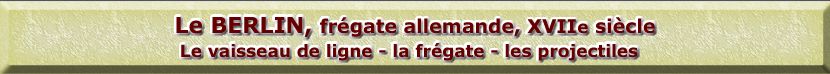



 Le Friesland, le
type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut
Le Friesland, le
type de vaisseau de ligne hollandais de deuxième rang. Il fut