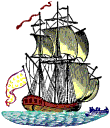|
||||||||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Jusqu'au XIXe siècle, on ne connaissait
pas grand-chose sur les navires vikings. Mais, en 1880, on trouva
dans un tumulus (une tombe) de près de 50 m de diamètre situé à
Gokstad, sur la rive du fjord d'Oslo, un drakkar parfaitement conservé.
Long de 23 m, large de 5, avec une hauteur de cale de 2 m, il a
été récemment daté des années 830 par dendrochronologie. En 1933,
on en trouva un autre à Äskekärr. Les archéologues pouvaient se
féliciter : les Vikings avaient l'habitude d'enterrer leurs chefs
avec leur navire de guerre. |
 |
|||||||||||||||||||||
|
Ci-dessous, l'avant en gros plan de la maquette (le langskip est un navire non ponté) |
Tête de viking casqué |
|||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
|
Maquette en teck d'un langskip ou drakkar |
||||||||||||||||||||||
|
D'où vient le mot drakkar? C'est une
invention française du XIXe siècle qui voulait donner une consonance
scandinave à des navires possédant une figure de proue en forme
d'animal, souvent le dragon. En fait le mot drakkar n'est connu
dans aucune langue scandinave. Les musées des pays nordiques consacrés
à la civilisation viking ne l'emploient pas. Dans la pratique, la
figure de proue servait souvent, par métonymie, à désigner le navire
tout entier. Il y avait des bisons, des béliers, des serpents et,
en majorité, des dragons. Le dragon, en vieux norois, est appelé
dreki (pluriel : drekar). De là vient sûrement la création du mot
drakkar, le deuxième k ayant visiblement été rajouté pour faire
plus vrai, plus sauvage... |
||||||||||||||||||||||
 |
Le bateau viking est un bâtiment bordé
à clin d'un mode de construction assez rudimentaire. On en a construit
un peu partout : il fallait juste un emplacement dégagé, dominant
une rivière navigable, près d'une forêt. Quand la coque était achevée,
on la poussait à l'eau sur des rondins. Une fois à quai, on mettait
en place l'accastillage. |
 |
||||||||||||||||||||
|
L'étrave du bateau de Gokstad est imposante
de fierté. |
||||||||||||||||||||||
|
Les langskips alliaient un faible tirant d'eau à un nombre important d'avirons afin de pénétrer profondément en amont des fleuves. Les boucliers des guerriers étaient fixés au-dessus des avirons. Ainsi, le plat-bord était rehaussé et protégeait les rameurs. Les navires étaient non pontés. L'équipage dormait dans des sacs de cuir sous une bâche pour se protéger des intempéries. |
||||||||||||||||||||||
|
A côté de la tradition guerrière, les Vikings avaient une très forte tradition marchande. L'Atlantique nord, la mer Baltique et la mer du Nord étaient sillonnés par un type de navire très bien adapté : le knarr. Ces navires, la plupart sans rames, étaient plus courts et plus larges que les langskips. Il n'est pas exagéré de dire que la Scandinavie des Vikings fut une véritable plaque tournante du commerce européen, une zone de transit particulièrement active entre l'Est et l'Ouest. |
|
|||||||||||||||||||||
 |
En provenance de la mer Blanche: peaux de cétacés, poissons, huile de poisson, lard de baleine et résineux. D'Angleterre ; vins, miels, froment et vêtements. Des ports vikings partaient des chargements de stéatite, la pierre de lard, recherchée par les potiers de toute l'Europe et les pierres à aiguiser indispensables aux agriculteurs. De Noirmoutier d'où les Vikings contrôlaient la vallée de la Loire arrivaient le sel et le vin. De l'embouchure du Rhin venaient les produits de la Rhénanie, d'Alsace et de l'Europe centrale : poteries, céramiques, verreries, armes franques. La Suède livrait son minerai de fer. |
|||||||||||||||||||||
|
Le knarr, navire marchand viking |
Acheminés le long des fleuves russes, puis par la Baltique arrivaient les produits de l'est de l'Europe et du Proche-Orient : soie, brocarts, épices et argent. Sans oublier le commerce sans doute le plus lucratif : la traite des esclaves razziés sans vergogne dans les steppes orientales sous prétexte qu'ils n'étaient pas chrétiens. |
|||||||||||||||||||||
 |
Le fait que les Vikings aient franchi le formidable Atlantique nord vers l'Islande, le Groenland et l'Amérique étonnent toujours les historiens. Malgré des naufrages sûrement nombreux, des infortunes de mer dues aux tempêtes, aux vents, à l'absence de boussole, les Scandinaves ont abordé les premiers des rivages nouveaux. La découverte en 1960 par l'archéologue norvégien Helge Ingstad d'un site viking à l'Anse-aux-Meadows à la pointe nord-ouest de Terre-Neuve a apporté la preuve définitive que les Vikings avaient découvert l'Amérique. Jusqu'où sont-ils allés? Certains prétendent qu'ils auraient été jusqu'à la latitude de New-York et même plus bas, jusqu'en Virginie. |
 |
||||||||||||||||||||
|
Langskip dans une fjord |
||||||||||||||||||||||
 |
L'histoire commence par les Iles Féroé,
atteintes dès le début du IXe siècle. Elle continue en 874 par l'Islande.
En 930, quand prend fin la première phase de la colonisation, ce
pays compte plus de 60 000 habitants. Suit en 986 le Groenland avec
une arrivée de 14 navires chargés de colons et de bétail conduits
par Éric le Rouge. Cette florissante colonie, dans le sud-ouest
de l'île, ne s'éteindra qu'au début du XVe siècle. En 986, le fils
d'un compagnon d'Eric le Rouge décida de rejoindre son père au Groenland
depuis l'Islande. Après avoir dérivé pendant plusieurs semaines,
il aperçut une terre "plate et boisée, semée de petits monticules".
C'était l'Amérique. Une demi-douzaine d'expéditions suivra, marquée
par un établissement durable. Malheureusement l'hostilité des indigènes
y mettra fin. |
|||||||||||||||||||||
|
Les voies par lesquelles les Vikings semaient l'effroi en Europe. Les guerriers du Nord sont descendus jusqu'en Méditerranée. |
||||||||||||||||||||||
|
Le langskip vu par le travers avant |
||||||||||||||||||||||
 |
Tous les spécialistes sont d'accord :
les Vikings ont bénéficié d'un climat clément pour parcourir les
mers et coloniser les terres les plus éloignées de leur pays d'origine.
La température des fjords était en moyenne de 4° supérieure à ce
qu'elle est aujourd'hui. La température au sud du Groenland pouvait
être comprise entre 13° et 14° degrés. C'était bien une terre verte.
L'eau de surface sur l'Atlantique nord était au moins de 2° supérieure
à celle qu'elle est aujourd'hui. |
|||||||||||||||||||||
|
Tête de dragon fixée à la proue et à la poupe des navires de guerre pour effrayer l'ennemi et les mauvais esprits. Elle était démontée à l'approche d'un rivage ami. |
||||||||||||||||||||||
|
Revenons en Europe. Après avoir contourné les côtes par cabotage, le navire de guerre viking pouvait pénétrer loin à l'intérieur des terres en remontant les fleuves grâce à son faible tirant d'eau. Les guerriers du Nord attaquaient l'ennemi par surprise, massacraient, rançonnaient, puis disparaissaient. A l'époque, les Européens n'avaient pas d'armes pour contrer cette véritable forme de commandos avant la lettre. On les vit combattre jusqu'en Méditerranée. Carolingiens, Bataves, Espagnols, Anglais furent des victimes presque passives pendant trois siècles. |
||||||||||||||||||||||
|
Le temps des Vikings aura duré près de
trois siècles. Débutant en 793 par le sac du monastère de Lindisfarne,
il s'achèvera en 1066 quand Harald Sigurdarson sera battu devant
York. La fin de l'hégémonie navale des Scandinaves s'explique par
plusieurs facteurs : |
|
|||||||||||||||||||||
 |
Navire entièrement ponté, muni de deux châteaux, haut de plus de 6 m à la cale, doté d'un gouvernail d'étambot et bien pansu, le cogge peut emporter près de 100 tonnes de charge utile. Evidemment, il a besoin de port en eaux profondes et condamne de ce fait les ports de première génération où langskips et knarrs pouvaient s'amarrer. Enfin, la construction de cogges demande des capitaux lourds quasiment introuvables dans la société scandinave. Désormais, l'histoire de l'Europe du Nord descend vers l'Allemagne : la Hanse va prendre le relais du commerce viking et multiplier comptoirs et factoreries sur toutes les côtes - de Nantes à Novgorod, de Dublin à Bergen - sous lesquels croisaient les langskips et les knarrs. |
|||||||||||||||||||||
|
Maquette d'un cogge de la Hanse, XIIe siècle |
La Hanse créera ensuite la hourque, navire plus gros que le cogge, permettant de doubler voire de tripler le tonnage des marchandises, mais également de se défendre contre les pirates et les corsaires grâce à ses nombreux canons. |
|||||||||||||||||||||