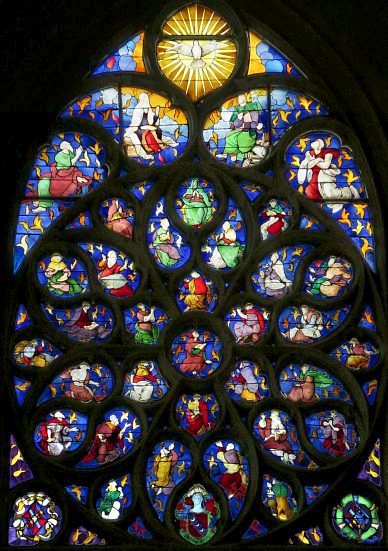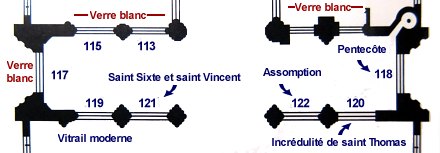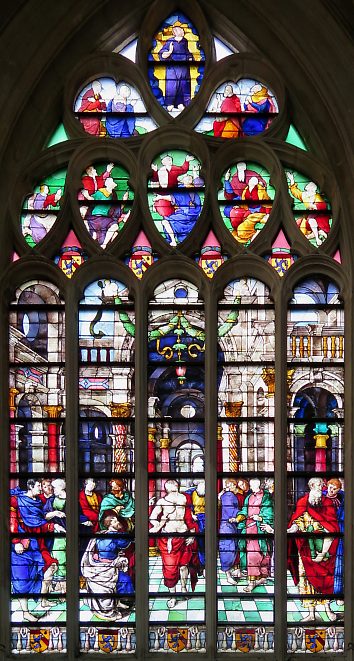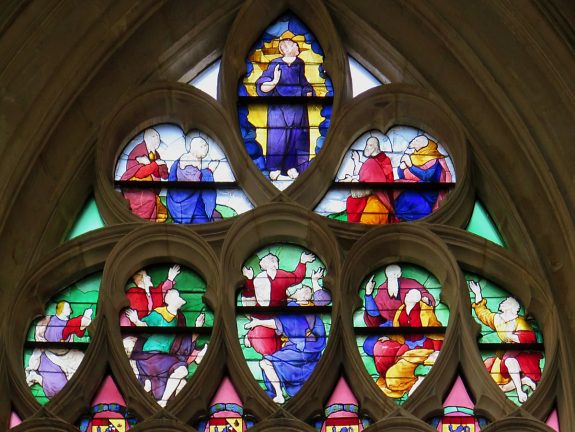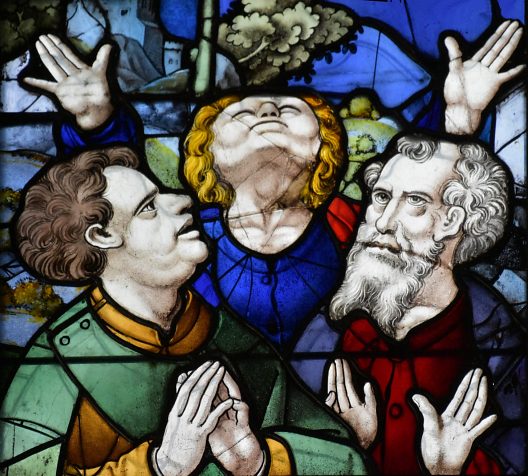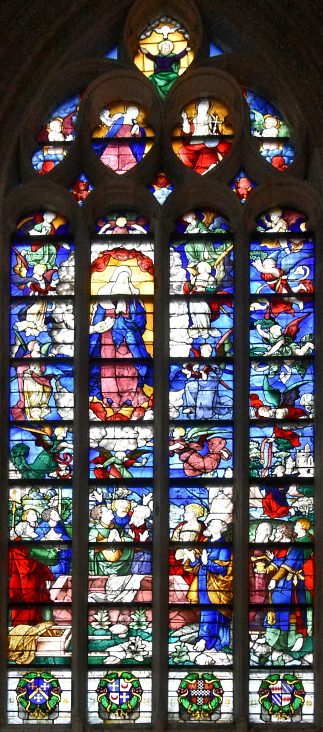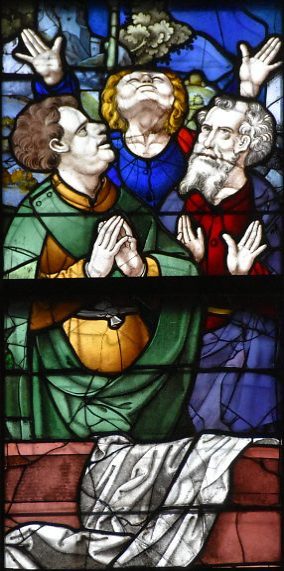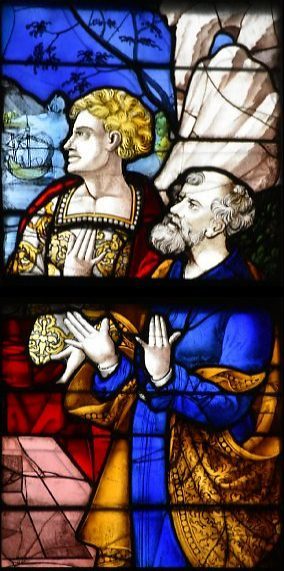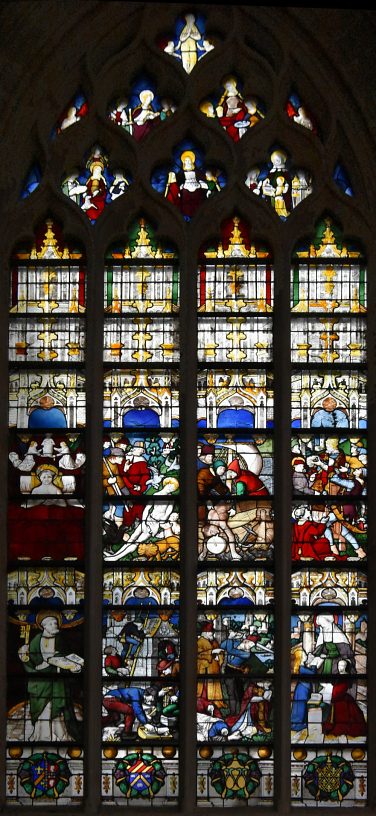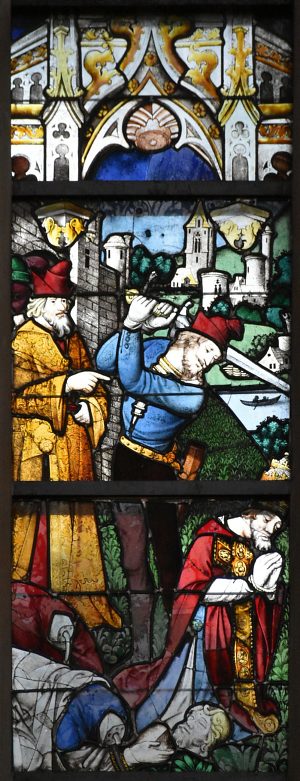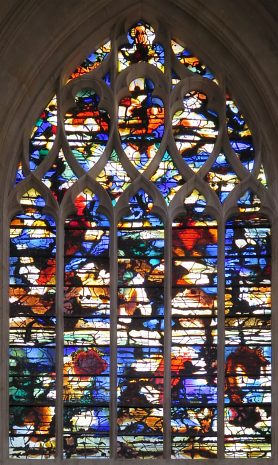|
|
 |
 |
Cette page est consacrée au transept
et à ses quatre grandes verrières du XVIe siècle.
La verrière de la baie 117 qui occupe la rose nord
est, en 2022, en restauration. Datée du XVIe siècle,
elle représente Dieu le Père entouré d'une
cour céleste. Du verre blanc la remplace. Datée de
la même époque, la verrière de la baie 119
représentait des scènes de la Vie publique du Christ.
Elle a été entièrement détruite en 2009
lors de l'incendie qui a ravagé l'atelier Courageux dans
l'Oise, chargé de la restauration. Une verrière
moderne du même atelier la remplace.
Les spécialistes du vitrail, Françoise Gatouillat
et Claudine Laudine, savent entretenir l'impatience des amoureux
des arts. En effet, en 1993, elles écrivent dans Vitraux
parisiens de la Renaissance que les verrières du transept
(situées par elles dans la période 1500-1520 et dont
la moitié n'est pas visible), possèdent des styles
extraordinairement divers. Cette diversité est due aux sources,
aux nombreux modèles, aux ateliers en présence, aux
cartons «parfois réutilisés de multiples manières».
Et qu'on ouvre ainsi deux champs d'examen très vastes : celui
du processus de création et celui de la transformation et
de la diffusion des styles.
En 2022, l'absence de la moitié des grandes verrières
(3 sur 6) ne permet pas de se faire une idée.
Quatre baies sont données dans cette page :
Baie
118 : Rose du Saint-Esprit (ou aussi rose de la Pentecôte)
;
Baie
120 : l'Incrédulité de saint Thomas ;
Baie
121 : Scènes de la vie du pape saint Sixte Ier et de
saint Vincent ;
Baie
122 : l'Assomption de la Vierge.
|
 |
| LE TRANSEPT ET
SES GRANDES VERRIÈRES |
|

La croisée du transept et le croisillon sud de l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois. |

Le croisillon sud du transept.
Il est enrichi de peintures murales et d'un bénitier en marbre
du XIXe siècle. |

Bénitier : «Trois enfants au pied de la croix»
par François Jouffroy (1806-1882), marbre. |

«L'Adoration des Mages»
Tableau de Joseph Guichard (1806-1880)
dans le croisillon sud. |

Le croisillon sud vu depuis la croisée.
Sur la droite, les baies 120
et 122.

|
Baie 118 : Rose du Saint-Esprit
---»»
Atelier de Jean Chastellain, 1532.
|
|
| BAIE 118 : LA
ROSE DU SAINT-ESPRIT (1532) |
|
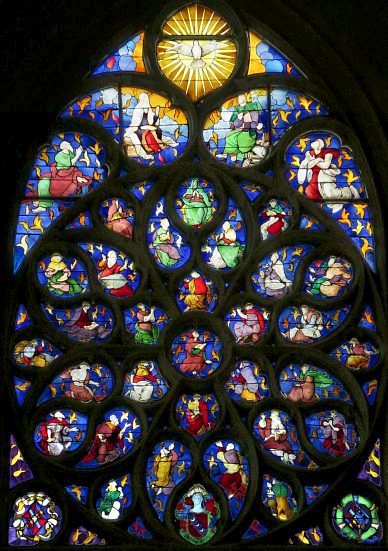 |
|
Baie
118 : Rose duSaint-Esprit.
Offerte en 1532 par Antoine Le Viste et
sa femme Charlotte Briçonnet, elle a été
réalisée par l'atelier parisien de Jean
Chastellain.
Lors de l'examen du vitrail, Élisabeth Pillet
révèle qu'elle a trouvé, dans le
médaillon central, une inscription, datée
de 1728, relative à une probable restauration.
Les historiens n'ont aucune trace d'une restauration
réalisée au XIXe siècle.
1728 ou pas, on peut constater la qualité de
la restauration dans l'art de combler les bouche-trous.
À preuve le gros plan donné ci-contre
de l'apôtre Jean (?) qui accompagne la colombe
du Saint-Esprit. Le bas de l'habit est peut-être
d'origine, mais le haut est à l'évidence
un remploi. Cependant leurs teintes s'harmonisent avec
l'ensemble de la mouchette. Et depuis le bas de la croisée,
il est impossible de distinguer les détails.
Source : Le vitrail
à Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver,
restaurer d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum,
P.U.R., 2010
|
|

Baie 118 : Rose de la Pentecôte, détail. |
|

Baie 118 : Rose de la Pentecôte, détail. |
 |

|
Baie 118 : Rose de la Pentecôte, détails.
|
|

|

«La Descente de croix», peinture murale dans le
croisillon sud, (1845).
Joseph Guichard (1806-1880), |
|
Prosper
Lafaye et la Commune.
Dans son ouvrage Le vitrail à Paris
au XIXe siècle (Corpus Vitrearum,
2010), l'historienne Élisabeth Pillet a établi
que le verrier Prosper Lafaye a eu la haute main
sur la restauration des vitraux anciens à Paris
après la guerre de 1870, bien qu'il ait commencé
sa restauration vers la fin des années 1860.
C'est pourquoi il est intéressant de lire le
Mémoire au sujet des vitraux anciens qu'il
adresse au préfet de la Seine dès 1871.
Il se félicite que Saint-Germain-l'Auxerrois
et ses verrières soient sortis indemnes des troubles
de la Commune :
«Par un hasard presque miraculeux, écrit-il,
auquel la rapidité des opérations de l'armée
libératrice n'a pas peu contribué, Saint-Germain-l'Auxerrois
a, comme d'autres églises, échappé
à la destruction qui lui était sans doute
réservée.» Les temples catholiques
n'ont pas été atteints par «l'impiété
des sectaires de la Commune».
Il se loue ensuite que, malgré sa proximité
avec les lieux du combat, «pas une seule vitre
n'a été brisée, rien de ce qui
se rattache à l'ornementation de l'église
n'a été ni enlevé ni détruit.
» C'eut été une grande perte, notamment
pour les verrières du transept car «l'administration
de la ville a fait, avec la plus louable libéralité,
les sacrifices considérables pour la réparation
des beaux vitraux qui le décorent.»
|
|
|
|
|

La voûte à liernes et tiercerons du croisillon
sud. |
|
Les
larmes de Marie-Madeleine (2/2).
---»» Les évangiles
canoniques ne précisent rien à propos
de ces larmes. Ils rapportent tous que Marie-Madeleine
se tenait à distance de la croix avec d'autres
femmes dont Marie, mère de Jésus
La position de la sainte agenouillée au
pied de la croix est une invention des artistes
irlandais et anglais, dès le VIIIe siècle.
Sur le continent, cette position de la sainte,
souvent peinte en contre-plongée et qui
la fait paraître plus grande, n'arrivera
qu'au XIIIe siècle sous l'influence des
franciscains.
Dans l'art, Marie-Madeleine va progressivement
se détacher du groupe des femmes qui observent
la Crucifixion, puis prendre une expression de
douleur très différente de celle
appliquée sur le visage de la Vierge. L'attitude
de Marie est toujours plus maîtrisée,
même lorsqu'elle est peinte évanouie.
Marie-Madeleine est représentée
plus expansive, entière, totalement humaine
et sous le joug de ses passions.
Les rôles seront dorénavant bien
séparés : à Marie-Madeleine,
les larmes ; à la Vierge, l'affliction
contenue.
Source : Marie-Madeleine
en tous ses états
d'Isabelle Renaud-Chamska, éditions du
Cerf, 2008.

On verra un second exemple de ces larmes
à la chapelle
Sainte-Colombe de la cathédrale
Saint-Étienne de Sens
dans un vitrail de la Crucifixion daté
de 1748. Un autre exemple, sur vitrail lui aussi,
est donné à la basilique
Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-du-Port.
Le vitrail est daté des années 1510-1520.
À l'opposé, les larmes peuvent être
vues comme un signe de tendresse. C'est le cas
quand la sainte est aux pieds de Jésus
lors du repas à Béthanie. Voir le
tableau Sainte Marie-Madeleine d'après Philippe
de Champaigne à l'église Sainte-Madeleine
de Besançon.
|
|
|
|
|
|

Baie 118, détail : la colombe du Saint-Esprit dans le
tympan (1532). |
|
Les grandes
verrières du transept.
«L'église Saint-Germain l'Auxerrois
ne possède plus que huit vitraux anciens dans le transept
: l'un date de la fin du XVe siècle, les sept autres
du premier tiers du XVIe siècle», écrit
l'historienne du vitrail, Élisabeth Pillet, en 2010
pour le Corpus Vitrearum. Mais, en 2022, si vous entrez
dans l'église, vous n'en verrez que quatre. La baie
119 a disparu
dans l'incendie de l'atelier de restauration en 2009. Les
verrières des baies 120
et 121,
déposées en 1993, sont revenues en place après
restauration. Les verrières 113, 115 et 117 sont, en
2022, en restauration.
Avant le XVIIIe siècle, il y avait dix verrières
dans le transept, ce qui correspond à toutes les baies
visibles. Une fois passé le XVIIIe, les verrières
sud-est 114 et 116 avaient disparu.
Le visiteur attentif remarquera la présence d'écussons
(modernes) au bas des verrières. En étudiant
les notes laissées par l'historien Nicolas-Michel Troche
au XIXe siècle, Élisabeth Pillet explique pourquoi.
Vers 1822, les verrières étaient entières.
Le vitrier que la Ville de Paris avait chargé de leur
entretien jugea bon de s'accaparer les vitraux de tous les
panneaux des soubassements, plus précisément
des dix-huit panneaux qui n'étaient pas en verre blanc.
On y voyait la continuation des scènes de la baie et
les blasons des donateurs. Pis, il fit payer par la Ville
le verre blanc qu'il posa à la place ! Les réclamations
posées par la fabrique et les restaurateurs de l'église
ne purent rien changer...
Un peu plus tôt, vers 1806, le vitrier Adelin eut une
idée qui paraît bien cocasse : remplacer les
parties en verre blanc qui se trouvaient dans le soubassement
et les parties hautes de certaines verrières par le
verre de couleur que l'on aurait extrait des deux roses nord
et sud du transept ! Les roses auraient reçu du verre
blanc.
Une autre solution aussi cocasse fut proposée : aller
chercher le verre de couleur dans les baies 113 et 115 du
bras nord pour réparer les autres ! Ces deux baies
seraient mises en verre blanc. Ainsi on établirait
une symétrie avec les deux grandes baies 114 et 116
du bras sud. Ces projets ne furent heureusement jamais réalisés.
Source : Le vitrail à
Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver, restaurer
d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum.
|
|
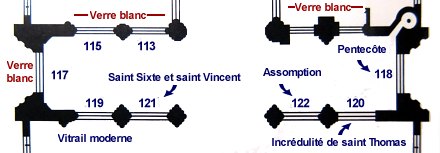
Les grandes verrières du transept. |
|
LES GRANDES
VERRIÈRES DU TRANSEPT

113, 115 et 117 : verre blanc (en restauration) ;
118 : Rose
du Saint-Esprit ou rose de la Pentecôte ;
119 : Verrière
originale incendiée en 2009, vitrail moderne de l'atelier
Courageux ;
120 : Verrière
Renaissance de l'Incrédulité de saint Thomas
;
121 : Scènes
de la vie de saint Sixte et de saint Vincent ;
122 : Verrière
Renaissance de l'Assomption de la Vierge.
|
|
| BAIE 120 : L'INCRÉDULITÉ
DE SAINT THOMAS (1533) |
|

Baie 120, détail : saint Thomas. |

Baie 120, détail : un apôtre. |
|
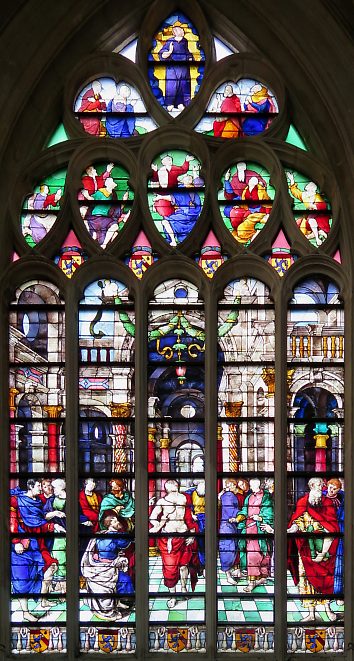
|

Baie 120, détail : le Christ ressuscité. |
|
«««--- Baie
120
L'Incrédulité de saint Thomas.
Atelier de Jean Chastellain, 1533
|
|
|
|
Baie 120
: l'Incrédulité de saint Thomas.
Cette verrière à cinq lancettes et tympan, de
huit mètres sur quatre, datée de 1533, a été
offerte par Antoine Bohier, conseiller du roi et général
de ses finances. Comme cette de la rose de la baie 118,
elle a été réalisée par l'atelier
de Jean Chastellain.
La scène principale présente les douze apôtres
autour du Christ. Ils sont douze. On en déduit que
Matthias a déjà pris la place de Judas. Devant
un portique riche de plusieurs colonnettes aux formes et chapiteaux
variés, Thomas met deux doigts dans la plaie ouverte
par le coup de lance du centurion Longin. Le tympan
illustre l'Ascension.
Pour le Corpus Vitrearum, Élisabeth Pillet rapporte
que, en juillet 1840, l'église accueillait une cérémonie
funèbre pour le transfèrement des morts de juillet
1830 dans les caveaux situés sous la colonne de la
Bastille. À cette occasion, les ouvriers ont gravement
endommagé la verrière.
En 1871, la réparation n'avait pas été
effectuée : selon Prosper Lafaye, responsable des restaurations
des verrières anciennes de l'église depuis 1870,
celle-ci présentait toujours des dommages importants
(vraisemblablement dans le soubassement).
La dernière restauration date de 2001-2002. À
cette occasion, «aucune pièce n'a pu être
attribuée de façon certaine à une restauration
antérieure aux dernières années du XIXe
siècle», écrit Catherine Pillet. Même
si la verrière paraît de très bonne qualité,
on peut en conclure qu'il est difficile d'obtenir un schéma
précis des restaurations passées.
En 1958, dans Le vitrail français, Jean Lafond
sigale que, avec l'Incrédulité de saint Thomas,
Saint-Germain-l'Auxerrois «possède du second
quart du siècle [le XVIe] une œuvre marquante
et dont le mérite n'a jamais été méconnu
(...).»
Il poursuit : «Bien conservé dans l'ensemble,
ce grand vitrail heureusement composé et dessiné
porte les armoiries d'Antoine Bohier et d'Anne Poncher. Il
ne se rattache pas pour autant à l'art de la Loire
; son coloris est trop bariolé en général
et trop soutenu dans la partie centrale du temple, où
les murailles et les voûtes sont bleues, vertes et violettes.»
Sources : 1) Le vitrail à
Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver, restaurer
d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum ; 2) Le
Vitrail français, éditions Mondes, 1958.
|
|

Baie 120, détail : têtes d'apôtres. |

Baie 120 : l'Incrédulité de saint Thomas, les
registres du bas.
La rangée basse, constituée de panneaux identiques d'armoiries,
est moderne. |
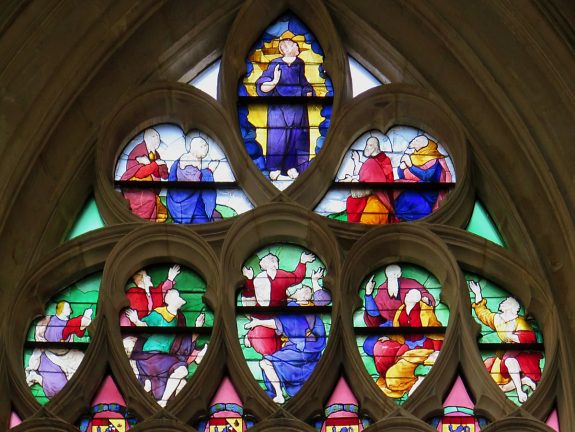
Baie 120, tympan : l'Ascension.
Atelier de Jean Chastellain, 1533. |

Baie 120, détail : un apôtre. |
 |

|
Baie 120
L'Incrédulité de saint Thomas.
Atelier de Jean Chastellain, 1533.
Têtes d'apôtes.
|
|
 |
 |
|
Baie 120 - L'Incrédulité
de saint Thomas.
Atelier de Jean Chastellain, 1533.

Deux priants à genoux dans l'Ascension au tympan.
|
|
| BAIE 122 : L'ASSOMPTION
DE LA VIERGE (Vers 1534-1535) |
|
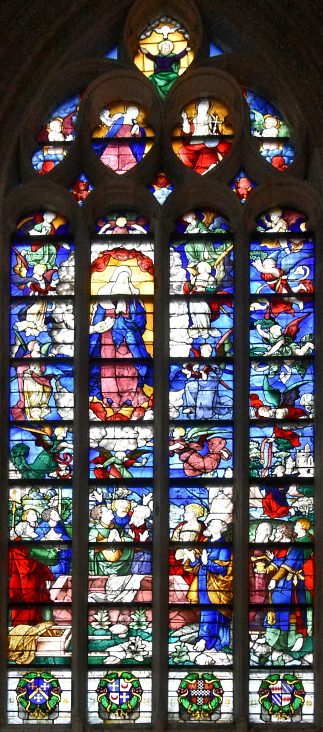
Baie 122 : l'Assomption de la Vierge. |
|
Baie 122, détail
: les apôtres ---»»
|
|
|
|
Baie
122 : L'Assomption de la Vierge (1/2).
Cette verrière est datée par
l'historienne Élisabeth Pillet des années
1534-1535. Son auteur reste inconnu. Il y a peu de pièces
de restauration, mais les panneaux du soubassement sont
modernes.
La Vierge s'élève dans les nuées,
au milieu des anges, tandis qu'au sol les apôtres
(voir plus
bas en gros plan) sont bouleversés à
la vue du tombeau vide.
La scène de l'Assomption est parfois surnommée
La seconde incrédulité de saint Thomas.
Selon un récit légendaire, l'apôtre,
refusant de croire à l'Assomption, fait ouvrir
le tombeau de Marie et le trouve rempli de fleurs. (Dans
cette verrière de la baie 122, le tombeau est
vide.) Du ciel, la Vierge détache sa ceinture
et la laisse choir dans les mains de Thomas. L'apôtre
en question est peint au second plan, dans la dernière
lancette. Il se saisit de la ceinture que lui tend un
ange. La scène est donnée plus
bas.
Les amateurs d'histoire navale seront étonnés
par la forme donnée au navire, à l'arrière-plan,
dans le vitrail ci-dessous, à droite. Ce navire
est dessiné avec une poupe et une proue très
relevées et une seule voile. Il ne correspond
plus aux navires marchands du XVIe siècle, mais
plutôt à ceux des XIIe et XIIIe siècles,
une époque où les constructeurs imposaient
aux extrémités d'un bateau d'être
le plus relevé possible afin de prendre l'ascendant
sur un assaillant éventuel. C'est un anachronisme
dans le dessin : au premier siècle de notre ére,
les navires marchands n'avaient ni poupe ni proue relevées
de la sorte. ---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|
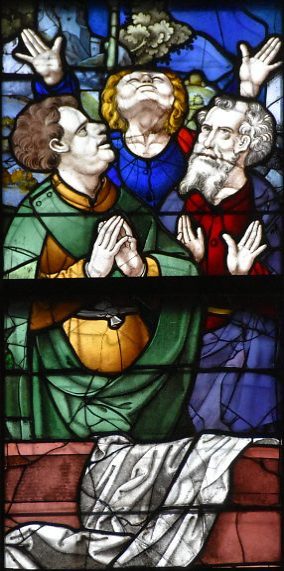 |
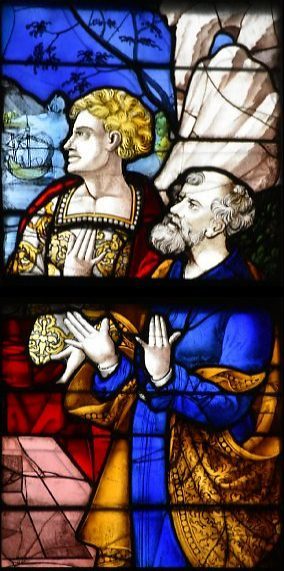 |
|

Baie 122, détail : la Vierge entourée d'anges. |
|
Baie
122 : L'Assomption de la Vierge 2/2).
---»» Dans son rapport adressé
en 1871 au préfet de la Seine, Prosper Lafaye,
qui a été chargé de la restauration
de la verrière, résume les tribulations
qui ont freiné sa tâche compte tenu de
la guerre contre la Prusse : difficulté de trouver
des ouvriers pour déplacer le vitrail ; une fois
trouvés, ceux-ci ont dû se déguiser
en gardes nationaux pour le transporter jusqu'à
l'atelier ; travail interrompu à plusieurs reprises
à cause du découragement causé
par le «spectacle qui paralysait l'esprit».
Et il termine en disant que la restauration fut achevée
quand l'Hôtel-de-Ville n'existait plus [brûlé
sous la Commune]...
Cela ne l'a pas empêché d'être très
impressionné par la qualité de l'œuvre.
Il écrit en effet : «Si les émotions
qui ont agité l'auteur pendant le travail de
restauration pouvaient en augmenter la valeur, le prix
en serait au-delà de toute expression».
Sources : 1) Mémoire
au sujet des vitraux anciens dans les églises de Paris
de M. Lafaye, 1871 ; 2) Le vitrail à Paris au XIXe
siècle d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum, 2010.
|
|
|

Baie 122, détail : Thomas se saisit de
la ceinture de la Vierge. |

Baie 122, l'Assomption : les apôtres sont bouleversés
à la vue du tombeau vide.
Vers 1534-1535.
Les panneaux du soubassement avec les armoiries sont du XIXe siècle. |
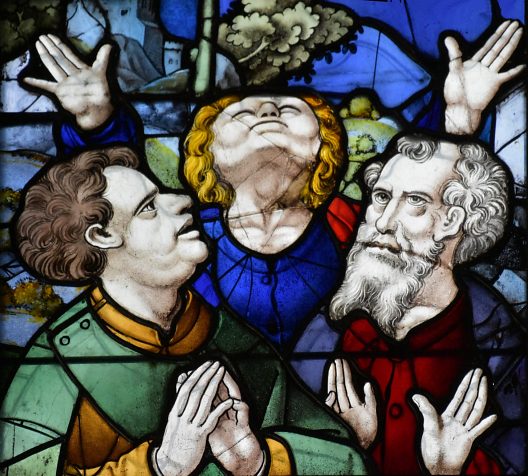 |

Baie 122, l'Assomption : les apôtres sont bouleversés
à la vue du tombeau vide.
Vers 1534-1535. |

Baie 122, détail : les apôtres regardent l'Assomption
de Marie.
Vers 1534-1535. |

Baie 122, détail : La Vierge en son Assomption.
Vers 1534-1535. |

Voûte du croisillon nord du transept.
Elle n'est pas aussi travaillée que celle
du croisillon sud. |
|
Le
transept existait-il avant la fin du XVe siècle
?
Dans son ouvrage Les églises flamboyantes
de Paris (Picard, 2003), l'historienne Agnès
Bos montre qu'il faut revoir les dates de construction
données traditionnellement pour Saint-Germain-l'Auxerrois.
Qu'en est-il du transept ? La chronologie habituelle
donne le transept actuel élevé au XVIe
siècle. Toutefois quelques contre-exemples subsistent.
Ainsi, en 1936, Maurice Dumolin dans Les églises
de France, Paris et la Seine, date le transept (et
la nef)
de la première moitié du XVe siècle.
En 1966, Maurice Eschapasse, inspecteur des monuments
historiques, retient pour le Dictionnaire des églises
de France (Éd. Laffont) la période
1435-1439, une année où l'on aurait également
bâti le porche
et les chapelles nord de la nef.
1435-1439 : cinq courtes années où l'on
aurait donc beaucoup bâti... Comme le remarque
Agnès Bos, cette hypothèse n'est pas crédible
: Paris était en proie à une épidémie
de peste, à la disette ; l'argent manquait et
la ville ployait sous la férule anglaise depuis
1420... Le départ des troupes occupantes en 1436
n'a pas entraîné un changement rapide.
La lecture des délibérations capitulaires
de l'époque parlent, au contraire, du mauvais
état d'une partie de l'église autour des
années 1430-1440. Pressée par les chanoines,
qui lui adressent des dons, la fabrique engage des travaux.
Mais ils ne suffisent pas : il y a trop d'éléments
à restaurer. En 1440, les marguilliers traînant
encore, le chapitre les menace d'un procès...
Dans cet environnement conflictuel et fragile, comment
mener des travaux importants ? Tout porte donc à
croire que le transept actuel date de la charnière
fin du XVe siècle - début du XVIe.
Les documents d'époque consultés par Agnès
Bos le prouvent. On sait ainsi qu'en 1488 les travaux
du nouveau transept étaient en cours. L'historienne
écrit que «l'achèvement des bras
du transept fut long.» En effet, en 1517, des
maçons furent payés pour un travail dans
le transept et, en 1519, «la vis du bras sud du
transept ainsi que le mur occidental de clôture
du trésor devaient encore être réalisés.»
Y avait-il déjà un transept avant celui
de la fin du XVe siècle ? Agnès Bos pose
cette intéressante question et y répond
positivement.
Plusieurs faits entrent en considération. D'une
part, un document de 1402 indique qu'il y avait une
porte au nord en sortant du chœur
pour aller au chapitre. D'autre part, la décision
de la fabrique de faire construire un porche
dès le XIVe siècle du côté
ouest montre que ce côté était le
lieu d'entrée des paroissiens. On en déduit
que la porte nord était réservée
aux chanoines du chapitre. Était-ce une simple
porte ? C'est inenvisageable. Compte tenu des dimensions
de l'église, les chanoines du «puissant»
[Bos] chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois n'auraient
pas accepté un passage aussi réduit. On
en conclut que le transept existait déjà
avant la reconstruction de la nef à la fin du
XVe siècle. Et accessoirement que l'agrandissement
de la nef, lors de cette reconstruction, ne pouvait
être entrepris ni à l'est ni à l'ouest
(voir l'encadré La
nef et ses bas-côtés en page 1).
Source : Le vitrail
à Paris au XIXe siècle. Entretenir, conserver, restaurer
d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum, P.U.R. 2010.
|
|
 |
|

La croisée du transept avec l'élévation
nord du chœur.
Les grandes verrières du bras nord du transept (baies
113 et 115)
que l'on aperçoit reçoivent du verre blanc.
En 2022, ces verrières sont en restauration. |

Statue de saint Vincent, diacre.
Pierre, fin du XVe siècle. |

Consoles à la retombée
des voûtes dans le transept, à l'est.

À l'est, dans la croisée, les voûtes
retombent sur des consoles
très sobres. Au côté ouest,
il n'y a pas de consoles. |
|

Statue de saint Germain d'Auxerre.
Bois, XVe siècle. |

Tronc en fonte conçu par Jean-Baptiste Lassus,
XIXe siècle. |
|
|
«««--- Bras
nord du transept avec les piles de la croisée.

Elles ne sont pas conçues selon la même
architecture.
À l'ouest, toutes les colonnettes retombent en
pénétration.
À l'est, les ogives des arcs principaux retombent
sur des colonnettes
butant sur des consoles.
On retrouve ces consoles dans les retombées d'ogives
du chœur.
En 2022, la rose de la baie 117, dans le bras nord du
transept,
est en restauration. Ce que l'on voit est du verre blanc.
|
|
|
| BAIE 121 : SCÈNES
DE LA VIE DE SAINT SIXTE ET DE SAINT VINCENT (Vers 1490-1500) |
|
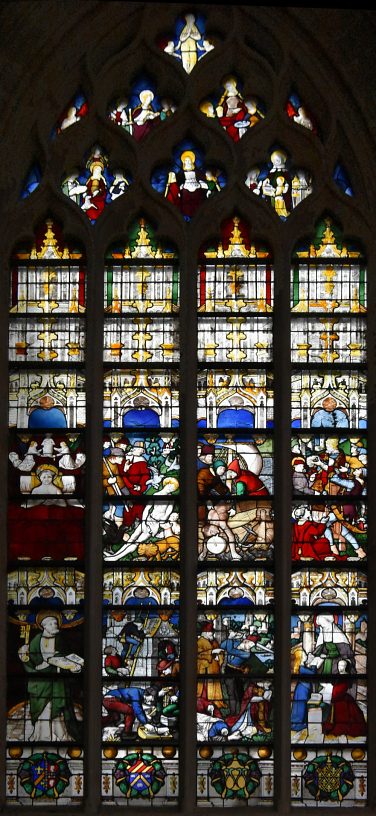
|
|
Baie
121 : Scènes de la vie de saint Sixte et saint
Vincent (2/2).
---»» La très haute qualité
des trois panneaux décrivant les maçons
au travail (ci-contre) ne laisse pas d'étonner.
Lafaye décrit l'ensemble comme un «tableau
de mœurs du XIVe siècle».
Le restaurateur se montre très laudateur sur
le panneau illustrant la découverte .par des
paysans du corps nu et mort de saint Vincent, laissé
intact par les bêtes sauvages (donné plus
bas). «Cette peinture, écrit-il, traitée
en maître, particulièrement le côté
où cette foule contemple l'homme couché
par terre, est digne en tout point des premiers artistes
de cette époque, si admirés des connaisseurs.»
Sources : 1) Mémoire
au sujet des vitraux anciens dans les églises de Paris
de M. Lafaye, 1871 ; 2) Le vitrail à Paris au XIXe
siècle d'Élisabeth Pillet, Corpus Vitrearum, 2010.
|
|
|
|
Baie
121 : Scènes de la vie de saint Sixte et de saint
Vincent (1/2).
Ce vitrail est daté par le Corpus
Vitrearum des années 1490-1500, sans lui
attribuer d'atelier. Il a été restauré
par Prosper Lafaye en 1868-69 et présente plusieurs
panneaux assemblés en deux groupes. Deux concernent
la vie de saint Sixte Ier, pape de 119-128 (son arrestation
et son martyre).
Trois concernent la vie de saint Vincent. Il faut y
rajouter un saint Pierre disproportionné, une
magnifique description de maçons construisant
un oratoire et enfin une Éducation de la Vierge.
Dans le tympan, la Vierge est accueillie par la Trinité.
Dans l'Éducation de la Vierge (trois panneaux
donnés ci-dessous à droite), la donatrice
(ou sa fille?) est présentée par sainte
Anne à la la jeune Marie. Détail étonnant
: on ne peut qu'être étonné par
la différence de beauté entre les deux
jeunes filles. Deux photos plus
bas les montrent côte à côte.
Il est clair que les visages ne sont pas ceux du même
modèle...
Élisabeth Pillet (Corpus Vitrearum) nous
apprend que le devis signé entre la Ville de
Paris et Prosper Lafaye signale que la partie supérieure
du vitrail est très endommagée et que
l'architecture doit être «passée
au feu» (!) Pour l'historienne, le vitrail est
relativement peu touché par les restaurations.
Le soubassement doit être classé à
part : le restaurateur y a inséré des
blasons fantaisistes.
En 1871, dans son mémoire au préfet de
la Seine, Prosper Lafaye se montre très enthousiaste
sur cette verrière qui «pourrait être
placée dans un musée». ---»»
Suite 2/2
plus bas.
|
|
|
«««--- Baie
121 : Scènes de la vie du pape saint Sixte
Ier et de saint Vincent.
Vers 1490-1500.
Les armoiries «fantaisistes» [Corpus Vitrearum]
sont des créations
de l'atelier du restaurateur Prosper Lafaye en 1868-69.
|
|
 |

Baie 121, détail : l'Éducation de la Vierge
avec la donatrice (ou la fille du donateur).
«««---
Baie 121, détail :
des maçons construisent un oratoire.
Vers 1490-1500.

Pour le restaurateur Prosper Lafaye,
cette scène est un tableau de
mœurs du XIVe siècle. |
|
|

Baie 121, détail : Marie reçoit les leçons
de sa mère Anne.
Vers 1490-1500. |

Baie 121, détail : la donatrice (ou peut-être
la fille du donateur).
Vers 1490-1500. |
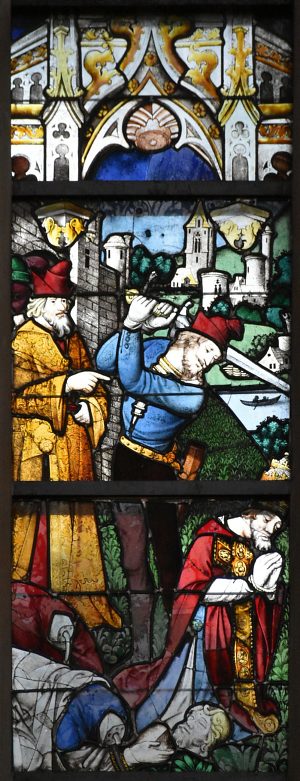
Baie 121, détail : martyre du pape saint Sixte
Ier.
Vers 1490-1500. |

Baie 121, détail : la dépouille de saint
Vincent est précipitée à la mer.
Saint Vincent de Saragosse est parfois représenté
attaché à une meule. Vers 1490-1500. |
|
Baie
121 : les louanges de Prosper Lafaye.
En 1871, dans son rapport au Préfet
de la Seine, le restaurateur ne tarit pas d'éloges
sur cette verrière de saint Sixte et saint Vincent
qu'il a vue de très près. Il écrit
: «L'intérêt devient plus intense
à mesure qu'on examine plus attentivement cette
fenêtre, bien qu'il n'y ait aucune suite dans
les images qui la composent, et que l'ordonnateur les
ait placées çà et là, du
haut en bas. L'ordre manque dans ces histoires, sans
doute rapportés où elles sont par les
transformations si communes chez nous. Mais il y a là
des pièces d'une telle puissance et d'une fécondité
de conception, qu'à leur aspect l'esprit se laisse
aisément entraîner jusqu'à l'admiration
!»
|
|
|
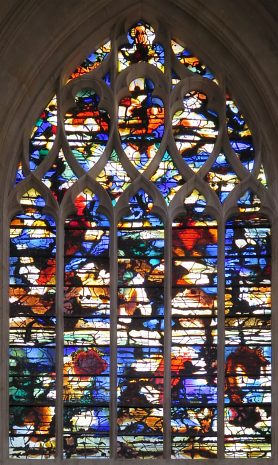
Baie 119 : vitrail moderne dans le croisillon nord du
transept.
(Atelier Courageux, 2011).
Ce vitrail a été créé par Courageux
pour remplacer la verrière
du XVIe siècle détruite dans l'incendie de son
atelier en 2009. |
|

Baie 121, détail : le visage (redressé)
de saint Vincent
précipité à la mer. Atelier inconnu.
Vers 1490-1500.
|
|

Baie 121, détail : arrestation du pape saint Sixte Ier.
Vers 1490-1500.
|

Baie 121, détail : des paysans découvrent
le corps de saint Vincent, laissé mort parmi les bêtes
sauvages (vers 1490-1500).
Les deux visages au centre ont été créés
avec le même carton. |

Baie 121, détail : deux hommes en précipitent
un troisième à la mer.
Vers 1490-1500. |
|

Baie 121, détail : saint Pierre
Vers 1490-1500. |

Baie 121, détail : arrestation du pape saint Sixte Ier.
Vers 1490-1500. |
 |
Documentation : «Paris d'église
en église», éditions Massin, 2007
+ «Les églises de France : Paris et la Seine»,
Librairie Letouzey et Ané, 1936
+ «Les églises flamboyantes de Paris» d'Agnès
Bos, éditions Picard, 2003
«Saint-Germain l'Auxerrois», dépliant disponible
dans l'église
+ «Le vitrail à Paris au XIXe siècle. Entretenir,
conserver, restaurer» d'Élisabeth Pillet, Corpus
Vitrearum, P.U.R., 2010
+ «Les vitraux de Paris, de la Région Parisienne et du
Nord-Pas-de-Calais», Corpus Vitrearum, CNRS, 1978
+ «Vitraux parisiens de la Renaissance», Délégation
à l'Action artistique de la Ville de Paris, 1993
+ «Mémoire au sujet des vitraux anciens dans les églises
de Paris» de M. Lafaye, 1871
+ «L'Art de Paris» de Jean-Marie Pérouse de Montclos,
éditions Place des Victoires, 2008
+ «Dictionnaire des Monuments de Paris», éditions
Hervas, 1992
+ «Mgr de Quélen et les incidents de St-Germain-l'Auxerrois
en février 1831» de Guillaume de Bertier de Sauvigny,
Revue d'Histoire de l'Église de France, 1946 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|