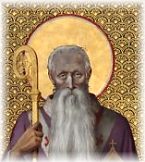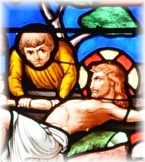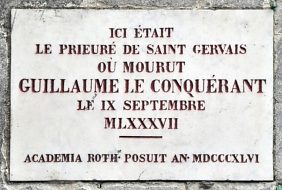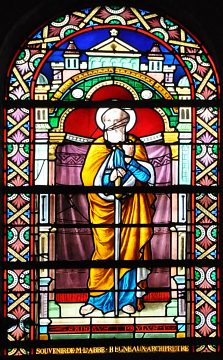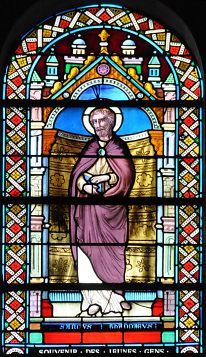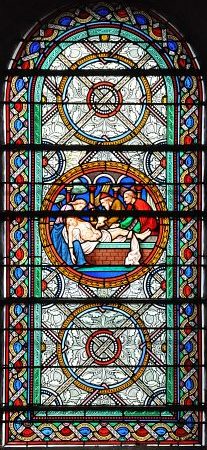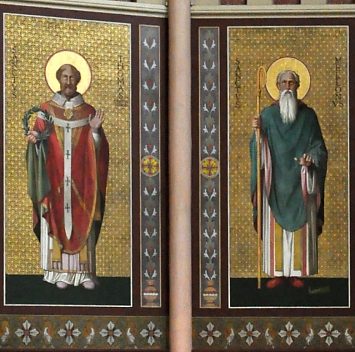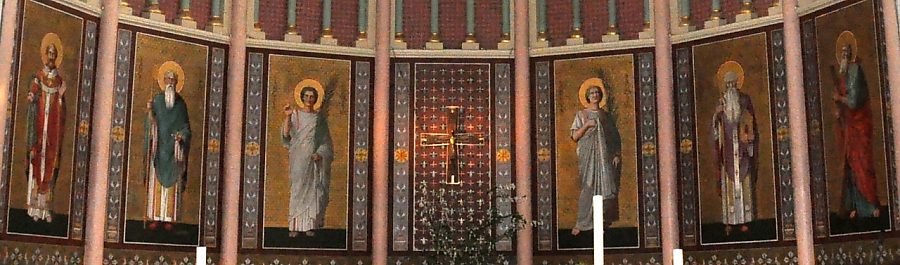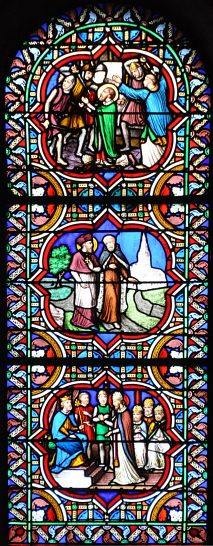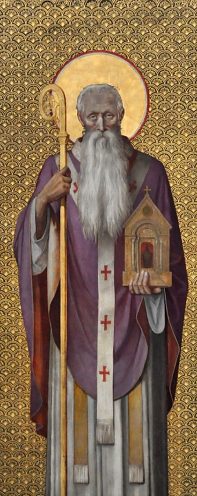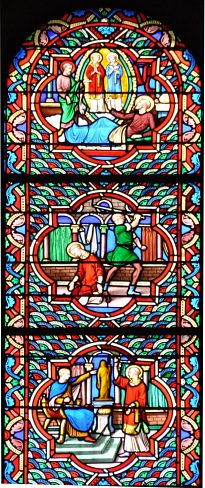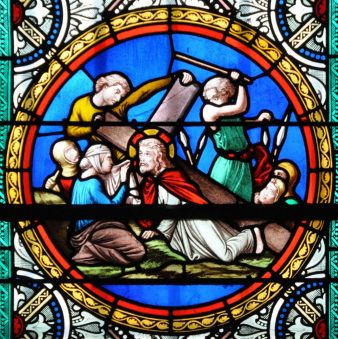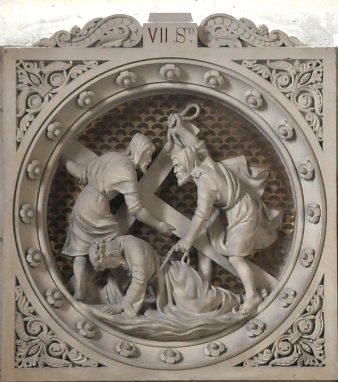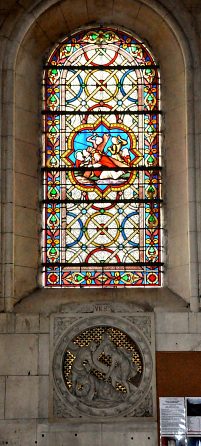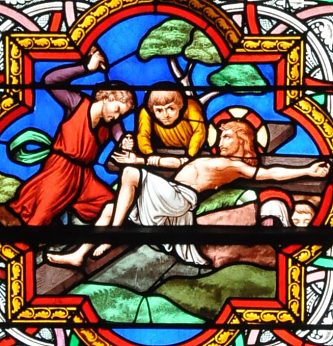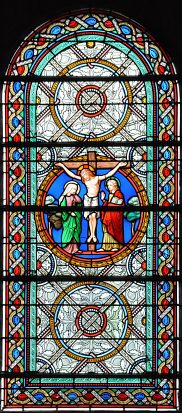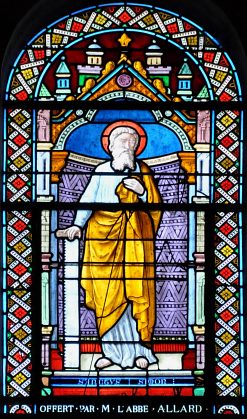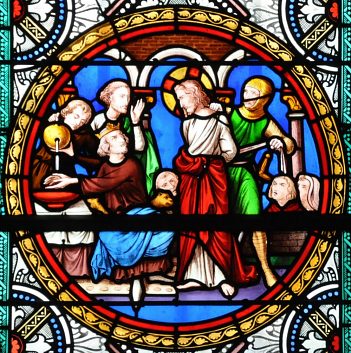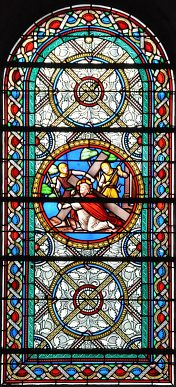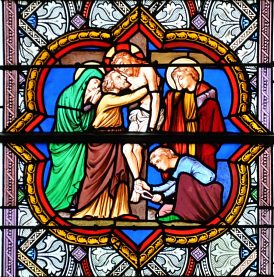|
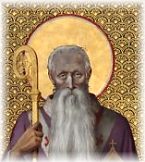 |
L'église Saint-Gervais de Rouen
ne fait pas partie du circuit des églises de la ville à
ne pas manquer, comme la Cathédrale,
Saint-Ouen
ou Saint-Maclou.
C'est un édifice néo-roman, typique de la seconde
moitié du XIXe siècle, construit par les architectes
Martin et Marical de 1868 à 1874. Saint-Gervais est une église
assez vaste, (photo ci-dessous) avec deux larges bas-côtés.
On y remarque un grand retable
en pierre dans chacune des deux chapelles absidiales, des vitraux
pastiche du XIIIe siècle et un chœur
embelli de belles peintures murales de Savinien Petit, un peintre
aujourd'hui bien méconnu. À voir aussi une belle chaire
à prêcher XIXe siècle très ouvragée.
L'église Saint-Gervais a été bâtie à
l'emplacement d'un ancien sanctuaire qui remonterait aux temps des
Carolingiens, dans un endroit qui était le Rouen
extra muros. Au début du XIe siècle, ce sanctuaire
fut rattaché à un prieuré dépendant
des Bénédictins de l'abbaye de Fécamp.
Guillaume le Conquérant vint y mourir en septembre
1087. Dégradée, détruite, reconstruite au gré
des malheurs de l'Histoire, cette antique église est restée
pauvre dans un quartier pauvre, celui des artisans tisserands. Du
bâti d'origine, il ne reste que la crypte, située sous
le chœur actuel.
|
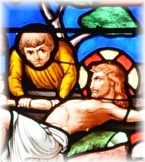 |

Vue d'ensemble de la nef de l'église Saint-Gervais. |

Le clocher et la porte sud face au square
de la «Place de l'église Saint-Gervais». |

Le chevet s'élève au-dessus d'une très ancienne
crypte. |

L'église néo-romane vue du nord. |
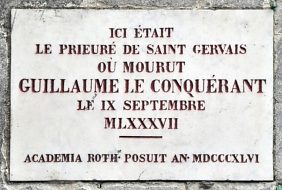
Plaque rappelant la mort de Guillaume le Conquérant en ce lieu. |
|
Guillaume
le Conquérant, âgé de 52 ans
et guerroyant contre des troupes royales françaises
dans le Vexin en 1087, fut contraint, par blessure ou maladie,
de regagner sa capitale, Rouen.
C'est au prieuré Saint-Gervais qu'il va agoniser pendant
plusieurs jours avant de s'éteindre le 9 septembre
de la même année (cf. plaque du souvenir accolée
au mur de l'église et donnée au-dessus). Lucide,
il a le temps de régler sa succession entre ses trois
fils... qui régleront leurs comptes sur les champs
de bataille peu de temps après. La dépouille
du Conquérant sera transportée à Caen
et inhumée en l'église Saint-Étienne
de l'abbaye-aux-Hommes.
|
|

Peinture murale sur le fronton du portail principal.
Saint Gervais et saint Protais en adoration devant le Sacré-Cœur,
XIXe siècle. |

Le portail occidental néo-roman. |

L'élévation gauche dans la nef.
Les chapiteaux sont jumelés à un large tailloir qui
reçoit la naissance des voûtes en plein cintre.
On remarquera l'originalité du triforium fermé avec
un jeu d'arcades qui s'entrecroisent. |

Vitrail du Chemin de croix, station V :
«Simon le Cyrénéen aide Jésus à
porter sa croix»
Fin du XIXe siècle. |
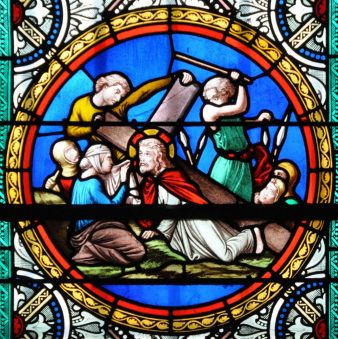
Vitrail du Chemin de croix, station VI :
«Véronique essuie la face de Jésus». |

Les fonts baptismaux, XIXe siècle.
La cuve est illustrée de beaux bas-reliefs représentant
les quatre évangélistes. |
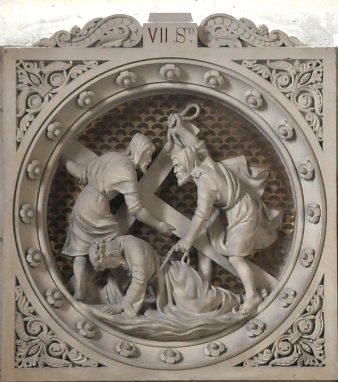
Chemin de croix, station VII :
Jésus tombe pour la deuxième fois. |

Bas-relief du bon Pasteur sur le dosseret d'un siège
de chœur. |
|
|
Le
chemin de croix de l'église
Saint-Gervais est double (ce qui n'est pas très
fréquent). Les bas-reliefs en pierre, qui
illustrent les stations de la Passion, sont doublés
de riches vitraux à motifs géométriques
(exemple ci-contre). Au centre de chaque vitrail
brille un médaillon qui reprend le thème
du numéro de la station (créations
de la seconde moitié du XIXe siècle).
L'expression des personnages inclus dans les médaillons
est parfois assez déroutante, comme le
visage
plutôt féroce du Christ au moment
où les bourreaux s'apprêtent à
le clouer sur la croix.
|
|
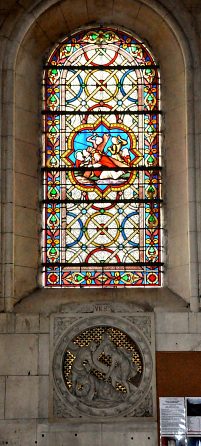
Chemin de croix, station IX :
«Jésus tombe pour la troisième fois». |

Les fonts baptismaux et le bas-relief du baptême
de Jésus (XIXe siècle). |
|

|

Chemin de croix, station 1 :
«Jésus est condamné».

«««---
Vitrail du Chemin de croix, station V :
«Simon le Cyrénéen aide Jésus
à porter sa croix»
XIXe siècle, pastiche du XIIIe. |
|

Le bas-côté gauche vers l'avant-nef. |
 |
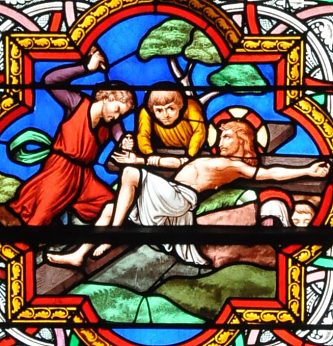
Vitrail du Chemin de croix, station XI :
«Jésus est attaché à la croix».
«««---
Apparition du Sacré-Cœur à sainte
Marie-Marguerite Alacoque
dans le bas-côté nord, XIXe siècle,
atelier inconnu
Ce vitrail reprend l'un des grands thèmes
de l'iconographie
chrétienne à la mode dans la seconde
moitié du XIXe siècle. |
|
|
|
|
L'ÉLEVATION DANS LA NEF ET LES VITRAUX
DU SECOND NIVEAU
|
|

Le bas-côté droit et la nef.
Au premier plan à droite, l'entrée de la crypte,
datée d'avant l'an mil.
(Elle est malheureusement très souvent fermée.) |
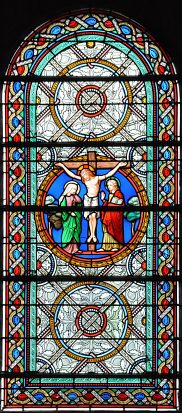
Vitrail du Chemin de croix, station XII :
«Jésus meurt sur la croix». |
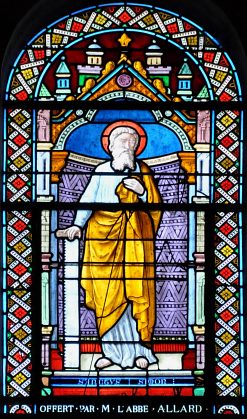
Saint Simon
Vitrail du second niveau dans la nef, XIXe siècle. |

Saint Matthieu
Vitrail du second niveau dans la nef.

Apparition du Sacré-Cœur ---»»»
à Marie-Marguerite Alacoque, XIXe siècle. |
|
|

Saint Jacques le Majeur
Vitrail du second niveau dans la nef. |

Chapiteau dans la nef. |
 |
|
|
LA CHAIRE À PRÊCHER DU XIXe
SIÈCLE
|
|
|
|
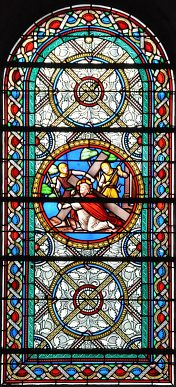
Vitrail du Chemin de croix, station III :
«Jésus tombe sous le poids de la croix». |

L'un des deux lions tenant un écusson
sur l'arrière de la chaire à prêcher. |

Chemin de croix, station IV :
«Jésus rencontre sa mère»
XIXe siècle. |
|
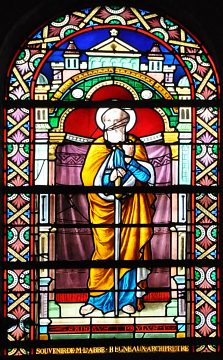
Saint Paul.
Vitrail du second niveau dans la nef, XIXe siècle. |

L'élévation sud et le bas-côté. |
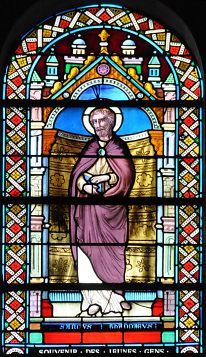
Saint Thaddée
Vitrail du 2e niveau dans la nef, XIXe siècle. |
|
|

Le bas-côté sud conduit à la chapelle de la Vierge
et à son très beau retable en pierre. |
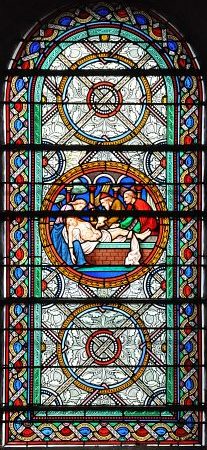
Vitrail du Chemin de croix, station XIV :
«Jésus est mis dans le sépulcre». |

|

La Vierge à l'Enfant
Retable de la chapelle de la Vierge.
Pierre, XIXe siècle.

«««---
Le retable de la chapelle de la Vierge.
XIXe siècle. |
|

Haut-relief, La Bénédiction d'un prélat, XIXe
siècle.
Retable de la chapelle de la Vierge. |

Haut-relief du Couronnement de la Vierge, XIXe siècle.
Retable de la chapelle de la Vierge. |

Le bas-côté nord conduit à la chapelle Saint-Joseph
et à son retable du XIXe siècle.
Ses pierres aux couleurs un peu jaunies lui donne presque un
aspect «vieux roman». |

Haut-relief de saint Joseph et de la Sainte Famille
Retable de la chapelle Saint-Joseph dans le bas-côté
nord. |

Saint Joseph portant l'Enfant
Retable du bas-côté nord, XIXe siècle. |
|
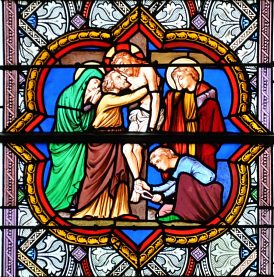
Vitrail du Chemin de croix, station XIII :
«Jésus est rendu à sa mère». |

Haut-relief de la Sainte Famille.
Retable de la chapelle Saint-Joseph dans le bas-côté
nord. |
|
|
LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-GERVAIS
|
|

Le chœur de l'église Saint-Gervais est embelli de peintures
murales de Savinien Petit.
Les peintures représentent les saints patrons de l'église et les premiers
évangélisateurs du diocèse : Thomas Becket, Mellon, Gervais, Protais,
Vitrice et André. |

Vierge à l'Enfant en bois sculpté, (XIXe siècle?) |

Le Passage de la mer Rouge
Vitrail historié dans l'abside, XIXe siècle. |
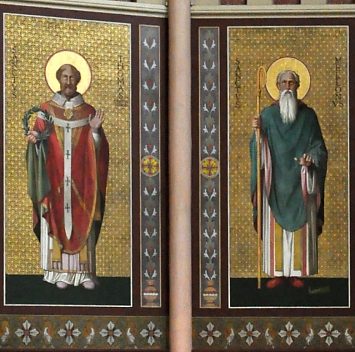
Saint Thomas Becket et saint Mellon
Peintures murales de Savinien Petit dans le chœur. |
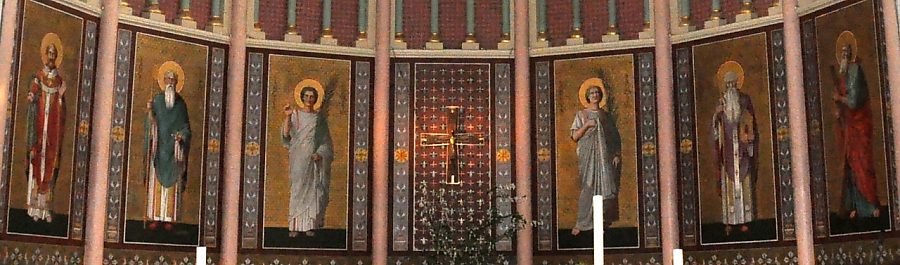
Peintures murales de l'abside.
De gauche à droite : Saint Thomas, saint Mellon, saint Gervais,
saint Protais, saint Vitrice et saint André.
Œuvre de Savinien Petit, XIXe siècle. |
|
Savinien Petit (1815-1878) est
un artiste méconnu. L'église Saint-Georges
à Richebourg dans les Yvelines
possède deux rares toiles de cet artiste : Jésus
chez Marthe et Marie et Jésus et la Samaritaine.
|
|
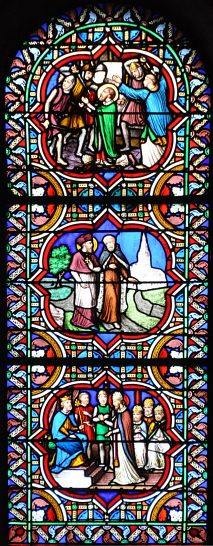
Vie des premiers évangélisateurs du diocèse.
Vitrail du XIXe siècle. |
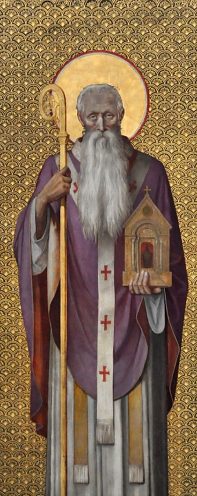
Saint Victrice dans le chœur
Peinture murale de Savinien Petit.
XIXe siècle. |

Vie des premiers évangélisateurs du diocèse
Panneau du XIXe siècle |

Vie des premiers évangélisateurs du diocèse.
Vitrail du XIXe siècle. |

Vie des premiers évangélisateurs du diocèse.
Panneau du XIXe siècle. |

L'orgue de tribune est un Cavaillé-Coll de 1889. |
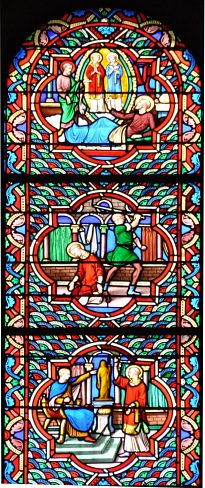
Vie de saint Gervais et saint Protais.
Vitrail du XIXe siècle. |
|
Vie de saint Gervais et de saint Protais.
La vie de ces deux frères jumeaux martyrs est illustrée
dans les vitraux de l'abside qui sont un pastiche du XIIIe
siècle. Elle y côtoie des épisodes de
la vie des premiers évangélisateurs du diocèse
pour lesquels les sources historiographiques sont assez rares.
Il est de ce fait difficile d'expliquer les scènes
des médaillons.
Dans la Légende dorée, Jacques de Voragine
ne s'étend guère sur les vies des deux frères
Gervais et Protais. D'ailleurs, les sources iconographiques
sur les deux autres frères jumeaux martyrs Crépin et
Crépinien ne sont pas plus abondantes. Seuls les Bollandistes
parlent d'eux. Voir le vitrail de leurs vies à l'église
Saint-Pierre
à Dreux.
Gervais et Protais vivent dans les Alpes, près
d'Embrun, sous le règne de l'empereur Néron.
Ils ont donné tous leurs biens aux pauvres et partagent
leur existence avec saint Nazaire qui s'occupe à construire
un oratoire.
Tous trois vont à Milan où réside Néron.
Arrive dans la ville le comte Astase qui doit partir en guerre
contre les Marcomans. Or Gervais et Protais n'ont pas sacrifié
aux dieux de l'Empire. Les Milanais, scandalisés, informent
Astase que les dieux ne le protégeront pas tant que
les deux hommes, en punition, n'auront pas été
immolés.
|
Sommés de sacrifier, les
frères jumeaux refusent. Gervais, qui dénigre
les idoles, est fouetté à mort par des lanières
plombées. Le comte Astase conseille alors la prudence
à Protais... qui trouve plus subtil de jouer les matamores
et de le provoquer (lancette ci-dessus, panneau du bas). En
punition, il est étendu sur un chevalet, mais les provocations
continuent : «(...) j'ai pitié de toi parce que
tu ignores ce que tu fais. Continue donc à me supplicier
afin que je puisse partager avec mon frère la faveur
de notre maître !» Astase lui fait alors
trancher la tête (panneau du milieu).
Les corps sont ensevelis par un autre chrétien dans
un endroit qui reste caché longtemps. C'est à
saint Ambroise, trois siècles plus tard, que l'on doit
l'honneur de l'avoir retrouvé grâce à
un songe. Saint Paul lui apparaît en compagnie des deux
jumeaux (panneau du haut de la lancette) et lui apprend que
les corps des deux martyrs sont sous sa propre demeure. Ils
seront déterrés peu après, intacts.
Source : La Légende
dorée de Jacques de
Voragine, éditions Diane de Selliers. Les citations
sont extraites du texte traduit par Teodor Wyzewa.
|
|

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur. |
Documentation : «Rouen aux cent clochers»
de François Lemoine et Jacques Tanguy
+ «La Légende dorée» de Jacques de Voragine,
éditions Diane de Selliers
+ «Histoire de Rouen» d'Henry Decaëns, éditions
Jean-Paul Gisserot |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |