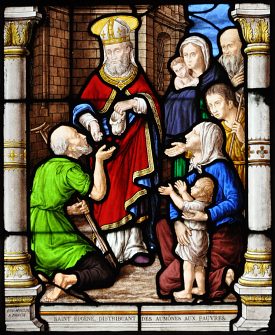|
Dans le vitrail ci-contre
(daté du début de la Renaissance), saint
Laurent fait l'aumône aux pauvres. Qui sont ces
pauvres? Nous voyons à gauche un homme estropié
avec une béquille (qui simule peut-être
parce sa jambe a l'air d'être repliée au-dessus
de la béquille). Nous voyons une femme (qui doit
être une veuve) avec ses deux jeunes enfants.
À l'extrême droite, une personne tient
une espèce de bâton jaune, sûrement
une grande béquille, tandis qu'un homme en rouge,
portant un chapeau, s'en retourne en s'appuyant sur
une canne. Bref, on ne voit pas d'homme valide en
train de mendier. Ce constat mérite des explications.
Au Moyen Âge, le pauvre est celui qui ne peut
pas subvenir à ses besoins par sa force physique.
Un serf n'est pas un pauvre parce qu'il a la sécurité
de l'emploi. Son champ et son travail lui permettent
de survivre au sein d'une communauté rurale encadrée
qui assure un soutien informel à tous. Les religieux
le prêchent : l'aumône est un devoir envers
les vieillards, les estropiés et les victimes
des hasards de la vie ; les biens de l'Église
tout comme le superflu des riches sont la propriété
des pauvres. (Voir le vitrail
des œuvres de miséricorde et le problème
du riche ingrat à l'église Sainte-Jeanne
d'Arc de Rouen).
Quant aux moines (qui font tous vœu de pauvreté),
ils restent attachés à un monastère.
Leur stabilité géographique et leur pauvreté
évangélique dûment choisie les font
accepter par les populations besogneuses.
Cependant le contexte social va changer. L'historien
Michel Mollat, dans un article de la Revue d'histoire
de l'Église de France [cf sources] écrit
: «(...) au cours des XIe et XIIe [siècles],
certaines révoltes de la faim, la prédication
de certains ermites, l'attraction de quelques pèlerinages,
surtout la Croisade, avaient déraciné
et jeté sur les chemins des bandes hétérogènes
de «jeunes» (juvenes) : paysans et
bergers en surnombre, cadets de familles chevaleresques,
mêlés à des criminels en rupture
de ban, à de simples amateurs d'aventures, aux
inadaptés de toutes sortes, enfin à des
prostituées.» Tous ces errants sont très
mal vus car l'errance fait peur. L'instabilité
heurte la mentalité médiévale.
À partir du milieu du XIIIe siècle, la
migration des errants des campagnes vers les villes
en croissance s'accentue. «Le pauvre rural était
généralement un personnage méprisé,
mais familier, connu et assisté des siens ; le
pauvre urbain devient un être anonyme, souvent
vagabond, sans autre recours que la communauté
d'un destin marginal, partagé avec ses congénères.»
[Michel Mollat]. Cependant, malgré les désordres
que ces gens pouvaient susciter, la mentalité
de l'époque était encore de leur côté.
Pour reprendre les termes de notre historien, on accusait
les «évêques infidèles»,
les «seigneurs exigeants», les «juges
iniques» d'avoir aggravé la misère.
La théorie de l'extrême nécessité,
prenant la défense des très pauvres pris
sur le fait de leur larcin, proclamait la communauté
des biens et l'innocence de l'affamé voleur.
Dans le cours du XIIIe siècle, le contexte va
empirer. Arrivent les ordres mendiants (dominicains
et franciscains) qui érigent la mendicité
en vertu. Il faut être nu comme le Christ. Le
mariage mystique de François d'Assise (le Poverello)
avec Dame Pauvreté va créer bien des problèmes
en Occident car il est pris comme modèle. Avec
les ordres mendiants et les sectes hérétiques,
la mendicité errante déferle sur l'Europe
occidentale. Les moines gyrovagues cheminent de village
en village, imités par une foule de gens, pas
toujours bien intentionnés. Michel Mollat note
avec lucidité : «Le vrai scandale du Poverello
est d'avoir exalté la pauvreté à
l'heure même où l'ébranlement de
la société préparait la multiplication
du nombre des pauvres.»
Arrive le XIVe siècle avec la Peste noire, la
guerre de Cent Ans en France et les Grandes Compagnies.
Dans la seconde moitié de ce siècle, la
mendicité s'accroît en Occident. Les ordres
mendiants, multipliant les pauvres, eux-mêmes
augmentés par les calamités de l'époque,
conduisent à des excès. Et la sensation
d'être envahis par les mendiants a dû devenir
insupportable. La position de la société
envers la pauvreté va peu à peu s'inverser.
La pauvreté volontaire des religieux finit par
être blâmée. L'époque était
assez dure comme cela, inutile de rajouter à
la liste des vrais pauvres des moines errants et oisifs.
Le changement de mentalité va d'ailleurs être
complet. Dans un premier temps, à la peur que
tous les errants suscitaient s'était ajouté
le mépris. Mais le mépris ne suffit plus.
À la fin du XIVe siècle, la mendicité
est regardée quasiment comme une insulte à
la dignité de la personne humaine, et la pauvreté
comme une déchéance. Même le don
spontané est freiné. Mieux vaut un prêt
sans intérêt qu'une aumône car le
prêt encourage et stimule le travail. La société,
de moins en moins rurale, devient plus policée
; l'ordre social est ressenti comme une nécessité
; les désordres dus aux pauvres sont jugés
inacceptables. Villes et États veulent contrôler
les indigents et les œuvres qui s'occupent d'eux.
Michel Mollat précise : «La législation
sur le travail et le paupérisme naît simultanément
en France et en Angleterre au lendemain de la Peste
noire. Les autorités municipales désignent
les administrateurs des hôpitaux, vérifient
leurs comptes et réglementent l'hospitalisation
des mendiants et des vagabonds.» La société
finit par établir une nette distinction entre
la charité, qui est à la source des œuvres
de miséricorde, et l'assistance administrative,
rendue nécessaire par l'exigence d'ordre social.
En Angleterre, les premières lois sur les pauvres
prises par Élisabeth Ière, au milieu du
XVIe siècle, instaureront le fouet pour les hommes
valides qui refusent de travailler. Au siècle
suivant, Colbert proposera d'enfermer les indigents
pour les mettre au travail. Au XVIIIe siècle,
à l'église Saint-Sulpice
à Paris, l'abbé de Terssac donne un exemple
admiré et copié : la glorification du
travail et la volonté d'y contraindre les pauvres
en échange d'assistance (voir le texte
suivant).
Le XVe siècle offre un passionnant exemple de
ce double souci en la personne de Jean Geiler de
Kaiserberg. De ce prélat énergique
qui a prêché à Strasbourg pendant
trente-deux ans (de 1478 à 1510), nous possédons
un recueil de sermons qui permet aux historiens de mieux
cerner la psychologie de l'époque, du moins en
Alsace, sur ce thème important. Dans un premier
temps, l'historien Francis Rapp, dans son article pour
la Revue d'histoire de l'Église de France,
nous révèle que notre orateur «honore
l'éminente dignité du pauvre», image
de Jésus. Il critique les riches qui attendent,
avant d'aider, de connaître la moralité
du solliciteur (autrement dit, qui veulent savoir ce
que le pauvre va faire de l'aide qu'on lui apporte).
Francis Rapp cite un extrait d'un sermon édifiant
de Geiler de Kaiserberg : «Et s'il était
effectivement pêcheur, aurais-tu le droit de le
condamner? Dieu, lui, n'hésite pas à lui
donner sans compter l'air, la lumière et l'eau.
Il te donne la nourriture à toi qui n'es sans
doute pas moins coupable que ce déshérité.»
Ce raisonnement, bien spécieux on en conviendra,
trouve son aboutissement révolutionnaire dans
l'encouragement que le prélat adresse aux pauvres d'user
de la force pour arracher ce qui leur est dû :
«Allez dans les maisons des riches. Elles regorgent
de blé. Si elles sont fermées, enfoncez
les portes à coups de hache et servez-vous. Marquez
le montant de votre prise sur une taille et, si vous
égarez cette dernière, venez me trouver.
Je vous dirai comment vous pourrez vous justifier.»
Voilà pour le premier visage de Janus. Le second
lui est bien opposé car Geiler ne supporte ni
les hypocrites ni les paresseux. Sa véhémence
attaque de front «ceux qui tendent la main parce
qu'ils ont peur du travail» [Rapp]. Vivre de mendicité
comme saint François ou saint Dominique est réservé
à une élite et ne doit en aucun cas être
imité. Geiler fustige les montreurs de reliques,
les marchands de pardons, les clochards de toutes sortes,
les simulateurs d'infirmité pour apitoyer le
passant. Ce sont de mauvais pauvres.
La mendicité acceptable ne peut avoir que deux
motifs : la recherche de la perfection chrétienne
ou le dénuement réel et complet. Et le
prélat se fait le défenseur d'une idée
qui est déjà dans l'air du temps : c'est
à l'État de s'occuper des pauvres. Mieux,
c'est son devoir. Autrement dit, ce que le particulier
ne doit pas faire (scruter le pauvre pour savoir ce
qu'il va faire de l'aumône qu'il reçoit),
l'État doit l'officialiser et le généraliser.
Disposant de l'autorité, l'État se doit
de contraindre les paresseux qui mendient à gagner
leur vie à la sueur de leur front. L'aumône
doit aller aux malades et aux vieillards incapables
de travailler, pas aux gens valides. De la sorte, les
bénéficiaires de l'aide (qui deviendra
donc publique) ne seront plus des mendiants, mais des
«assistés» (sens bien différent
de celui qu'il possède aujourd'hui). Autre avantage
: l'aide sera bien répartie, contrairement aux
aumônes «aveugles». Et la caisse d'assistance
sera alimentée par les dons des riches.
Dans un mémoire qu'il adresse vers 1501 aux autorités
de Strasbourg, Geiler propose de partager la ville en
six ou sept secteurs. Dans chacun d'entre eux, un homme
désigné (et qui en viendrait vite à
connaître le quartier), serait chargé de
repérer les faux mendiants. Francis Rapp fait
remarquer qu'il n'y a plus aucune trace de spiritualité
dans ce programme social.
Après 1460, la ville de Strasbourg prit effectivement
de sévères mesures contre les indigents
: seuls ceux qui étaient incapables de gagner
leur vie eurent le droit de mendier ; ceux qui venaient
du «plat pays» ne devaient pas rester dans
la ville plus de trois jours. Des sergents de ville
pouvaient perquisitionner au domicile des mendiants
suspectés de fraude. Au début du XVIe
siècle, les mesures s'aggravèrent : le
délai de trois jours fut réduit à
un seul et les citadins qui avaient reçu le droit
de mendier durent porter un insigne.
Depuis les origines, lutte contre la paresse et recherche
de ceux qui mendient indûment ont fait partie
intégrante des valeurs chrétiennes. Tout
part de l'apôtre Paul et de sa Première
épitre à Timothée. Se soucier des
autres, c'est avant tout prendre soin de ses proches.
Pour Paul, l'altruisme commence au sein de sa famille.
Notons en passant la thèse séduisante
du sociologue américain Rodney Stark, dans son
ouvrage L'Essor du christianisme (Excelsis, 2013)
: ce souci des malades au sein du cercle familial, contraire
à la mentalité romaine, a favorisé
l'expansion de la religion nouvelle lors des pestes
qui ravagèrent l'Empire romain aux IIe et IIIe
siècles. Sans vraiment en comprendre les raisons,
des auteurs chrétiens des premiers siècles
(Denys, Eusèbe de Césarée) ont
d'ailleurs reconnu que ces épidémies mortelles
avaient servi la cause du christianisme.
En matière de mendicité, la pensée
chrétienne s'appuie sur le duo don et contre-don.
Donner est le devoir du riche, mais il oblige celui
qui reçoit. Dans son ouvrage Les Marchands
et le Temple (Albin Michel, 2017), le médiéviste
italien Giacomo Todeschini analyse cette relation en
profondeur L'un des premiers textes du christianisme
primitif, le Didaché, écrit vers
la fin du Ier siècle, affirme déjà
les obligations de celui qui reçoit. Le riche
donne, soit, mais le pauvre a le devoir d'être
reconnaissant et de restituer ce qu'il a perçu
à tort. «Malheur à celui qui reçoit
: si quelqu'un reçoit parce qu'il a besoin, il
sera sans reproche, lit-on dans ce texte. Mais, s'il
n'a pas besoin, il devra dire pourquoi il a reçu
et dans quel but. Jeté en prison, il sera examiné
sur ce qu'il a fait et il ne sera pas relâché
jusqu'à ce qu'il ait restitué le dernier
quadrant.».
La notion paulinienne d'obligation de prendre soin de
ses proches est à considérer comme la
racine même de la fidelitas, c'est-à-dire
l'appartenance au cercle des élus. Cette notion
va s'élargir au fil des siècles, être
théorisée et englobée dans une
vision socio-économique des rapports humains.
Pour faire court : vivre sa foi chrétienne, c'est
produire et convertir. Le mendiant ne produit rien et,
en principe, ne croit plus. En faisant l'aumône,
le riche lui permet de se ressaisir pour croire à
nouveau et produire à son tour. De la sorte,
le mendiant pourra espérer réincorporer
la fidelitas, cette fois prise au sens large.
Thomas d'Aquin partira du texte de Paul et utilisera
le don comme fondement et lien de sa société
chrétienne.
Giacomo Todeschini prend l'exemple des Hôtel-Dieu
qui vont se répandre en Europe occidentale à
partir du XIIe siècle, faisant affluer les dons.
L'étude des discours de l'époque sur la
mendicité conduit l'historien à écrire
à ce sujet : «(...) le don fait à
l'hôpital s'inscrivait dans une conception présentant
la marginalité sociale et économique comme
perte à réparer.» Autrement dit,
mendier est l'expression d'une fissure dans l'organisation
sociale chrétienne, une fissure qu'il appartient
aux riches de combler. En recevant un pécule,
le mendiant doit rendre à son tour, par la foi
et par le produit de son futur travail, faisant ainsi
disparaître la fissure. Aux XIIe-XIVe siècles,
la charité, écrit l'historien, se conçoit
comme «une générosité productrice
d'obligations internes à la sphère du
bien public».
Todeschini explicite clairement les obligations du pauvre
: avoir un métier pour être utile à
la société, se guérir des maux
physiques et spirituels qui peuvent l'en empêcher
; bref se convertir «à une chrétienté
effective, à la fois religieuse et sociale mais
aussi spécifiquement économique.»
Au IXe siècle, bien avant Jean Geiler de Kaiserberg,
le moine de l'abbaye de Lobbes en Belgique, Rathier
de Vérone, qui fut aussi évêque
de Vérone, s'était élevé
contre les pauvres oisifs, que leur pauvreté
avait rendus arrogants. Il les opposait aux riches pieux
qui utilisaient leurs richesses pour faire le bien.
Rathier, en se proposant d'examiner les capacités
des pauvres, réfléchissait déjà
à des stratégies d'insertion. Todeschini
cite quelques extraits de cet auteur du IXe siècle.
Ainsi, quand il s'adresse aux pauvres : « Gare
à toi donc si, abruti par la paresse, tu profites
du labeur d'autrui alors que tu peux vivre de ton travail»
; si le pauvre est malade et se plaint : «Prie
plutôt pour ceux aux dépends desquels tu
vis» ; si le pauvre est en bonne santé,
mais a de nombreux enfants : «Pratique la continence
si tu le peux (...) en accord avec ton épouse,
et mets-toi au travail pour subvenir à tes besoins
et à ceux des autres» ; si le pauvre n'est
pas capable de travailler : «Pleure donc pour
ce vice car c'est un malheur grave: demande en aumône
ce qui te suffit pour vivre et garde-toi d'accumuler
ce qui ne te sert pas» ; si le pauvre est en bonne
santé : «offre ton soutien aux autres:
visite les infirmes, enterre les morts et partage avec
ton prochain cette bénédiction que Dieu
t'a accordée (...)».
En résumé, au-delà du don, de la
foi, de la conversion, au-delà de la générosité
productrice, la philosophie du christianisme universel
se résume en un principe simple : s'appliquer
à faire quelque chose pour les autres ; sur un
plan théologique, utiliser la liberté
donnée par Dieu pour que chacun apporte son écot
à l'édification de la fidelitas,
c'est-à-dire de la société chrétienne.
Le concept de caritas (charité) représente
stricto sensu l'amour civique exprimé
par les membres de la communauté, un amour qui
les porte au souci administratif de bien gérer
l'argent en circulation. Au sens chrétien, la
caritas, ce n'est pas faire l'aumône. La
caritas, c'est faire quelque chose pour les autres,
ce qui inclut l'aumône évidemment, mais
avec l'obligation du contre-don pour celui qui
reçoit. Ce qui signifie que celui qui donne a
un droit de regard sur ce qui est fait de son aumône.
La notion de don et de contre-don s'intègre
dans un englobant socio-économique de générosité
créatrice où chacun doit faire quelque
chose pour l'autre. Même les soldats qui revenaient
manchots de la guerre pouvaient se rendre utiles dans
l'armée, souvent en tant que simple garde, comme
en témoigne le protestant Jean Marteilhe dans
ses Mémoires d'un galérien du Roi-Soleil
(Mercure de France, 2021). Avoir bonne conscience parce
qu'on a donné une pièce à un mendiant
- et s'en tenir là - ne correspond nullement
à la pensée des Pères de l'Église.
Faire quelque chose pour les autres, c'est œuvrer,
dans la foi, à l'édification de la société
chrétienne. Le catholicisme prône ainsi
la justification par les œuvres. De la sorte, on
peut imaginer qu'un croyant, après sa mort, arrive
dans l'Au-delà et s'entende poser la question
qui résume en fait toute sa vie : «Qu'as-tu
fait pour les autres ?» La question a le
mérite de la clarté. Quant à l'analyse
des œuvres réalisées, elle est aisée
à faire.
À l'opposé, le protestantisme a mis en
avant la justification par la foi. Ce qui n'empêchait
pas Calvin, notons-le, de penser que la foi a pour conséquence
les (bonnes) œuvres. Mais «avoir la foi»
pose le problème de la définition. Croire
en quoi exactement ? À l'existence de Dieu,
entité omnisciente et omnipotente ? Aux
anges ? Au paradis ? À l'enfer ?
Des philosophes protestants se sont d'ailleurs livrés
à d'amusantes digressions sur ce sujet. Au XIXe
siècle, le Danois Sœren Kierkegaard (1813-1855)
s'y est essayé dans son essai Coupable ? Non
coupable ?
Rappelons rapidement les faits : en 1845, Kierkegaard
vient de rompre ses fiançailles avec Régine
Olsen, cassant ainsi un amour partagé ; son motif
caché est d'ôter toute barrière
à sa mélancolie afin de se livrer au plaisir
suprême qu'est pour lui la méditation philosophique.
Torturé par les affres du doute, de la culpabilité
possible, du malheur où il a peut-être
plongé sa fiancée, il s'imagine jeté
dans l'absurde et n'avoir, lui le protestant, la foi
qu'à un certain degré. Il écrit
: «Qu'on introduise en pensée l'éternité
dans une telle confusion, qu'on imagine un tel homme
au jour du jugement suprême, et qu'on écoute
la voix de Dieu : "As-tu eu la foi ?"
— qu'on écoute la réponse :
"La foi est l'immédiat ; il ne faut pas
s'arrêter à l'immédiat, on le faisait
au moyen âge, mais depuis Hegel on va plus loin,
toutefois, on avoue que la foi est l'immédiat
et que l'immédiat existe, mais on attend une
nouvelle étude."»
Si l'oisiveté et la mendicité frauduleuse
sont regardées par le christianisme authentique
comme des perversions à pourchasser, il faut
tirer le constat, depuis le début du XXe siècle,
de l'oubli total par les chrétiens du principe
du don et du contre-don. Autrement dit,
le principe de charité chrétienne
est maintenant totalement dévoyé. À
croire que les Églises sont fières de
se livrer à une aide débridée,
sans doute pour ne pas se sentir débordées
par l'aide sociale mise en place par les gouvernements.
À la naïveté pseudo-chrétienne
qui s'exclame : «Il a faim ! Il gémit !
Nourrissons-le !» répond le doigt
autoritaire de Rathier de Vérone et des Pères
de l'Église pointé sur le mendiant :
«Que fais-tu pour les autres ?» et
«Comment uses-tu de ta liberté ?»
Et ces questions tombent, tel un couperet, contre toutes
les lâchetés, toutes les naïvetés.
|