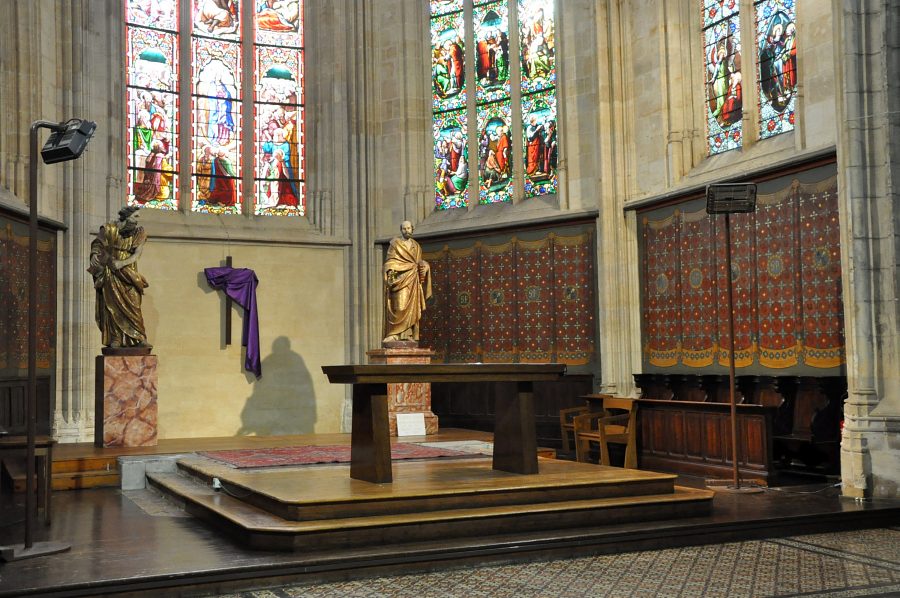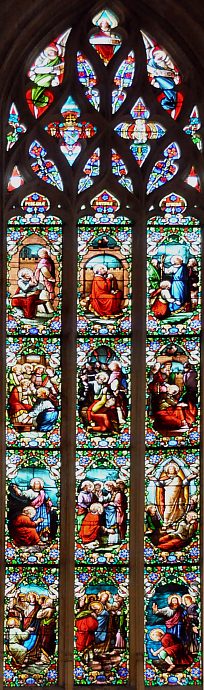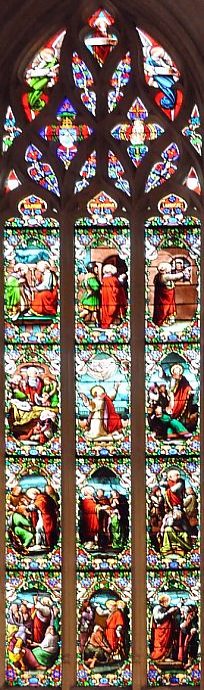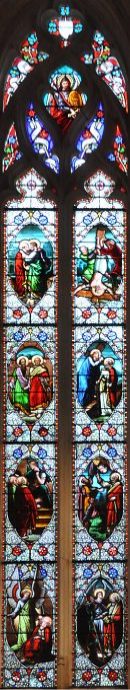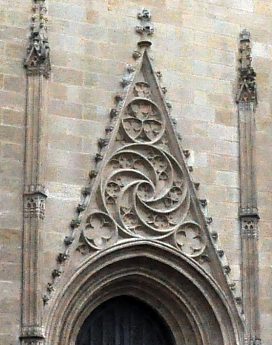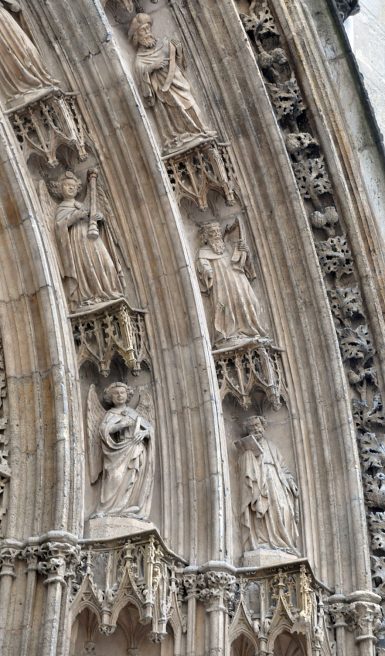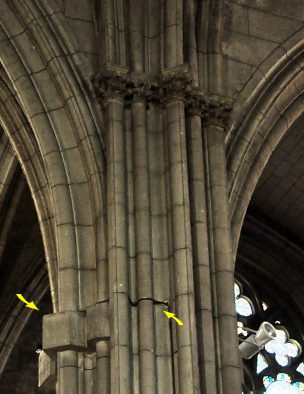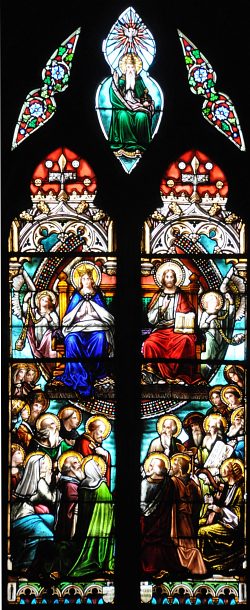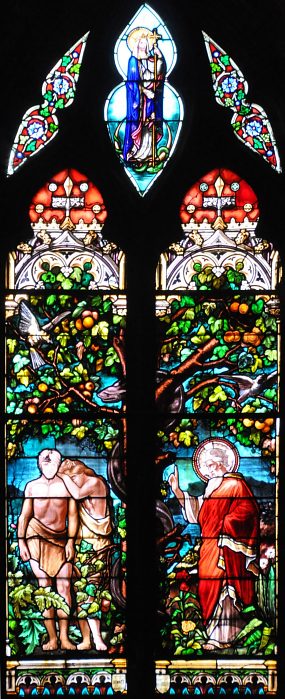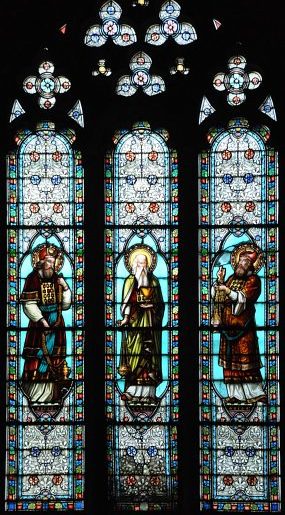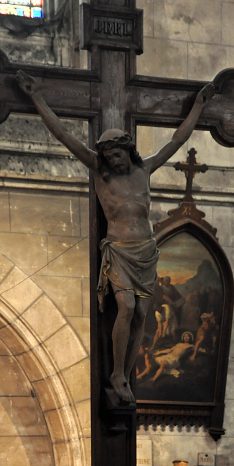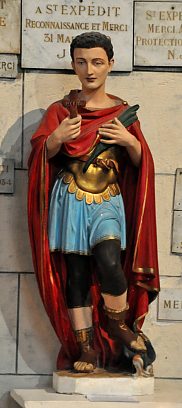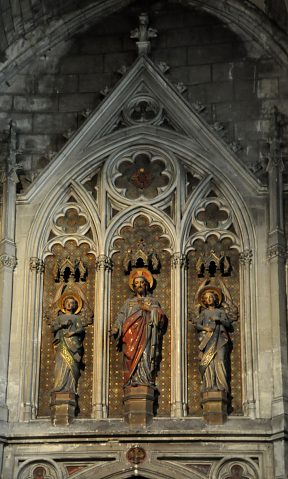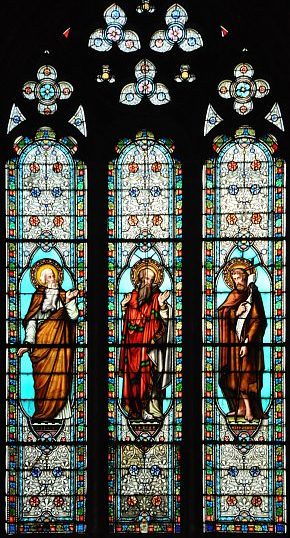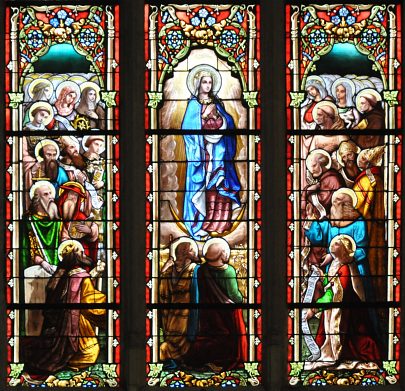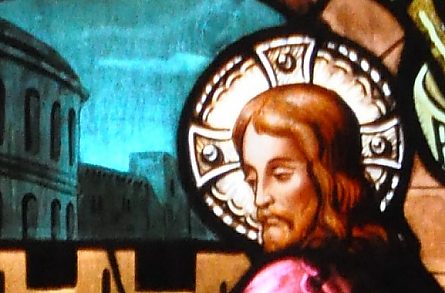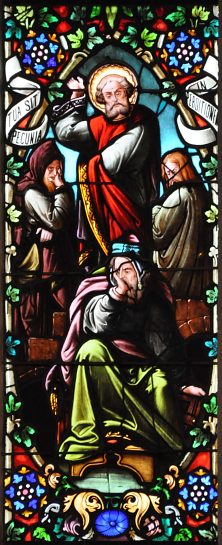|
|
 |
 |
Située près du port de la Lune, la paroisse
Saint-Pierre est l'une des plus anciennes de Bordeaux.
Mais son église a depuis longtemps disparu. Vers le XIIe siècle,
un édifice roman, dont l'emplacement n'est pas sûr, lui succède.
Au XIVe, la troisième enceinte de la ville est bâtie. C'est à sa
proximité immédiate, sur un ancien bassin du port, qu'une nouvelle
église est alors construite en gothique flamboyant. C'est l'édifice
actuel que le XIXe siècle va fortement modifier.
Cette église est engoncée au milieu des maisons, comme
le montrent d'anciens dessins. Sa façade, surgissant de rues
étroites, est difficilement visible. Il faut dire que ce
quartier populeux abrite de nombreux mariniers, des petits métiers,
mais aussi des marchands et des notables, notamment anglais. Car
la Guyenne est détenue par la couronne britannique. C'est
aussi le centre de plusieurs confréries : les pâtissiers
et les rôtisseurs ; les sacristains ; les matelots ; les orfèvres.
Selon l'abbé Brun (Les églises de Bordeaux,
1952), la vie religieuse n'y est pourtant pas très active,
un déclassement qui se fait au profit du quartier Saint-Michel.
En 1848, on dégage enfin une place devant la façade
ouest. C'est la place Saint-Pierre actuelle.
En 1861, un rapport réalisé pour l'Administration
municipale fait état de nombreuses lézardes et de
perturbations dans les maçonneries de l'édifice. La
construction d'une nouvelle église, avec ossature de fer,
étant rejetée, une restauration de fond s'impose.
Elle sera menée par l'architecte Jean- Jules Mondet dont
les plans sont approuvés en 1879.
Robert Couster et Marc Saboya en décrivent les grands principes
dans Bordeaux, le temps de l'histoire : «dégagement
du monument, augmentation de la place réservée aux
fidèles et "rétablissement de la régularité
et de l'homogénéité de la construction"».
Ce qui signifie : clocher reconstruit ; nef,
voûtes et bas-côté
nord refaits. Le chœur
est laissé intact, comme pratiquement tout le bas-côté
sud. La nouvelle façade
occidentale, achevée en 1880, y gagne un cachet néogothique,
loin de la fadeur initiale. Restent inchangés toutefois le
portail central du XVe siècle et sa belle archivolte.
Les constructions qui enserrent l'édifice depuis les temps
médiévaux sont détruites.
Nos deux auteurs ajoutent que la restauration entreprise par Mondet
est en fait l'application du discours rationaliste en vogue depuis
les années 1850 à propos de l'architecture gothique.
Il s'agit en effet d'unifier le style du monument, en l'occurrence
le gothique flamboyant, en présupposant que c'était
le style dominant de l'édifice lors de sa création.
On colle ainsi à la politique de restauration définie
par Viollet-le-Duc selon qui : «Restaurer un édifice,
ce n'est pas l'entretenir ou le refaire, c'est le rétablir
dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé.»
Notons que les parties extérieures du monument ont été
restaurées au début des années 2000.
Hormis quelques statues, une Piéta
du XVIIe siècle et un tableau
de 1664, il n'y a guère d'œuvres artistiques dans
l'église. En revanche, les vitraux
des années 1860-70 sont de belle facture et offrent, notamment
dans le chœur,
quelques saynètes peu communes dont une illustrant Jésus
regardant Pierre après son triple reniement.
L'église Saint-Pierre, classée aux Monuments historiques
en 1908, demeure un exemple intéressant de gothique flamboyant
au XVe siècle dans un quartier jadis très fréquenté.
|
 |

La nef et le chœur
de l'église Saint-Pierre vus depuis l'entrée. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |
|

Façade occidentale de l'église Saint-Pierre.
Seul le portail central et son archivolte
datent du début du XVe siècle.
Le trumeau a perdu sa statue. |
|
Architecture
extérieure (2/2).
---»» Cette porte se prolonge vers l'est
par des éléments en saillie où se trouvaient jadis deux chapelles et un baptistère
(photo ci-contre). En 1861, Charles Marionneau écrit
que ces chapelles abritent la sacristie et le dépôt
de chaises, sans que personne ne sache exactement quand
cette réaffectation eut lieu. L'historien complète
sa description en écrivant que ces petites chapelles
sont «terminées en pignon à crochets,
avec une petite croix pour amortissement.» Effectivement,
à son époque, seule la grande baie orientale
(n°6) existait. Les dessins réalisés
au début du XIXe siècle montrent qu'il
y en avait trois autres, de toute petite taille, perçant
le nu du mur où venaient s'accrocher les toitures
des chapelles.
En l'an 2000, Robert Coustet et Marc Saboya écrivent
dans Bordeaux, le temps de l'histoire que, pour
la restauration entreprise à partir de 1879,
les plans de Jean-Jules Mondet prévoyaient la
reconstruction des sacristies «qui perdent leurs
toitures pour permettre l'ouverture des grandes verrières
gothiques du mur sud.» Deux grandes verrières
(baies 8 et 10) ont ainsi remplacé trois toutes
petites.
Terminons par une note négative qui concerne
tout l'édifice. Et citons à nouveau Charles
Marionneau à propos des projets de restauration
dressés dès le début des années
1860 : «il faut bien reconnaître, écrit-il,
que l'église Saint-Pierre est plus intéressante
par ses souvenirs historiques qu'au point de vue de
l'art et qu'elle ne peut pas exciter un grand enthousiasme
archéologique. On peut même dire que si
l'antique église mérovingienne, citée
par Grégoire de Tours, n'a pas été
conservée par les siècles appelés
les siècles de foi, on est peu fondé
de nos jours d'en appeler à des sentiments de
respect pour un monument sans intérêt architectural.»
Pour se cantonner à l'aspect extérieur,
précisons que, d'après les dessins qui
subsistent, la façade, avant les restaurations,
avait un aspect très pauvre.
Sources : 1) Les églises
de Bordeaux de l'abbé Brun, éditions Delmas, 1952
; 2) Description des œuvres d'art qui décorent les
édifices publics de Bordeaux de Charles Marionneau,
1861 ; 3) Bordeaux Le temps de l'histoire de
Robert Coustet et Marc Saboya, éditions Mollat,
2000 ; 4) Église Saint-Pierre, brochure
de l'Office de Tourisme.
|
|
|
|
Architecture
extérieure (1/2).
Le regard du visiteur est tout de suite attiré
par la façade occidentale, en grande partie refaite
à la fin du XIXe siècle, hormis le portail.
Les éléments néogothiques de style
flamboyant sur les baies et le pignon sont des créations
des restaurateurs ; l'oculus sommital est un ajout,
tout comme les portes latérales qui correspondent
à la présence des bas-côtés.
Sur le côté nord, le haut campanile, bâti
en hors œuvre, date aussi de cette époque.
Il est venu remplacer un ancien clocher qui s'élevait
encore en 1861 au-dessus du pignon de la façade.
Charles Marionneau en fait mention dans sa Description
des œuvres d'art qui décorent les édifices publics de
Bordeaux parue cette année-là, et
le dit tronqué et inachevé.
Seuls le portail central et son archivolte
datent du début du XVe siècle.
Ils constituent un bel exemple de gothique flamboyant.
La voussure intérieure de l'archivolte reçoit
une suite d'anges aux longues ailes tenant les instruments
de la Passion ; la voussure médiane, selon l'abbé
Brun en 1952, reçoit des statues de prophètes
tenant un phylactère. En 1861, Charles Marionneau
s'était montré plus précis : il
y voyait des apôtres et des rois ancêtres
de la Vierge. L'historien des édifices bordelais
ajoutait ce commentaire un peu étonnant : «Ces
statuettes ne sont pas d'une bonne exécution,
et pour les rendre plus grossières elles ont
été badigeonnées.» Enfin,
la voussure externe est une simple guirlande de feuillage
qui descend jusqu'au sol.
Au bas de la voussure médiane, l'apôtre
Pierre est absorbé dans un livre, sa main
gauche tient la clé du Paradis. Au sommet de
la voussure interne, une statue
bien dégradée offre ce qu'il reste
du Père céleste et de ses deux grosses
mains avides (!)
À cause de parties sculptées manquantes,
il n'est pas possible de connaître le programme
iconographique retenu pour le portail par les bâtisseurs
: le tympan est nu ; les niches sont vides de statues.
Le trumeau qui coupe la porte centrale en deux parties
n'a lui aussi plus sa statue. En 1861, une statue en
costume de pontife s'y trouvait encore, comme le rappelle
Charles Marionneau. Le cardinal Donnet y voyait le pape
Clément V ; l'architecte Viollet-le-Duc penchait pour
l'apôtre Pierre. Viollet-le-Duc, dans son Dictionnaire
raisonné de l'Architecture française, justifiait
ainsi son choix (cité par Charles Marionneau) : «Au
XVe siècle, saint Pierre, lorsqu'il est seul, est souvent
vêtu en Pape, la tiare sur la tête et les clefs à la
main.» Et Pierre est ici le patron de l'église... Le
chœur
de Saint-Pierre en donne d'ailleurs un exemple immédiat
: sa clé
de voûte polychrome du XVe siècle représente l'apôtre
coiffé de la tiare papale !
Quoi qu'il soit, Marionneau jugeait la statue du trumeau
«peu intéressante comme objet d'art»
et lui préférait la statuette
de la voussure médiane.
Au côté sud, le visiteur ne manquera pas
d'admirer le magnifique gable
gothique à rose en spirale qui surmonte l'ancienne
porte principale de l'église. Marionneau date
ce gable du XVe siècle, comme le portail ouest,
et le décrit simplement comme «un pignon
à placage, ornés de meneaux enroulés.»
Là encore, les niches qui encadrent la porte
ont perdu leurs statues.
---»» Suite 2/2
à gauche.
|
|

Bas-côté sud de l'église avec l'ancienne entrée principale.
Les extensions le long de l'élévation étaient
jadis des chapelles, devenues sacristie.
La grande baie la plus à droite existe depuis l'origine.
Les deux autres ont été percées lors
de la restauration entreprise à partir de 1879 par l'architecte
Jean-Jules Mondet. |
|
|
|

Le portail du début du XVe siècle a conservé
une belle archivolte alors que le tympan est nu. |

Le Père céleste trône au sommet de la voussure interne
de l'archivolte.
Depuis le XVe siècle, l'usure du temps lui a donné
des mains d'un aspect redoutable (!) |
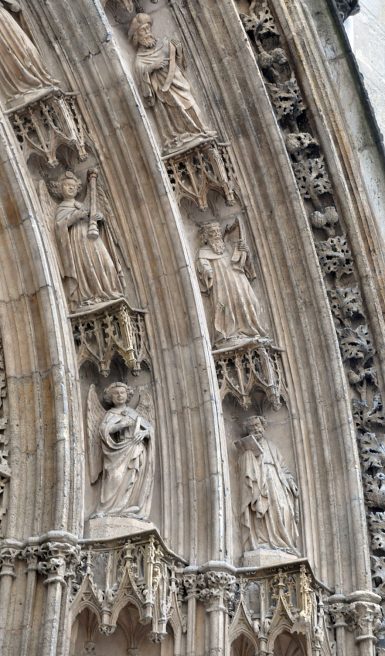 |
|

Saint Pierre et sa clé au bas
de la voussure médiane, début du XVe siècle. |

Un ange dans l'archivolte, début du XVe siècle. |
|
|
| LA NEF DE L'ÉGLISE
SAINT-PIERRE |
|

La nef, les piles sud et le bas-côté sud.
La grande baie à gauche (n°6) existe depuis l'origine de
l'église.
Les baies 8 et 10 ont été percées lors de la
restauration entreprise à partir de 1879 sur les plans de Jean-Jules
Mondet. |

Le baptistère et le tableau de Pierre de Nantiac (1664).
Le tableau est donné en grand format
plus bas.
Le baptistère se situe au rez-de-chaussée du campanile
bâti
au XIXe siècle. Il n'est pas dans une chapelle latérale. |
|
Architecture
intérieure de l'église.
Avec une nef de 41 mètres de long, de 21 mètres
de large, une hauteur sous voûte de 15,40 mètres
et deux bas-côtés, Saint-Pierre n'est pas une
petite église. On s'attendrait à trouver des
chapelles latérales, mais les trois qui se trouvaient
dans le bas-côté
sud (Sainte-Trinité, Saint-Joseph et baptistère)
étaient déjà aménagées
en sacristie lors de l'étude de Charles Marionneau
en 1861.
Conformément à l'art gothique, les voûtes
sont ogivales. Le chœur
à cinq pans est en forte saillie sur l'élévation
orientale.
Qu'y a-t-il du début du XVe siècle dans l'église ?
Lors des restaurations du XIXe, le chœur,
élevé à partir de 1411, a été
préservé, mais la nef a été complètement
refaite. Le bas-côté
nord, dont les voûtes étaient disloquées
et qui menaçait ruine, a lui aussi été
entièrement reconstruit. Seul le bas-côté
sud présente une touche réellement ancienne,
mis à part le percement des baies 8 et 10 qui datent
de 1880. En 1952, l'abbé Brun, dans son ouvrage sur
les églises de Bordeaux,
se félicite du travail des restaurateurs : les raccords
de la nef au chœur
ne montrent aucune discontinuité.
L'historien Charles Marionneau, en 1861, n'appréciait
pas l'intérieur de l'édifice. Un siècle
plus tard en revanche, l'abbé Brun trouve que, malgré
ses dimensions réduites, il «plaît à
l'œil et séduit». Il n'a pas tort car, si
l'on pouvait inverser le fil du temps, on jugerait que le
gothique de l'église est une séduisante copie
du néogothique du XIXe, si forte est l'impression de
déambuler dans un édifice de ce siècle
orné de beaux vitraux
d'époque !
Au XIXe siècle, de nouveaux chapiteaux néogothiques
à thème floral ont été sculptés.
Le visiteur curieux remarquera, sur les piles nord de la nef,
des chapiteaux laissés
à l'état brut. Visiblement, le sculpteur
n'a pas eu le temps de parfaire son œuvre. Ou bien les
fonds manquaient-ils pour honorer sa facture à suivre ?
|
|

L'ancienne entrée principale de l'église (XVe siècle)
se trouve dans l'avant-nef sud.
La baie n°12 est obstruée par le gable
gothique.
Son vitrail n'est guère visible. |

Écusson de cardinal. |

Écusson de seigneur. |

Insignes du Vatican. |

Écusson de cardinal. |
|
Ces quatre clés de voûte
modernes dans le bas-côté nord montrent que ce
bas-côté a bien été reconstruit
à partir de 1879.
|
|
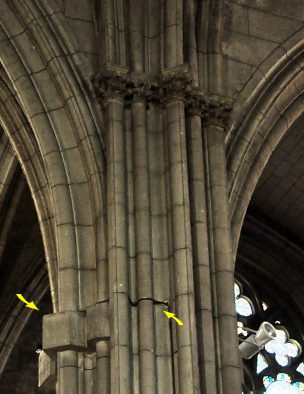
Une pile de la nef et son faisceau de colonnettes.
La réfection de la fin du XIXe siècle a laissé
des traces...
Est-ce le manque de fond qui a laissé ces chapiteaux
à l'état brut ? |
|
Les
vitraux (1/2).
En 1861, dans sa Description des œuvres d'art
qui décorent les édifices publics de Bordeaux,
Charles Marionneau ne parle nullement des vitraux.
Il faut croire que les baies étaient fermées
par du verre blanc, peut-être orné
d'une frange sur le pourtour.
Dans les années 1860-70, de nombreux donateurs
ont permis à la nef et au chœur
de s'embellir de verrières modernes «de
belle facture» comme le reconnaissait l'abbé
Brun dans sa présentation de l'église
en 1952.
Les bas-côtés reçoivent des
vitraux
figurés avec des personnages en pied,
groupés par trois. de saints et de prophètes.
Le fond est comblé par de petits motifs
géométriques qui laissent une grande
place au verre blanc et donc à la lumière.
Les verrières les plus intéressantes
sont dans le chœur.
Dans l'axe (baie 0) s'élève un vitrail
dédié à Marie
consolatrice qui vient de l'ancienne église
Saint-Jacques, aujourd'hui désaffectée.
Il est complété d'une belle Assomption.
Les quatre
autres pans sont illustrés de saynètes
de la vie de saint Pierre créées
par l'atelier bordelais Villiet. Elles
datent des années 1862 et 1873. On remarquera
le panneau de la chute
de Simon le Magicien et deux autres, plus
rares : saint
Pierre recevant la sanction divine qui déclare
purs des aliments que l'apôtre refusait
de manger et Jésus
regardant Pierre après son triple reniement.
Enfin, sur la façade ouest, deux jolies scènes
historiées dont l'atelier est inconnu : Adam et
Ève chassés du Paradis terrestre (baie 13 ci-contre)
; Jésus et la Vierge en majesté (baie 14).
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|
|

Baie 13 : Adam et Ève chassés du Paradis
terrestre
par le Père céleste, détail.
XIXe siècle, |

La chaire à prêcher est due au sculpteur Brunet (XVIIIe
siècle ?) |
|

La cuve de la chaire à prêcher est ornée du Tétramorphe.
Ici, l'aigle de Jean et le taureau de Luc. |
|
En 2011, dans L'esprit
des bâtisseurs, Pierre Coudroy de Lille évoque
l'existence, aux XVIIe et XVIIIe siècles, d'une
lignée de sculpteurs et de menuisiers nommés Brunet
(Étienne, Jean-Baptiste et Jean-Jacques). La chaire
serait ainsi l'œuvre d'un Brunet mort en 1785.
|
|

«Le Christ remettant les clés à saint Pierre»
Tableau de Pierre de Nantiac, 1664. |
|
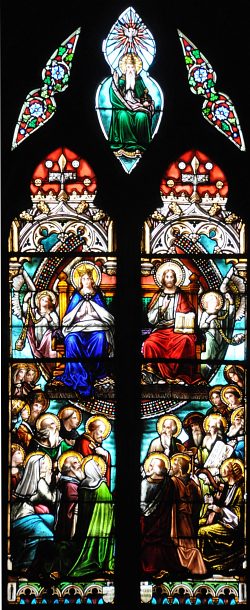
Baie 14 : le Christ et la Vierge en majesté
devant une assemblée de saints et de saintes.
Vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté
sud. |
|
Les
tableaux.
L'église Saint-Pierre a perdu bien des tableaux
que Charles Marionneau y recensait en 1861 dans
sa Description des œuvres d'art qui décorent
les édifices publics de Bordeaux.
Il y notait ainsi une Adoration des Mages,
un portrait de saint Paulin, évêque de Nole,
une Sainte-Trinité et un Saint Pierre
délivré de sa prison. Selon la base Palissy,
ces deux derniers tableaux sont au musée
des Beaux Arts de Bordeaux.
La base Palissy donne également deux tableaux
exposés à la sacristie de l'église : Jésus
et la Samaritaine et une Vierge à la chaise.
Ce dernier tableau est une copie de la célèbre
toile de Raphaël. L'église Notre-Dame
à Auxonne possède une autre copie de cette
œuvre.
La toile Le Christ remettant les clés à saint
Pierre, exposée dans le baptistère,
est la seule visible dans l'église.
|
|
|
|
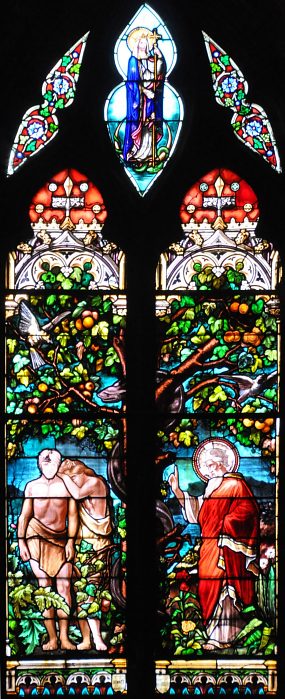
Baie 13 : Adam et Ève chassés du paradis terreste
par le Père céleste, XIXe siècle.
Vitrail ouest du bas-côté nord.
Don du cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. |

Bénitier reposant sur un lion.
XVIIe ou XVIIIe siècle ? |

La chaire à prêcher possède un escalier double. |
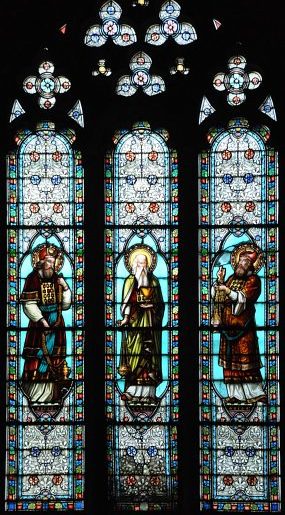
Baie 7 : Aaron, Esdras, Esnias.
Atelier Villiet, 2e moitié du XIXe siècle. |
|

Le bas-côté sud remonte en très grande partie au XIVe siècle.
Les trois arcades sous les baies correspondaient jadis à l'entrée
de deux chapelles latérales et du baptistère.
Les arcades ont été bouchées pour créer
une sacristie à une époque mal déterminée,
mais avant 1860. |
|
|

Baie 8, détail central : Constantin, Charlemagne
et saint Louis.
Atelier Villiet, 2e moitié du XIXe siècle. |
|
Constantin
avec une auréole.
Dans les trois personnages du vitrail de la baie 8 (photo
ci-dessus), l'empereur Constantin, à gauche,
est représenté avec une auréole.
Si l'Église de Rome n'a jamais canonisé
cet empereur, en revanche l'Église orthodoxe l'a déclaré
saint et l'associe souvent avec sa mère sainte
Hélène à qui revient l'«Invention»
de la croix.
|
|

Sainte Anne avec Marie
ou L'Éducation de la Vierge.
Bas-côté nord. |

Baie 9, détail : le roi David.
Atelier Villiet, Bordeaux.
2e moitié du XIXe siècle. |
|
Baie 5 ---»»»
Élias, Isaïe, saint Jean-Baptiste.
Atelier Villiet, Bordeaux
2e moitié du XIXe siècle.
|
|
|
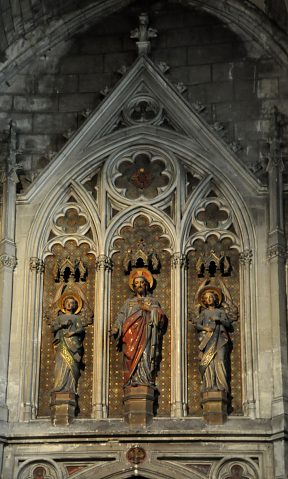
Le Sacré-Cœur entouré de deux anges.
Chevet sud, XIXe siècle. |
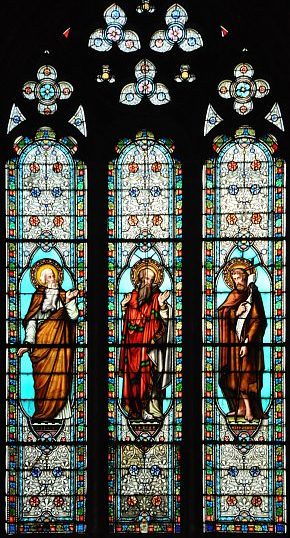 |
|
|

Le côté nord de la nef avec la chaire à prêcher
et le bas-côté nord.
De part et d'autre de la chaire, on remarque que les chapiteaux des
piles n'ont pas été sculptés. |

Statue de la Vierge à l'Enfant, détail.
Fin du XIXe siècle. |

Le bas-côté nord débouche sur une Piéta du XVIIe siècle.
Ce bas-côté a été très largement
reconstruit au XIXe siècle. |

Piéta en ronde-bosse du XVIIe siècle.
|
Baie 6 ---»»»
Saint Rémi, saint Augustin, saint Boniface.
Atelier Villiet, Bordeaux, 2e moitié du XIXe siècle.
|
|
 |

Le visage de la Vierge dans la Piéta du XVIIe siècle. |

La Vierge et l'Enfant entourés de saint Joseph et de saint Jean.
Chevet nord, XIXe siècle. |
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-PIERRE |
|
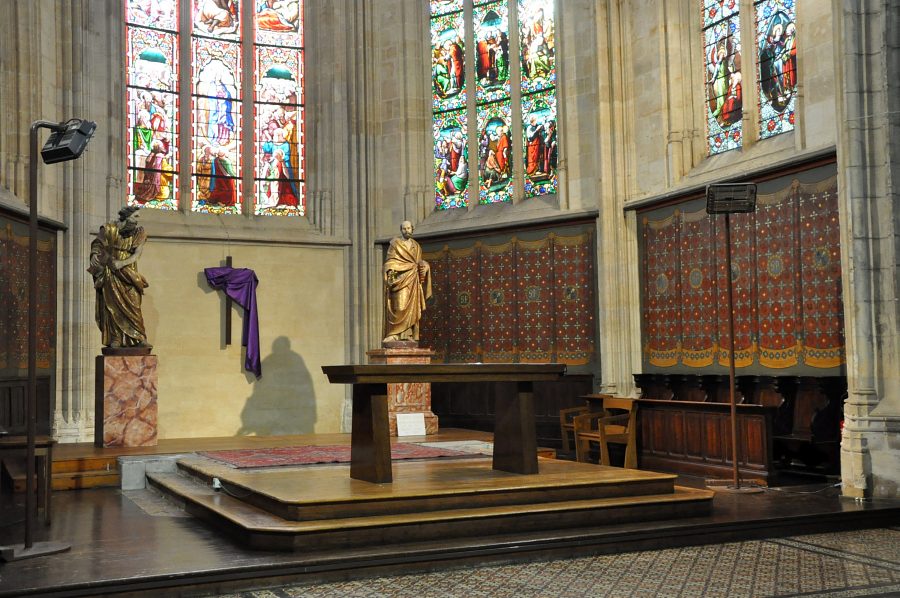
Le chœur de l'église Saint-Pierre est aujourd'hui très
dépouillé.
Jadis, un retable surmonté d'une gloire se dressait contre
le pan médian. |
|
L'ancien
chœur (1/2).
Si le chœur actuel est très dépouillé,
il n'en était pas de même en 1861 lorsque
Charles Marionneau a rédigé sa Description
des œuvres d'art qui décorent les édifices publics de
Bordeaux.
En plus d'avoir contre le pan axial un retable couronné
d'une gloire, les pans du chœur recevaient une
remarquable série de boiseries avec colonnes
cannelées, guirlandes de chêne, têtes
d'anges, le tout au sein d'un agglomérat de moulures
et de volutes «bizarrement contournées»,
précise Marioneau qui date l'ensemble de la fin
du XVIIe siècle.
L'auteur reconnaît lui-même le problème
que posent ces boiseries : leur complète discordance
avec les arcades ogivales et les faisceaux de colonnettes
hérités de la construction de l'abside
au XVe siècle.
Mais l'historien de la ville de Bordeaux
a un argument : il plaide pour la conservation des œuvres
d'art dès lors que l'église est pauvre
en mobilier, ce qui était le cas de Saint-Pierre
en 1861. Malheureusement, depuis, tout a été
supprimé. Sur ces cinq pans, le chœur actuel
n'offre que de simples tentures pour couvrir le nu des
murs.
Marionneau cite un intéressant texte d'Adolphe
Didron dans les Annales archéologiques
relatif à la discordance visuelle entre les œuvres
d'art et leur environnement. «Nous regretterons
toujours, écrit Didron, que sous prétexte
de ramener les anciens édifices à leur
beauté primitive, on détruise des œuvres
souvent remarquables de différentes époques,
et postérieures à la construction même
de ces édifices.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|

Statue de saint Pierre en bois doré.
Sculpteur Jacques Brunet, 1664. |

Voûte gothique de l'abside, début du XVe siècle. |
|
L'ancien
chœur (2/2).
---»» Quand il n'existe rien et qu'on fait
une chaire, un jubé, un autel nouveau, rien de
mieux que de mettre cet autel, ce jubé, cette
chaire, en harmonie avec le monument où on les
place ; mais quand tout cela existe, même du XVIIe
siècle, même du XVIIIe, dans un édifice
du XIIe ou du XIIIe siècle, il faut le conserver
avec le plus grand soin. Il y a tel retable du temps
de Louis XIII, telle chaire du temps de Louis XIV, tel
jubé du temps de Louis XV, qui sont de vrais
chefs-d'œuvre ; les détruire pour les remplacer
par des œuvres à nous, dans le style que
nous croyons roman ou gothique, est un acte véritable
de vandalisme... La grande harmonie des choses entre
elles, c'est quand une belle œuvre renferme un
objet beau.»
Des parties du retable baroque du XVIIe siècle
sont encore visibles dans l'église. Le centre
était occupé par le tableau de Pierre
de Nantiac, Saint
Pierre recevant les clés du Ciel, actuellement
dans le baptistère.
De part et d'autre se dressaient les grandes statues
polychromes de saint
Pierre et de saint
Paul. Au sommet, on voyait le haut-relief
du Père éternel, placé à
présent dans le bas-côté sud. En
1861, précise Marionneau, il était entreposé
à la sacristie ; une gloire l'avait remplacé.
|
|
|

Les cinq pans du chœur sont pourvus de vitraux historiés
du XIXe siècle.
Ici, les deux vitraux au nord et le vitrail axial. |

Saint Pierre trône avec la clé du Paradis à la clé de voûte
du chœur, XVe siècle.
L'apôtre est coiffé d'une tiare papale au format réduit. |
|
| LES CINQ VITRAUX
DE L'ABSIDE |
|

Baie 3 : début de la vie
néotestamentaire de
saint Pierre.
Atelier Villiet, Bordeaux. |
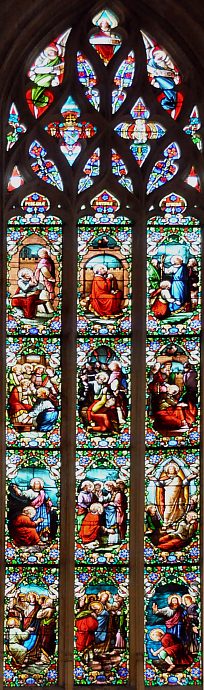
Baie 1 : Vie de saint Pierre.
Atelier Villiet, 1862. |

Baie 0 : la Vierge consolatrice
Atelier inconnu (Villiet ?)
Fragments venant de l'église Saint-Jacques
à Bordeaux. |
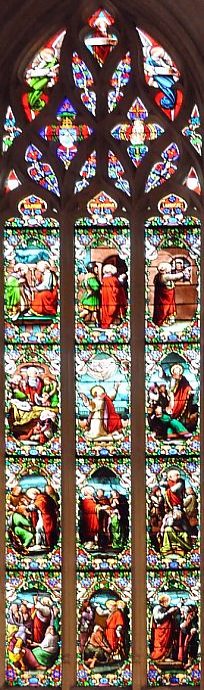
Baie 2 : Vie de saint Pierre.
Atelier Villiet, 1873.
|
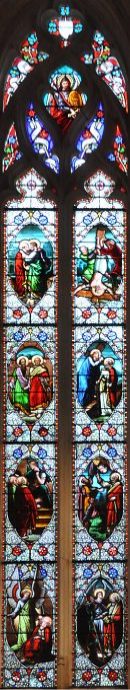
Baie 4 : Vie de saint Pierre.
Atelier Villiet, 1873. |

Baie 0, partie haute : la Vierge consolatrice portant
l'Enfant est entourée de deux anges.
Des hommes et des femmes lui adressent leurs prières.
En bas, au centre : une reine, aux mains liées, est accompagnée
de deux esclaves enchaînés. |
|
Baie
0 : la Vierge consolatrice (2/2).
---»» D'autre part, le rappel du rôle
de Bordeaux
dans le trafic négrier, au bas de la baie 0,
et surtout son association apparente avec Israël
- et donc avec la communauté juive de la ville
- ne correspond pas aux études des historiens,
la plus grande part de ce trafic ayant été
l'œuvre des familles chrétiennes de la ville.
Donc, la question subsiste : pourquoi cette association ? Y aurait-il eu, chez certains chanoines, une volonté
de salir le judaïsme en lui attribuant un rôle
historique qu'il n'a pas eu à Bordeaux ? Le mystère demeure.
Quant au bas du vitrail de la baie 0, il est indépendant
de la partie haute. Il représente une très
belle Assomption (donnée ci-contre) honorée
par la présence des grandes figures du christianisme
(rois et hommes d'Église).
|
|

Baie 0, panneau central du bas, détail.
La femme couronnée symbolise-t-elle la Synagogue ? Et
pourquoi cette association avec des esclaves noirs ?
Est-ce une procession de moines à l'arrière-plan
? |
|
|
Baie
0 : la Vierge consolatrice (1/2).
Le vitrail qui orne la baie centrale de l'abside ne
fait initialement pas partie des vitraux ornant les
cinq pans de cette abside. Le précédent
vitrail a en effet été détruit
dans un incendie en 1973. Cependant, la désaffectation
de l'église bordelaise Saint-Jacques, rue du
Mirail, a été mise à profit : certaines
parties de ses verrières ont été
utilisées pour reconstituer, pour la baie 0,
un grand vitrail dédié à la Vierge
consolatrice.
Le vitrail est clairement du XIXe siècle. La
comparaison des styles porte à croire qu'il sort,
comme ceux des autres baies de l'abside, de l'atelier
bordelais de Joseph Villiet.
La partie haute présente Marie portant l'Enfant
entourée de deux anges. Dans la partie basse,
hommes et femmes, soldats et mères adressent
leurs prières à la Vierge. Un détail
doit être souligné : la présence,
juste au-dessous de Marie, d'une femme couronnée,
aux mains ligotées, accompagnée de deux
esclaves noirs enchaînés.
Que signifie ce dessin ? La juxtaposition des
trois personnages a-t-elle un sens caché ou n'est-elle
qu'une simple composition artistique ? Le thème
de la reine ligotée n'a pu être retenu
par le cartonnier qu'à la demande des chanoines
du chapitre de l'église Saint-Jacques, ou au
minimum avec leur accord.
Cette femme couronnée et aux mains liées
pourrait être une allégorie de Jérusalem ou d'Israël
: la reine captive et infidèle serait punie pour ses
fautes, la couronne symbolisant sa gloire passée. Les
esclaves à ses pieds associeraient sa chute au
trafic esclavagiste bordelais, présenté
comme une faute. Pourquoi cette association ?
Si l'on se restreint au cadre religieux et à
l'opposition originelle entre christianisme et judaïsme,
la reine aux mains liées pourrait symboliser
plus simplement la Synagogue, toujours représentée
dans l'iconographie chrétienne par une femme,
ici honteuse devant Marie et son fils.
Il est intéressant de relier ce panneau (qui, rappelons-le,
vient de l'église Saint-Jacques) à un panneau de la
baie 2 de l'abside de l'église Saint-Pierre, donné plus
bas et contemporain du précédent : l'apôtre Pierre,
les bras levés vers le Ciel, reçoit le refus divin de
l'existence d'aliments impurs. Cette scène, plutôt rare
dans les vitraux, doit être rattachée au Concile
de Jérusalem qui eut lieu vers l'année 49-50 (voir
le commentaire
plus bas). Aux yeux de l'Église, l'inclusion de cette
image de Pierre recevant la sanction divine pourrait
être interprétée comme une charge contre les principes
judaïques et le refus bimillénaire des Juifs d'ouvrir
les yeux devant la vérité chrétienne. Ce qui serait
donc à nouveau une attaque contre la Synagogue.
Ces deux vitraux viennent de deux églises différentes
et illustrent donc la volonté de deux chapitres
de chanoines différents. D'où la question
: pourquoi, dans les années 1870, cette offensive
concertée contre le judaïsme ? Le cardinal
Donnet (1795-1882), archevêque de Bordeaux
en fonction cette époque, était-il à
la manœuvre ? Ce serait compatible avec la date
de création des verrières : 1873 pour
la baie 2 et vraisemblablement une date voisine pour
la baie 0. Mais le cardinal Donnet a laissé à
la postérité l'image d'un inlassable constructeur
d'églises, et non celle d'un pourfendeur de la
Synagogue.
---»» Suite 2/2
ci-dessous à gauche.
|
|
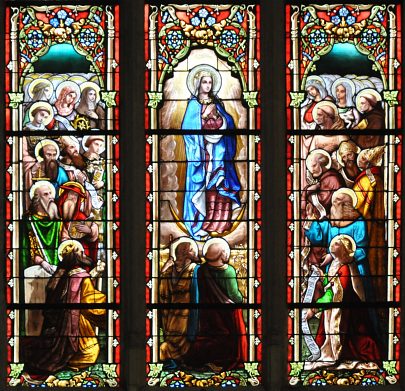
Baie 0, partie basse : l'Assomption.
Atelier inconnu (Villiet ?), fin du XIXe siècle. |

Baie 0, partie basse : l'Assomption, détail. |
|

Statue de saint Paul en bois doré.
Sculpteur Jacques Brunet, 1664. |
| Baies 1
et 2 à trois lancettes : Épisodes de la
vie de saint Pierre |
|

Baie 1, 3e registre : Lavement des pieds ; Pierre coupe
l'oreille d'un serviteur du grand prêtre ; Reniement de
Pierre.
Atelier Villiet, Bordeaux, 1862. |
|

Baie 1, 4e registre : Jésus regarde Pierre qui
vient de le renier ;
Repentir de Pierre ; Pierre pasteur des brebis du Christ.
Atelier Villiet, Bordeaux, 1862. |
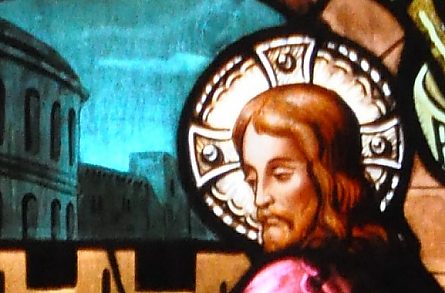
Baie 1, 4e registre : Jésus regarde Pierre qui
vient de le renier, détail.
Atelier Villiet, Bordeaux, 1862.
Loin de mépriser son apôtre, Jésus
lui adresse un regard plein de compassion. |
|
|
Jésus
regardant Pierre après son triple reniement ---»»
C'est une scène rare dans les vitraux et les
tableaux. Les artistes préfèrent représenter
le repentir de Pierre.
La scène ne se trouve que dans l'Évangile
selon saint Luc.
Rappelons les faits selon cet Évangile :
Une fois arrêté, Jésus est emmené
dans la résidence du grand prêtre. Il s'agirait
de Hanne, beau-père de Caïphe, grand prêtre
en exercice. Contrairement à ce qu'écrivent
les Évangiles selon Matthieu et selon Marc, les
apôtres, sous la plume de Luc, ne s'enfuient pas.
Au contraire, l'Évangéliste précise
qu'un feu avait été allumé au milieu
de la cour [dans la résidence du grand prêtre]
et que tous étaient assis là, Pierre au
milieu d'eux.
Viennent à passer une servante et deux serviteurs
du grand prêtre qui, reconnaissant Pierre, le
contraignent à renier l'engagement que ce dernier
a pris quelques heures plus tôt auprès
de Jésus.
Luc ajoute alors, laconiquement, que le Seigneur se
retourna et posa son regard sur Pierre. Et c'est tout.
Dès lors, comment représenter le visage
du Christ regardant l'apôtre ?
Le choix de l'atelier Villiet a peut-être été
de peindre ce visage dans une expression impassible.
Néanmoins, vu de loin, on ne peut s'empêcher
d'y déceler un regard peu amène, voire
méprisant envers Pierre. Le Christ ligoté
toise son apôtre de haut.
Il faut agrandir l'image pour repérer, dans le
visage christique, une expression vraie de pitié,
en quelque sorte une prise en compte de la faiblesse
humaine et du pardon qu'elle entraîne. Bref, l'expression
que l'on attend de Jésus.
Comme quoi, il n'est pas simple pour un cartonnier de
peindre cette scène. Ce que l'on voit de loin n'est
pas toujours ce que l'on observe de près.
|
|

Baie 2, 3e registre : Pierre ressuscite Tabitha ; Aliments
déclarés purs par Dieu ; Mort d'Ananie.
Atelier Villiet, Bordeaux, 1873. |
|
Baie
2 : les aliments déclarés purs par Dieu.
Avec Jésus
qui regarde Pierre après son reniement, le panneau
central de l'image ci-dessus montre une autre scène
peu présente dans les tableaux et les vitraux : tous
les aliments sont déclarés purs par le Ciel.
La scène se trouve dans les Actes des Apôtres
(10, 9-16). Pierre a une vision : une grande toile descend
des cieux ; elle abrite tous les quadrupèdes, tous les
reptiles de la terre et tous les oiseaux. Une voix céleste
demande à l'apôtre de les offrir en sacrifice et de
les manger. Pierre refuse : il n'a jamais pris d'aliment
interdit et impur !
La voix répond : «Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne
le déclare pas interdit.» Ce court dialogue se répète
deux fois, puis la toile remonte au ciel avec tous les
animaux qu'elle contient. Pierre reste perplexe. Quel
sens donner à cette vision ? Il s'en va alors
à Césarée trouver le centurion Corneille, guidé par
les envoyés du centurion.
Quel est le sens de la vision ? Au début de notre
ère, l'univers gréco-romain est un melting-pot culturel
et cultuel complexe. Dans cet univers, le petit monde
du judaïsme comprend essentiellement deux groupes :
les Juifs (qui appliquent les lois de Moïse) et les
Craignant-Dieu qui sont des sympathisants du judaïsme.
Les Craignant-Dieu adoptent les croyances des Juifs,
fréquentent la synagogue, mais n'appliquent pas la circoncision
et pas non plus les interdits alimentaires. Corneille
est un Craignant-Dieu. Les non-Juifs se regroupent dans
le terme de «nations» ou de «gentils».
C'est quand il se retrouve en face du centurion et de
toute sa maisonnée que Pierre comprend le sens de la
vision : aucun animal n'est impur, mais également aucun
être humain. Il faut côtoyer tous les hommes et sortir
de l'ostracisme dont les Juifs frappent les non-Juifs.
Ainsi la Bonne Nouvelle pourra être portée à tous : Juifs et Gentils.
Quelque temps plus tard, vers l'an 49-50, c'est ce principe
qui sera adopté par les apôtres lors du
Concile de Jérusalem. Les théologiens appellent
ainsi les discussions qui opposeront Paul à Jacques.
Pour étendre la foi dans le Christ, il faut sortir du
cadre mosaïque, c'est-à-dire rejeter la circoncision
et oublier le concept d'aliments impurs. Jacques défend
la loi de Moïse ; Paul veut son abandon et l'ouverture
du baptême à tous. Pierre, chef des apôtres, se ralliera
à Paul et ouvrira ainsi le christianisme au monde.
|
|
|
Baie 2, 1er registre :
Pierre baptise le centurion Corneille ---»»»
Atelier Villiet, Bordeaux, 1873.
|
|
|

Baie 1, 4e registre : Jésus regarde Pierre
qui vient de le renier (Évangile selon saint Luc)
Atelier Villiet, Bordeaux, 1862.
Jésus semble mépriser son apôtre... |
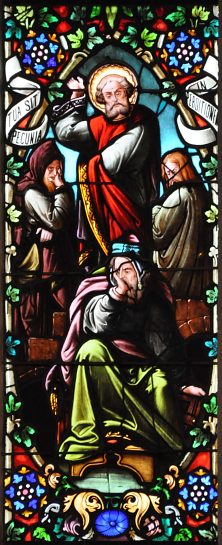
Baie 2, 2e registre : Pierre repousse l'offre
du magicien Simon.
Voyant Pierre faire descendre l'Esprit-Saint
sur les chrétiens baptisés, Simon lui propose
de lui acheter son pouvoir. |
 |
|
| Baies 3 et 4 à
deux lancettes : Épisodes de la vie de saint Pierre (début
et fin) |
|

Baie 3, 4e reg. : Jésus marche sur les eaux et sauve
Pierre ; Jésus ressuscite la fille de Jaïre.
Atelier Villiet, Bordeaux, 1873. |

Baie 4, 3e registre : Quo vadis domine ?
Atelier Villiet, Bordeaux, XIXe siècle. |

Baie 4, tympan : l'Archange saint Michel
et son bouclier, XIXe siècle. |
|
|
Quo
vadis, domine ?
Cette question vient de la Légende Dorée
de Jacques de Voragine : Pierre fuit Rome pour
ne pas y subir le martyre et Jésus lui apparaît
en chemin. Où vas-tu, maître ? demande
Pierre. À Rome pour y être crucifié à nouveau,
rétorque le Christ. Sous-entendu :
puisque tu ne veux pas y aller ! Et Pierre
fait demi-tour.
L'église Saint-Aignan
à Chartres
possède une verrière datée
de 1540 sur ce thème. Voir aussi la toile
de Jérôme Saurlay, datée de 1664,
à la cathédrale
Saint-Louis de Versailles.
|
|

Baie 4, 1er registre : un ange délivre Pierre
dans sa prison. |
|
««---Quis
ut Deus ?
Qui est comme Dieu ? C'est
la devise de l'archange saint Michel inscrite
ici sur son bouclier.
|
|
|
|

Baie 4, 2e registre : Pierre et Paul devant Néron, Pierre
fait tomber Simon le magicien.
Atelier Villiet, Bordeaux, 1873. |
|
La
chute de Simon le magicien.
L'image ci-dessus illustre deux scènes : à gauche, Pierre
et Paul devant l'empereur Néron et une autre, à droite,
présentée comme une «scène inconnue et difficilement
identifiable» dans le panneau descriptif de l'église.
Il s'agit pourtant d'une scène relativement connue de
la chute de Simon le Magicien telle qu'elle est relatée
dans les Actes de Pierre, texte apocryphe daté de la fin du IIe siècle.
La scène est à Rome où le magicien Simon jouit de l'admiration
de ses nombreux disciples et de la faveur de l'empereur
Néron. Quelques semaines plus tôt, Simon a perdu
la face lors de l'épreuve de la résurrection
d'un cadavre : Simon n'a pas réussi à ramener le mort à la vie ; l'apôtre Pierre
l'a fait. Offensé et humilié, le magicien menace
de quitter Rome en s'envolant au Ciel d'où il enverra
des châtiments sur la ville ! Il décide de mettre
sa menace à exécution et en annonce le jour.
À la date convenue, sur la colline du Capitole,
des milliers de gens se rassemblent. Et Simon s'envole
vers le Ciel devant une foule admirative...
Sachant que le magicien ne tient ses pouvoirs que d'une
puissance maléfique, Pierre s'adresse alors à Jésus
et le prie de montrer sa toute-puissance divine. Au
nom du Christ, l'apôtre ordonne aux démons de lâcher
Simon. Aussitôt celui-ci s'écroule à terre et se blesse
mortellement. L'auteur du récit ajoute que Simon mourut
quelques jours plus tard comme un réprouvé, c'est-à-dire
en ennemi de Dieu, en maudissant Pierre et les chrétiens.
L'image ci-dessous illustre la chute de Simon le magicien
dans le vitrail du XIIIe siècle consacré aux vies de
saint Blaise, saint Pierre et saint Paul dans l'église
Saint-Pierre
à Saint-Julien du Sault en Bourgogne. Voir aussi l'église
Saint-Martin-ès-Vignes
à Troyes.
Deux tableaux, dans ce site, présentent une vue d'artiste
de cette chute : la première au musée
des Beaux Arts de Caen ; la seconde au musée
André-Malraux au Havre.
|
|

ÉGLISE
SAINT-PIERRE À SAINT-JULIEN-DU-SAULT (YONNE)
Baie 1, détail : Pierre et Paul prient pour que
Dieu stoppe le pouvoir du démon qui a permis à
Simon de voler.
(Les Actes des Apôtres ne font mention que de la présence
de Pierre.)
Vitrail du milieu du XIIIe siècle, restauré au XIXe siècle. |
|

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur.
Les grandes orgues, de 1850, sont dues au facteur Georges Wenner.
comme celles de l'église Saint-Louis
et de l'église Saint-Éloi.
|
Documentation : «Les églises de Bordeaux» de
l'abbé Brun, éditions Delmas, 1952
+ «Aquitaine gothique» de Jacques Gardelles, éditions Picard, 1992
+ «Description des œuvres d'art qui décorent les édifices publics
de Bordeaux» de Charles Marionneau, 1861
+ «Bordeaux Le temps de l'histoire» de Robert Coustet et Marc Saboya,
éditions Mollat, 2000
+ «L'esprit des bâtisseurs», édité par les Amis d'Ars et Fides Bordeaux, 2011
+ «Église Saint-Pierre», brochure de l'Office de Tourisme
+ Panneaux d'information dans la nef. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|