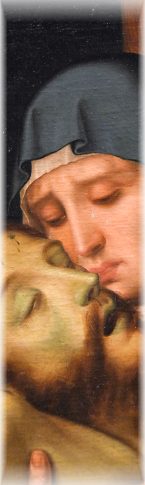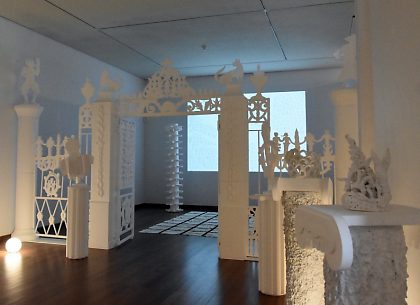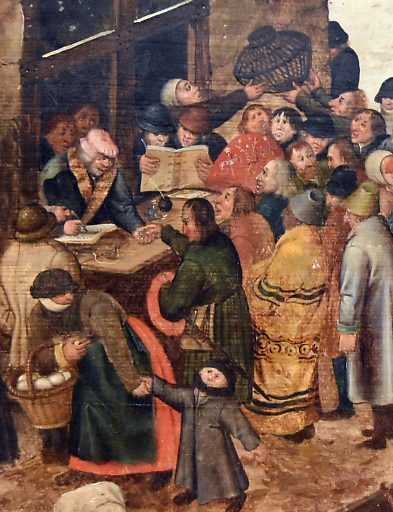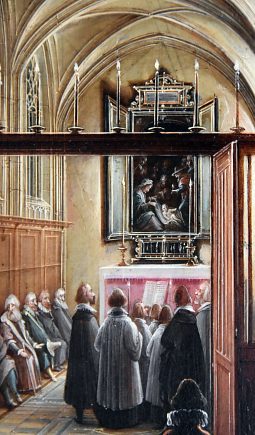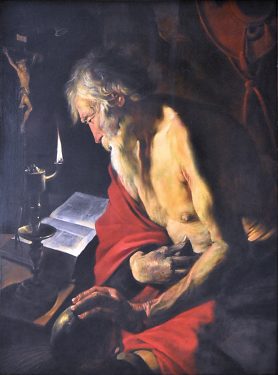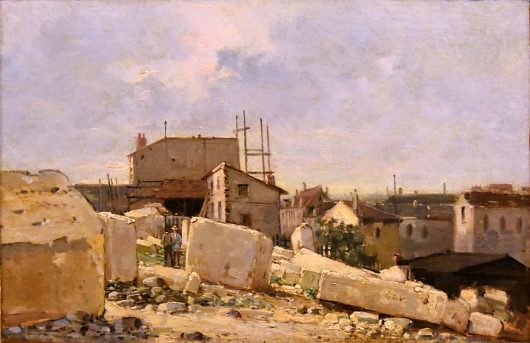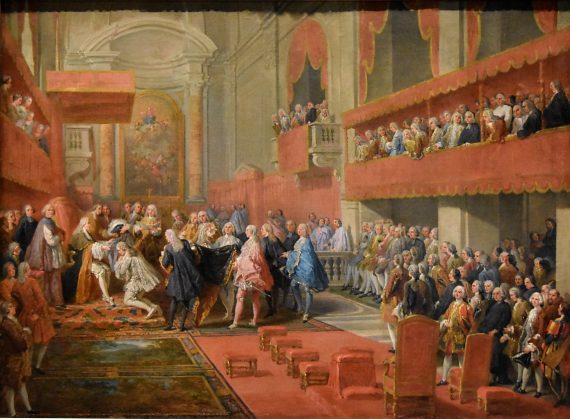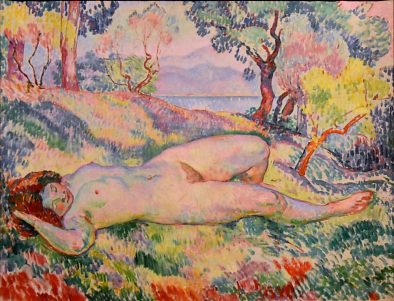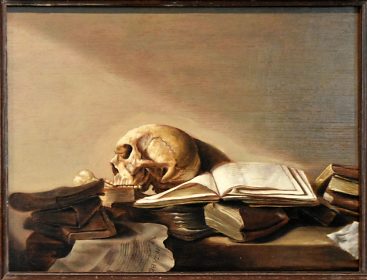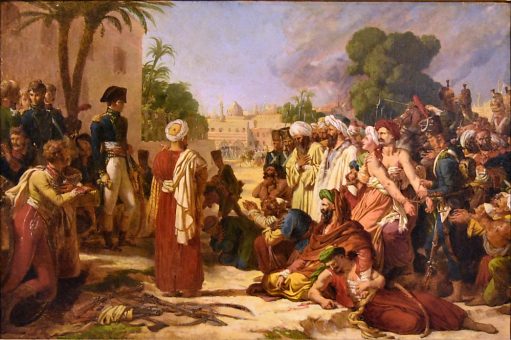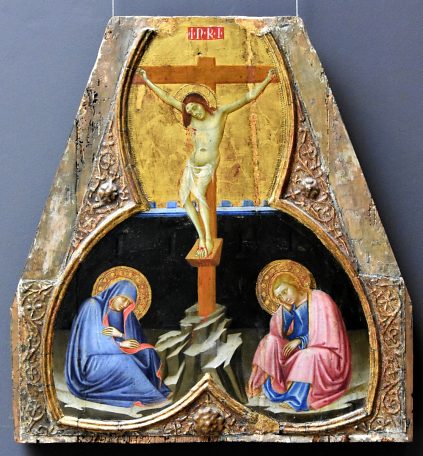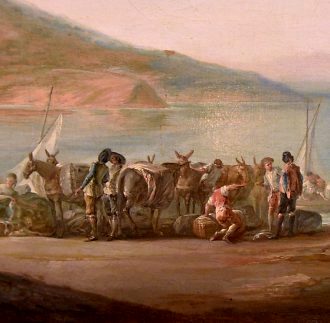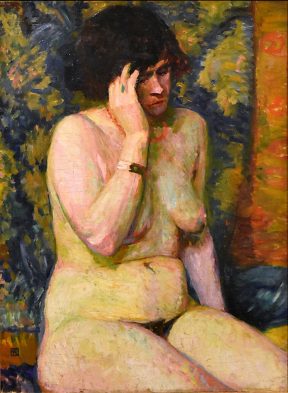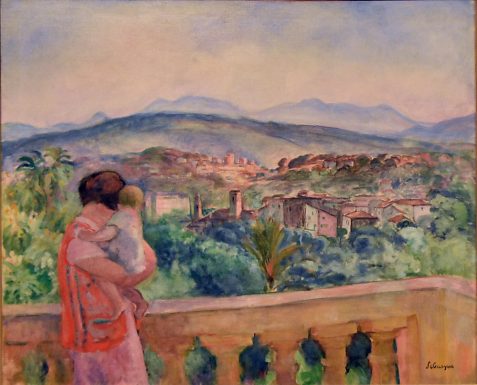|
|
 |
 |
Avec sa superficie à taille humaine
le musée des Beaux-Arts de Caen
ne doit être négligé par aucun visiteur de la
ville. Certes, il n'est pas aussi étendu que son voisin le
musée
des Beaux-Arts de Rouen, mais la qualité de ses tableaux
est de la même étoffe. Logé dans un bâtiment
moderne au sein de l'enceinte du château
et tout près du musée
de Normandie, il présente une succession de galeries
agréablement aménagées. Cette page propose
des extraits des importantes collections italiennes,
françaises,
flamandes
et hollandaises
du XVIe au XIXe siècle.
Historiquement, le premier musée ouvre ses portes à
Caen
en 1809. La volonté du pouvoir impérial est d'exposer,
dans quinze villes de province, les toiles confisquées aux émigrés
ou acquises lors des guerres révolutionnaires et napoléoniennes.
Caen est du nombre et le musée s'installe dans une aile de
l’ancien séminaire des Eudistes. Les collections s'enrichissent
tout au long du XIXe siècle. En 1811, ce sont 35 peintures
qui sont attribuées à Caen par le ministre de l’Intérieur.
En 1853, la ville accepte un legs de 141 tableaux dont la plupart
viennent de la galerie de Jean Regnault de Segrais. En 1858, nouveau
legs : celui de la baronne de Montaran qui offre des œuvres
de François Boucher, de Théodore Gudin et une de Pierre Mignard.
En 1872, le musée voit arriver le très important legs
de la collection Mancel. Bernard Mancel est un libraire caennais
qui a acheté à Rome en 1845 une grande partie de la collection
du cardinal Fesch, oncle de Napoléon Ier. Cette collection, riche
de plus de 50 000 œuvres, recèle des trésors
: estampes de Dürer, de Rembrandt, de Callot et une trentaine de
toiles dont la Vierge
à l'Enfant de Rogier van der Weyden.
Au début du XXe siècle, la conservation s'oriente
davantage vers l'achat d'œuvres régionalistes «d’intérêt exclusivement
local» lit-on sur le site Web du musée. Malheureusement,
en novembre 1905, les bâtiments, devenus vétustes, sont la
proie des flammes. Une partie des collections part en fumée.
Des œuvres des écoles hollandaise et flamande sont perdues.
Bien évidemment, dans les presses régionale et nationale,
cet incendie fait scandale. On exige que le musée soit réorganisé.
Ce qui ne sera fait qu'en 1970...
Au début de la seconde guerre mondiale, une bonne partie
des collections (dont la collection Mancel) sont mises à
l'abri au prieuré Saint-Gabriel, à l’abbaye de Mondaye et au château
de Baillou. Mais le sort s'acharne encore sur les Beaux-Arts caennais.
Lors des bombardements de juin et juillet 1944, l’ancien séminaire
des Eudistes, où se trouve toujours le musée, est
en grande partie détruit. La plupart des œuvres qui n'ont pas
été mises à l'abri sont détruites :
tableaux, dessins, meubles, objets d'art, sculptures. Auxquelles
il faut rajouter les archives, les inventaires et les cadres...
Ce qui reste est entreposé dans les ruines de l’hôtel d'Escoville
et du musée Langlois.
Dans les années 1960, un nouveau bâtiment est construit
dans l'enceinte du château.
Il ouvre ses portes en 1970. La conservation entame alors une politique
d’acquisition centrée sur les écoles françaises,
italiennes
et flamandes
du XVIIe siècle. En 1982, saluant leur importance ainsi que la vitalité
de la politique d'acquisition, le musée est promu musée classé.
Si vous passez à Caen,
ne manquez pas ce musée des Beaux-Arts. Il contient peu de
sculptures, mais offre aux visiteurs des tableaux dignes d'intérêt
dans un espace très étudié. Les différentes
vues des salles incluses dans cette page pourront en convaincre
les amateurs d'art.
|
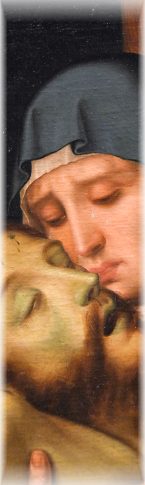 |

Une salle des peintures de l'École française.
Au premier plan à gauche, un bronze d'Antoine-Louis BARYE :
Le Lion au serpent. |

L'entrée du musée. |
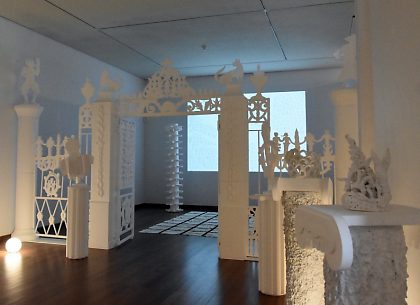
Une salle d'art moderne. |

Le Parc des sculptures au-dessus de l'entrée. |
| FLANDRES - ÉCOLES
DU NORD |
|

Une salle des Écoles du Nord. |
|
Le
cachet du musée. La photo ci-dessus
donne une idée assez précise de l'aspect
du musée des Beaux-Arts de Caen.
Il a été créé dans un ensemble
de béton avec, pour seul objectif, sa fonctionnalité
: assurer un espace suffisant pour admirer les nombreux
tableaux qui garnissent les murs. On peut en conclure
qu'il n'a pas de «cachet». À ce titre,
il rejoint les musées français des Beaux-Arts
construits dans le même but, comme le très
riche musée
de Rouen.
Ceux qui aiment se retrouver dans une atmosphère
pittoresque en visitant un musée pourront se
diriger vers le musée
d'Arras, logé dans l'ancienne abbaye Saint-Vaast
dotée d'un très beau cloître, le
musée
Lambinet de Versailles,
logé dans un hôtel particulier de 1750
ou encore le musée
de Chaumont dont une partie se trouve dans les salles
basses d'un château, des salles dont le voûtement
est soutenu par de pittoresques grosses piles en parasol.
|
|
«La Vierge et
l'Enfant avec sainte Barbe, sainte Catherine et sainte
Madeleine» ---»»»
Maniériste anversois. Vers 1505-1515. Huile
sur bois. |
|
|
 |

«Le Dénombrement de Bethléem»
Pieter BRUEGEL LE JEUNE dit d'ENFER (1564-1638)
Huile sur bois.

|
«Le
Dénombrement de Bethléem».
Le thème du dénombrement (avec la présence
de Marie et Joseph) se superpose au paiement de la dîme
à l'empereur Charles-Quint.
Cette œuvre est une copie du tableau de Pieter Bruegel
l'Ancien, daté de 1566 et exposé au musée
royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Source : note
affichée dans le musée.
|
| 
«La Vierge et l'Enfant avec sainte Barbe,
sainte Catherine et sainte Madeleine» détail.
Maniériste anversois. Vers 1505-1515.
Huile sur bois.

Le maniérisme a fait des doigts de
sainte Barbe des doigts qui font peur ! |

«La Vierge et l'Enfant»
Rogier de la Pasture ou Rogier van der WEYDEN (1399/1400-1464)
Huile sur bois.

Cette œuvre est la moitié d'un diptyque exposé
aux Musées Royaux de Bruxelles. L'autre moitié représente
le donateur en prière, Laurent Froimont. |
|
Pourquoi
il faut visiter les musées. Le tableau de
Pieter Bruegel le Jeune ci-dessus recèle quelques détails
dignes d'intérêt.
Mais on ne les découvre qu'en mettant quasiment le
nez sur la toile ! Il n'est pas possible de les voir
en regardant la photographie du tableau dans un livre d'art.
D'où l'intérêt d'entrer dans les musées
des Beaux Arts dès qu'on se trouve dans une ville que
l'on visite.
La toile de Pieter Bruegel illustre le dénombrement
de Bethléem, mais aussi le recouvrement de la dîme.
Quoi de plus intéressant que la tête goguenarde
du collecteur d'impôt, un brin provocatrice, qui reçoit
les pièces d'un paysan qui, lui, affiche une mine piteuse
!
La toile du baptême
du Christ par Lambert Sustris donnée plus bas montre
aussi un détail savoureux : une jeune femme aux seins
nus se prélasse sur un rocher sous le soleil tandis
que le Sauveur du monde et Fils de l'Homme est en train de
se faire baptiser à côté ! Encore un détail
que vous ne verrez pas dans la reproduction de ce tableau
dans un livre d'art...
|
|
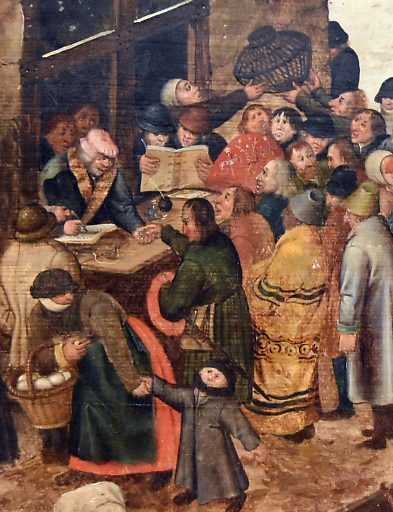
«Le Dénombrement de Bethléem», détail.
Pieter BRUEGEL LE JEUNE dit d'ENFER (1564-1638).
Huile sur bois. |

«Intérieur d'église»
Hendrick II van STEENWYCK (1580-1649).
Huile sur cuivre doublé de bois.

La note du musée indique que le tableau représente vraisemblablement
une variation de l'intérieur de la cathédrale d'Anvers.
Voir un autre intérieur d'église du même artiste
au musée des Beaux-Arts
de Cambrai. |
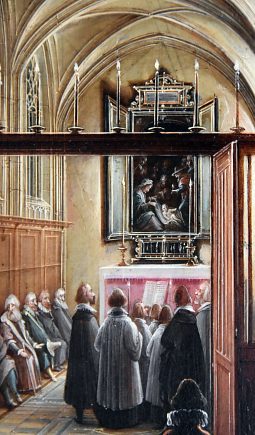
«Intérieur d'église», détail.
Hendrick II van STEENWYCK (1580-1649).

Cette partie de la toile représente une messe dans une chapelle
privée, sûrement la propriété d'un haut
dignitaire. |

«Portrait de jeune femme»
Cornelis JANSSENS van CEULEN (1593-1661)
Huile sur toile. |

«Figure d'apôtre en prière»
Jacob JORDAENS (1593-1678). Huile sur bois. |

«Portrait de femme»
Abraham van den TEMPEL (1622/1623-1672). Huile sur toile.
Il devait faire bien froid dans les logements
pour être aussi couverts... |

«Le Baptême du Christ»
Lambert SUSTRIS (1515/1520 - après 1568)
Huile sur toile. |

«Le Baptême du Christ», détail.
Lambert SUSTRIS (1515/1520 - après 1568).

La présence d'un nu féminin est originale dans une scène
du baptême du Christ. |

«Paysage avec convoi attelé»
Frederick de MOUCHERON (1633-1686)
Huile sur toile. |

«L'Assomption de la Vierge»
Pierre Paul RUBENS (1577-1640). Huile sur cuivre.

Très inspiré par ce thème, Rubens a réalisé
une dizaine de versions de l'Assomption. |

«Intérieur d'un laboratoire d'alchimiste»
Thomas WYCK (vers 1616-1677)
Huile sur bois. |

«Marie-Madeleine pénitente»
Johannes MOREELSE (vers 1603-1634)
Huile sur bois. |
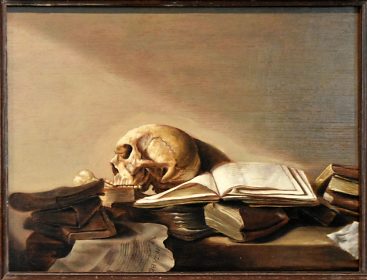
«Vanité»
Jan Davidsz de HEEM (1606-1684)
Huile sur bois. |
«Intérieur
de cuisine» ---»»»
Hendrick Maertensz SORGH (1610/1611-1670).
Huile sur bois.
L'existence de ce genre de tableau est fort utile
pour les historiens de la vie quotidienne. |
|
|
|

«Paysage avec trois figures, un lac et un château»
Jan Frans van BLOEMEN dit L'ORIZZONTE (1656-1749)
Huile sur toile. |
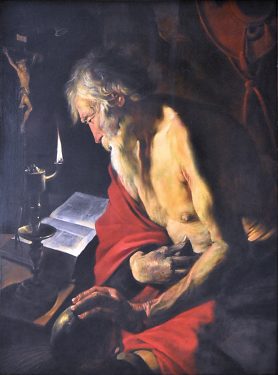
«Saint Jérôme»
École flamande (1ère moitié du XVIIe siècle)
Huile sur bois.
Cette toile est parfois attribuée à Artus Wolffort. |
|
|
|
|

«L'Annonciation»
Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)
Huile sur toile. |

«L'Homme à la figue»
Simon VOUET (1590-1649)
Huile sur toile. |
|

«Saint Charles Borromée donnant la Communion»
Pierre MIGNARD (1612-1695)
Huile sur toile. |

«La Samaritaine»
Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)
Huile sur toile. |
|
«Saint
Charles Borromée donnant la Communion».
Ce thème religieux est très populaire au XVIIe
siècle. Charles Borromée, archevêque de
Milan, est resté dans sa ville pendant la peste de
1576. Ce qui lui coûtera la vie. Sa conduite, jugée
exemplaire et sans cesse rappelée dans les peintures,
incarne la piété et la charité. Cette
esquisse a été réalisée à
l'occasion du concours pour l'ornement du maître-autel
de l'église San Carlo ai Catinari de Rome. Charles
Borromée s'est aussi beaucoup investi dans la Contre-Réforme.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|

«La Sibylle d'Érythrée»
École française ?
Vers 1630-1640.

Très belle œuvre caravagesque marquée par
différentes influences artistiques,
ce qui rend son attribution très difficile. |

«La Sibylle d'Érythrée», détail. |

«Portrait du graveur Benoît I Audran»
Joseph VIVIEN (1657-1734)
Huile sur toile. |

«Chaumière près d'une rivière»
Jean PILLEMENT (1728-1808)
Huile sur toile. |

«Pastorale ou Berger gardant ses moutons»
François BOUCHER (1703-1770)
Huile sur toile. |
|
«Portrait
de jeune femme inconnue». La note du
musée indique que les Souvenirs de madame
Vigée Lebrun, qui donnent la liste de ses œuvres,
ne permettent pas d'identifier ce modèle.
|
|
|

«David insultant Goliath après l'avoir vaincu»
Jean-Jacques LAGRENÉE (1739-1821)
Huile sur toile. |

«Portrait de jeune femme inconnue»
Louise Élisabeth VIGÉE LEBRUN (1755-1842)
Huile sur toile, 1755. |
|

«Portrait du frère François Romain, architecte»
François JOUVENET (1664-1749)
Huile sur toile.

|
Le dominicain François
Romain, originaire de Gand, fut appelé par Louis XIV
pour assister Jacques Gabriel dans la construction du pont
Royal. L'impétuosité de la Seine en accroissait
la difficulté.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|

«Moïse exposé aux eaux»
Robert LE VRAC dit TOURNIÈRES (1667-1752)
Huile sur bois.

Tournières est un peintre local puisqu'il est né et
mort à Caen. |

«Salomon fait transporter l'arche dans le Temple»
Blaise-Nicolas LE SUEUR (1716-1783)
Huile sur toile. |

«Jésus chassant les marchands du Temple»
Simon JULIEN (1735-1800)
Huile sur toile, 1798. |

«Le Soleil couchant» ou «Vue des environs
de Dieppe»
Antoine LEBEL (1705-1793)
Huile sur toile. |
|
|

«Hermione rejetant Oreste»
École française. Vers 1800-1810
Huile sur toile. |
|
«Hermione
rejetant Oreste» (1/2).
Cette toile, acquise par le musée à l'Hôtel
Drouot en 1966, pose un problème d'interprétation.
Lors de la vente, elle s'intitulait : Tableau représentant
un guerrier romain avec deux femmes et son auteur restait
anonyme. Françoise Debaisieux, la conservatrice du
musée des Beaux-Arts de Caen qui acheta l'œuvre
à l'époque, y reconnaissait une scène
tirée de l'Andromaque de Racine, quand Oreste,
au dernier acte, vient annoncer à Hermione qu'il a
tué Pyrrhus conformément à sa demande.
Notons tout de suite que le bas de la toile, très dégradé,
a bénéficié d'une excellente restauration
réalisée par Normandie Patrimoine (Centre
régional de conservation-restauration des biens culturels
de Basse Normandie).
La conservatrice publia aussitôt cette acquisition dans
la Revue du Louvre en l'attribuant à Pierre-Narcisse
Guérin (1774-1833) sous le titre : Oreste annonçant
à Hermione la mort de Pyrrhus. De prime abord,
on ne voit pas à quel autre peintre rattacher ce tableau
très expressif de l'école néo-classique.
En effet, le baron Guérin a déjà réalisé
un Phèdre et Hippolyte et un Andromaque et
Pyrrhus, tous deux au musée du Louvre (et donnés
plus bas).
Dans une brochure de 2008, centrée sur ce tableau,
Patrick Ramade, à l'époque lui aussi conservateur
en chef du musée des Beaux-Arts de Caen, remet en cause
cette attribution. Au terme d'une analyse savante, il y voit
plutôt la patte d'un élève de Girodet.
Ce brillant dessinateur a déjà illustré
des scènes d'Andromaque dans la luxueuse édition
de Didot en 1801. L'argument principal retenu par Patrick
Ramade tient dans la nature du tableau lui-même et peut
se résumer en deux questions antagonistes : le tableau
est-il l'illustration d'une scène précise d'une
tragédie ou propose-t-il la «synthèse
de plusieurs scènes afin de mieux restituer les caractères
des personnages» [Ramade] ?
Le conservateur nous donne sa réponse : les grands
tableaux d'histoire de Guérin sur les œuvres de
Racine (rappelés plus haut) offrent une conception
personnelle des tragédies sans en illustrer un moment
précis. Suite --»» 2/2
|
|
|
«Hermione
rejetant Oreste» (2/2).
Ils se classent donc dans la seconde catégorie. En
effet, son tableau Andromaque et Pyrrhus ne correspond
à aucune scène de la pièce. Jamais Racine
ne met en présence Pyrrhus, Oreste, Andromaque, Astyanax
et Céphise, la confidente d'Andromaque représentée
dans la partie gauche. Même chose pour Phèdre
et Hippolyte. Jamais Thésée, Phèdre
et Hippolyte ne sont en présence (mise à part
la très courte scène 4 de l'acte III qui n'est
qu'un intermède). Ces toiles sont bien des interprétations
d'auteur pour résumer en un dessin la trame de la tragédie.
À propos de la toile énigmatique d'Hermione
rejetant Oreste, Patrick Ramade écrit : «Notre
peintre se contente, lui, d'illustrer un moment de l'action,
qui malgré son caractère dramatique n'en demeure
pas moins purement narratif.» Françoise Debaisieux,
en effet, attribuait le tableau à un moment très
précis de la tragédie : quand Oreste se présente
devant Hermione au tout début de la scène 3
de l'acte V. Dans une note, elle illustrait la scène
par ces propos d'Oreste : Vous seule avez poussé
les coups... Ce à quoi Hermione répond :
Tais-toi perfide / Et n'impute qu'à toi ton lâche
parricide.
Une étude de la pièce de Racine conduit à
remettre en question cette interprétation factuelle.
Reprenons le dernier acte à son début.
À la scène 1, Hermione, est en proie au doute
: elle ne sait pas si elle veut vraiment la mort de Pyrrhus
qu'elle aime et qui la repousse. Elle a envoyé Oreste
le tuer, ce qu'elle regrette sans le regretter vraiment :

Où suis-je ? Qu'ai-je fait?
Que dois-je faire encore ?
Quel transport me saisit ? Quel chagrin
me dévore?

.À la scène 2, surexcitée par son désir
de vengeance, elle interroge sa confidente Cléone qui
revient du mariage de Pyrrhus et d'Andromaque (mais qui n'en
a pas vu le dénouement) pour s'assurer que sa vengeance
est assouvie. Elle en doute et s'en lamente, rappelant le
rôle si important de sa mère, Hélène,
dans le déclenchement de la guerre de Troie. Le génie
racinien met dans ses lèvres ces vers assez extraordinaires
:

Quoi ? sans qu'elle employât
une seule prière,
Ma mère en sa faveur arma la
Grèce entière ?
Ses yeux pour leur querelle, en dix
ans de combats,
Virent périr vingt rois qu'ils
ne connaissaient pas ?
|
Et moi
je ne prétends que la mort d'un parjure,
Et je charge un amant du soin de mon
injure,
Il peut me conquérir à
ce prix sans danger,
Je me livre moi-même, et ne
puis me venger ?
 
Son état de surexcitation meurtrière est à
son paroxysme. Survient Oreste qui déclare :
 
Madame, c'en est fait, et vous
êtes servie :
Pyrrhus rend à l'autel son
infidèle vie.

Il est mort ?

Il
expire ; et nos Grecs irrités
Ont lavé dans son sang ses
infidélités.

Suit une longue tirade d'Oreste pour décrire l'assassinat
de Pyrrhus par les Grecs qu'Oreste a amenés avec lui.
Le jeune homme précise bien qu'il n'a pu porter le
moindre coup et d'ailleurs s'en excuse. En conséquence,
son épée ne peut porter de traces de sang :

L'infidèle s'est vu partout
envelopper,
et je n'ai pu trouver de place pour
frapper.

À aucun moment de la scène, Hermione n'est susceptible
de présenter un visage horrifié à la
vue d'une épée ensanglantée. La prise
de conscience de la mort de Pyrrhus est progressive. Le visage
très expressif peint par l'artiste inconnu ne correspond
pas à son état d'esprit quand survient Oreste.
C'est toujours la haine envers Pyrrhus qui l'anime, associée
au désir de mort. Lors de la longue description du
meurtre qui suit dans la bouche d'Oreste, Racine lui donne
tout le temps de ruminer son erreur et de prendre le parti
contraire, mettant bien en évidence l'inconstance d'une
femme déchirée entre deux desseins.
Pour autant, la toile est-elle l'interprétation personnelle
d'un peintre qui, dans un seul dessin, entend résumer
la trame de la pièce ? Certainement pas. Il y
manque bien des faits et des personnages. Ce qui nous renvoie
à l'hypothèse raisonnable d'un élève
de Girodet comme auteur de la toile, un auteur qui aurait
un peu «forcé» sur le déroulement
de la scène.
Source : «Hermione rejetant
Oreste, Musée des Beaux Arts de Caen, L'œuvre
en question - 5», 2008.
|
|

«Andromaque et Pyrrhus»
1810
Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)
********* MUSÉE DU LOUVRE ********* |

«Phèdre et Hippolyte»
Salon de 1802
Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833)
********* MUSÉE DU LOUVRE ********* |
|

«Le Lion au serpent»
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Bronze. |

«Groupe allégorique en l'honneur du dauphin
Louis-Charles de France»
Biscuit en pâte dure, Manufacture Locré, 1791. |

«Hermione rejetant Oreste», détail.
École française. Vers 1800-1810
Huile sur toile. |
|
Groupe
allégorique ---»»»
Il représente le dauphin Louis-Charles de
France chevauchant un chien. Louis-Charles est le fils de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, «l'enfant du Temple»
et éphémère Louis XVII. Il est entouré
ici de putti et des figures de Junon, Cérès
et de l'Amour.
Ce biscuit en pâte dure est dédié à
M. Roucelle, architecte des bâtiments de la Guerre et
de la Marine. Il est daté du 18 décembre 1791.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|

«L'Abside de l'église Saint-Pierre
à Caen»
François D'HERBÈS (1805-1877)
Huile sur toile, 1861. |

«Les Petits patriotes»
Philippe-Auguste JEANRON (1809-1877)
Huile sur toile, 1830. |
|
«Les
Petits patriotes». Au XIXe siècle,
Philippe-Auguste Jeanron fut l'un des tenants de l'«art
social». À ce titre, la toile les Petits
patriotes fut sa première œuvre exposée.
Cette toile se veut une image des Trois Glorieuses des
27, 28 et 29 juillet 1830 qui chassèrent Charles
X du pouvoir. Ces gamins de Paris, débraillés
et jouant déjà avec les armes, annoncent
le futur Gavroche de Victor Hugo. Ils sont devenus depuis
un symbole de la République.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|
|
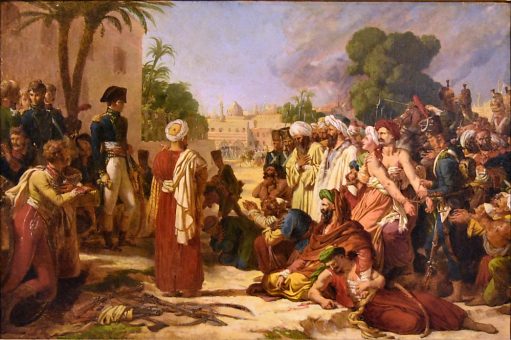
«Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire»
Pierre Narcisse, baron GUÉRIN (1789-1863)
Huile sur papier marouflé sur toile. |

«Le Retour du fils prodigue»
François-André VINCENT (1746-1816)
Huile sur toile. |

«Matelots sortant du port de Saint-Valéry»
Eugène ISABEY (1803-1886). |
|

«Le port de Caen»
Stanislas LÉPINE (1835-1892)
Huile sur toile, vers 1875-1880. |

«Buste de Madame Albert Guérin»
Albert GUÉRIN (1874-1960)
Marbre, 1904.

Le musée possédait une première œuvre d'Albert
Guérin,
«Le dernier ami», qui a été détruite
lors des bombardements de 1944. |
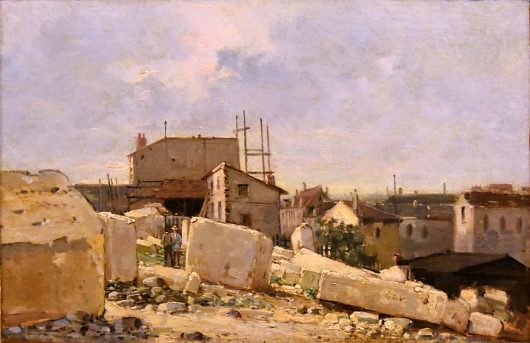
«Une carrière à Caen»
Stanislas LÉPINE (1835-1892)
Huile sur toile. |
|
La pierre
de Caen. Est-ce, comme le suggère la note
du musée, la carrière à ciel ouvert du
faubourg Saint-Julien au nord du château
que Stanislas Lépine a représentée sur
la toile donnée à gauche ? Ce peut être
aussi celle de Vaucelles ou de Calix, les deux autres carrières
urbaines à ciel ouvert en dehors de celles du château.
Ces carrières, qui sont presque toutes dans le centre
habité, creusent des pentes artificielles dans le paysage
urbain. Elles sont arrivées jusqu'à notre époque
très dégradées, excepté celles
plus récentes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Quelle était la qualité du matériau extrait ?
L'historien Giovanni Coppola écrit : «Ces carrières
offrent dans l'ensemble un matériau de mauvaise qualité
et des blocs de petite dimension en raison des micro-diaclases
qui se trouvent en surface et des effets de la pluie ou du
gel sur les bancs de surface.»
Comment s'y faisait l'extraction ? La méthode
la plus pratiquée consistait à creuser dans
le sol pour parvenir au niveau de la pierre saine, puis à
y délimiter une superficie selon la taille de cette
pierre et sa composition. Les carriers mettaient ensuite à
profit, parmi les fissures naturelles de la roche, celles
qui étaient dans le sens de la coupe. Ils y glissaient
des coins en bois ou en fer et les forçaient avec une
massette. Le bloc se détachait ; on faisait la même
chose sur la pierre du dessous ainsi mise à nu et,
de proche en proche, on finissait par trouver une roche de
la qualité recherchée.
Voir l'encadré sur la pierre de Caen à la page
de l'église Saint-Pierre
dans la même ville.
Source : Architecture normande au
Moyen Âge, Éditions Charles Corlet &
Presses Universitaires de Caen, Colloque de Ceristy-la-Salle,
1997, article sur la Pierre de Caen par Giovanni Coppola.
|
|

«La Plage de Deauville»
Eugène BOUDIN (1824-1898)
Huile sur toile, 1893. |

«Paysage aux lavandières»
Eugène BOUDIN (1824-1898)
Huile sur toile, 1873. |
|
|
|
|

«Vierge à l'Enfant entre saint Georges et saint
Jacques»
Giovanni Battista CIMA dit CIMA DA CONEGLIANO (vers 1469-vers
1517).
Triptyque sur bois transposé sur toile, vers 1510-1511. |

«Le Mariage de la Vierge»
Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523)
Huile sur bois, 1504. |

«Le Mariage de la Vierge», détail.
Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523).
Huile sur bois, 1504. |
|

«Saint Jérôme dans le désert»
Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523).
Peinture sur bois. |

«Saint Jérôme dans le désert»,
détail.
Pietro VANNUCCI dit LE PÉRUGIN (vers 1448-1523).
Peinture sur bois.

Le lion et le chapeau cardinalice
sont les attributs de saint Jérôme. |

«Paysage du Latium avec bergers, troupeaux et château»
Gaspard DUGHET (1615-1675)
Huile sur toile. |
|
Selon Tite-Live, Coriolan,
menaçant de détruire Rome, reçut
dans son camp sa mère Volumnie et son épouse
Véturie venues le supplier d'épargner
la Ville.
|
|

«La Cène»
Jacopo ROBUSTI dit LE TINTORET (1518-1594). Huile sur
toile. |
|
«La
Cène». La toile représente
l'interrogation des apôtres après que le
Christ leur a dit : «L'un d'entre vous me livrera».
À gauche, Juda, penché, est déjà
à l'écart.
«La Descente de croix».
Le Tintoret a fait figurer beaucoup de monde dans cette
descente de croix. Au premier plan, saint Jean et les
trois Maries, demi-sœurs de la Vierge, tentent
de réconforter la mère du Crucifié
qui s'est évanouie de douleur. Deux hommes descendent
le corps de Jésus tandis que Joseph d'Arimathie
et Nicodème déploient le linceul. À
droite, l'homme en prière est peut-être
le commanditaire du tableau.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|
|

«La Vierge, les mains croisées sur la poitrine»
Francesco ALBANI (1578-1660)
Huile sur cuivre.
Francesco Albani, dit l'Albane, était un disciple
d'Annibal Carrache. |

«Coriolan supplié par sa mère»
Francesco BARBIERI dit LE GUERCHIN (1591-1666)
Huile sur toile, vers 1640. |

«La Descente de croix»
Jacopo ROBUSTI dit LE TINTORET (1518-1594)
Huile sur toile. |
|

«Apparition du Christ à saint Pierre et saint Paul»
Paolo CALIARI dit VÉRONÈSE (1528-1588)
Huile sur toile. |

«La Tentation de saint Antoine»
Paolo CALIARI dit VÉRONÈSE (1528-1588)
Huile sur toile.
Antoine est tenté par une femme à moitié nue,
puis agressé par un démon musculeux. |

«L'Annonciation»
Paris BORDONE (1500-1571)
Huile sur toile, vers 1545-1550.
Cette jolie toile est plus un prétexte à peindre une
architecture en perspective qu'un moyen d'exprimer la profondeur de
sa foi.
C'est à se demander si l'archange Gabriel regarde la Vierge
ou l'arcature panoramique... |

Une salle des toiles de l'École française. |

«Le Mariage de la Vierge»
Paris BORDONE (1500-1571)
Huile sur toile. |
|

«La Madeleine au tombeau du Christ»
Pietro FACCINI (1562-1602)
Huile sur bois, années 1590.

|
«La
Madeleine au tombeau du Christ». Ce magnifique
tableau très expressif et tout en suggestions, montre
une Marie-Madeleine désemparée à la vue
du tombeau vide. Devant elle, deux anges gesticulent avec
de grands gestes pour lui faire comprendre que son maître
Jésus n'est plus là.
Les œuvres de Pietro Faccini sont rares : on n'en trouve
qu'une trentaine dans le monde. Source : note
affichée dans le musée.
|
|

«La Victoire de Tullus Hostilius sur les forces de Veies et
de Fidena»
Giuseppe CESARI dit LE CAVALIER D'ARPIN (1568-1640)
Huile sur bois. |
|
«La
Victoire de Tullus Hostilius». Cette imposante
scène de bataille est une étude préparatoire
pour l'une des immenses fresques illustrant l'histoire légendaire
de Rome. Ces fresques ont été commandées
au Cavalier d'Arpin pour le Palais des Conservateurs de Rome.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|

«Samson et Dalila»
Giuseppe NUVOLONE (1619-1703)
Huile sur toile. |

«Saint Sébastien»
École Romaine, début du XVIIe siècle
Huile sur bois. |

«Le Martyre de sainte Ursule et des onze mille vierges»
Scipione COMPAGNO (actif entre 1636 et 1658)
Huile sur cuivre. |

Buste de la baronne de Montaran,
née Marie-Constance Moisson de Vaux (1796-1869)
Lorenzo BARTOLINI (1775-1850)
Marbre de Carrare.

|
«Le
Martyre de sainte Ursule et des onze mille vierges».
D'après la Légende dorée, ce martyre
est l'œuvre des Huns et se situe à Cologne. Mais
Scipione Compagno le représente près de Castelnuovo,
dans la baie de Naples, dont il est originaire.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|

«Glaucus et Scylla»
Salvator ROSA (1615-1673). Huile sur toile.

|
«Glaucus
et Scylla». D'après les métamorphoses
d'Ovide, le dieu marin Glaucus s'éprend de Scylla venue
se baigner au bord de la mer. Il essaie de l'attraper, mais
elle se dérobe.
Source : note affichée
dans le musée.
|
|

«Le Martyre de sainte Ursule et des onze mille vierges»,
détail.
Scipione COMPAGNO (actif entre 1636 et 1658). Huile sur cuivre.

|
Ce genre de tableau est très
utile aux historiens navals pour connaître la nature
des navires dans les siècles passés.
On voit ici deux grands cogges
à la poupe surélevée. Un dessin plein
d'intérêt.
|
|

«Ecce Homo»
Gian Domenico TIEPOLO (1727-1804).
Huile sur toile. |
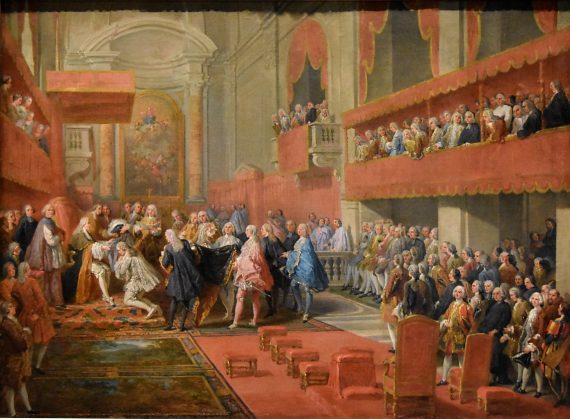
«Remise de l'Ordre du Saint-Esprit par le duc de Saint-Aignan
au prince Vaini
en l'église Saint-Louis-des-Français, le 15 septembre
1737»
Giovanni Paolo PANNINI (vers 1691-1765).
Huile sur toile. |

«La Chute de Simon le Magicien»
Valerio CASTELLO (1624-1659). Huile sur toile.
Voir le commentaire sur la chute de Simon le Magicien à l'église
Saint-Pierre
de Bordeaux. |
 |

«Sainte couronnée de roses»
Bernardo STROZZI (1581-1644)
Huile sur toile.
«««---
«Le Baptême du Christ»
Giovani Battisa GAULLI dit IL BACICCIO
(1639-1709)
Huile sur toile. |
|
|
|

«Vue de Fontarabie»
Luis PARET y ALCAZAR (1746-1799). Huile sur toile. |
|
«Vue
de Fontarabie». Par cette toile, Paret y
Alcazar répond à la commande du roi Charles
III d'Espagne qui voulait une série de toiles représentant
les ports espagnols. Sans doute était-ce pour imiter
la décision du roi Louis XV de France qui avait commandé
la même chose à Joseph Vernet sur les ports de
France.
|
|

|

Trois gros plans sur la «Vue de Fontarabie»
Luis PARET y ALCAZAR (1746-1799)
Huile sur toile. |
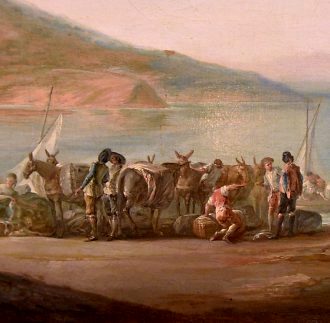 |
|

«Pietà»
Luis de MORALÈS (1509-1586)
Huile sur bois transposée sur toile. |

«New Mill»
Joshua SHAW of BATH (1776-1861)
Huile sur bois, 1809. |

«Le Couronnement d'épines»
d'après Jusepe RIBERA (1591-1652)
Huile sur toile.

Les forts contrastes d'ombre et de lumière marquent l'influence
du Caravage. |

«Pietà», détail.
Luis de MORALÈS (1509-1586)
Huile sur bois transposée sur toile. |
|

«Vue de l'église Saint-Pierre de Caen»
William FOWLER (actif à Londres de 1825 à 1867). |
|
«Vue
de l'église Saint-Pierre de Caen» (1/3).
Dans un musée, on tombe parfois sur
une toile très instructive car elle témoigne
du passé d'une ville ou de celui d'un bâtiment
modifié, voire disparu. C'est le cas de la Vue
de l'église Saint-Pierre
à Caen du peintre anglais William Fowler,
un tableau réalisé avant les travaux d'assainissement
des années 1850.
Caen
a été surnommée la «Venise
normande». Comme dans le delta du Rhône,
mais à petite échelle, l'Orne et l'Odon
se segmentent au sud de la ville et font couler leurs
bras au milieu des maisons. L'Odon rejoint l'Orne, et
continue ensuite vers le nord pour se jeter dans la
Manche. L'Orne naît au sud, près de Sées,
puis se divise en trois branches. Les travaux pour canaliser
ce petit fleuve dans la ville de Caen
ont commencé sous Louis XIV, mais, jusqu'au XXIe
siècle inclus, les inondations ont sans cesse
remis le chantier sur la table.
L'Odon, quant à lui, prend sa source près
de Jurques, à une trentaine de kilomètres
au sud-ouest de Caen
et se sépare en deux rivières à
la hauteur de Fontaine-Étoupefour, dans la grande
banlieue de la cité normande. Jadis, le Petit
Odon et le Grand Odon évoluaient parallèlement
à travers Caen,
de l'ouest vers l'est. Le Petit Odon, qui coulait le
plus au nord, passait entre l'Abbaye
aux-Hommes et l'église Saint-Étienne-le-Vieux,
puis rejoignait le Grand Odon à la hauteur de
l'église Saint-Pierre.
Le Grand Odon coulait plus au sud : il longeait les
jardins de l'Abbaye
aux-Hommes et suivait un cours parallèle
à la rue Saint-Pierre actuelle. Après
s'être enrichi des eaux du Petit Odon, il se jetait
dans la Petite Orne, dans les quartiers est de la ville.
«Robert Courteheuse, fils de Guillaume le Conquérant,
écrit la documentaliste Christine Méry-Barnabé
dans son ouvrage Caen de A à Z, avait
fait creuser un canal entre l'Orne et l'Odon qui a porté
jusqu'à son recouvrement le nom de canal Robert.
Ce canal, qui permettait au Moyen Âge de naviguer
jusqu'aux portes de l'Abbaye
aux-Hommes, est devenu par la suite une simple rigole
d'écoulement entre l'Orne et l'Odon.» ---»»
Suite 2/3 ci-dessous.
|
|

«Vue de l'église Saint-Pierre de Caen»
William FOWLER (actif à Londres de 1825 à
1867)
Détail : les lavandières. |
|
|
«Vue
de l'église Saint-Pierre de Caen» (2/3).
Conséquence logique de la présence de ces rivières
dans la ville : les habitants s'en servaient évidemment
d'égouts, avec les odeurs nauséabondes que l'on
imagine, les dépôts d'ordures cachés par
la vase, sans oublier les bactéries et leur cortège
d'épidémies. Le tableau de William Fowler le
montre aisément : les Caennaises y lavent leur linge
et tout le monde y jette à peu près ce qu'il
veut. Dans leurs relations, des écrivains de passage
s'offusquent ouvertement de ces «cloaques». À
ce dangereux tableau il faut encore ajouter les inondations
qui envahissent trop souvent les maisons et les échoppes,
transformant des quartiers entiers de Caen en une véritable
petite Venise. Plusieurs causes sont à redouter : d'abord
l'automne ; puis un redoux brutal en hiver entraînant
une fonte brutale des neiges ; enfin, de fortes pluies combinées
à des marées de fort coefficient.
Pourtant la présence de ces bras de rivières
ne fait pas que des malheureux. Les peintres romantiques y
voient une merveilleuse source d'inspiration mêlant
les cours d'eau, les arbustes et les vieilles pierres. En
l'occurrence celles de l'église Saint-Pierre
! Christine Méry-Barnabé cite ainsi Théophile
Gauthier qui relate dans un journal de voyage : «Si
vous voulez voir Saint-Pierre
dans toute sa beauté, il faut vous placer de l'autre
côté du ruisseau qui baigne son chevet. C'est
là que s'assoient les aquarellistes sur une pierre
[...] Le cours d'eau obstrué de pierres, de tessons,
de plantes aquatiques, d'oseraies qui ont pris racine sur
la berge, forme un premier plan arrangé à souhait,
à droite s'affaissent quelques vieilles maisons lézardées.»
Pour éradiquer cette pestilence et ce nid à
bactéries arrive un homme énergique et déterminé
: François Gabriel Bertrand (1797- 1875). Maire
de Caen
de 1848 à 1870, député de 1863 à
1869, il va lancer les travaux de recouvrement des deux Odons
et bouleverser à jamais l'aspect de sa ville. Mettant
à profit la loi d'expropriation de 1807, il fait raser
les habitations vétustes qui entourent l'église
Saint-Pierre
et supprime une fois pour toutes les points de vue pittoresques
chers aux romantiques. Exit saules, oseraies, vieux ponts
et moulin ! Exit les vieilles pierres paresseuses que l'onde
caresse sous le soleil !
Résultat immédiat : les poètes sont consternés !
Christine Méry-Barnabé relate quelques-unes
de leurs réactions outrées. Ainsi Barbey d'Aurevilly
qui regrette «les embellissements à contre-sens
de cette malheureuse ville» ! Ainsi l'historien Gabriel
Vanel qui prend le temps de ponctuer sa prose d'une touche
romantique : «l'abside de l'église ne baigne
plus dans l'eau ses fines sculptures», mais qui se console
en maudissant «l'hygiène [qui] est trop souvent,
je n'ose pas dire toujours, le contraire de l'intéressant
et du pittoresque»...
|
Après l'épidémie
de choléra qui frappe Caen
en 1854, Bertrand fait accélérer les travaux
: destruction d'immeubles malsains, élargissement de
rues avec parfois pavage payé par les propriétaires
riverains. En 1856, on creuse un puits artésien pour
rechercher une eau plus pure. Malheureusement, cette eau sera
porteuse de la typhoïde. En 1857, on réalise un
nouveau réseau de captage et de distribution d'eau,
suivi en 1859 de la construction d'un réservoir d'eau
potable. L'éclairage au gaz se répand dans les
quartiers de la ville. Notons un point intéressant
: la publication entre 1849 et 1870 de règlements sur
l'hygiène public (balayage de rues, écoulement
des eaux de pluie, évacuation des eaux ménagères).
En 1850, Bertrand inaugure un établissement gratuit
de bains et lavoirs publics... qui sera pitoyablement mis
en échec par la concurrence privée. Le bâtiment
deviendra une caserne de pompiers.
Fatigué, malade, Bertrand renonce à toutes ses
fonctions en 1870 et se retire à la campagne. Il meurt
à Bellou-en-Houlme le 24 avril 1875. Il est enterré
au cimetière Saint-Jean à Caen. Un boulevard
de la ville porte son nom.
En 1883, le couvrement de l'Odon était achevé depuis longtemps
quand la Société Française d'Archéologie vint en juillet
tenir son Congrès annuel. Là, entre rapports d'experts et
analyses savantes, fut organisée pour les participants une
Promenade à Caen. Historiens et archéologues
parcoururent la ville en s'arrêtant devant tous les
monuments historiques. Eugène de Beaurepaire, secrétaire général
de la Société, en rédigea un compte-rendu fort intéressant.
Un siècle et demi plus tard, sa prose nous renseigne
sur l'opinion de doctes messieurs vivant sous la IIIe République,
Jules Ferry étant président du Conseil.
Après s'être extasié sur le magnifique chevet de l'église
Saint-Pierre
érigé au XVIe siècle par Hector Sohier (un bijou architectural,
écrit-il), il s'attaque au problème du couvrement de l'Odon.
Sa prose mérite d'être citée :
«Malheureusement, depuis qu'une voûte recouvre la rivière
sur les bords de laquelle il s'élevait, ce bijou architectural
a perdu une partie de sa valeur. On ne saurait trop regretter
que la municipalité caennaise n'ait pas compris la nécessité
de maintenir au pied de l'abside, non un fossé d'aspect triste
et maussade, mais une nappe d'eau limpide dans laquelle elle
eût pu se refléter tout entière en devenant ainsi plus gaie,
plus lumineuse et plus grande. Même avec les transformations
de voirie projetées, le problème à résoudre, s'il offrait
quelques difficultés, n'était certainement pas insoluble,
et il eût honoré l'artiste qui l'eût mené à bien et la ville
qui en eût eu la noble préoccupation.»
---»» Suite 3/3 ci-dessous.
|
|
|
«Vue
de l'église Saint-Pierre de Caen» (3/3).
---»» L'auteur cite ensuite un extrait du
Bulletin de la Société des Antiquaires où le
célèbre architecte de l'époque, Victor Ruprich-Robert,
se plaint, dans un accès de romantisme, qu'au chevet
de Saint-Pierre
la merveilleuse union d'art entre l'eau et la
pierre ait été brisée : «Vous vous souvenez, écrit-il,
de son élégant soubassement aux fines
moulures se mirant alors dans l'Odon et actuellement
enfoui dans le sol, malgré l'étroit fossé
qui l'entoure, de ce mariage de la pierre et des eaux
qu'un artiste du XVIe siècle avait cru rendre
indissoluble. Eh bien ! cette union merveilleuse
d'art a été brisée ! Était-il
donc nécessaire, dans cette circonstance, de
sacrifier à un besoin matériel, qui pouvait
recevoir autrement satisfaction, la conservation d'un
de ces chefs-d'œuvre d'architecture qui, eux, ne
se remplacent pas.»
Beaurepaire termine sa critique du couvrement de l'Odon
par une prose assez étonnante dans la France de Jules
Ferry, dominée par le souci impérieux
de l'Instruction publique : «Nous ne sommes malheureusement
pas au bout de nos désastres. L'abside d'Hector Sohier,
popularisée par la gravure, est à l'heure qu'il est
gravement endommagée, et l'on peut prévoir le moment
où, grâce à l'action du temps et à l'incurie des hommes,
ce chef-d'œuvre de la Renaissance française n'existera
plus qu'à l'état de souvenir. L'argent abonde, paraît-il,
pour la construction de bâtisses scolaires, aussi dispendieuses
qu'inutiles ; mais d'ici longtemps encore il fera défaut
pour la restauration des œuvres immortelles qui forment
le trésor incomparable des richesses d'art de notre
pays.»
Heureusement qu'Eugène de Beaurepaire n'était pas là
en juin 1944 pour voir le déluge de bombes anglaises
s'abattre sur la ville...
Voir aussi l'article
de Beaurepaire sur les peintures du chœur de
l'église
Saint-Michel de Vaucelles et le refus de l'Administration
de prendre part au financemet de leur restauration.
Sources : 1) Caen de
A à Z par Christine Méry-Barnabé,
éditions Alan Sutton, 2006 ; 2) Congrès archéologique
de France tenu à Caen en 1883, compte-rendu de la
Promenade dans Caen par Eugène de Beaurepaire.
|
|

«Vue de l'église Saint-Pierre de Caen»
William FOWLER (actif à Londres de 1825 à
1867)
Détail : des passants regardent le reflet des pierres
dans l'eau. |
|
|
|

Une salle d'Art moderne. |
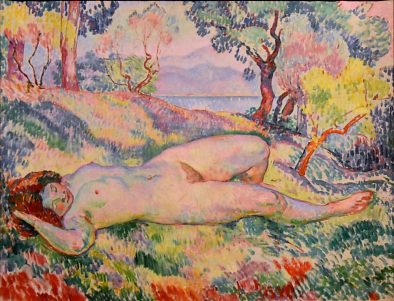
«Nu couché dans un paysage»
Henri LEBASQUE (1865-1937)
Huile sur toile, vers 1911-1912. |

«Le Bassin du Roy au Havre»
Albert MARQUET (1841-1927)
Huile sur toile 1906. |

«Baigneuses»
André LHOTE (1885-1962)
Huile sur toile. |
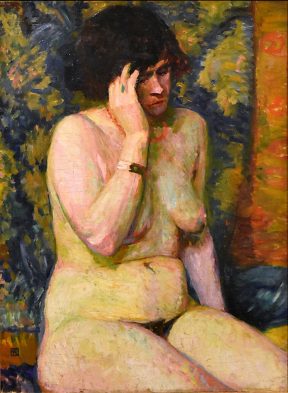
«Femme nue assise»
Théo van RYSSELBERGHE (1862-1926).
Huile sur toile, vers 1900-1910. |
 |
|
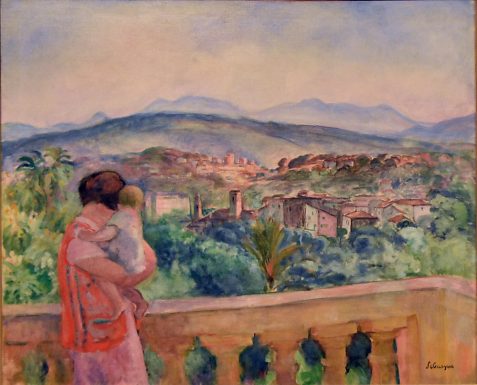
«Le Cannet au printemps»
Henri LEBASQUE (1865-1937)
Huile sur toile, 1927. |

«Le Balcon»
René-Xavier PRINET (1861-1946)
Huile sur toile, 1905-1906. |

«Au Balcon à Venise»
Maurice DENIS (1870-1943)
Huile sur toile, 1907. |

«La Joueuse de boules»
Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904).
Marbre sculpté, patiné et rehaussé
de polychromie, vers 1902. |
«««---
«La Joueuse de boules», détail.
Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904).
Marbre sculpté et patiné. |
|
|
Documentation : «Caen» de Xavier
Barral i Altet, édition Jean-Paul Gisserot
+ Site du musée des Beaux-Arts de Caen
+ «Architecture normande au Moyen Âge», Éditions
Charles Corlet & Presses Universitaires de Caen, Colloque de Ceristy-la-Salle,
1997
+ «Caen de A à Z» de Christine Méry-Barnabé,
éditions Alan Sutton, 2006
+ «Hermione rejetant Oreste, Musée des Beaux Arts de
Caen, L'œuvre en question - 5», 2008
+ «Congrès archéologique de France» tenu à Caen
en 1883, compte-rendu de la Promenade dans Caen par Eugène
de Beaurepaire.
+ notes descriptives des tableaux du musée. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|