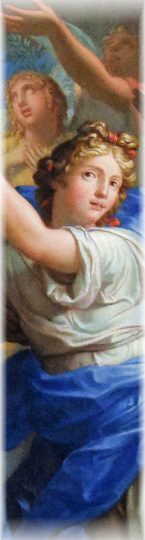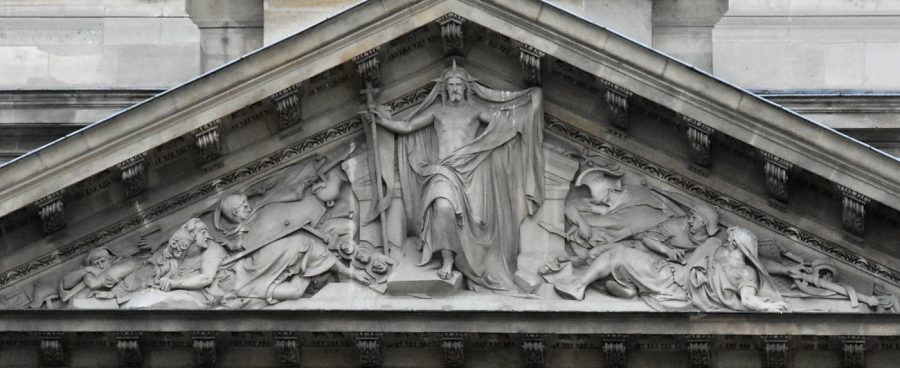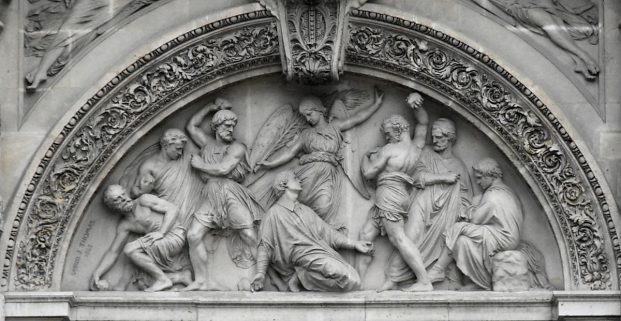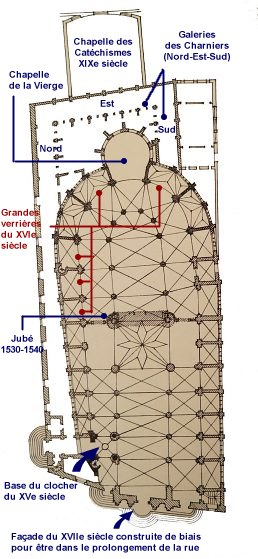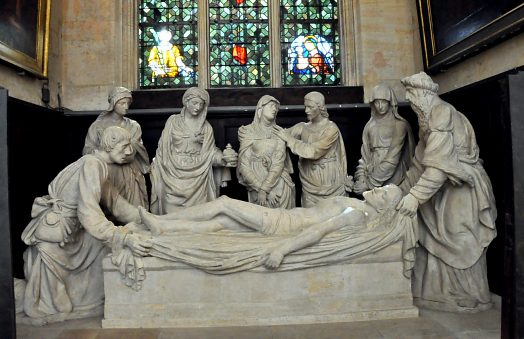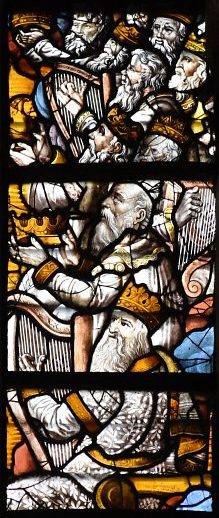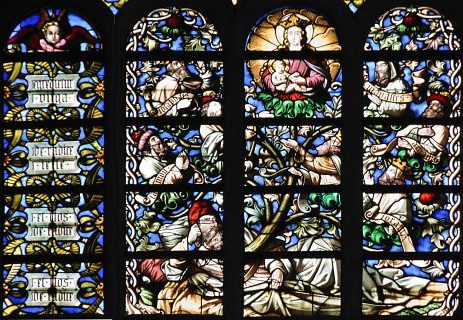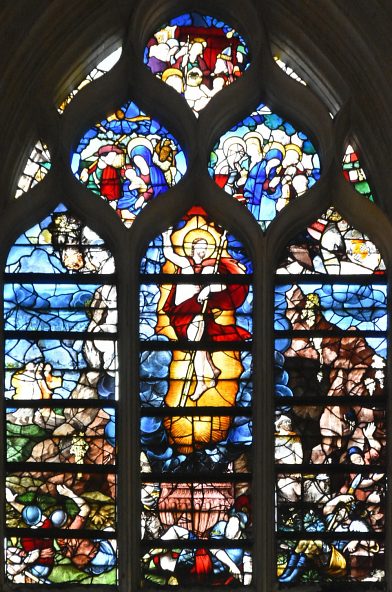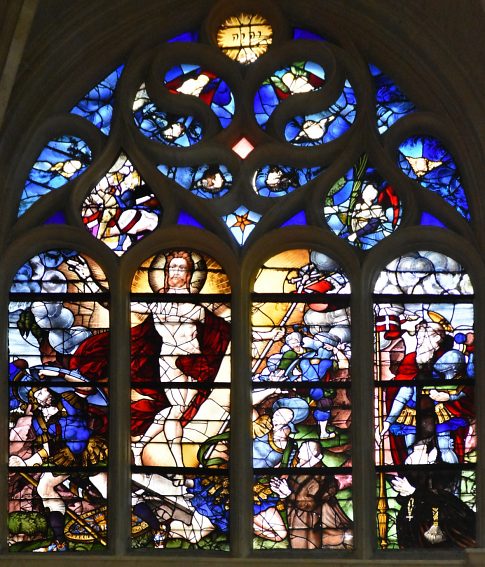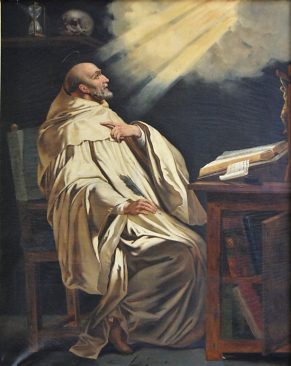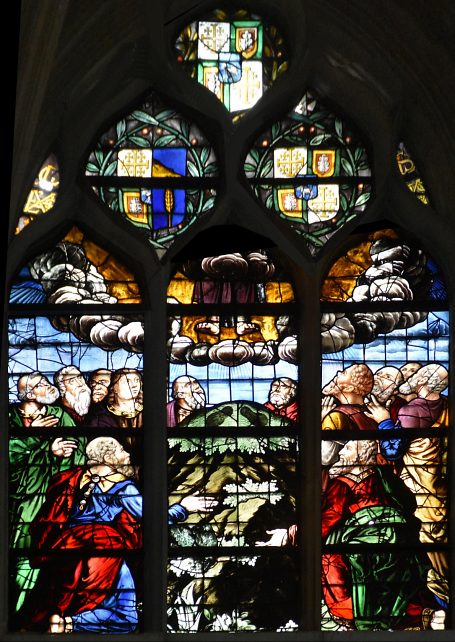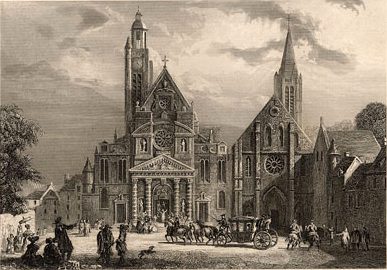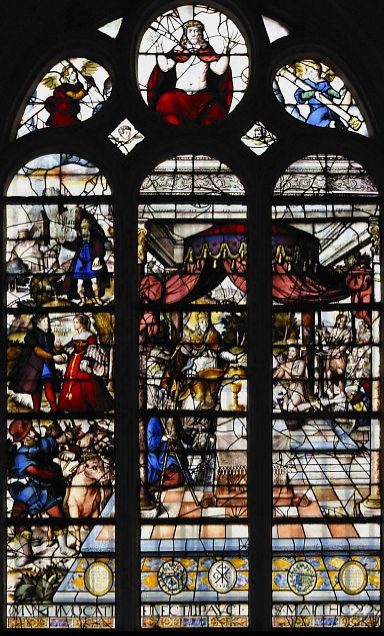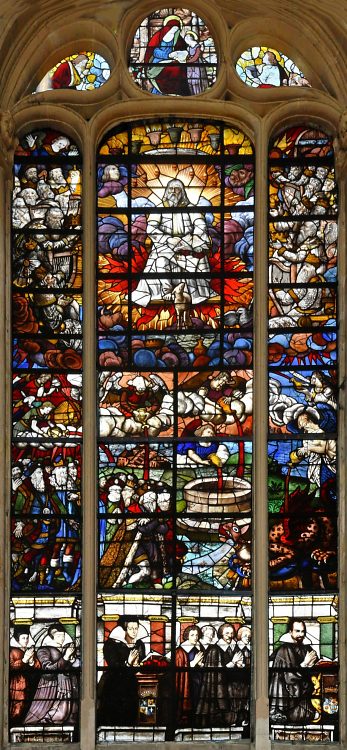|
|
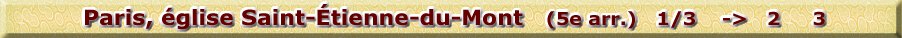 |
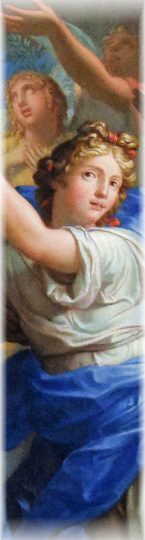 |
L'église Saint-Étienne-du-Mont
fait partie intégrante de l'histoire de l'abbaye Sainte-Geneviève
(aujourd'hui le lycée Henri IV). L'abbaye tire son origine
de l'église des Saints Apôtres Pierre et Paul fondée
par Clovis, vers 508, au sommet de ce qui est à présent
la montagne Sainte-Geneviève. L'abbaye abritait les reliques
de la sainte et de Clovis et, à ce titre, elle devint le
lieu de pèlerinage le plus important de la ville. Au début
du XIIIe siècle, Philippe Auguste fait entreprendre la construction
d'une nouvelle muraille pour ceinturer Paris. Le quartier de l'abbaye,
qui s'étend justement près de la muraille, en est
sécurisé ; sa population s'accroît. Conséquence
: l'église abbatiale, qui sert aussi pour les paroissiens,
ne suffit plus. Une église paroissiale est alors construite,
dédiée à saint Étienne. Elle est intégrée
dans le cloître et les moines conservent la haute main sur
sa gestion.
À la fin du XVe siècle, devenue à son tour
insuffisante, elle est remplacée par un édifice plus
vaste. Les travaux, menés sous la direction de Jean Turbillon,
commencent par le chœur. Puis ce chœur s'étoffe
de sept chapelles rayonnantes que de riches familles du quartier
se font bâtir. La construction complète de l'église
va s'échelonner sur plus d'un siècle (de 1492 à
1626) et traverser les guerres de Religion. Parfois elle ralentira
par manque de fonds. Les maîtres maçons Nicolas
Beaucorps, son fils Antoine, puis Pierre Nicolle
se succèdent à la tête du chantier. La nouvelle
église, qui abrite des reliques de saint Étienne,
est accolée à l'abbatiale (voir le dessin
d'époque). Les moines génofévains la regardent
toujours comme partie intégrante de leur fief (le curé
de l'église est un membre de leur communauté). Mais,
au fil du temps, cette attache va s'atténuer. Au début
du XVIIe siècle, la fabrique fait construire, au chevet de
l'église, le cloître des Charniers qui accueille encore
actuellement la
galerie des vitraux des Charniers qui comptent parmi les plus
beaux de Paris.
Malgré une construction du chœur, puis de la nef, étalée
sur une trentaine d'années, l'architecture de l'édifice
offre une remarquable uniformité, bien visible au niveau
des piles et de la voûte. Le style architectural gothique
est enrichi d'une ornementation Renaissance, dans un mariage très
harmonieux. Un magnifique jubé
(le seul qui reste à Paris) coupe l'édifice en deux
et en fait son principal atout artistique (ce qui lui vaut la visite
de nombreux touristes). Dans les premières décennies
de son existence, l'église va s'embellir grâce au mécénat
privé et aux dons des confréries : chapelles, tableaux,
vitraux et autels se multiplient. Pour ce qui est de la luminosité,
dont l'intensité frappe le visiteur dès son entrée,
la fabrique imprime sa volonté : sauf exceptions, les
baies de l'étage médian recevront du verre blanc.
Et ce choix est une réussite : en dépit de nombreuses
verrières historiées et colorées, Saint-Étienne-du-Mont
baigne dans la lumière. Le XVIIIe siècle et ses grands
programmes architecturaux ne modifient pas l'église : son
aménagement peu commun la protège et le quartier n'est
guère dynamique.
La Révolution dépouille entièrement l'édifice.
Ne restent que le jubé,
l'orgue de tribune
et la chaire à
prêcher. L'église devient temple de la Piété
filiale, à l'usage d'un nouveau culte : la théophilanthropie.
Cependant, dès juillet 1795, les prêtres catholiques
reviennent et partagent l'église avec les théophilanthropes.
En 1807, l'église abbatiale Sainte-Geneviève, dévastée
par le pillage, est détruite. Seul subsiste son clocher (actuellement
tour Clovis). Les bâtiments du monastère vont devenir
le lycée Henri IV. Quant au Panthéon,
bâti sous Louis XV pour remplacer l'église abbatiale,
la Révolution en avait fait un édifice consacré
aux gloires de la France.
Sous le Premier Empire, l'ameublement va s'enrichir ; des tableaux
anciens décorent les chapelles (voir l'encadré
sur les œuvres d'art). Au cours du XIXe siècle, les
dons des paroissiens redonnent vie à son ornementation. Sous
Napoléon III, l'architecte Victor Baltard (1805-1874)
construit la chapelle
des catéchismes (1857).
Ce site consacre trois pages à l'église Saint-Étienne-du-Mont
et les vitraux y sont largement représentés. Page
1 : la nef, son ornementation et ses verrières ; page
2 : le chœur et ses grandes verrières ; page
3 : les vitraux des charniers et la chapelle des catéchismes.
|
 |

Vue d'ensemble de la nef et du chœur de Saint-Étienne-du-Mont.
Le jubé de Saint-Étienne-du-Mont est le seul qui subsiste
dans les églises de Paris. |

La façade occidentale de l'église a été
érigée de 1610 à 1622.
Elle a été restaurée par l'architecte Baltard
sous le Second Empire. Il fit refaire toute la statuaire.
La façade se présente légèrement de biais
par rapport à l'axe de la nef (voir le plan). |

Le premier niveau de la façade est coiffé d'un fronton
triangulaire orné d'une résurrection.
Statues et bas-reliefs sont du XIXe siècle. |
|
Lors des siècles passés,
l'ordonnancement architectural de la façade a été
décrié. On se demande un peu pourquoi. Est-ce
l'impression donnée par le fronton curviligne du deuxième
niveau qui surmonte le fronton triangulaire du premier ? Ou
le manque de force architecturale des élévations
des bas-côtés ?
|
|
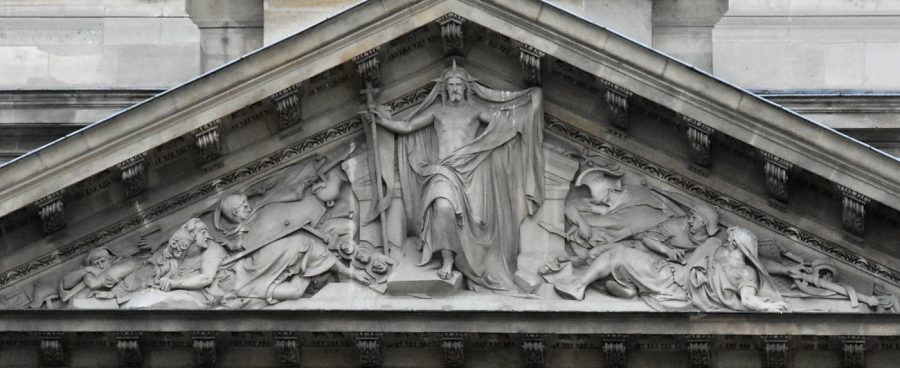
La «Résurrection du Christ» date de 1862. Œuvre
d'Auguste-Hyacinthe de Bay (1804-1865).
Fronton triangulaire du premier niveau de la façade occidentale. |

Le deuxième niveau de la façade et le fronton
du premier niveau.
Bas-reliefs et statues sont du XIXe siècle.
La rose est encadrée par une Annonciation : l'ange Gabriel
et la Vierge. |

Le chevet de Saint-Étienne-du-Mont.
Depuis la rue, il n'est pas possible de voir le chevet de face. |
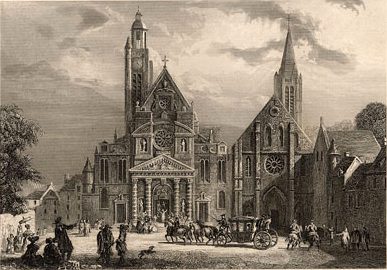
L'église paroissiale Sainte-Étienne-du-Mont et
l'église abbatiale Sainte-Geneviève.
L'abbatiale est détruite de 1802 à 1807. Seul
subsiste son clocher : la tour Clovis actuelle. |
|
|
La
façade occidentale. Ce n'est qu'en
1610 que le conseil de fabrique de Saint-Étienne
arrêta les dispositions définitives de
la façade. Dans les faits, ce fut la première
grande façade à l'antique de la capitale.
Le dessin était signé de l'architecte
Claude Guérin et la construction s'étala
de 1611 à 1622. La première pierre fut
posée par la reine Margot le 2 août 1610.
Celle-ci donna en outre mille écus à la
fabrique pour les travaux. Malgré ce don, les
sources de financement manquaient. Les paroissiens préféraient
en effet offrir des vitraux (où ils pouvaient
être représentés en tant que donateurs)
plutôt que d'œuvrer, quasi anonymement, à
l'élévation d'une maçonnerie.
Le style architectural de la façade, assez éclectique,
reste harmonieux. Le premier niveau forme l'entrée
d'un temple grec. Deux paires de colonnes rustiques
cannelées, à chapiteaux corinthiens encadrent
un portail, le tout est surmonté d'un fronton
triangulaire. Le deuxième niveau présente
une rose coiffée d'un fronton curviligne. Ces
variations rappellent l'architecture romaine. Enfin,
le troisième niveau, qui termine l'élévation,
est un pinacle gothique orné d'une rose et d'un
vase Renaissance enrichi d'un angelot.
La façade a été critiquée
parce qu'elle torture les règles académiques
et le modèle romain. Certains puristes la jugent
«chaotique». De plus, la comparaison avec
celle de Saint-Gervais,
conçue par Salomon de Brosse vers 1615
et qui représente le type même de la façade
à l'italienne à Paris, la dessert fortement.
En fait, dans leur ouvrage sur Saint-Étienne-du-Mont
paru aux éditions Picard, Étienne Hamon
et Françoise Gatouillat invitent le visiteur
à voir les choses d'une autre manière
: la façade traduit le renouveau du dynamisme
dans l'architecture religieuse au retour du roi Henri
IV dans sa capitale, en 1594. La paix retrouvée
déclenchait l'ambition des créateurs.
Sans oublier que Saint-Étienne-du-Mont, édifiée
sur la colline Sainte-Geneviève, domine Paris
et qu'elle côtoie l'illustre église abbatiale
Sainte-Geneviève.
En 1860, Victor Baltard entreprit la restauration
de la façade en en respectant en grande partie
la structure primitive. La Révolution avait brisé
toutes les statues. Baltard les fit reconstruire en
renouvelant leur iconographie. L'architecte donna d'ailleurs
dans la surenchère : il multiplia les statues
et les bas-reliefs, accentuant ainsi son caractère
baroque, qui était à l'origine plus discret.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
Éd. Picard, 2016.
|
|

Le fronton curviligne est sculpté aux armes de France
(les lis) et de Navarre (la chaîne)
(deuxième niveau de la façade). |

Sainte Geneviève,
dans une niche de la façade,
par Pierre Hébert (1804-1869). |

Saint Étienne,
dans une niche de la façade,
par Joseph-Marius Ramus
(1805-1888). |

La Vierge de l'Annonciation,
au deuxième niveau de la façade,
par Joseph Félon (1818-1896). |
|

Le Panthéon vu de l'église Saint-Étienne-du-Mont. |
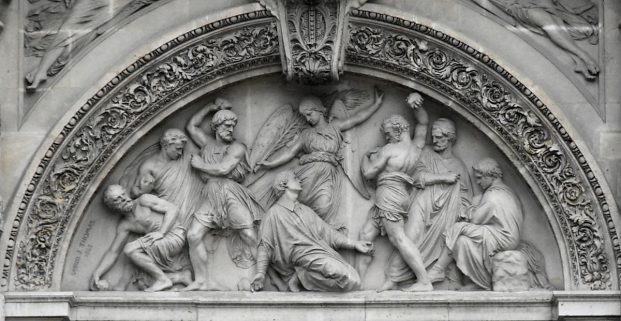
«La Lapidation de saint Étienne» par Gabriel-Jules
Thomas (1824-1905).
Tympan du portail central. |
|
Le Panthéon.
Au XVIIIe siècle, l'édifice a été
construit en tant qu'église pour abriter la châsse
de sainte Geneviève. Il a été achevé
en 1780. La Révolution a transformé l'église
en monument national pour honorer les gloires de la France.
|
|
| LA NEF, LE TRANSEPT
ET LEURS CHAPELLES LATÉRALES |
|

L'élévation sud et le chœur.
L'église Saint-Étienne-du-Mont, avec la cathédrale
Notre-Dame et le Sacré-Cœur
de Montmartre, est l'un des édifices religieux les plus
visités de Paris. |
|
La nef
de Saint-Étienne-du-Mont n'a pas sa pareille
dans la capitale. Mis à part le jubé, qu'elle
est la seule église parisienne à conserver,
toute son originalité architecturale - et qui frappe
le visiteur - est la présence d'une coursive scandée
de balcons circulaires qui relie à mi-hauteur les hautes
piles de la nef. La balustrade de pierre, en coupant la hauteur
de la nef en deux, brise l'élancement de l'élévation.
Sans cette coursive, on imagine aisément l'effet que
produiraient les piles nues qui séparent le vaisseau
central des bas-côtés. Certes, l'impression d'élancement
serait accentuée, mais la froideur envahirait l'espace.
À l'origine, la coursive servait, lors des fêtes,
à accrocher des tapisseries illustrant la vie de saint
Étienne. Elle barre malheureusement aussi la vue si
l'on veut observer avec assez de recul les verrières
qui sont à mi-hauteur...
Si l'architecture de Saint-Étienne-du-Mont relève
du gothique flamboyant (voûtes d'ogives, clés
pendantes), l'ornementation de l'église est celle de
la Renaissance italienne, ce que les colonnes cylindriques,
l'arcature en plein cintre, les nombreux putti et les têtes
d'angelots rappellent abondamment.
L'autre point qui frappe le visiteur est la très grande
luminosité de la nef. Les baies sont disposées
sur trois niveaux et beaucoup d'entre elles ne reçoivent
que du verre blanc, notamment celles à mi-hauteur.
Les autres sont enrichies, dans leur grande majorité,
de verrières Renaissance qui font toute la richesse
artistique de l'église.
La croisée possède une magnifique clé
de voûte Renaissance qui fait l'objet de plusieurs
images plus bas.
|
|

Le bas-côté sud et les balcons de la coursive. |
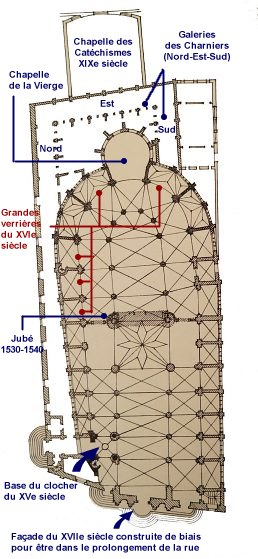
Plan de l'église Saint-Étienne-de-Mont. |

«Le Baptême du Christ» par Théodore
Caruelle d'Aligny, 1850.
Peinture murale dans la chapelle des Fonts baptismaux. |
|
Plan.
Le visiteur ne doit pas se contenter de voir l'église
car il y a plus à admirer. L'ancien cimetière
fait place aujourd'hui à trois galeries (sud,
est et nord) et à la chapelle
des catéchismes.
La galerie sud accueille la réception où
l'on peut se procurer livres et cartes postales. On
peut aussi y voir un petit vitrail Renaissance. La galerie
Est expose les vitraux
des charniers. Enfin, si vous avez de la chance,
la porte de la galerie Nord sera peut-être ouverte.
Vous pourrez y contempler cinq autres vitraux Renaissance.
Certains d'entre eux sont donnés à page
consacrée à la chapelle
des catéchismes.
|
|
|

La voûte de la nef, de la croisée et du chœur.
Bien que la construction du chevet et de la nef se soit
étalée sur plus de trente ans,
la voûte est remarquable par son uniformité. |
|

Le retable de la chapelle des Fonts baptismaux. |

Bas-relief en marbre de la Sainte Famille sur le retable (avant
le XVIIe)
Chapelle des Fonts baptismaux. |
|
Chapelle
des Fonts. La cuve baptismale d'origine a
été détruite en 1793. Celle que
l'on voit est une vasque de marbre posée sur
une console de pierre du XVIIIe siècle. La statue
est un Saint Jean-Baptiste enfant de Joseph-Marius Ramus.
|
|
|

Chapelle des Fonts baptismaux, partie ouest. |

«Les neuf chœurs des esprits célestes»
Tableau de Louis Licherie de Beurie (1629-1687). |

Chapelle du Saint-Sépulcre et sa Mise au tombeau du XVIe
siècle. |
|
La
chapelle du Saint-Sépulcre. Donnée
dans l'image ci-dessus, elle abritait un passage qui
faisait communiquer la nef de Saint-Étienne avec
celle de l'abbatiale Sainte-Geneviève.
Le nom de Saint-Sépulcre vient à l'évidence
de la grande Mise au tombeau qui ne laisse aucune place
pour un autel. Cette œuvre du XVIe siècle
a été installée en 1825, après
son acquisition par le curé de l'église.
Les huit grandes statues qui la composent ont été
commandées en 1539 par Yolande Bonhomme, veuve
du libraire Thielman Kerver. La famille Kerver possédait
une chapelle dans l'église Saint-Benoît-le-Bétourné
(disparue depuis). Les personnages étaient peints
dans des rehauts de couleurs et d'or, aujourd'hui réduits
à l'état de traces. On n'a aucune certitude
sur le sculpteur, mais l'historien Guy-Michel Leproux
propose Lorenzo Naldini, artiste florentin installé
à Paris en 1528.
Le vitrail de cette chapelle (baie 24) n'a guère
d'intérêt. Il réunit des débris
de vitraux du XVIe siècle. Au tympan, on y voit
les restes d'un Jugement dernier.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
éditions Picard, 2016.
|
|

«Charles Borromée distribuant des aumônes»
Tableau de Quentin Varin, 1627. |
|

«Le Martyre de saint Jean l'Évangéliste»
Tableau anonyme, XVIIe siècle. |

Christ en croix, début du XVIIe siècle
Baie 32 dans la chapelle des Fonts baptismaux. |
|
Les
œuvres d'art. Grâce aux
documents et aux marchés du XVIe siècle
que nous conservons, nous savons que l'église
Saint-Étienne-du-Mont disposait de nombreux
ornements, notamment dans les chapelles. La Révolution
l'a dépouillée de tout, à
l'exception du jubé, de l'orgue et de la
chaire à prêcher. Autels, marbres
et œuvres d'art avaient disparu. Avec le
Concordat, l'église fut rouverte au culte,
mais elle était à présent
propriété de l'État. Celui-ci
devait veiller à son entretien et avait
la haute main sur son ornementation. On sait que
le Premier Consul (le général Bonaparte),
soucieux de ramener la paix de l'Église,
fut très sensible à la question.
Il initia une très large opération
de reconstitution des ornements dans la quarantaine
de paroisses parisiennes qui subsistait. En 1806,
puis en 1811, l'État impérial répartit,
de manière aléatoire, deux cent
cinquante-cinq tableaux anciens du musée
Napoléon. Une bonne partie de ces toiles
provenait évidemment d'églises détruites.
À ce titre, on trouve à Saint-Étienne
Les
neuf chœurs des esprits célestes
de Louis Licherie de Beurie (donné ci-contre),
auparavant à l'église des Pères
de Saint-Lazare, ou encore La
Charité de saint Charles de Borromée
de Quentin Varin qui se trouvait à Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Les dons privés venant de hauts prélats
du clergé se multiplièrent aussi.
Ainsi, La
Chute de la manne de Jean-Baptiste de Champaigne
fut offerte (avec d'autres tableaux) en 1811 par
le cardinal Fesch, oncle de l'empereur, grand
aumônier de France et archevêque de
Lyon. En 1803, ce sont les vitraux Renaissance
des charniers qui retrouvèrent leur place.
Une politique d'enrichissement de l'église
en œuvres d'art vint aussi d'une vaste création
contemporaine. Sous l'Empire, les paroissiens
contribuèrent à la création
du maître-autel et des autels secondaires
en marbre. De la Restauration au Second Empire,
les commandes publiques prirent le relais. Les
créations étaient d'abord exposées
au Salon officiel, puis attribuées à
un édifice religieux. Il leur arrivait
aussi d'être captées par l'État
pour ses collections nationales.
Il faut s'arrêter un instant sur le tableau
donné juste en haut, à droite :
La
Vierge à l'Enfant entre saint Pierre et
sainte Lucie de Syracuse. C'est une peinture
sur bois de Pier Ilario Mazzola, datée
de 1518. Les sources indiquent qu'elle a été
enlevée à l'église Sainte-Lucie
de Parme en 1803. Elle fait donc partie des très
nombreuses œuvres d'art prises par les armées
françaises lors des conquêtes révolutionnaires
et napoléoniennes. Et elle n'a pas été
rendue après la chute de l'Empire.
Rappelons ici les principes qui guidèrent
la gestion des œuvres d'art après
la chute de Napoléon Ier. Lors du Congrès
de Vienne, avant les Cent-Jours, la France eut
le droit de conserver toutes les œuvres d'art
que les armées de la Révolution,
du Directoire, du Consulat et de l'Empire avaient
saisies dans les palais et les églises
d'Europe (les musées n'existaient pas encore).
Après les Cent-Jours, les têtes couronnées
du Congrès, excédées, décidèrent
de frapper fort : ordre fut donné à
la France de rendre aux pays spoliés toutes
les œuvres d'art saisies, à l'exception
de celles qui seraient déjà exposées
dans les églises. L'église Saint-Eustache
possède une de ces rares toiles : Tobie
et l'ange du peintre italien Santi di Tito
(1536-1603). Il est vraisemblable que la peinture
sur bois de Mazzola fait aussi partie de ce lot.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise
Gatouillat, éditions Picard, 2016.
|
|

«La Vierge à l'Enfant entre saint Pierre
et sainte Lucie de Syracuse»
Peinture sur bois de Pier Ilario Mazzola, 1518.
Enlevée en 1803 à l'église Sainte-Lucie
de Parme. |

«Calvaire», anonyme, XVIIe siècle.
Aristote se tient aux côtés de la Vierge,
tandis que saint Jean est suivi de Louis XIII et de saint
Louis.
Ce tableau veut illustrer le lien indéfectible
entre la dynastie royale et la religion catholique.
Chapelle du Saint-Sépulcre. |
|

«Les neuf chœurs des esprits célestes»
de Louis Licherie de Beurie (1629-1687), détail. |
|
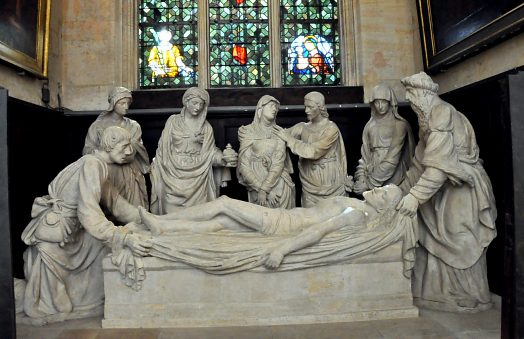
La Mise au tombeau du XVIe siècle dans la chapelle du Saint-Sépulcre. |

La Vierge et saint Jean.
Détail de la Mise au tombeau (vers 1540). |
| BAIE 28 - LE VITRAIL
DES CONVIÉS |
|
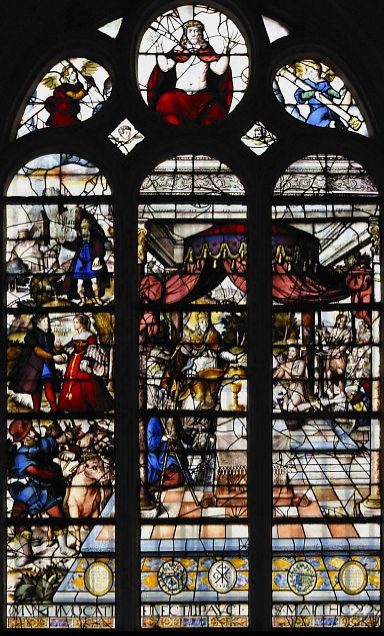
LA PARABOLE DES CONVIÉS AUX NOCES, 1568 (baie 28)
Chapelle du Crucifix. |

«Le Jugement dernier» attribué (peut-être
à tort) à Martin Fréminet, 1605.
Chapelle Saint-Bernard.
Les historiens s'accordent pour voir un moine de l'abbaye Sainte-Geneviève
dans le donateur en bas à gauche. Le tableau vient vraisemblablement
de cette abbaye. |

La Force (vertu cardinale) et la Charité (vertu théologale)
sur la cuve de la chaire.
Dans le bas-relief, saint Étienne est appréhendé
par ses persécuteurs. |
|

LA PARABOLE DES CONVIÉS AUX NOCES
Détail de la baie 28.
Un homme vient de se marier et ne peut participer au banquet.

Un pauvre (qui n'a pas d'obligation) vient participer
au banquet --»» |

La Parabole des conviés aux noces
Détail de la baie 28. |
|
|
Baie
28, le vitrail des conviés. Daté
de 1568, ce très beau vitrail illustre une parabole
peu connue. Dans la lancette centrale, un seigneur (qui
symbolise le Père céleste) appelle ses
amis fortunés à un banquet (qui consiste
en fait à célébrer l'Eucharistie).
Chacun trouve une excuse pour ne pas venir : l'un se
marie, un autre veut voir la maison qu'il vient d'acquérir,
un troisième vient d'acheter une paire de bœufs.
Ces scènes figurent dans la lancette de gauche.
Ce sont donc les pauvres qui vont participer au banquet.
Moralité de la parabole : les pauvres, ne possédant
rien, n'ont pas d'obligation et sont ainsi ouverts à
la parole du Christ.
Les panneaux inférieurs ont été
renouvelés en 1887.
|
|

«Le Jugement dernier», détail. |

Sainte Élisabeth de Hongrie faisant l'aumône
Baie 30, vers 1560. |
|
|
|

La chaire à prêcher
du maître menuisier Germain Pillon, 1651.
|

L'ange trompettiste sur l'abat-son
de la chaire à prêcher. |

Samson tenant la cuve de la chaire à prêcher. |
|
|
|
La
chaire à prêcher.
Épargnée par la Révolution, la
chaire est l'œuvre du maître menuisier Germain
Pillon. Elle est datée de 1651. Les sources
rapportent que la fabrique fit appel à trois
de ses confrères, fin 1651, pour expertiser son
œuvre. À la suite de quoi, elle lui régla
la somme de 4800 livres. Tous les anciens historiens
attribuent l'ensemble des sculptures et des bas-reliefs
à Claude Lestocard, bien qu'aucun document
ne soit là pour nous en convaincre. Lestocard
aurait ainsi réalisé le Samson, mué
en atlante, qui supporte la chaire ainsi que les sept
Vertus théologales et cardinales. On lui devrait
aussi les bas-reliefs sur la cuve et le manteau de l'escalier
: ce sont d'abord six médaillons aux effigies
des évangélistes, de saint Jérôme
et de saint Augustin, puis des panneaux illustrant des
épisodes de la vie de saint Étienne, dessinés
par Laurent de la Hyre.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
éditions Picard, 2016.
|
|

L'Espérance, la Tempérance, la Force et la Charité
sur la cuve de la chaire à prêcher. |
|

L'élévation nord dans la nef. |
|
L'ornementation
de la nef et des arcades est assez simple. Les piles
cylindriques ne possèdent aucune colonnette engagée
comme on peut en voir dans le style gothique. Nous sommes
ici dans le style Renaissance avec sa suite d'arcades
en plein cintre, ornées d'une double moulure
assez pauvre. La coursive à mi-hauteur habille
l'ensemble. À la retombée des voûtes,
l'architecte de la nef a néanmoins enrichi quelque
peu la nudité des supports. L'image ci-dessus
à droite en donne une illustration. Le double
liseré qui joint les retombées des voûtes
se transforme en une petite corniche en arrivant sur
la colonne. L'intrados de cette corniche reçoit
une élégante bague creusée d'une
série d'oves (photo ci-contre). Cette ornementation
se retrouve au niveau de la deuxième bague, à
la retombée de l'arcature du second niveau. Dans
le chœur, ces colonnes qui descendent des voûtes
sont laissées totalement nues. Rappelons que
la nef a été construite deux décennies
après le chœur.
|
|
|

L'ornementation des bagues
sur un pilier de la nef. |

«La Charité»
par Charles-René Laitié, 1824.
Chapelle de l'Immaculée-Conception |
|

L'ÉDUCATION DE LA VIERGE par Guillaume le Vieil (baie
22)
panneau peint vers 1712 pour l'église Saint-Roch. |

Bague ornée d'oves sur la partie haute des colonnes de
la nef. |

«La Chute de la manne» de Jean-Baptiste de Champaigne,
vers 1662. |
|

La base du clocher vue depuis le bas-côté nord de la
nef.
Derrière les deux ouvertures du premier étage se trouve
une salle qui servait
aux réunions des marguilliers aux XVIIe et XVIIIe siècles. |

«La Déploration sur le corps du Christ» par
Amélie Legrand de Saint-Aubin, 1827. |
|
Le
clocher. Sa base est le seul vestige du XVe
siècle. En 1624, il a subi un rehaussement qui
a respecté son allure générale
: élancée et étroite. Dans la photo
ci-contre, la pile sud qui le soutient accuse un diamètre
trois fois supérieur à celui des autres
piles (voir plan).
Ce clocher a sans cesse subi le regard inquisiteur des
moines de l'abbaye Saint-Geneviève. En aucun
cas il ne devait prendre le dessus, par sa masse et
sa hauteur, sur celui de l'église abbatiale.
Pas question de le surmonter d'une flèche ni
de grossir son gabarit. Ainsi limité, on ne pouvait
augmenter le nombre de cloches et leur taille : elles
ne résonneraient pas plus loin que celles de
l'abbatiale !
|
|
|
| BAIE 115 - VITRAIL
DE L'APOCALYPSE |
|
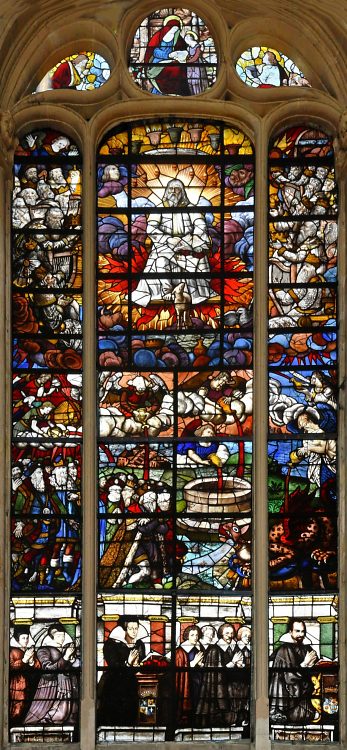
L'APOCALYPSE, 1614 (baie 115)
(Le Père céleste du haut est du XIXe siècle.) |

Détail du vêtement d'un roi qui adore la Bête
(APOCALYPSE) |
|

L'Éducation de la Vierge entourée de saint Jean
avec le calice et de saint Jean écrivant son évangile.
Tympan du vitrail de l'APOCALYPSE (baie 115).
C'est l'une des rares parties de ce grand vitrail à être
entièrement du début du XVIIe siècle. |
|
Baie
115. Vitrail de l'Apocalypse. Ce très
beau vitrail Renaissance mérite quelques développements.
Il se trouve que son histoire est connue grâce
aux registres de délibérations de la paroisse
conservés aux Archives nationales. La construction
de Saint-Étienne-du-Mont a toujours été
mise en péril par le manque de fonds. Vers 1608-1609,
le projet d'une nouvelle façade prend forme.
Il faut redoubler les quêtes et les appels aux
dons. C'est dans ce contexte qu'en 1609 un marchand
de vins et ancien marguillier, Jean le Juge, propose
d'offrir un vitrail à l'église pour orner
le bas-côté nord. Le chapitre essaya de
l'en dissuader : financer la construction du portail
ou la fonte des cloches était plus utile. Cette
noble assemblée fit aussi appel à l'argument
de la luminosité : mieux valait laisser du verre
blanc pour éclairer la nef que l'obscurcir par
un vitrail coloré. Mais, pour notre marchand
de vins, on peut penser que les deux financements étaient
bien différents. Sur un vitrail, l'habitude était
de s'afficher en prière avec femme et enfants
dans le registre inférieur. C'était voyant,
reconnaissable et prestigieux pour le donateur. À
l'inverse, il était difficile de laisser une
marque aussi visible dans une élévation
de pierres, et pis dans une fonte de cloches ! Le chapitre
eut beau lui proposer en compensation de placer ses
armoiries dans le bas de la vitrerie, rien n'y fit.
Jean le Juge ne céda pas et obtint gain de cause.
Le vitrail illustre les grands thèmes de l'Apocalypse.
Dans la partie haute, le Père céleste
tient le livre des sept sceaux. L'agneau (c'est-à-dire
Jésus-Christ) a ouvert le livre et les calamités
commencent à se répandre, apportées
par les quatre cavaliers (partie médiane). Les
vingt-quatre vieillards célèbrent la gloire
du Créateur. Des anges penchent leurs coupes
dans les puits et les sources et y versent la colère
divine. Toujours dans la partie médiane, les
peuples et leurs rois adorent la Bête. Au niveau
inférieur, le donateur en prière et sa
nombreuse famille jettent un regard (de fierté?)
vers l'observateur. En voyant ce registre, on comprend
que Jean le Juge ne pouvait pas se contenter d'inscrire
simplement ses armoiries dans une vitrerie...
Que subsiste-t-il réellement de l'époque
Renaissance dans cette verrière? Peu de choses
: d'une part, la magnifique rangée des donateurs (presque entièrement du début du XVIIe siècle) ;
d'autre part, le tympan (scène de l'Éducation de
la Vierge entourée de deux saint Jean). Le reste
a été très restauré au XIXe.
Le Père céleste et toute
la lancette centrale qui l'entoure sont modernes. Parmi
les vieillards qui adorent le Père et les rois
qui adorent la Bête, certaines têtes et
certains vêtements sont de la Renaissance. Quant
à la Bête
tout en couleurs, elle semble venir en majorité
de la Renaissance.
Source : Vitraux parisiens
de la Renaissance édité par La Délégation
à l'Action artistique de la ville de Paris, 1993.
|
|

La famille de Jean le Juge : Vue partielle des donateurs dans
le vitrail de l'APOCALYPSE (1614).
Partie presque entièrement du début du XVIIe siècle. |
|

Les donateurs du vitrail de l'Apocalypse : la mère. |

Les donateurs du vitrail de l'Apocalypse : le père. |
|
La
Bête du vitrail de l'Apocalypse de
Saint-Étienne-du-Mont, par sa petite taille,
rappelle un peu la tarasque traditionnellement tenue
en laisse par sainte Marthe (voir la tarasque du musée
d'Art et d'Histoire de Chaumont).
Pour avoir d'autres illustrations de la Bête de
l'Apocalypse, on pourra se reporter au vitrail du Jugement
dernier à l'église Saint-Nizier
de Troyes.
Un vitrail contemporain à l'église Saint-Pierre
de Caen
propose un dessin assez simple, mais suggestif.
|
|
|

La Bête dans le vitrail de l'APOCALYPSE.
Les anges versent la colère divine dans les puits et les sources. |

«Madeleine contemplant le Christ en croix»
Tableau anonyme, XVIIe siècle.
|

La chapelle Saint-Louis avec le buste de Pascal. |
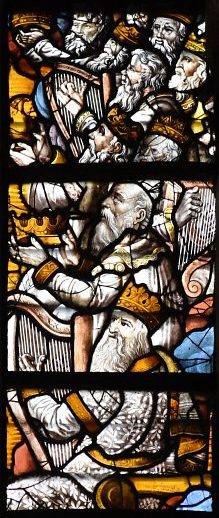
Les Vieillards dans le vitrail de l'Apocalypse. |

Buste de Racine par J. Frère, 1899.
Chapelle de l'Ange gardien. |
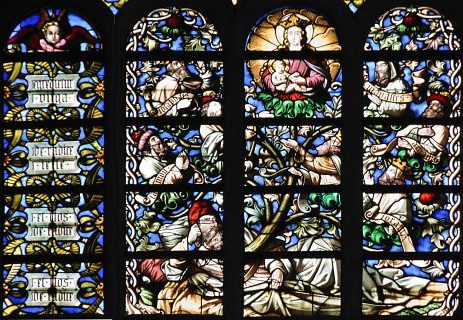
L'ARBRE DE JESSÉ (registre du bas), 1858, atelier Laurent Gsell
(baie 215).
L'atelier n'a mis que peu de couleurs pour conserver le ton du vitrail
de Marie, à côté (donné ci-dessous). |

Buste de Pascal par J. Frère, 1899.
Chapelle Saint-Louis. |
 |

LA VIERGE DES LITANIES (baie 213)
attribué à Nicolas Pinaigrier, vers 1586.
«««--- La nef et l'élévation sud près
de la croisée.
Les baies en verre blanc, au niveau médian, sont en place depuis
le XVIe siècle. |
|
Les vitraux
de l'église Saint-Étienne-du-Mont.
La vitrerie Renaissance est l'une des richesses de l'église.
On y dénombre près de cinquante verrières
anciennes, plus que n'importe quelle autre église de
Paris. À Saint-Étienne-du-Mont, on peut partager
en trois cette copieuse vitrerie : les vitraux du chœur
; ceux du transept et de la nef (chapelles et parties hautes)
; enfin ceux qui sont actuellement dans les trois galeries des Charniers, près de la chapelle des Catéchismes
Ce qui rend cette collection exceptionnelle est sa permanence
historique. Dans le chœur, les fenêtres hautes
ont gardé la totalité de leur vitrerie du XVIe
siècle, alternant vitraux historiés et verres
blancs bordés de rinceaux. Dans les parties hautes de
la nef et du transept, c'est pratiquement aussi le programme
primitif du XVIe siècle que l'on peut admirer. En revanche,
ceux des chapelles ont connu quelques déboires. On
y trouve des parties d'anciens vitraux (comme Sainte-Élisabeth
de Hongrie dans une chapelle sud de la nef) ou des créations
du XIXe siècle, dont certaines sont fort belles (voir
le vitrail de la
Cène de l'atelier Charles Champigneulle, daté
de 1899, dans la chapelle du Sacré-Cœur). Enfin,
les vitraux des charniers, de plus faible dimension et créés
pour être vus de près, ont connu quelques vicissitudes
(notamment à la Révolution), mais, dans leur
majorité, ils ont regagné l'église au
début du XIXe siècle.
La première campagne de vitrage concerne les baies
du chœur (puisque celui-ci a été construit
avec la nef). Nous sommes là dans les années
1540-1542. La seconde campagne a lieu quarante ans plus tard
: les fenêtres hautes de la partie occidentale reçoivent
leurs verrières entre 1586 et 1588. L'intervalle de
temps assez court - deux à trois ans - de chacune des
campagnes indique aisément, compte tenu de la surface
à vitrer, que la fabrique à monopoliser le gratin
des maîtres verriers parisiens à son seul profit
pendant cette période.
Qui sont ces maîtres verriers ? La découverte
récente de seize marchés dans les archives de
la fabrique a clarifié la réponse à cette
question et permis d'écarter définitivement
des noms comme ceux de Claude Henriet ou d'Engrand Le Prince,
une des gloires des vitraux Renaissance du Beauvaisis. Paris
ne manquait pas
|
d'ateliers ni de maîtres
verriers de première force. À côté
d'artisans de moindre renommée, on note trois noms
célèbres : Jean Chastellain et Nicolas
Beaurain pour la première campagne, Nicolas
Pinaigrier pour la seconde. Au tout début du XVIIIe
siècle, bien que la mode du vitrail fût passée,
Guillaume Le Vieil créa encore deux verrières
pour l'église. Lui-même et son fils Pierre
furent ensuite en charge de l'entretien des vitraux de Saint-Étienne-du-Mont,
charge qui s'étala pratiquement jusqu'à la Révolution.
Par un habile équilibre entre les vitraux historiés
et ceux en verre blanc (ce qui assurait une belle luminosité),
l'église a pu passer le dangereux cap du XVIIIe siècle,
un siècle bien souvent fatal à la vitrerie des
églises trop sombres. Avec le recul, on peut même
dire que Guillaume Le Vieil et son fils Pierre ont réalisé
un excellent travail d'entretien tout au long du XVIIIe.
Qui a offert ces verrières? Assurément, pour
les plus grandes, des confréries et des riches familles
(comme le marchand de vins Jean le Juge qui offrit, vers 1610,
le vitrail de l'Apocalypse).
Celles des chapelles latérales l'ont aussi été
par des particuliers habitant vraisemblablement la Montagne
Sainte-Geneviève ou ses alentours. Quoique, dans ce
cas, l'offre d'un vitrail, certes de plus petite taille, doit
être pensée comme l'élément d'un
don plus important : celui d'une chapelle et de sa décoration.
Au XIXe siècle, quelques dons de particuliers vinrent
enrichir cette impressionnante collection dans les chapelles
du chevet. Parmi ces vitraux, signalons l'intéressante
création, datée de 1882, de l'atelier d'Édouard
Didron dans la chapelle Sainte-Geneviève. Ce vitrail
illustre une procession
de la châsse de la sainte, telle qu'elle devait se dérouler
avant la Révolution. L'atelier a utilisé un
dessin du XVIIe siècle qui montre les églises
Saint-Étienne et Sainte-Geneviève côte-à-côte.
Les trois pages consacrées à Saint-Étienne-du-Mont
dans ce site présentent la quasi-totalité des
vitraux Renaissance de l'église. En page 1, ceux de
la nef ; en page 2, ceux du chœur ; en page 3, ceux des
charniers.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
éditions Picard, 2016.
|
|

Les QUATRE SAINTS (et les donateurs), 1586 (baie 216)
Ce sont les saints patrons de la famille Bouchinet (saint Nicolas,
saint Jean-Baptiste, saint Olivier et sainte Agnès) |
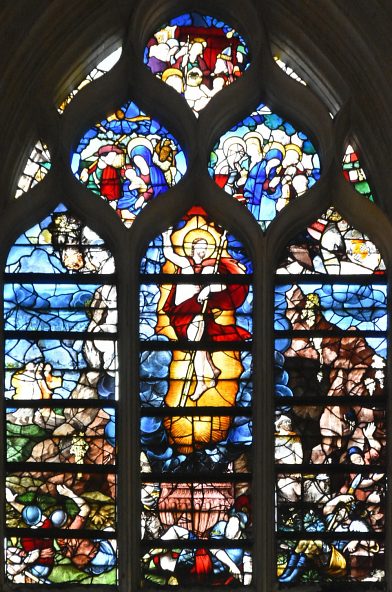
LA RÉSURRECTION DU CHRIST (baie 221)
(2e ou 3e quart du XVIe siècle). |

LES SAINTES FEMMES AU TOMBEAU, fin du XVIe siècle (baie 220). |
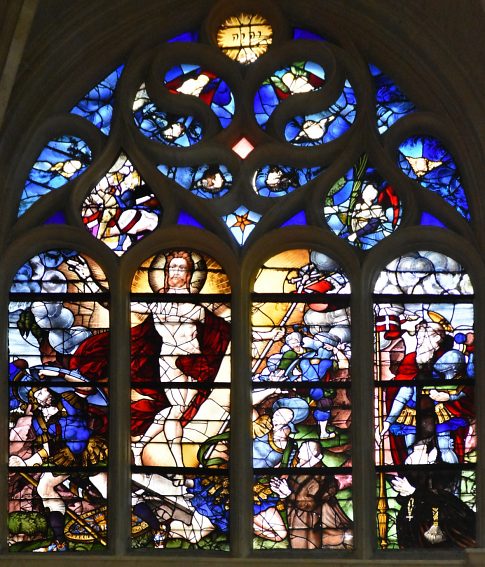
LA RÉSURRECTION DU CHRIST de Nicolas Pinaigrier, 1586 (baie
214)
Le donateur (à droite) est présenté par saint
Guillaume.
Ce vitrail s'inspire d'une peinture maniériste sur bois d'Antoine
Caron, «La Résurrection du Christ»,
une œuvre où le Christ ressemble étrangement à
Henri III !
Voir cette œuvre au Musée
départemenal de l'Oise à Beauvais.
|
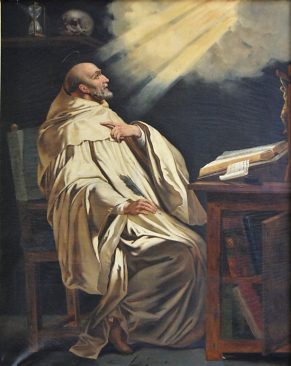
«Saint Bernard en oraison» par François-Vincent Latil
d'après Philippe de Champaigne, vers 1825.
Chapelle Saint-Bernard. |
 |

«Jésus enfant préchant, sainte Vierge, sainte
Anne et saint Joachim»
Anonyme XVIIe siècle. |
| «««---
«La Crucifixion», anonyme, 2e quart du XVIIIe siècle.
|
|

L'INCRÉDULITÉ DE SAINT THOMAS, fin du XVIe siècle
(baie 224). |
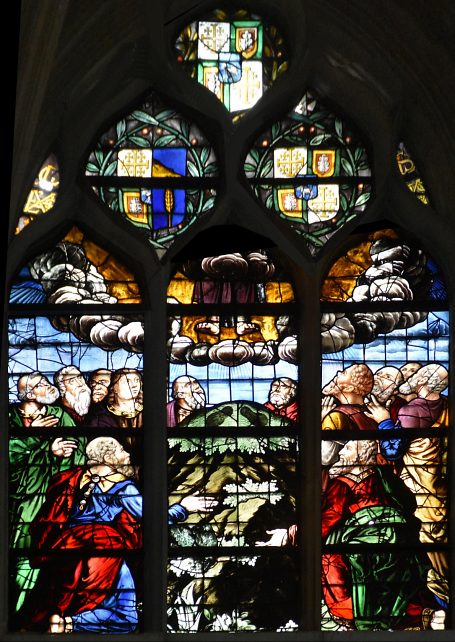
L'ASCENSION, fin du XVIe siècle
(Baie 226). |

LE COURONNEMENT DE LA VIERGE, vers 1550, registre central (baie
219).
Le visage de la Vierge est clairement une re-création
de la fin du XIXe siècle. |

«Le Martyre de sainte Catherine»
Tableau attribué à Thomas Goussé, vers 1650. |
|
 |

LES DISCIPLES D'EMMAÜS, vers 1587, registre central (baie 222).
Œuvre de l'atelier de Nicolas Pinaigrier.
«««--- LA CRUCIFIXION ET LA DESCENTE DE CROIX, vers
1587 (baie 223).
Œuvre de l'atelier de Nicolas Pinaigrier. |
| LES CLÉS
PENDANTES DE LA CROISÉE ET DE LA PREMIÈRE TRAVÉE
DE LA NEF |
|

Jubé, voûte et élévations du chœur. |
|
La
voûte de la croisée. C'est l'un
des chefs-d'œuvre de l'église. Elle a été
posée vers 1584-1586, puis restaurée par
Victor Baltard vers 1858. Cette voûte est un magnifique
exemple de la transition du gothique tardif au style
Renaissance. Les tiercerons qui divisent l'espace sont
gothiques, tout comme les clés pendantes et les
disques ajourés aux fines ciselures qui meublent
ces espaces. Les autres motifs de l'ornementation sont
totalement Renaissance. La fantaisie artistique de l'ensemble
est aussi typique de la fin du XVIe siècle :
les symboles ailés des évangélistes
(ci-contre le taureau de Luc) sont associés à
des putti, eux aussi ailés. La clé pendante
centrale accuse une hauteur de 2,40 mètres. Elle
est «maintenue en équilibre près
de cinq mètres sous le sommet de la voûte
grâce à des liens courbes raidis par une
armature métallique invisible, présente
dès l'origine (...)», lit-on dans l'ouvrage
sur l'église Saint-Étienne-du-Mont paru
aux éditions Picard.
Le visiteur qui prend le temps d'admirer ce système
de clés pendantes y reconnaîtra une allégorie
de la voûte étoilée, les disques
ajourés aux fines ciselures tenant le rôle
des étoiles.
La voûte qui orne la première travée
de la nef (photo ci-dessous), devant le grand orgue,
a été posée vers 1624. Elle applique
le modèle avec liernes et tiercerons, un classique
du gothique flamboyant.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
éditions Picard, 2016.
|
|

Clés pendantes au-dessus de la première travée
de la nef. |
|

Les clés pendantes à la voûte de la croisée
ou le mariage de l'art gothique et de l'ornementation Renaissance.
|

Le taureau ailé de saint Luc entouré de têtes
d'angelots ailés à la voûte de la croisée. |
 |

Clé pendante ornée d'angelots
au-dessus de la première travée de la nef
(style gothique flamboyant).
«««--- L'imposante clé pendante
de la voûte de la croisée
(2,40 mètres de haut). |
|
|
|

Vue d'ensemble du jubé. |

L'escalier sud du jubé et sa luxuriante ornementation.
|

La porte nord du jubé. |

Le jubé vu du chœur avec l'orgue de chœur. |
|

La porte sud du jubé, partie supérieure. |

Renommée ailée païenne (un sein est dévoilé)
en bas-relief dans un écoinçon du jubé. |
|
Le
jubé de l'église Saint-Étienne
est le seul qui subsiste à Paris. Sa conception
date du début des années 1530, celle des
escaliers nord et sud, des années 1540. Les portes
latérales et la statuaire sont, quant à
elles, du XVIIe siècle. La tribune, de neuf mètres
de long, est soutenue par une voûte en anse de
panier qui culmine à quatre mètres.
Une ornementation typique de la première Renaissance
(les écoinçons) s'allie au
style gothique classique de la balustrade et des escaliers,
style non dénué d'influence mauresque.
L'incertitude la plus complète règne sur
l'auteur ou les auteurs de ce jubé. Les sources
manquent. On a parlé de Pierre Biard (auteur
d'un Calvaire sur la tribune, mais définitivement
écarté), puis de Philibert Delorme pour
la conception des escaliers. On y a ajouté la
piste des maîtres d'œuvre de l'église
au XVIe siècle (Nicolas et Antoine Beaucorps,
Pierre Nicolle). Et un dernier ajout, celui d'un «maître
Clément», assez mystérieux.
Au cours de son histoire, le jubé a été
remanié selon les caprices du temps et les modes
décoratives. Sous Louis XVI, la tribune ne portait
qu'un crucifix et les deux piliers nord et sud accueillaient
chacun un autel. À la Révolution, toute
la statuaire a disparu. Aux écoinçons
de la tribune, les anges porteurs des instruments de
la Passion ont fait place à des renommées
païennes tenant des palmes, des rameaux ou des
couronnes (voir la photo ci-dessus). Après le
Concordat, un Christ de pitié et deux anges ont
été placés sur la tribune. Depuis
1851 s'y dresse un grand Christ en croix provenant de
la chapelle de l'École polytechnique. Il a été
sculpté dans les années 1820 par l'artiste
autrichien Ulrich de Grienewald, à la suite d'une
commande du duc d'Angoulême, protecteur officiel
de l'École depuis 1816.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
éditions Picard.
|
|

L'intrados du jubé. |

Le Christ en croix d'Ulrich de Grienewald (vers 1825), détail. |
|

Vue du jubé et de la porte sud depuis le bas-côté
sud. |
|
Quand
le jubé faillit être détruit...
Avec la Contre-Réforme, l'heure n'est plus aux jubés.
Regardés comme de véritables murs séparant
la nef et le chœur, ils isolent les desservants des fidèles.
Le Concile de Trente (1542-1563) eut à cœur de
faire disparaître cette barrière pour réunir
la communauté lors des offices. Dans les années
1730, Saint-Germain-l'Auxerrois
perdit son jubé qui datait du XVIe siècle. La
destruction de celui de Saint-Étienne-du-Mont se rapprochait.
En 1737, le conseil de fabrique délibéra sur
une offre proposée par une personne qui désirait
rester anonyme : 3000 livres pour détruire le jubé.
Mais le principal problème relevait de l'architecture
: la disparition du jubé risquait-elle de fragiliser
l'édifice ? Le conseil de fabrique avait déjà
pris l'avis des hommes de l'art et la réponse était
négative. La démolition fut donc votée,
mais à une condition : elle ne pourrait être
validée qu'après obtention d'un rapport écrit,
et dûment signé, concluant à l'absence
de risques d'éboulement. Cependant l'opération
fut ajournée : d'anciens marguilliers s'y opposaient
farouchement.
En 1740, deuxième offensive des partisans de la démolition.
Un architecte, Hivert, excédé par ce jubé
qu'il regardait comme un pont cachant la célébration
des saints Mystères, en proposait le démontage.
Mieux : il proposait aussi le réemploi de ses éléments
dans la construction de deux autels blottis contre les piliers
de l'entrée du chœur. Et son rapport précisait
: «comme à Notre-Dame».
|
Hivert voyait-il dans cette comparaison
un atout décisif ? Toujours est-il que la fabrique
temporisa à nouveau. Visiblement, l'unanimité
n'était pas faite, d'autant plus qu'une perte substantielle
de revenus était à craindre. En effet, des particuliers
louaient des emplacements sur la tribune du jubé, ce
qui rapportait 60 à 80 livres par an à la fabrique.
À cette époque, l'église subissait un
vaste réaménagement dans les chapelles du chœur
et du jubé ainsi qu'un transfert de la sacristie. Il
fallait trouver les financements. Or, c'est aussi dans ces
années, en 1758 précisément, que l'architecte
Jacques-Germain Soufflot commença à consolider
le terrain - gorgé de galeries plusieurs fois centenaires
- prévu pour la nouvelle église abbatiale Sainte-Geneviève
qui deviendra le Panthéon. (Louis XV n'en posera la
première pierre qu'en 1764.) Évidemment, les
donateurs préféraient privilégier l'édifice
qui allait abriter les reliques de la sainte patronne de Paris
plutôt que de donner pour l'aménagement de l'église
paroissiale. Pour la fabrique de Saint-Étienne, les
ressources se tarissaient. Il y eut pis : en 1760, un incendie
consuma une partie du mobilier, au sud de la nef. L'orgue
de tribune fut gravement touché. Maçons, charpentiers,
couvreurs, serruriers et facteurs d'orgue ne terminèrent
la restauration qu'en 1768. Et on ne parla plus de la démolition
du jubé.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
éditions Picard, 2016.
|
|
| L'ORGUE DE TRIBUNE
DU XVIIe SIÈCLE |
|

L'orgue de tribune et la clé pendante sur la voûte. |
|
L'orgue
de tribune est l'un des chefs-d'œuvre
de l'église Saint-Étienne, l'un des plus
beaux de la capitale et le plus ancien totalement conservé.
Le devis de la construction remonte à 1631 :
Pierre Pescheur pour l'instrument et Jean
Buron pour la menuiserie. La beauté de l'orgue
saute aux yeux de tous les visiteurs. Harpies, anges
accroupis, anges musiciens, angelots et Christ ressuscité
contribuent à ce déploiement de faste,
encore accentué par les bas-reliefs au niveau
du positif. Les sources mentionnent que l'orgue a été
choyé pendant le premier siècle de son
existence. En 1760, il est victime d'un incendie et
le facteur Nicolas Somer en entreprend la restauration
en 1766. En 1772, François-Henri Clicquot en
fait un grand instrument qui porte en lui tout le classicisme
français tardif. Dans les années 1830,
une restauration ratée aggrave son état.
En 1862, Cavaillé-Coll en entreprend une autre
- sans l'accord de la fabrique qui manque de ressources.
Enfin, en 1929, arrive le jeune compositeur et organiste
Maurice Duruflé. Sous son impulsion, la
ville de Paris charge la maison Gonzalez, en 1934, d'une
restauration profonde. Interrompue par la guerre, celle-ci
reprend sous la houlette de la manufacture Beuchet-Debierre.
Ce n'est qu'un demi-succès et Maurice Duruflé
ne cache pas sa déception. Aussi, en 1975, la
maison Gonzalez, de nouveau à la manœuvre,
procède-t-elle à une ré-harmonisation
complète. À ce jour, c'est le facteur
Bernard Dargassies qui entretient l'instrument présenté
comme un orgue néoclassique.
Source : Saint-Étienne-du-Mont
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat,
éditions Picard, 2016, article d'Henri de Rohan-Csermak.
|
|

|

Harpie soutenant la tourelle sud de l'orgue de tribune.
(Menuisier Jean Buron, 1631).
«««--- Le Christ ressuscité sur la
tourelle centrale
de l'orgue de tribune. |
|

Buffet de l'orgue de tribune : Christ ressuscité et anges musiciens
sur les tourelles ;
deux anges adolescents sur l'entablement des plates-faces. |

La croisée du transept avec l'autel de messe et le jubé.
Cliquez sur la photo pour aller en page 2. |

La nef et l'orgue de tribune vus de la croisée. |
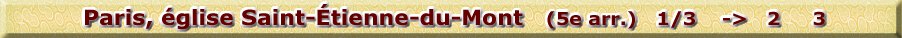 |
Documentation : «Saint-Étienne-du-Mont»
par Étienne Hamon & Françoise Gatouillat, éditions
Picard, 2016
+ «Les églises de France, Paris et la Seine», éditions
Letouzey et Ané - Paris, 1936
+ «Les églises flamboyantes de Paris» par Agnès
Bos, éditions Picard, 2003
+ «Corpus Vitrearum, les vitraux de Paris, de la Région
parisienne, de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais», éditions
du CNRS, 1978
+ «Vitraux parisiens de la Renaissance» édité
par La Délégation à l'Action artistique de la
ville de Paris
+ «Saint-Étienne-du-Mont, au cœur du quartier latin»,
brochure de l'association «Art, Culture et Foi-Paris»,
2012
+ feuillets de présentation de l'église disponibles
dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|