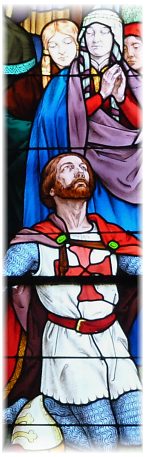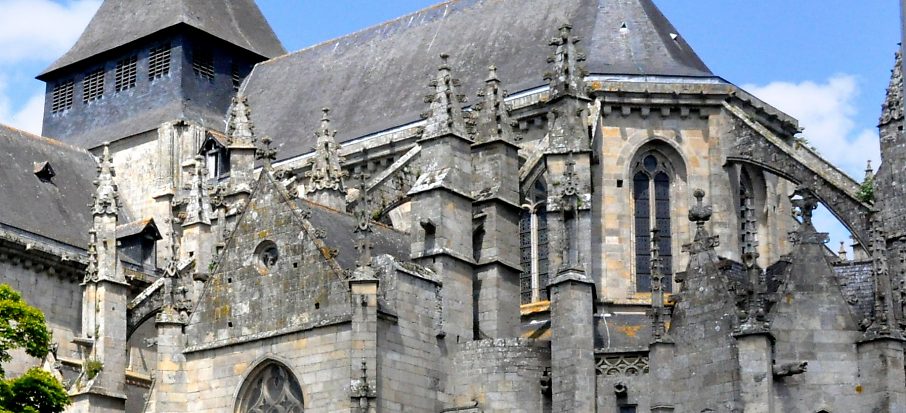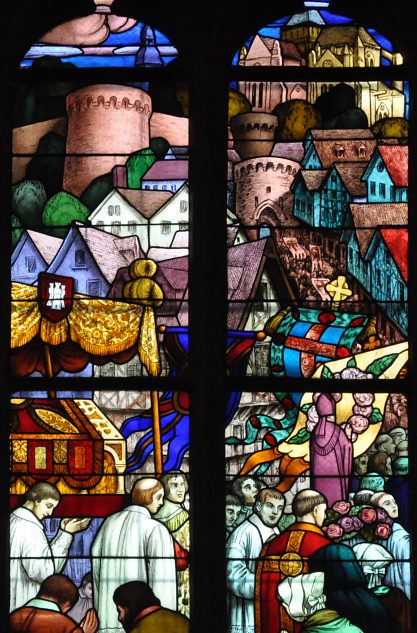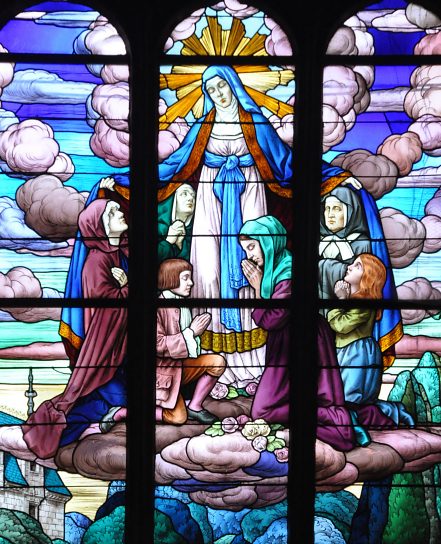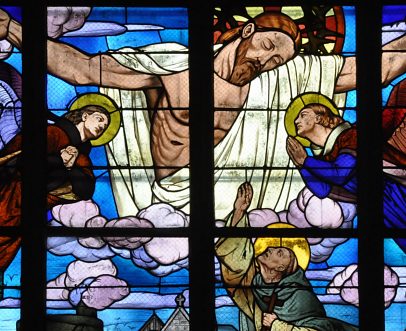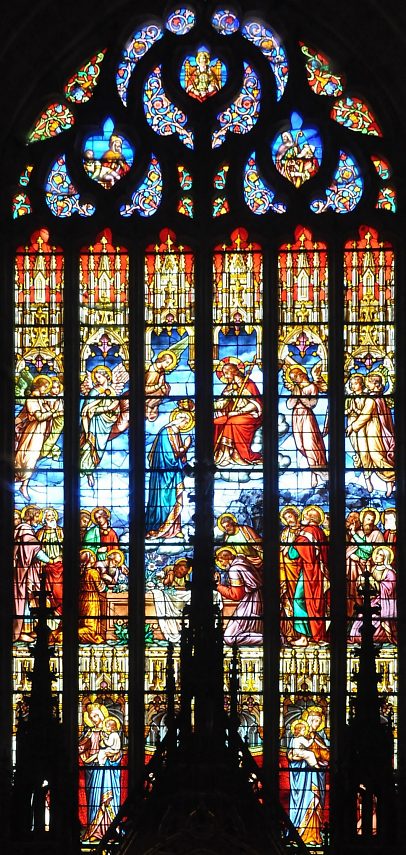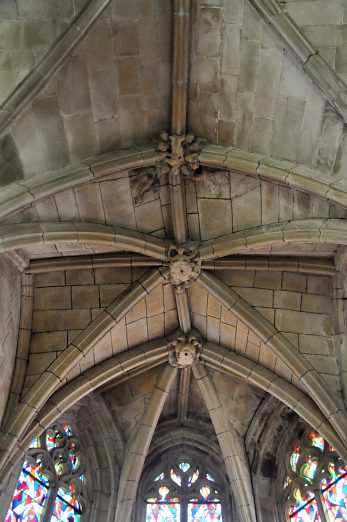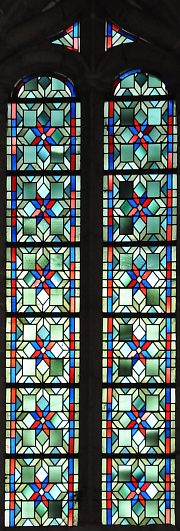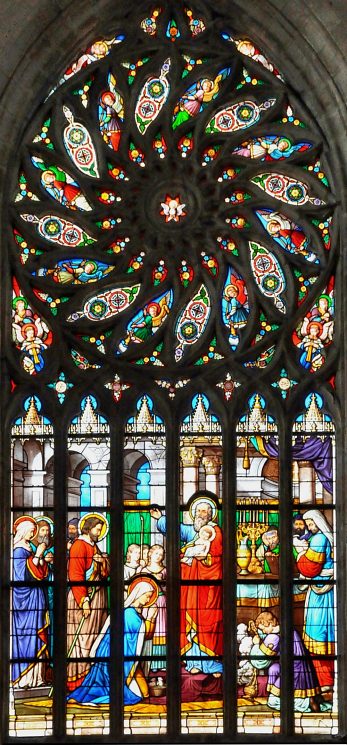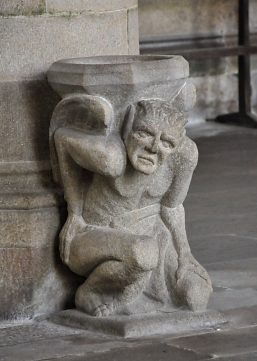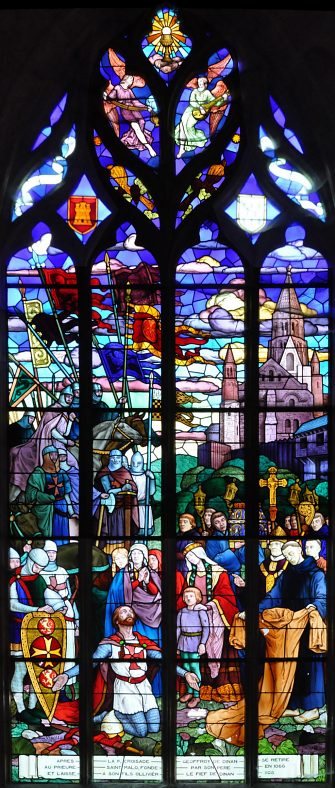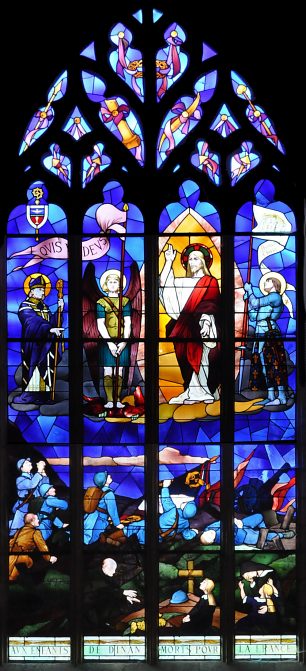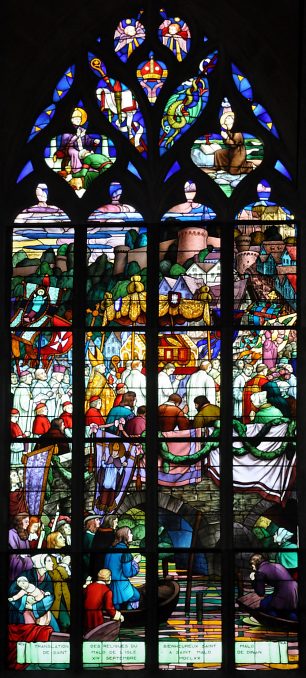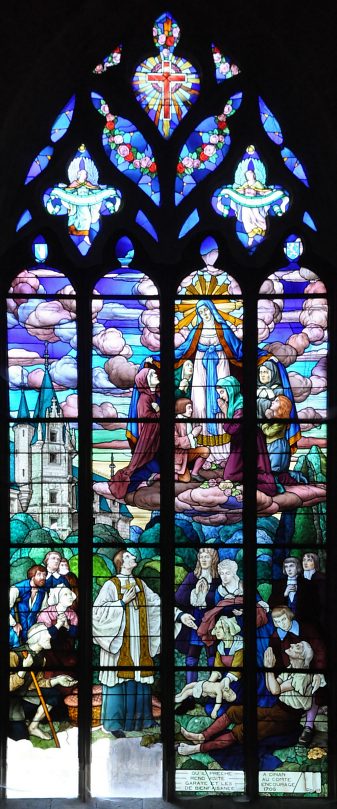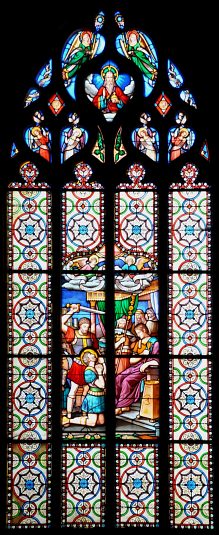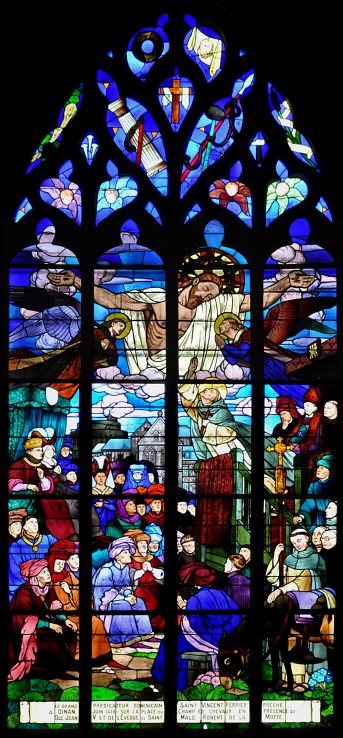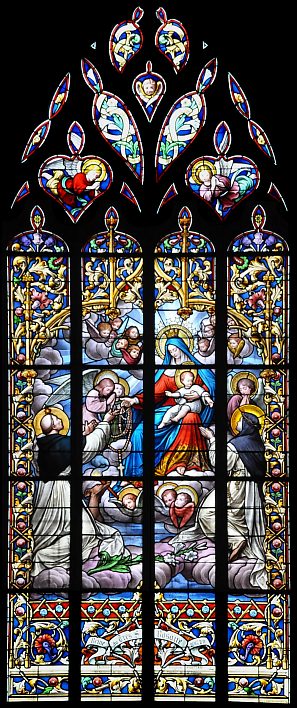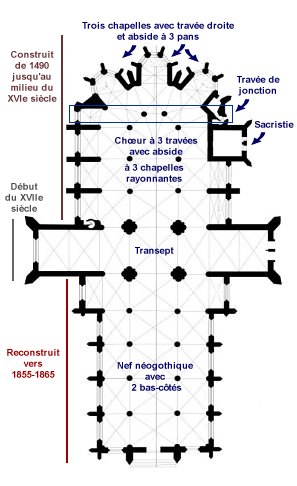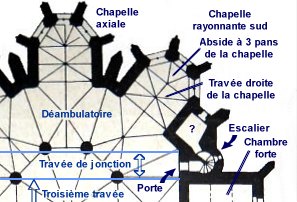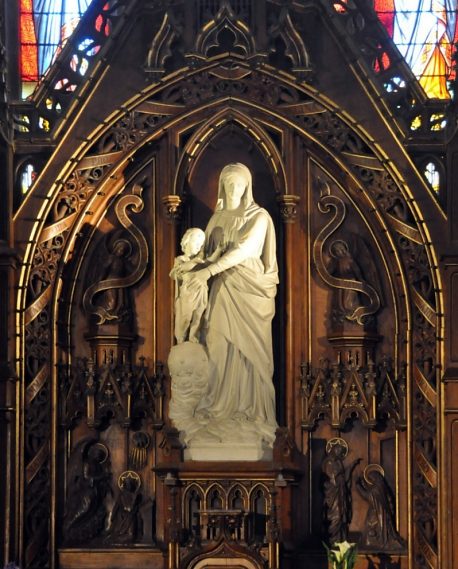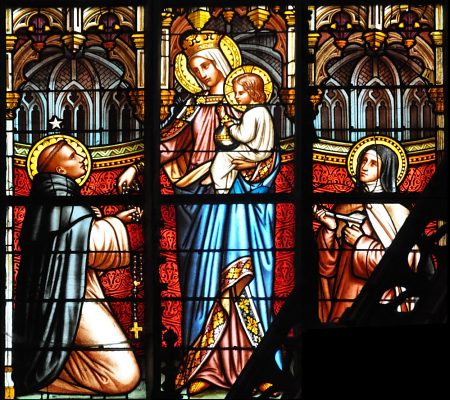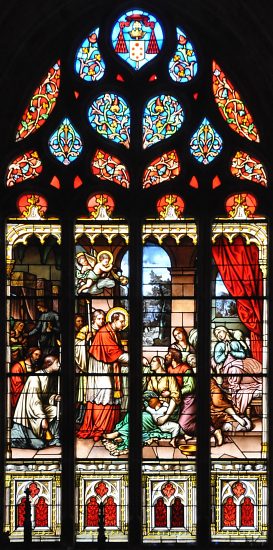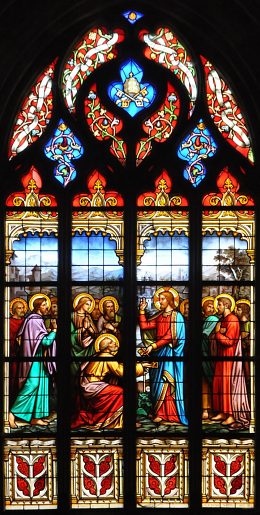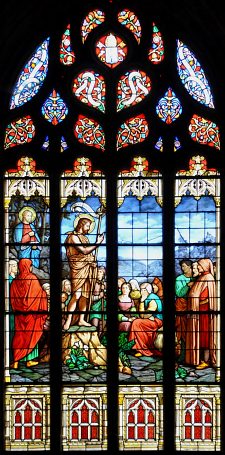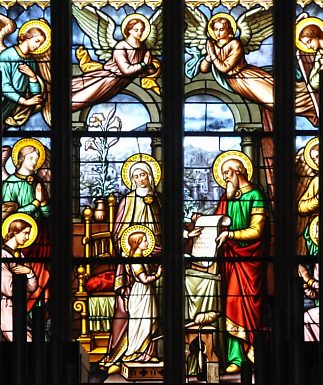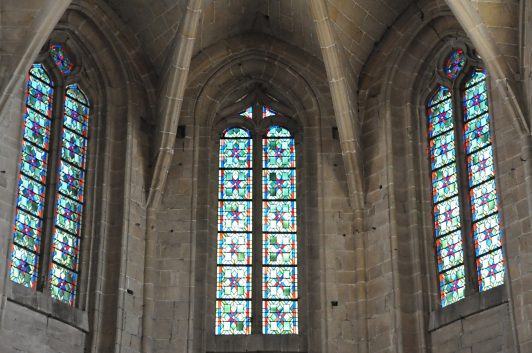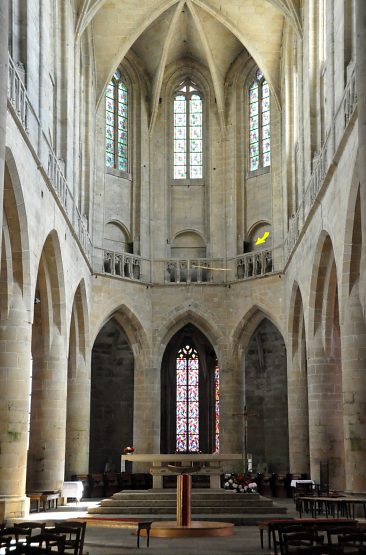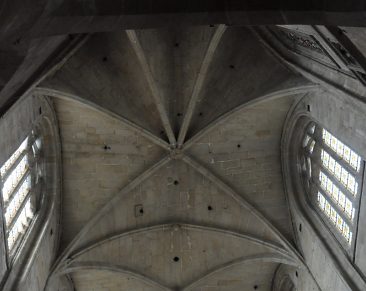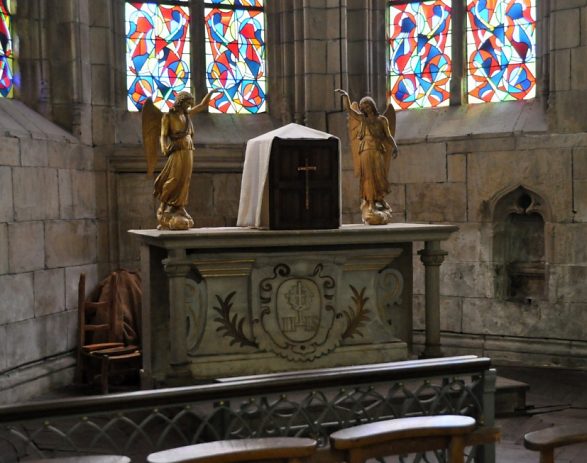|
|
 |
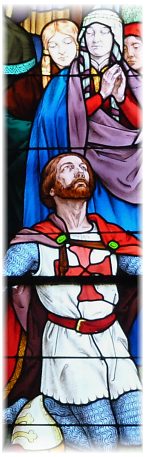 |
Dès le XIe siècle, il
y eut à Dinan
un église Saint-Malo qui ne s'élevait pas au même
endroit que l'édifice actuel : elle était hors-les-murs,
ce qui entraîna sa destruction. En effet, sous le règne
du jeune roi Charles VIII (qui n'épousera la duchesse Anne
de Bretagne qu'en 1491), la France veut soumettre la Bretagne à
son autorité. Les habitants de Dinan
redoutent que le bâtiment serve de point d'appui aux Français
en cas de siège. En 1487, François II, duc de Bretagne,
donne donc l'ordre de faire raser l'église Saint-Malo qui
devra être rebâtie intra muros. En réalité,
le siège n'eut jamais lieu : la ville se rendra l'année
suivante, sans résistance à l'autorité du roi
de France.
La construction de la nouvelle église commença dès
l'année 1490 comme l'indique une inscription
gravée sur le pilier sud-est de la croisée. Le terrain
était offert par Jehan II, vicomte de Rohan. Allié
de Charles VIII, le vicomte devint l'homme fort de la ville ainsi
que son généreux mécène. Dinan
était une cité prospère et les dons
affluèrent. L'édifice, bâti avec la pierre de
granit si courante en Bretagne, sera en style gothique flamboyant.
La partie basse du chœur
est élevée dès 1491, sous la direction de Guillaume
Juhel. Sa toiture charpentée est recouverte de chaume
à titre provisoire, ce qui permet la tenue du culte. Au cours
de la décennie 1500, bénéficiant des donations
de Jehan II de Rohan, du roi Louis XII et de la reine Anne de Bretagne,
le nouveau maître d'œuvre, Jean Lemaître,
achève le chœur : il se présente sur deux
niveaux d'élévation, selon un modèle plutôt
normand, et se termine par trois chapelles
rayonnantes, ce qui n'est pas banal dans une Bretagne qui privilégie
plutôt les chevets plats ou à pans coupés.
Les sources de financement finissent par se tarir. Le fondateur
de l'église et son principal donateur, Jehan II, est passé
à la Réforme... En dépit d'une donation
de François Ier, il faut attendre le XVIIe siècle
pour voir le
chœur et le transept complètement voûtés
et achevés. Quant à la nef, pendant près de
quatre siècles elle restera inachevée et sans utilité
: sa double rangée d'arcades, privée de bas-côtés,
sera fermée par un mur sommaire.
Pendant la Révolution, écrit l'historien René
Couffin pour le Congrès archéologique de France
en 1949, le bâtiment «servit de halle au blé,
de magasin, de salle de spectacle et de caserne.» En 1793,
il fut entièrement dévasté. Le maître-autel,
commandé au sculpteur Pilon en 1664, fut détruit,
tout comme le tombeau en marbre d'Italie de Raoul Marot des Alleux,
sénéchal de Dinan pendant la Ligue. Quinze pièces
de tapisseries offertes à l'église en 1685 disparurent.
Saint-Malo fut rendu au culte en 1803 dans un état lamentable.
Le devis de restauration, jugé trop coûteux, n'eut
pas de suite. Prosper Mérimée, inspecteur général
des Monuments historiques, passera à Dinan en 1835 et n'aura
que mépris pour cette église (voir plus
bas).
Vint enfin le Second Empire et sa prospérité économique.
Avec l'aide de l'État, la nef
fut réédifiée de 1855 à 1865 en s'inspirant
des plans disponibles et des éléments architecturaux
du chœur. Toutefois,
la flèche prévue à l'origine au-dessus de la
croisée, ne sera jamais construite. L'église sera
classée monument historique en 1907.
L'église Saint-Malo possède deux éléments
dignes d'une visite : la partie
extérieure du chevet avec sa forêt de pinacles,
de fleurons, de choux frisés et de gargouilles, une forêt
que la pierre de granit rend typiquement bretonne ; puis ses vitraux
des années 1920 illustrant quelques épisodes de l'histoire
de Dinan dont l'entrée
d'Anne de Bretagne dans la ville en 1505.
|
 |

Vue d'ensemble de l'église Saint-Malo depuis l'entrée
occidentale.
La nef a été rebâtie presque entièrement
sous le Second Empire. |
| ASPECT EXTÉRIEUR
DE L'ÉGLISE SAINT-MALO |
|

Vue extérieure de Saint-Malo depuis la façade occidentale
du XIXe siècle. |

Les grandes baies sud de la nef.
Les historiens n'accordent guère d'intérêt à
la
reconstruction de la nef réalisée sous le Second Empire.
Les bas-côtés sont une création des architectes
Guépin et Aubry. |
|
Architecture
extérieure (1/4).
La nef et les bas-côtés ont été
presque entièrement reconstruits de 1855 à 1865
par les architectes Aubry et Guépin, spécialistes
du néo-gothique. Aussi les historiens actuels négligent-ils
allégrement ces parties de l'édifice, que ce
soit leur aspect extérieur ou intérieur. Seul
le chœur et son chevet,
élevés de la fin du XVe siècle jusqu'au
XVIIe si l'on inclut les restaurations, ont retenu leur attention.
Pourtant, le chevet ne parvient pas toujours à se faire
apprécier. Il en va ainsi avec Prosper Mérimée
qui parcourt la Bretagne en 1835 en tant qu'inspecteur général
des Monuments historiques. De passage à Dinan,
s'il daigne écrire trois pages sur la basilique Saint-Sauveur,
il est plus que bref pour Saint-Malo : «L'autre
église de Dinan n'offre aucun intérêt.»
C'est dit. Peut-être l'inspecteur a-t-il été
déçu par la nef inachevée et la misère
du chœur laissé sans réparation après
la Révolution.
Dans son article pour le Congrès archéologique
de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, l'historien
René Couffon écrit que «Saint-Malo fut
rendue au culte en 1803 dans un état pitoyable».
Il ajoute que le devis des réparations se montait à
plus de dix mille francs, une somme considérable qui
poussa la municipalité, incapable d'avancer cette somme,
à demander la suppression de la paroisse ! La
demande fut rejetée. Au contraire, le maître-autel
de 1664 réalisé par le sculpteur Pilon ayant
été détruit en 1793, on le remplaça
par le maître-autel de l'abbaye de Lehon et on y installa
aussi les stalles de cette même abbaye.
Qu'a vu Prosper Mérimée de la nef ? Au
début du XVIIe siècle, les sources de financement
s'épuisent. ---»» Suite 2/4.
|
|

L'église Saint-Malo vue depuis le sommet du château. |

Le chevet sud de l'église Saint-Malo.
Fin du XVe-début du XVIe siècle.

Les historiens admettent que le premier niveau de l'élévation
était achevé à la fin de l'année 1490.
Sur la partie gauche, l'élément en forte saillie (une
sorte de faux transept) a reçu le nom de chambre forte. |
|
Architecture
extérieure (2/4).
---»» La nef, inachevée, se
réduit au vaisseau central sans voûte ni collatéraux,
avec des arcades obturées par un mur sommaire. Et ceci
perdura jusqu'au XIXe siècle. De quoi repousser Prosper
Mérimée en effet.
La nef fut donc rebâtie sous le Second Empire par les
architectes Guépin et Aubry en respectant la conception
d'origine. C'est à eux que l'on doit la suite de chapelles
latérales nord et sud et les bas-côtés
voûtés d'ogives.
L'élévation choisie est à deux niveaux
(photo
plus haut). Le premier, très élevé, s'ouvre
sur de larges baies en arc brisé, ornées depuis
les années 1920 par d'intéressants vitraux
sur l'histoire de Dinan.
Dans les remplages de ces baies, les réseaux sont de
style néogothique. Le second niveau, plus étroit,
n'est ouvert que de petites
baies logées sous les formerets, à hauteur
des retombées d'ogives. Il aurait été
intéressant que les historiens actuels nous disent
quels monuments d'Armorique ont inspiré Guépin
et Aubry.
Le chœur mérite une observation attentive. Comme
souvent dans les édifices bretons, c'est le côté
sud qui a la meilleure part. Ici, il est rendu plus élégant
par la présence d'un bras en forte saillie qui agit
comme un faux transept (photo ci-contre). Ce bras présente
une structure à deux niveaux que l'historienne Michèle
Boccard appelle une chambre forte. On y trouve la sacristie
au rez-de-chaussée et, à l'étage, la
chambre d'archives.
Dans Bretagne gothique, Philippe Bonnet et Jean-Jacques
Rioult écrivent que cette pièce a pu servir
d'oratoire à Jean II de Rohan. C'est ce que suggère
la fenêtre à meneaux qui donne sur le chœur.
Elle a pu servir ensuite de salle pour les réunions
de la fabrique. La tourelle à côté de
cette élévation abrite l'escalier qui mène
à cette fameuse pièce et qui en est d'ailleurs
le seul moyen d'accès. Voir plus
bas la porte de la sacristie dans le déambulatoire.
---»» Suite 3/4
|
|
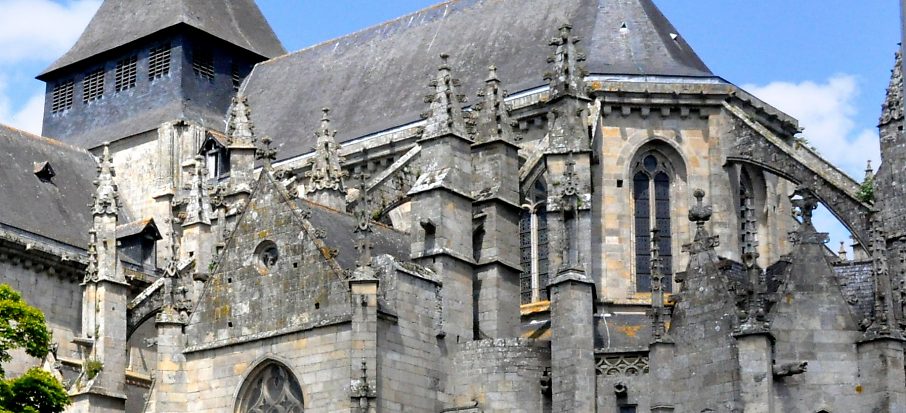
Le chevet gothique et sa forêt de pignons flamboyants. |

Le côté sud et le croisillon sud du transept de
l'église. |
|
Architecture
extérieure (4/4).
---»» de frontons triangulaires et de motifs
géométriques s'insèrent mal, écrit-elle,
dans un ensemble bien antérieur : au premier
niveau, les moulures horizontales délimitant
le faux entablement s'interrompent au niveau des contreforts
sans solution de continuité (...)».
Quant à la double baie en plein cintre surmontée
d'un oculus qui domine ce portail, elle a vraisemblablement
succédé à une grande baie flamboyante.
Pour résumer et sans forcer le trait, on pourrait
dire qu'une façade d'aspect général
roman et d'ornementation Renaissance a succédé
à une façade gothique dans un édifice
de style flamboyant...
Sources : 1) Notes d'un
voyage dans l'Ouest de la France de Prosper Mérimée,
1836 ; 2) Bretagne gothique de Philippe Bonnet
et Jean-Jacques Rioult, éditions Picard, 2010
; 3) Congrès archéologique de France,
Côtes-d'Armor, 2015, article sur l'église
Saint-Malo par Michèle Boccard ; 4) Congrès
archéologique de France tenu à Saint-Brieuc
en 1949, article sur l'église Saint-Malo par
René Couffon.
|
|
 |
|
|
Architecture
extérieure (3/4).
---»» La photo ci-dessus montre l'impressionnante
suite de pinacles flamboyants qui encercle le chevet.
Les pans des chapelles rayonnantes sont étroits
et les angles des pignons qui les surmontent, aigus,
ce qui permet d'étoffer encore ce décor
un peu féérique gorgé de crochets,
de choux frisés et de fleurons dominateurs. À
ce sujet, les historiens ont soulevé une question
: ce type de chevet a-t-il été créé
par un membre de la famille Dumanoir ? Voir
plus
bas les analyses qu'ils proposent depuis 1949.
La façade du croisillon sud du transept (photo
ci-contre) ne possède pas d'aspect flamboyant.
Dans son article pour le Congrès archéologique
de France de 2015, Michèle Boccard écrit
que ce croisillon, tel qu'on le voit aujourd'hui, est
certainement le résultat d'une reprise du XVIIe
siècle. En effet, un magasin à poudre
de la tour Saint-Julien, située au nord-ouest
de l'église, explosa en 1585 (ou en 1597 selon
René Couffon). Même si cette tour de la
muraille n'est pas toute proche, l'effet de souffle
provoqua des lézardes dans les murs de Saint-Malo,
notamment dans le croisillon sud, directement exposé.
En 1949, l'historien René Couffon mentionne la
date de 1613 située au-dessus de l'entrée
méridionale de l'église et ajoute qu'elle
concerne «probablement des travaux de restauration
et de réfection exécutés à
la suite de cet accident.»
Le portail sud (donné ci-dessous) affiche une
ornementation d'inspiration Renaissance sculptée
dans le granit. En 1835, lors de son passage à
Dinan,
Prosper Mérimée était assez négatif
sur cette pierre : «L'espèce de granit
employée dans toutes les constructions, écrivait-il,
est, par sa nature, impropre à recevoir une ornementation
soignée. C'est une pâte peu compacte, renfermant
un sable très dur; le ciseau l'égrène
au lieu de la couper.» (Voir l'encadré
sur le granit en Bretagne à l'église Saint-Sauveur
de Dinan.)
En 2015, Michèle Boccard se montre assez circonspecte
sur cette ornementation rajoutée au XVIIe siècle.
Le décor «composé de volutes, de
coquilles, de demi-colonnes à fûts cannelés
et chapiteaux ioniques, ---»» Suite 4/4.
|
|

La double porte du croisillon sud sert d'entrée principale.
La pierre de granit porte un décor du début du
XVIIe siècle. |
| «««---
Ornementations sur la double porte du croisillon sud. |
|
|
|
Le rôle
de la famille Beaumanoir dans l'architecture du chevet (1/2).
La recherche historique avance toujours par étapes.
La conception du chevet de Saint-Malo en donne un bon exemple.
Une photo
plus haut le montre : les trois chapelles pentagonales de
ce chevet sont embellies à l'extérieur par une
forêt de pignons à choux frisés, de fins
pinacles flamboyants, de fleurons et de gargouilles.
En 1949, l'historien René Couffon, pour le Congrès
archéologique, signale, à propos de ces
trois chapelles, que leur couverture est à noues multiples.
En architecture, une noue est «une arête rentrante
formée par la rencontre des versants de deux toits»
(Architecture, éditions du Patrimoine, 2011).
René Couffon écrit sans hésitation que
cette disposition est à mettre sur le compte de l'architecte
Philippe Beaumanoir qui l'a introduite en Bretagne
en 1488. Il ajoute qu'on la rencontre «dans de nombreux
édifices dont le patronage appartenait aux Rohan»
et que «c'est probablement à cette circonstance
qu'elle dut être utilisée à Saint-Malo
de Dinan.» On se souvient que Jean II de Rohan est le
fondateur de l'église. Précisons une évidence
: la multiplicité des noues est la conséquence
des pans étroits et des pignons aigus qui définissent
le tracé des chapelles pentagonales.
En 2007, dans les Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest,
l'historien Laurent Guitton reprend l'idée de la paternité
Beaumanoir et la renforce. En tant que fondateur de l'église,
Jean II de Rohan, écrit-il, pouvait intervenir sur
certains choix architectoniques. Et il ajoute : «La
comparaison de la localisation des domaines de Rohan et de
la production de ces chevets polygonaux semble aller dans
le sens d'une diffusion de ce modèle par Jean II de
Rohan, lequel l'aurait proposé, sinon imposé
aux trésoriers de la paroisse.» Une idée
intéressante, mais rédigée ici au conditionnel.
Néanmoins, Laurent Guitton conclut sans retenue : «Rohan
est l'initiateur d'une nouvelle esthétique religieuse
dans notre ville : il a donc largement contribué à
lancer une mode architecturale.» L'historien précise
que le prototype de ce «nouveau» chevet se trouve
en fait à la chapelle Saint-Nicolas de Plufur, élevée
par l'atelier Beaumanoir-Plusquellec. Saint-Malo de Dinan
a suivi quelques mois après. Exit donc le chevet plat
répandu en Bretagne sous le mécénat du
duc François II, adversaire des Rohan. Cette rupture
architecturale viendrait tout à propos renforcer une
opposition politique.
En 2010, dans leur ouvrage Bretagne gothique (éditions
Picard), les historiens Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult
reprennent à leur tour cette affirmation et l'englobent
même dans une pratique plus générale.
Ils écrivent : «L'emploi des absides à
pans et gâbles aigus, traditionnellement attribué
à l'atelier Beaumanoir actif dans l'ouest du Trégor
vers 1500, appartient plus largement à des recherches
structurelles et formelles qui se manifestent en basse Bretagne
à la charnière du XVe et du XVIe siècle.»
Et ils précisent que ce type de chevet polygonal [que
le lecteur suppose toujours à pans et «gâbles»
aigus] se rencontre en particulier sur les terres des Rohan
: à Quelven dès 1485-1490 et à la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Encontre à Rohan en 1510. Quant au
chevet de Saint-Malo, constatons qu'il surpasse en complexité
tout ce qui a été réalisé jusque-là.
Notons en passant que le terme gâble est ici
impropre : un pignon est la partie triangulaire qui termine
un mur à son sommet, alors qu'un gâble est un
couronnement. Ainsi, un pignon peut recevoir un gâble
en guise d'embellissement.
Si l'on veut être rigoureux, remarquons que, jusqu'à
présent, il n'a jamais été question d'attribuer
aux Beaumanoir le foisonnement flamboyant qui surplombe les
toits des chapelles, mais uniquement la forme polygonale aiguë
de celles-ci et les noues multiples de leurs toits. Les deux
concepts sont distincts.
À présent, il faut considérer qu'ils
sont étroitement liés. C'est ce que sous-entend
l'historienne Michèle Boccard, docteur en histoire
de l'art médiéval, en 2015. Dans son article
sur l'église Saint-Malo pour le Congrès archéologique
tenu dans les Côtes-d'Armor, elle ne se cantonne pas
à la forme aiguë des pans et des «gâbles»,
mais renouvelle le concept en y incluant la multiplicité
des pinacles, des choux frisés et des fleurons. Un
concept dont elle remet en question la paternité.
Michèle Boccard parle ainsi, pour la construction du
chevet de Saint-Malo, de choix formels dont la source
est difficile à localiser. En citant l'article de Laurent
Guitton de 2007, elle rappelle qu'on a beaucoup associé
ces chevets à pans et noues multiples au nom des Beaumanoir,
«une famille de tailleurs de pierre bien documentée
à Morlaix et ses environs autour de 1500», ajoute-t-elle
et «qu'on a parfois même voulu y voir la source
d'inspiration des chapelles rayonnantes [de Saint-Malo].»
Selon l'historienne, rien n'est avéré. Elle
indique que le chantier le plus représentatif de ces
chevets Beaumanoir est la petite chapelle Saint-Nicolas
de Plufur construite en 1499 et que rien ne prouve son lien
architectural avec l'église Saint-Malo de Dinan. ---»»
Suite 2/2 ci-dessous
|
|

Les chapelles nord du chœur et leurs remplages flamboyants. |

Baie 26, détail : Jésus et les petits enfants.
Atelier Eugène Denis ? |
|

Baie 19, détail : la Sainte Famille.
Atelier Eugène Denis ? |
|
Le rôle
de la famille Beaumanoir dans l'architecture du chevet (2/2).
---»» Enfin, prenant le contre-pied de ce qui
est écrit dans Bretagne gothique en 2010, Michèle
Boccard minimise le rôle des Rohan : «l'aire de
production des chevets Beaumanoir autour de 1500, écrit-elle,
n'appartient pas aux domaines des Rohan». En effet,
cette forme de chevet y est rare, précise l'historienne,
l'exemple de Notre-Dame de Quelven, construite entre 1485
et 1490 et citée par Philippe Bonnet et Jean-Jacques
Rioult, étant à ses yeux une exception.
Il reste néanmoins à préciser le rôle
de la maîtresse-vitre. En optant pour le chevet plat,
le duc François II créait, derrière le
maître-autel, un grand mur vertical capable d'accueillir
une large et haute verrière démarrant assez
bas dans le mur. Tout paroissien qui entrait dans l'église
la voyait immédiatement. Cette maîtresse-vitre
illuminait le chœur : c'était l'endroit idéal
pour apposer ses armoiries et affirmer à tous son pouvoir.
Laurent Guitton rappelle que, dans l'acte de fondation de
Saint-Malo daté du 12 juin 1489, Jean II de Rohan offre
«la grant vitre du pignon du chanceau d'icelle».
Chanceau, qui rappelle chancel, signifie chœur.
Il s'agit donc du vitrail principal, donc de la maîtresse-vitre
derrière le maître-autel comme à Ploërmel,
Josselin
ou Guenguat. Mais, quand il y a un déambulatoire bordé
de chapelles rayonnantes, soit il n'y a plus de place pour
la maîtresse-vitre, soit celle-ci est réduite
en hauteur, comme à Dol-de-Bretagne,
donc moins lisible
Certes, le vicomte de Rohan, comme le rappelle Laurent Guitton,
disposait de la prérogative d'insérer ses armoiries
dans la baie «principale» de la chapelle
axiale du chœur.
Mais c'est un bien petit endroit pour un si grand désir
d'affirmation de soi et de rivalité avec le duc !
De fait, Jean II se rattrapa sur les piliers. Malgré
les martelages de la Révolution, on distingue encore
les armes des Rohan sur les côtés antérieurs
des piliers du chœur
à la retombée des arcs. Pour rappeler sa lignée
et sans doute aussi ses prétentions, le vicomte associa
ses armes à celles de sa femme, Marie de Bretagne,
parente du duc François II.
En définitive, que les Beaumanoir soient à l'origine
ou pas de ce «nouveau» style, Jean II de Rohan
aurait eu à choisir entre deux possibilités
: un chevet plat (selon le style initié par son adversaire
François II) avec des armoiries au bas de la maîtresse-vitre,
c'est-à-dire à la place d'honneur, ou bien des
chapelles rayonnantes (pour s'opposer au style de François
II) et des armoiries rejetées sur les piliers du chœur...
Sources : 1) Bretagne gothique
de Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult, éditions
Picard, 2010 ; 2) Congrès archéologique de
France, Côtes-d'Armor, 2015, article sur l'église
Saint-Malo par Michèle Boccard ; 3) Congrès
archéologique de France tenu à Saint-Brieuc
en 1949, article sur l'église Saint-Malo par René
Couffon ; 4) Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest,
juin 2007, article de Laurent Guitton sur Jean II de Rohan
et Dinan.
|
|
| LA NEF DE L'ÉGLISE
SAINT-MALO |
|

La nef et les bas-côtés ont été reconstruits
de 1855 à 1865.
Ici, le bas-côté nord et les vitraux historiés
illustrant l'histoire de Dinan. |

La chaire à prêcher, du XVIIIe siècle, a
été restaurée en 1902.
Elle provient du couvent des Jacobins de Dinan.
L'ange qui la surmonte a été refait au XIXe siècle. |
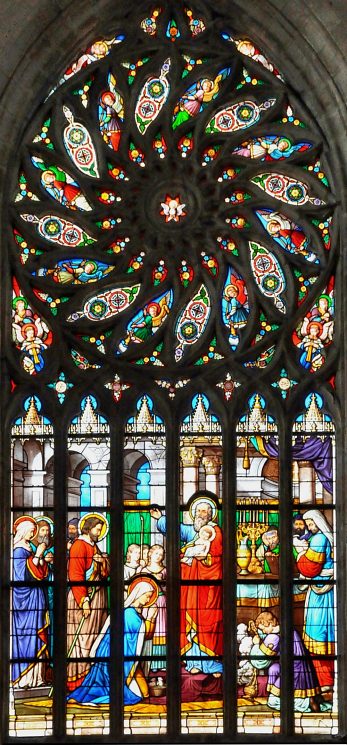
Baie 31 : Présentation de Jésus au temple.
Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |
|
|
Architecture
de la nef. Dans les années 1850, les
architectes Guépin et Aubry furent
chargés d'en finir avec le statut d'édifice
inachevé que traînait l'église Saint-Malo
depuis le XVIe siècle. Respectant le style du
gothique breton, ils restaurèrent la nef en lui
ajoutant des bas-côtés nord et sud avec
leurs grandes baies. La source d'inspiration fut évidemment
le chœur.
Ils reproduisirent le même système d'arcatures
avec des piles rondes, des arcades en tiers-points à
pénétration, un intrados à deux
rouleaux chanfreinés. Le vaisseau central et
les bas-côtés furent voûtés
d'ogives.
Guépin et Aubry réutilisèrent,
de manière assez heureuse, des éléments
de la première construction comme les piscines,
les crédences ainsi que la cuve baptismale en
granit sculpté du XVe siècle qui est devenue
depuis un bénitier (photo ci-dessous).
En dépit des verrières historiques des
années 1920 dans les grandes baies, la nef bénéficie
d'une assez bonne luminosité que viennent encore
accroître les petites fenêtres du second
niveau. La photo
du haut de cette page, prise depuis l'avant-nef, montre
un bas-côté sud bien éclairé
par le soleil.
|
|

Éléments anciens dans l'avant-nef : cuve baptismale
du XVe siècle servant de bénitier
et, sur la droite, piscine gothique. |
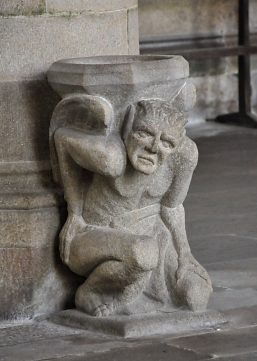
Bénitier porté par le démon.
Œuvre des ouvriers dinannais
Louis Bouchet et Jean Delaune
XIXe siècle. |
|
Les
vitraux de Saint-Malo (1/2).
Les vitraux de l'église sont modernes. On sait
que, par le passé, les vitraux affichaient les
armoiries des seigneurs et des familles de la ville,
mais rien n'a survécu à la Révolution.
Le Corpus Vitrearum sur les vitraux de Bretagne
n'en fait pas état.
L'usage en Bretagne est de mettre à profit la
maîtresse-vitre pour y loger une grande verrière
afin d'attirer les regards. C'est le cas à Ploërmel
et à Josselin.
Mais, à l'église, Saint-Malo, pas de chevet
plat, donc pas de maîtresse-vitre. De fait, cette
église, avec ses trois chapelles rayonnantes,
sort complètement du schéma traditionnel
de l'art du vitrail en Bretagne.
Saint-Malo possède trois sortes de vitraux.
D'abord des vitraux à thème géométrique
ou abstrait, souvent peu colorés, qui permettent
un agréable passage de la lumière. C'est
le cas dans le chevet.
Puis, des vitraux créés dans la seconde
moitié du XIXe siècle, semblables, il
faut bien le dire, à ceux que l'on trouve partout...
Ici, ce sont les ateliers Champigneulle, Lorin, du Carmel
du Mans et surtout celui d'Eugène Denis qui ont
été sollicités. Ils offrent une
petite image au centre d'un décor de figures
géométriques (La
Décollation de saint Victor), une grande
scène sur deux ou trois registres illustrant
un épisode du Nouveau Testament (Jésus
et la Samaritaine, Jésus
remet les clés à Pierre, Prédication
de saint Jean-Baptiste), ---»»
Suite 2/2
ci-dessous.
|
|

Baie 31, détail du tympan : les anges sont obtenus
à partir du même carton, mais leur coloris diffère.
Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |
|

Élévations nord de la nef
et vitraux de l'atelier G. Merklen. |
|
Les
vitraux de Saint-Malo (2/2).
---»» ou une très large scène
marquée par l'ultramontanisme victorieux (La
Vierge remet le rosaire à saint Dominique,
les Âmes
du purgatoire), ou encore un vitrail-tableau dans
les grandes verrières du transept et de la baie
occidentale (Présentation
de Jésus au temple, donné ci-dessus,
Mort et
Couronnement de la Vierge. On notera dans quelques-unes
de ces verrières l'inclusion de paysages en arrière-plan
réalisés en camaïeu de bleus (Jésus
et la Samaritaine) ou de bruns (Jésus
remet les clés à Pierre).
Mais les vitraux les plus intéressants sont sans
nul doute ceux de la nef.
Créés dans les années 1922-1925
par l'atelier Merklen (qui devint ensuite l'atelier
Desjardins) et sur des cartons de Jean Virolle, ils
illustrent des épisodes de l'histoire de Dinan
dans un style qui rappelle un peu la bande dessinée.
Ces œuvres s'intègrent dans la phase de
renouvellement du vitrail historique qui a démarré
au XIXe siècle. L'église Saint-Malo possède
ainsi un cachet artistique unique en Bretagne que le
visiteur prendra plaisir à admirer.
Ces vitraux historiques sont tous reproduits dans cette
page. On y voit les épisodes suivants : Anne
de Bretagne entrant à Dinan en 1505 ; Geoffroy
de Dinan se retire au prieuré Saint-Malo
; Charles
de Blois reçu au couvent des Cordeliers ;
Prédication
de saint Vincent Ferrier ; Grignon
de Monfort rencontre le comte et la comtesse de la Garaye
et enfin La
Translation des reliques du bienheureux saint Malo.
À cette liste, on pourra ajouter le vitrail,
donné ci-contre, Aux
Enfants de Dinan morts pour la France de l'atelier
Charles Champigneulle réalisé, un peu
dans le même style, en 1921.
|
|

Baie 22, détail : «Aux Enfants de Dinan
morts pour la France» (Atelier Charles Champigneulle,
Paris 1921). |
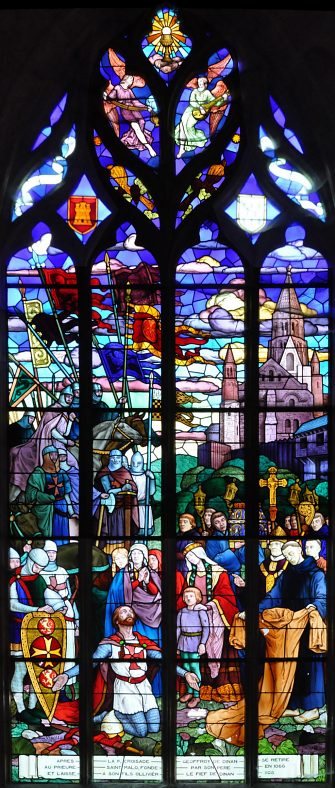
Baie 24 : Geoffroy de Dinan se retire au prieuré
Saint-Malo.
Atelier G. Merklen, Angers 1923. |

Baie 24, détail : chevaliers montés
et chevaliers à pied. |
|
Les
donateurs de l'église Saint-Malo (1/2).
Commencée en 1490, la construction
a été menée rapidement du
fait de l'importance des donations. Une fois le
terrain acquis grâce à un don de
Jean II,
vicomte de Rohan, les offrandes affluèrent,
venant principalement des familles nobles et bourgeoises
de la ville.
Les articles des Congrès archéologiques
de France donnent une liste d'exemples. René
Avalleuc, seigneur de Keroussaud et miseur de
Dinan offre 32 livres en 1490. Denys Gervaise,
receveur du domaine, donne un ducat pour avoir
assis la première pierre du pignon. Jacques
Matignon donne un vieil écu pour avoir
assis la première pierre d'un petit pilier.
Mme de Coëtquen donne vingt livres. Des changeurs
juifs versent quinze livres. La dame de Plumaugat
donne en 1491 douze écus «pour aider
à acquérir la perrière de
Quélinan et pour avoir deux tombes dedans
le cueur de lad. eglise». Sans oublier qu'une
partie des pierres provient de l'ancienne église
Saint-Malo qui a été rasée
en 1487 sur ordre du duc de Bretagne, François
II. ---»» Suite 2/2
à droite
|
|
|

Baie 24, détail : après la croisade, Geoffroy
de Dinan se retire au prieuré Saint-Malo en 1108.
Atelier G. Merklen, Angers 1923. |
|
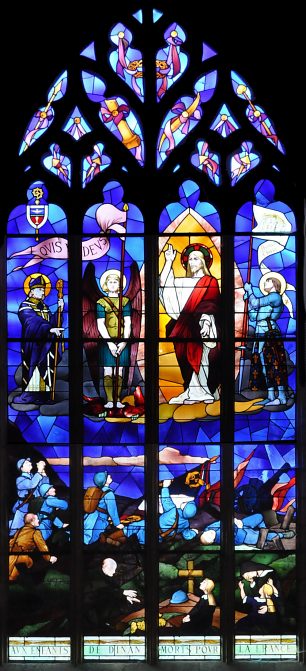
Baie 22 : «Aux Enfants de Dinan morts pour la France».
Atelier Charles Champigneulle, Paris 1921. |
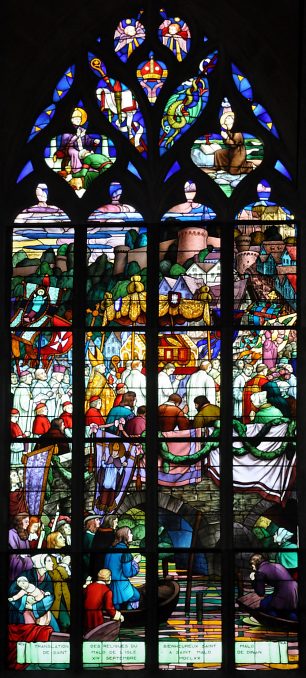
Baie 21 : Translation des reliques du bienheureux saint
Malo.
Atelier G. Merklen, Angers 1924. |
|
Les
donateurs de l'église Saint-Malo (2/2).
---»» En 1949, lors du Congrès
archéologique de France tenu à Saint-Brieuc,
l'historien René Couffon écrit que, une
fois le chœur
élevé et recouvert d'une charpente et
d'un toit de chaume provisoire (septembre 1491), les
ressources étaient passablement épuisées.
On envoya alors à Rome un certain Jean Toullou
auprès de Mgr Thomas James, évêque
de Dol (certainement pour obtenir des subsides du pape
ou, pourquoi pas? des indulgences). En 2015, l'article
de l'historienne Michèle Boccard, pour le Congrès
archéologique dans les Côtes-d'Armor,
va dans le sens contraire ! Sans reprendre cette histoire
de voyage à Rome (qui, s'il a existé,
n'a vraisemblablement pas abouti), elle écrit
que, dans la décennie 1490, le chantier avançait
vite. Deux dons importants de Jean II de Rohan y ont
aidé : deux cents livres tournois en 1493 et
cent autres en 1497.
Puis, le flux financier s'est un peu tari. Selon René
Couffon, Jean II de Rohan est passé à
la Réforme au début du XVIe siècle
et sa générosité s'est asséchée...
Heureusement, les têtes couronnées qui
gèrent la France prirent le relais, ce qui n'est
pas très fréquent. La duchesse Anne de
Bretagne, veuve de Charles VIII en 1498, épouse
Louis XII et devient reine de France pour la seconde
fois. Elle n'a pas oublié sa Bretagne. En 1505,
elle passe à Dinan (voir le vitrail de la baie
23) et offre cent livres à la paroisse. En
1508, son don à la fabrique de l'église
est plus important : cent livres annuelles pendant dix
ans. Le roi Louis XII offrira aussi cent livres en 1511.
La caisse sera bientôt vide. René Couffon
écrit que les trésoriers envoyèrent
en 1517 Guy de Santerre à la Cour pour demander
des secours. Le roi François Ier donna vingt-cinq
écus d'or.
Il y eut encore quelques dons puisqu'une inscription
dans la petite chapelle
de jonction dans le déambulatoire nord indique
qu'elle a été bâtie en 1549.
Le fait essentiel pour l'église est la perte
de son protecteur, qui était aussi son principal
financier, Jean II de Rohan passé à la
Réforme. L'édifice restera inachevé
jusqu'au Second Empire : pas de tour à la croisée
; pas de flèche ; pas de bas-côtés
bordant la nef et pas de nef disponible.
Sources : 1) Congrès
archéologique de France, Côtes-d'Armor,
2015, article sur l'église Saint-Malo par Michèle
Boccard ; 2) Congrès archéologique
de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, article
sur l'église Saint-Malo par René Couffon.
|
|
|
|
Les donateurs
de l'église Saint-Malo : une rivalité entre
Jehan II de Rohan et Anne de Bretagne ? (1/3)
Le vicomte Jean II de Rohan est présenté
par l'Histoire comme le fondateur et le bienfaiteur de l'église
Saint-Malo. En tant que fondateur, la chose est certaine.
Passé au service de la France dès la guerre
d'indépendance de la Bretagne (1487-1491), il est devenu
maître de la ville de Dinan
après sa reddition à Charles VIII. Jean II reprend
alors à son compte la promesse de son rival, le duc
de Bretagne François II, de reconstruire l'ancienne
église Saint-Malo, située hors les murs et détruite
en 1487 sur ordre ducal.
Rohan a de l'ambition. Il est déjà «premier
baron de Bretagne», c'est-à-dire le deuxième
personnage du duché après François II
en personne, mais il veut devenir duc à la place du
duc ! François II s'éteint en 1488. Après
Dinan, Jean II part guerroyer en Basse-Bretagne et se fait
même appeler «duc». Charles VIII doit le
rappeler à la raison. En revanche, pour le mécénat,
le «premier baron» a tout loisir d'évincer
son défunt rival. À Dinan,
pour la reconstruction promise de l'église détruite,
il va prendre sa place. Bientôt, il s'immiscera dans
l'édification du monastère des Clarisses, fondé
par François II en 1480 et dont la construction a été
retardée.
Rappelons ici que Dinan,
au XVe siècle, est de la même taille que Vannes
et qu'elle dépasse Saint-Malo. C'est la troisième
ville dans l'ordre de l'impôt annuel versé à
l'État breton. Cité riche, Dinan
est aussi une place militaire stratégique avec ses
remparts et son château qui dominent la vallée
de la Rance.
Revenons à l'église Saint-Malo. En 1489, Jean
II débourse plus de 557 livres tournois pour l'achat
des bien-fonds. De plus, il s'engage à payer la maîtresse-vitre
derrière le maître-autel et à faire «aumône
et libéralités» à la paroisse.
En 1493, il débourse à nouveau deux cents livres.
Un peu plus tard, il demande au receveur de la ville de prélever
cent livres sur les recettes de la ville au bénéfice
de l'église. Cela fait plus de 850 livres.
Dans son article de 2007 dans les Annales de Bretagne et
des Pays de l'Ouest, l'historien Laurent Guitton signale
que cette somme correspond en fait au salaire d'un maître
maçon (disons d'un architecte) pendant quinze ans.
Ce qui est peu pour un personnage de cette importance. Qui
est Jean II de Rohan ? Laurent Guitton cite son titre
: «le très redouté, haut et puissant Monseigneur
Jehan, Vicomte de Rohan et de Léon, Comte de Porhouët
et de la Ganasche et seigneur de Beauvoir sur mer».
Il possède le cinquième des terres de la Bretagne
et ses revenus sont aussi élevés que son titre
est long ! Laurent Guitton cite les travaux de l'historien
Yvonig Gicquel qui a calculé les revenus nets de son
domaine personnel : environ vingt mille livres annuelles dès
les années 1480 puis, par le biais de son ralliement
à Charles VIII, entre quarante et cinquante mille livres
dès le début du XVIe siècle (Jean II
s'éteindra en 1516). Au sein de cette immense fortune,
que représentent 850 livres ? Dans le même
temps, le vicomte finance la construction ou l'agrandissement
d'une vingtaine d'édifices religieux en Bretagne auxquels
il faut ajouter les travaux de sa forteresse de Pontivy et
ceux de la coûteuse façade de son château
de Josselin.
Nommé par Charles VIII, en 1488, capitaine de la place
et de la forteresse de Dinan et du château voisin de
Léon, il en reçoit évidemment les bénéfices
qui y sont rattachés. En 1490, ce sont les revenus
de la châtellenie de Dinan qui tombent dans sa poche,
c'est-à-dire les droits à l'intérieur
de la ville et dans trente-trois paroisses alentour. À
cela s'ajoutent les fouages de l'archidiaconé de Dinan
: «l'impôt direct levé sur tous les foyers
roturiers des campagnes de la moitié septentrionale
de l'évêché de Saint-Malo», précise
Laurent Guitton. S'être rangé au côté
du roi de France se révèle très lucratif.
---»» Suite 2/3
|
|
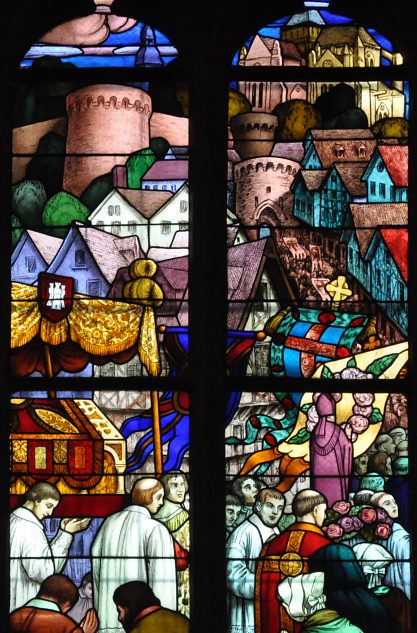
Baie 21, détail : Translation des reliques du
bienheureux saint Malo.
Atelier G. Merklen, Angers 1924. |
| LA BAIE 23 - ANNE
DE BRETAGNE ENTRE À DINAN EN 1505 |
|

Baie 23 : Entrée d'Anne de Bretagne, reine de France,
à Dinan par la Porte de Brest en 1505.
Atelier Desjardins, Angers 1926. |

Baie 23, détail : Anne de Bretagne, reine de France,
entre à Dinan en 1505.
Atelier Desjardins, Angers 1926. |

Chapelle latérale sud dans le bas-côté de
la nef avec son autel néogothique dédié
à saint Victor. |
|

Baie 27, détail : Charles de Blois, duc de Bretagne
est reçu au couvent des Cordeliers.
Atelier G. Merklen, années 1920 ? |

Retable de bois dans la chapelle latérale sud Saint-Victor.
|
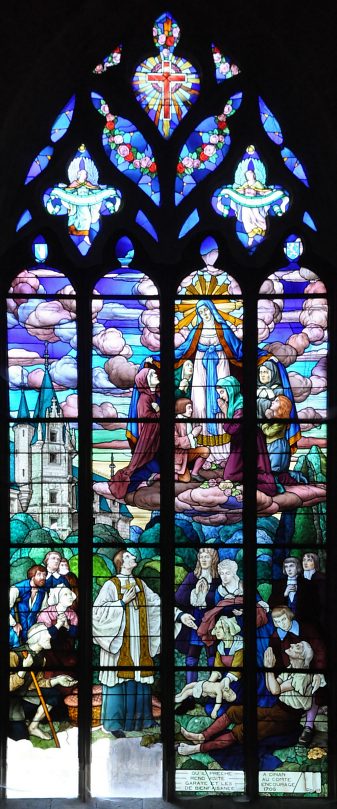
Baie 20 : Grignon de Monfort rencontre le comte
et la comtesse
de la Garaye en 1706 au château de la Garaye.
Atelier G. Merklen Angers 1923. |
Chemin de croix
XIXe siècle ?
Station I : Jésus est condamné à mort. |
|
|

Statue de saint Victor
dans la chapelle Saint-Victor.
Bois peint, XIXe siècle ? |
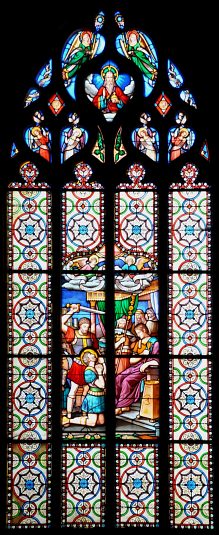
Baie 16 : Décollation de saint Victor.
Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |
 |
|

Le bas-côté sud créé au XIXe siècle
et la nef. |
|

Baie 27 : CHARLES DE BOIS, duc de Bretagne
et ses féaux DUGUESCLIN et BEAUMANOIR
sont reçus au couvent des Cordeliers.
Atelier G. Merklen, années 1920 ? |
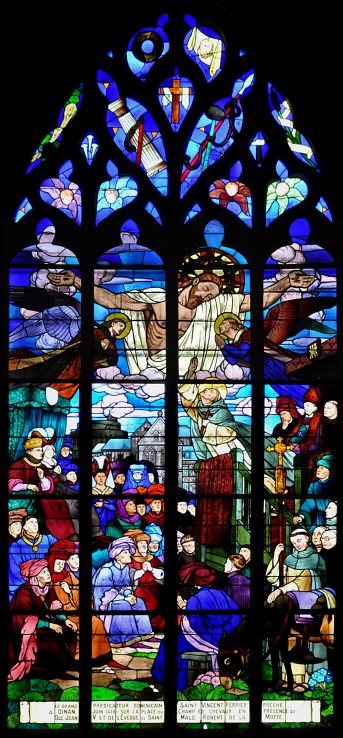
Baie 25 : Prédication de saint Vincent Ferrier
en 1418 à Dinan
en présence de l'évêque de Saint-Malo et
du duc de Bretagne.
Atelier G. Merklen, années 1920 ? |

Baie 16, détail : Décollation de saint
Victor.
Atelier Eugène Denis, années 1870 ? |
«««---
Au milieu de la photo, le pilier massif de trois mètres
de diamètre est l'un des quatre piliers de la croisée.
Ces piliers massifs, élevés à partir
de 1490, étaient prévus pour
soutenir une flèche qui n'a jamais été
construite. |
|
|
|
Les donateurs
de l'église Saint-Malo : une rivalité entre
Jehan II de Rohan et Anne de Bretagne ? (2/3)
---»» Par ailleurs, à Dinan,
le vicomte de Rohan a su placer des hommes de confiance aux
postes clés, se créant ainsi un véritable
réseau. Il a fait mieux : il a utilisé à
son profit, dans toute la Bretagne, des agents qui travaillaient
pour le duc, notamment la famille Avalleuc. Cette famille,
originaire de la région de Josselin-Ploërmel (le
cœur du fief des Rohan) était très présente
dans l'administration ducale où elle comptait plusieurs
officiers de finances. La constitution de ce réseau
d'«agents doubles» permit au vicomte, souligne
Laurent Guitton, d'employer les officiers ducaux à
son unique service, une fois commencée la guerre contre
Charles VIII.
Il cite d'autre part les conclusions d'une étude menée
par l'historien Jean Kerhervé : Jean II de Rohan mit
en place «une vaste organisation clandestine destinée
à financer sur le pays les opérations militaires
du parti francophile et à réduire d'autant plus
les moyens d'action de l'État breton» [Kerhervé].
De la sorte, dans l'ensemble du duché de Bretagne pendant
la guerre d'Indépendance, un petit nombre de percepteurs,
nommés par François II, aura réussi à
détourner de l'impôt public plus de trente mille
livres au profit de Jean II... Jean Kerhervé donne
un exemple : l'un des agents était le receveur du fouage
de l'évêché de Saint-Brieuc, un dénommé
Denis Gervaise. En 1490, Jean II lui attribua le poste de
receveur du domaine de Dinan.
Certainement pour service rendu. C'est aussi en 1490 que la
duchesse Anne lança contre Gervaise un ordre d'arrestation...
qui ne fut jamais exécuté !
Jean II n'oubliait pas son mécénat et ses édifices.
Laurent Guitton ajoute qu'il incita son réseau d'officiers
à contribuer personnellement à la construction
de l'église Saint-Malo par des dons. Ainsi René
Avalleuc, Denis Gervaise, Mme de Plumaugat, femme de Charles
du Breuil (rival malheureux de René Avalleuc) - voir
plus haut.
L'ambitieux Jean II voulait le duché pour lui. Sa relation
avec la fille de François II († 1488), la jeune
duchesse Anne, fut très conflictuelle. Il chercha en
vain à l'épouser. Il essaya ensuite de la marier
à son fils aîné, puis à son fils
cadet. Sans plus de succès. Il combattit contre elle
lors de la guerre d'indépendance. En 1492, il prit
part au «complot breton» qui réclamait
l'aide d'Henry VII d'Angleterre pour chasser les Français
du duché. (Il fut pardonné par Charles VIII.)
Selon Georges Minois (cité par Laurent Guitton), il
faut encore y ajouter les nombreux procès intentés
à la duchesse pour lui arracher des avantages.
En 1491, par son mariage avec Charles VIII, Anne devient reine
de France. Pour les historiens, ce n'est pourtant qu'à
partir de 1498 et de son remariage avec Louis XII que les
querelles bretonnes vont s'apaiser. En effet, elle doit s'efforcer
de rallier la noblesse du duché à la couronne.
Les droits de Rohan sur sa ville de Dinan sont ainsi confirmés
en octobre 1498. L'ancien trublion est même salué
comme le «très cher et très aimé
cousin». Le mois précédent, la reine-duchesse
s'était rendue à Dinan,
mais, à part ses prières dans les églises,
on ne sait rien de sa visite qu'elle voulait sans éclat.
On ignore si elle a fait des dons. ---»»
Suite 3/3
ci-dessous
|
|
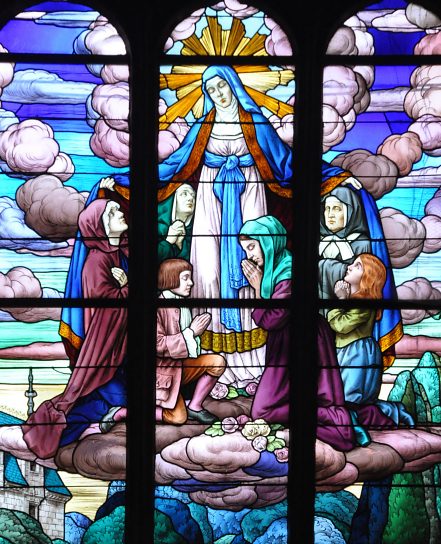
Baie 20, détail : Grignon de Monfort rencontre le comte
et la comtesse
de la Garaye en 1706 au château de la Garaye.
Atelier G. Merklen Angers 1923. |
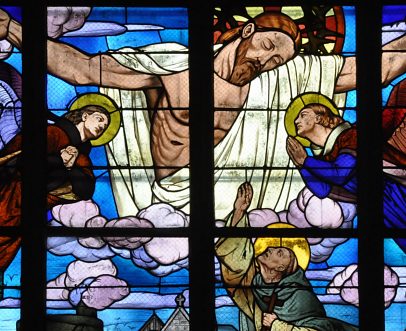
|
|
Les donateurs
de l'église Saint-Malo : une rivalité entre
Jehan II de Rohan et Anne de Bretagne ? (3/3)
---»» En revanche, elle revint en
1505 à l'occasion d'un tour de Bretagne. Son entrée
dans la ville, en compagnie de Jean II, fut très solennelle
et saluée par de nombreux Dinannais - voir le vitrail
de la baie 23.
Elle fit un don de cent livres à la paroisse Saint-Malo.
En 1507, elle n'effectua qu'un bref passage. Elle sera néanmoins
désignée marraine de la nouvelle cloche du beffroi
; Jean II en sera le parrain. En 1508, elle s'engagea à
verser cent livres pendant dix ans. Le roi Louis XII donnera
lui aussi cent livres en 1511. Le couple royal a donc contribué
pour mille deux cents livres à l'édification
de l'église Saint-Malo, vraisemblablement plus que
Jean II de Rohan, resté dans l'Histoire comme le fondateur
officiel.
Comment analyser cette donation royale ? Est-ce la façon
de la reine-duchesse d'honorer, sur le tard, la promesse de
son père de reconstruire Saint-Malo intra muros ?
Est-ce la volonté de concurrencer l'acte de fondation
du vicomte Jean et de s'afficher autant mécène
que lui, voire davantage ? Ou est-ce tout simplement
le désir, sans arrière-pensée, d'embellir
l'église et, par-delà, la ville de Dinan ?
Laurent Guitton livre les trois hypothèses, mais aucun
élément historique ne nous est parvenu pour
autoriser un choix.
Source : Annales de Bretagne
et des Pays de l'Ouest, tome 114, juin 2007, article de
Laurent Guitton : «Un
vicomte dans la cité : Jean II de Rohan et Dinan».
|
«««---
Baie 25, détail : Prédication de saint Vincent
Ferrier en 1418 à Dinan
en présence de l'évêque de Saint-Malo et
du duc de Bretagne.
Atelier G. Merklen, années 1920 ? |
|
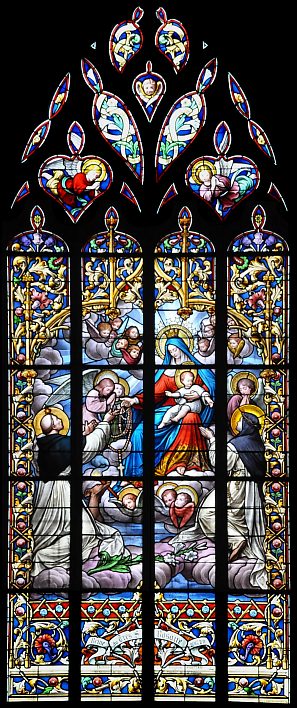
Baie 18 : La Vierge remet le rosaire à saint Dominique.
Atelier Charles Lorin, Chartres 1901. |
Constructions des années
1855-1865 ---»»»
Elles respectent les plans du XVe siècle et l'esprit
du gothique breton visible dans le chœur : piles
rondes
et arcs en pénétration. |
|
|

Baie 18, détail : La Vierge remet le rosaire à
saint Dominique.
Atelier Charles Lorin, Chartres 1901. |
 |
|
| L'ÉGLISE
SAINT-MALO DES XVe, XVIe ET XVIIe SIÈCLES : TRANSEPT
ET CHŒUR |
|

Vue d'ensemble du chœur de l'église Saint-Malo.
Le maître-autel date du XVIIIe siècle et provient de
l'abbaye de Lehon. |
|
|
|
Architecture
et ornementation du transept et du chœur.
Ce sont les parties anciennes de l'édifice. Elles
sont très sobres. Comme on le voit ci-dessus,
les arcades du premier niveau retombent en pénétration
dans les piles rondes. Leurs intrados possèdent
deux rouleaux chanfreinés comme à la basilique
Saint-Sauveur
de Dinan, toute proche.
En général, dans les grandes églises
bretonnes bâties jusqu'au XVe siècle, l'élévation
est à trois niveaux : grandes arcades, triforium
et fenêtres hautes. À Saint-Malo, le chœur
des XVe et XVIe siècles n'en a que deux. Les
historiens pensent en connaître l'explication.
Le maître d'œuvre du chantier depuis l'année
de démarrage (1489) était un certain Guillaume
Juhel. En 1505, il est remplacé par un dénommé
Jean Lemaître (on en ignore la raison).
Ce dernier est aussitôt envoyé par le chapitre
à Coutances pour étudier la construction
de l'église Saint-Pierre, déjà
bien avancée. Or Saint-Pierre, édifice
de bonne taille, n'a que deux niveaux. Jean Lemaître
se serait donc inspiré du modèle normand.
Le second niveau du chœur est une suite d'arcs
de décharge séparés par des murs
épais. Dans les parties tournantes (photo ci-dessus),
cet arc contient, en haut, une baie vitrée à
deux lancettes et, en bas, un arc en plein cintre bordé
d'un garde-corps
à quatre motifs trilobés. Dans les parties
droites du chœur (photo plus
bas), l'arc de décharge, plus large, abrite
une baie à quatre lancettes et un garde-corps
à six motifs trilobés.
On remarquera que Jean Lemaître a reproduit un
modèle d'élévation typiquement
breton : le garde-corps
est fractionné afin de ne pas casser la tombée
des pans de mur. La lecture horizontale de la galerie
apparaît ainsi brisée au bénéfice
de sa lecture verticale. Ce modèle de garde-corps,
vieux de plus de cent ans, «était largement
usité au XVe siècle dans les triforiums
bretons» écrivent Philippe Bonnet et Jean-Jacques
Rioult en 2010 dans Bretagne gothique. Évidemment,
Jean Lemaître a dû assurer la continuité
de la galerie de circulation en prévoyant une
trouée au niveau de chaque pan de mur, comme
le montre une photo
du garde-corps plus bas, reproduisant ainsi de manière
systématique ce qu'on appelle en Champagne le
passage champenois.
Le déambulatoire présente un point intéressant
développé par l'historienne Michèle
Boccard lors du Congrès archéologique
de France de 2015 : la liaison entre les travées
droites du chœur et les chapelles du chevet paraît
maladroite. On en a un aperçu sur le plan ci-contre
et sur l'extrait
de plan plus bas. La troisième travée
vient buter au sud sur le mur de la sacristie. Mais
il faut assurer la liaison de cette travée avec
les parties tournantes et leurs trois chapelles rayonnantes.
Ce qui se fait par le biais d'une étroite travée
de plan triangulaire, un peu biscornue. Au sud, cette
étroite travée se termine par l'escalier
menant au premier étage de ce que l'historienne
Michèle Boccard appelle la chambre forte
(extrait
de plan plus bas). Au nord, l'espace est comblé
par une petite
chapelle construite en 1549 grâce à
une donation de Jehan de la Haye. Cette chapelle devait
servir de sépulture à sa famille.
Le visiteur intéressé pourra constater,
comme le fait remarquer Michèle Boccard, que
l'arc qui ouvre cette chapelle sur le déambulatoire
retombe maladroitement vers l'est. Il est probable que
le dessin du plan de cette travée de jonction
a donné du fil à retordre à l'architecte.
Le déambulatoire de Saint-Malo ouvre sur trois
chapelles rayonnantes pentagonales : c'est un choix
courant en Normandie, mais rare en Bretagne où
l'on privilégie plutôt les chevets plats
(églises de Ploërmel,
Genguat et Josselin
par exemple) ou encore les chevets à trois pans
coupés. Michèle Boccard rappelle qu'en
Bretagne seule la cathédrale de Tréguier
possède un chevet à trois chapelles rayonnantes,
édifié à la charnière des
XIVe et XVe siècles. Mais elle souligne qu'il
existe une différence notable entre les deux
édifices : à Saint-Malo de Dinan, les
chapelles possèdent une travée droite,
puis par une abside à trois pans, ce qui crée
une forte saillie sur le pourtour du chevet ; à
Tréguier, les chapelles n'ont qu'une seule abside.
La voûte
du déambulatoire est en berceau brisé.
Les nervures des retombées d'ogives ont été
ajoutées pour la beauté de l'ensemble
et n'ont aucun rôle de soutien. Les chapelles
rayonnantes sont, quant à elles, voûtées
d'ogives, mais la liaison entre les fausses nervures
du déambulatoire et les vraies nervures des chapelles
est assez maladroite comme on peut le voir sur une photo
plus bas.
Le déambulatoire sud possède une série
de clés
de voûte sculptées dans le granit centrées
autour du thème de la Passion. Malgré
les dégradations de la Révolution, les
chapelles du chœur ont conservé un mobilier
d'attache en granit sculpté. On y trouve des
retables à fortes moulures ou des crédences
avec ou sans enfeu. Il est clair que la construction
de ces chapelles a été financée
par des familles nobles ou bourgeoises aisées
de Dinan au XVIe siècle.
Sources : 1) Bretagne
gothique de Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult,
éditions Picard, 2010 ; 2) Congrès
archéologique de France, Côtes-d'Armor,
2015, article sur l'église Saint-Malo par Michèle
Boccard.
|
|

Le pilier sud-est de la croisée contient une inscription
de 1490 relative au début de la construction. |
|
| LES CROISILLONS
DU TRANSEPT |
|

Le grand orgue de l'église dans le croisillon sud du
transept.
Il est l'œuvre du facteur anglais Oldknow et date de 1889. |
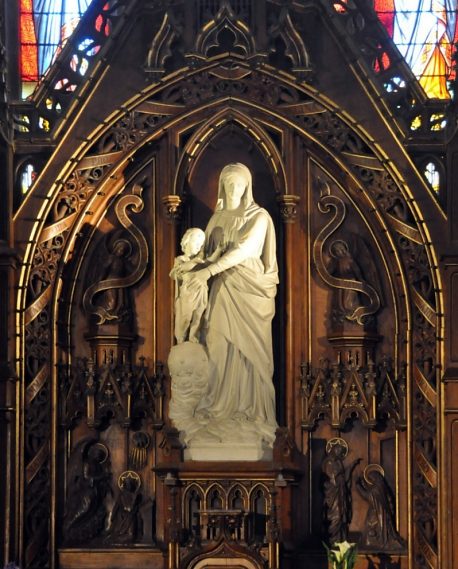
Autel de la Vierge : détail central.
La statue de la Vierge à l'Enfant est en marbre blanc.
XIXe siècle.

À partir de 1598, la chapelle du bras nord abrita la
corporation
des drapiers, des sergiers et des épiciers. |
|

Les tuyaux peints du grand orgue. |

L'autel de la Vierge (XIXe siècle) dans le croisillon
nord du transept. |
 |

Deux statues du XVIIIe siècle
dans l'autel de la Vierge. |
|
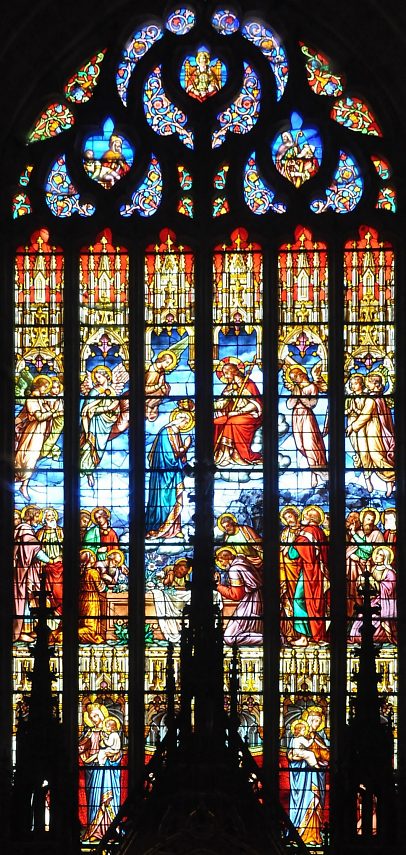
Baie 17 : Mort de la Vierge et Couronnement de la Vierge.
Atelier Eugène Denis, Nantes 1875.
Baie 17, détail : La Vierge remet le scapulaire à
saint Simon Stock ---»»»
en présence d'une sainte. Laquelle ? |
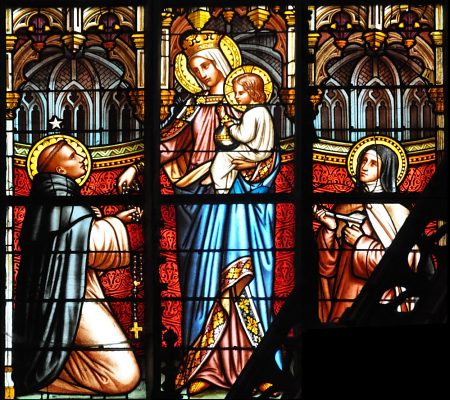
Baie 17, détail : La Vierge remet le rosaire à
saint Dominique en présence d'une sainte tenant une flèche.
Est-ce sainte Ursule ? Est-ce sainte Thérèse d'Avila
? |
|
La
Vierge remet le rosaire et le scapulaire.
Les deux hauts pinacles latéraux du retable de
la Vierge empêchent de voir ces deux scènes
convenablement. Leur reconstitution partielle est donnée
ici à partir de plusieurs photos redressées.
Saint Dominique est associé à une sainte
tenant une flèche : Ursule? Thérèse
d'Avila? Et pourquoi? En bas, saint Simon Stock porte
l'habit des carmes et reçoit le scapulaire en
présence d'une autre sainte. Laquelle? Sainte
Claire, fondatrice des clarisses? Ces deux scènes
laissent planer quelques mystères.
|
|
 |
|

Baie 17, détail : Mort de la Vierge et Couronnement
de la Vierge.
Atelier Eugène Denis, Nantes 1875.
Dans le tombeau, les apôtres découvrent un lit de fleurs
à la place de la dépouille de Marie. |
| LE DÉAMBULATOIRE
ET LES CHAPELLES DU CHŒUR |
|

Déambulatoire : clé de voûte représentant
la Sainte Face. |

Déambulatoire : clé de voûte. |

Déambulatoire : clé de voûte avec armoiries. |
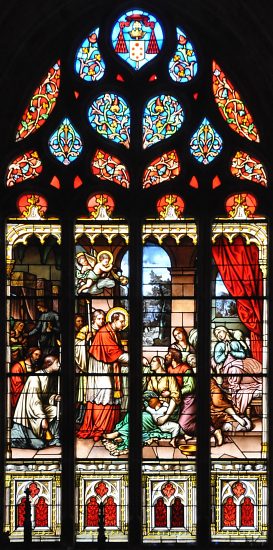
Baie 13 : saint Charles Borromée remet
le viatique aux pestiférés de Milan.
Atelier Eugène Denis ? |
|

Le déambulatoire sud avec deux chapelles.
Au premier plan à droite, la chapelle Saint-Pierre. |

Déambulatoire : l'agneau pascal
dans la clé de voûte d'une chapelle. |

Groupe sculpté représentant
l'Éducation de la Vierge
dans le déambulatoire. |
|

«La Barque de Saint Pierre»
Bas-relief dans la chapelle Saint-Pierre.
XIXe siècle ? |

Enfeu dans une chapelle du déambulatoire et ses armoiries
---»»
XVe siècle. |

Armoiries d'un enfeu. |
|

Déambulatoire : clé de voûte
avec un ange tenant un écusson
(martelé à la Révolution). |

La voûte oblongue d'une chapelle sud du déambulatoire
XVIe siècle. |

Déambulatoire : clé de voûte
avec un ange tenant un écusson
(martelé à la Révolution). |

Le déambulatoire sud et ses fausses retombées
d'ogives.
La maladresse de la liaison entre les fausses voûtes d'ogives
du déambulatoire et les ogives des chapelles rayonnantes
est ici bien visible (flèche). |

Baie 10 : Jésus et la Samaritaine
Atelier Eugène Denis, Nantes 1874.
|
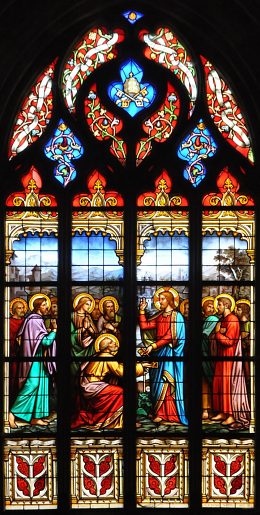
Baie 12 : Jésus remet les clés à
Pierre.
Atelier Eugène Denis, Nantes 1876. |

Les deux niveaux de l'élévation dans le
chœur. Ici, le côté nord.
Le garde-corps s'interrompt à chaque pan de mur.
Il faut ---»»
donc prévoir des passages dans le mur pour permettre
la circulation dans la galerie. |
|
|

Fresque polychrome dans une chapelle du déambulatoire. |

Retable du XIXe siècle dans une chapelle du déambulatoire. |

Le garde-corps de la galerie au-dessus du premier niveau de
l'élévation. |
|

Baie 10, détail : Jésus et la Samaritaine avec
le paysage d'arrière-plan en camaïeu de bleus.
Atelier Eugène Denis, Nantes 1874.
La pratique du camaïeu de bleus dans les paysages est imitée
des peintres verriers de la Renaissance. |

Statue d'un évêque dans un retable
XIXe siècle. |
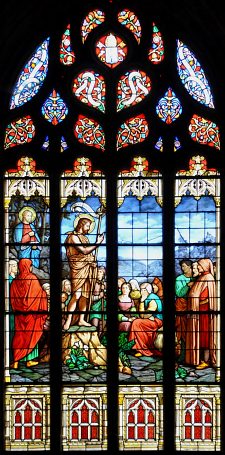
Baie 15 : Prédication de saint Jean-Baptiste.
Atelier Eugène Denis, Nantes 1881. |
|
|

Baie 12, détail : Jésus remet les clés à Pierre.
Atelier Eugène Denis, Nantes 1876.
Décor en camaïeu de bruns et de bleus à l'arrière-plan. |
|
|

Baie 9 : les Âmes du purgatoire.
Atelier Charles Champigneulle 1893. |
|
|

Baie 9, détail : La Vierge et l'Enfant. |
|
Le purgatoire
(2/2). ---»» de l'hagiographe
Charles Barthélemy, directeur des Annales Hagiologiques
de la France, avec le court texte proposé par le
chanoine Jean-François Godescard au XVIIIe siècle.
L'illustration du purgatoire est assez courant dans les églises.
On le rencontre en tableau : cathédrale Saint-Pierre
de Saintes,
église Notre-Dame-des-Marais
à La
Ferté-Bernard, église de la Sainte-Trinité
à Paris. Quant à la grande toile Le passage
des âmes du purgatoire au ciel, une œuvre magnifique
de Gabriel Briard (1725-1777) à l'église parisienne
de Sainte-Marguerite
dans le 11e arrondissement, elle est un incontournable du
thème.
Au XIXe siècle, plus encore que dans les toiles, le
feu de l'Enfer rougissant aux pieds des affligés du
purgatoire se voit dans les vitraux. Les peintres verriers
savaient se surpasser pour créer des scènes
édifiantes. On pourra consulter l'église Saint-Vivien
à Saintes
(atelier Dagrand, 1896), l'église Notre-Dame
à Chateauroux
(atelier Lobin, années 1880), l'église Saint-Étienne
à Fécamp
(atelier Boulanger, 1891) ou encore l'église Notre-Dame
à Dole
dans le Jura (atelier du Carmel du Mans, vers 1864).
À l'inverse, sans ajouter de feu infernal, d'autres
artistes du XIXe siècle représentent les âmes
du purgatoire dans une simple pénitence, C'est le cas
dans les églises parisiennes de Saint-Roch
(toile de Louis Boulanger) et de Saint-Eustache.
|
|
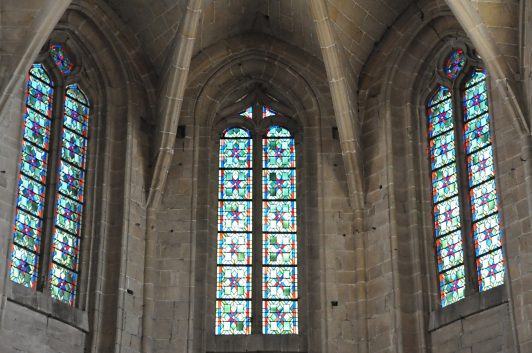
Baie 101-100-102 : l'abside et ses vitraux contemporains
au second niveau de l'élévation. |
|
Le
chœur ne possède que deux niveaux
d'élévation et non pas trois, comme c'est
la tradition dans les grandes églises bretonnes
jusqu'à la fin du XVe siècle. Ce choix
est vraisemblablement le résultat de la visite
du chantier de l'église Saint-Pierre à
Coutances par le maître d'œuvre de Saint-Malo
en 1505.
On remarquera l'originalité du garde-corps qui
privilégie une vision verticale du chœur
: sa structure en arcature trilobée s'interrompt
à chaque fois qu'elle vient buter contre le pan
de mur épais qui sépare les baies. Ce
pan de mur est conçu avec art : il est légèrement
concave et rehaussé d'une fine colonnette dans
sa partie centrale. Pour permettre une circulation ininterrompue
dans la galerie, l'architecte a dû multiplier
les ouvertures dans la pierre (flèche).
|
|

Le chœur et la partie orientale du déambulatoire. |
|
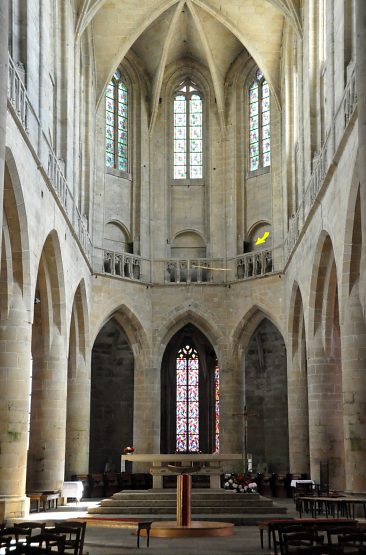
Le chœur de l'église Saint-Malo remonte au XVIe
siècle. |
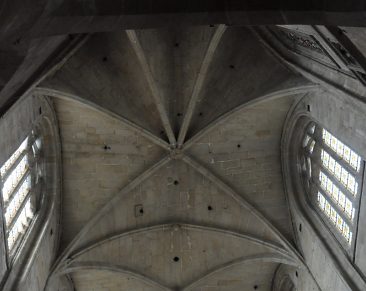
La voûte de l'abside. |
|
| LES CHAPELLES
RAYONNANTES DE L'ÉGLISE SAINT-MALO |
|

La chapelle axiale et ses vitraux contemporains. |
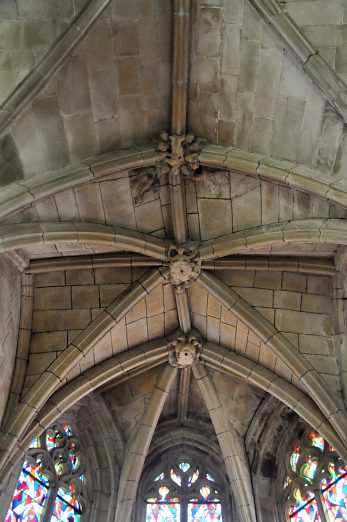
La voûte de la chapelle axiale et ses clés. |
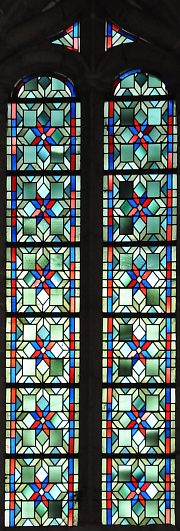
Baie 100 : vitrail contemporain
(second niveau de l'abside). |

Baie 0 : détail d'un vitrail contemporain. |
|
La
Vie de saint Malo vue par les hagiographes.
Malo est l'un des sept saints fondateurs de la
Bretagne. Quittant le pays de Galles, il partit
évangéliser l'Armorique vers 538
sur les conseils de saint Brendan. Il commença
sa mission à Alet (aujourd'hui Saint-Servan,
faubourg de Saint-Malo) et devint évêque.
Trop rigoureux dans ses exigences, il entra en
conflit avec les Alétiens et s'exila en
Saintonge. Plus tard, il revint à Alet,
puis repartit à Saintes où il mourut
vers 620.
Au XIXe siècle, la vie peu documentée
de Malo ouvrit la porte aux fantaisies des hagiographes
dans un but avoué d'édification.
On trouve ainsi dans Vies des saints illustrées,
ouvrage paru en 1896 aux éditions Pellerin,
ce passage relatif à l'arrivée de
Malo sur l'île de Césembre (au nord
d'Alet) où se trouve une école pour
enfants :
«Il y avait près du rivage une caverne
qui servait de repère à un cruel
dragon ; le monstre avait déjà dévoré
trois des enfants de l'école. Comme saint
Malo, après avoir débarqué,
dirigeait ses pas vers cette caverne sans y prendre
garde, les habitants de l'île l'avertirent
du danger ; mais le saint, poussé par l'esprit
de Dieu, s'avança toujours sans rien craindre
: soudain l'horrible bête fit entendre son
sifflement, et déjà on la voyait
sur le point de se jeter sur le serviteur de Dieu,
lorsque celui-ci, la touchant du bout de son bâton,
lui enjoignit, au nom du Seigneur, de quitter
ces lieux et de ne plus faire de mal à
personne.
Et aussitôt, à la grande admiration
de tous ceux qui étaient présents,
la terrible bête inclina la tête,
se mit à ramper vers la mer et disparut
dans les flots. ---»»
|
|
|
|
---»»
Saint Malo pénétra alors dans la caverne,
et, frappant le roc de son bâton, en fit jaillir
une source limpide qui coule encore aujourd'hui.»
Ce texte ne sort pas d'un conte de Grimm ou de Perrault,
mais fait bel et bien partie des hagiographies de saints
et de saintes éditées à la fin
du XIXe siècle... pour les adultes.
En matière d'édification morale, ce genre
de contes rédigés sans aucun scrupule
est de la même nature que les flammes du purgatoire
peintes dans les ateliers des verriers à la même
époque (voir plus
haut). On ne peut s'empêcher de s'interroger
: la sagesse de nos anciens avait-elle compris qu'il
fallait sans cesse remettre les fers au feu pour empêcher
les enfants du bon Dieu de se nuire les uns les autres ?
La question est posée.
|
|
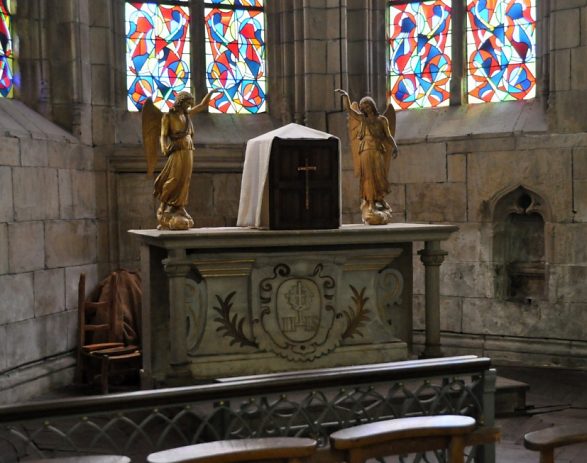
La chapelle axiale, son autel et sa piscine gothique. |
 |

Les Sept péchés capitaux,
Clé de voûte de la chapelle axiale.
«««--- Ange en bois doré (fin du XVIIIe
siècle). |
|
|

Vue de la nef du XIXe siècle depuis le transept. |
Documentation : Congrès archéologique
de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, article sur l'église
Saint-Malo par René Couffon
+ Congrès archéologique de France, Côtes-d'Armor,
2015, article sur l'église Saint-Malo par Michèle Boccard
+ «Bretagne gothique» de Philippe Bonnet et Jean-Jacques
Rioult, éditions Picard, 2010
+ Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, juin 2007, article de
Laurent Guitton : «Un vicomte dans la cité : Jean II
de Rohan et Dinan»
+ «Dinan» de Gérard Malherbe, éditions JOS
Le Doaré, 1976
+ «Dinan» de Peter Meazey, édition Comunicom, collection
«L'Histoire en Héritage», 2002
+ «Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France», Prosper
Mérimée, 1836
+ Note sur l'église disponible à l'entrée de
l'édifice
+ Dictionnaire des églises de France, éditions Robert
Laffont, 1966. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|