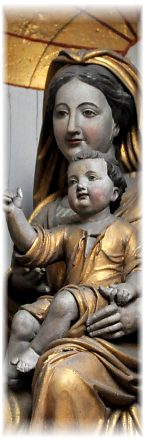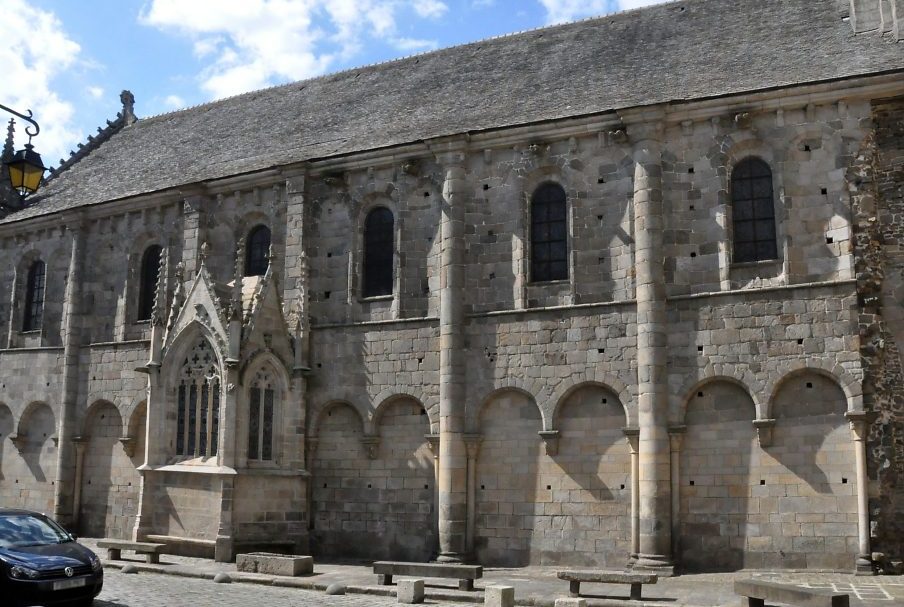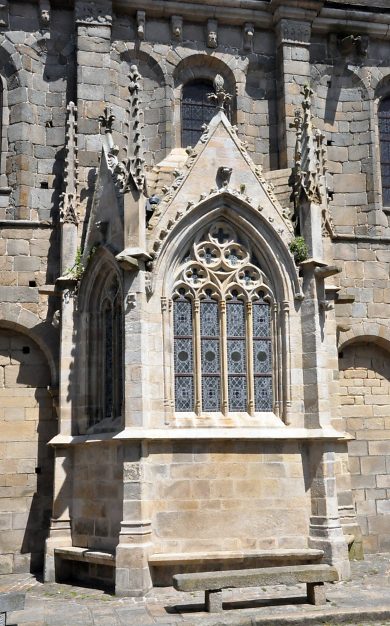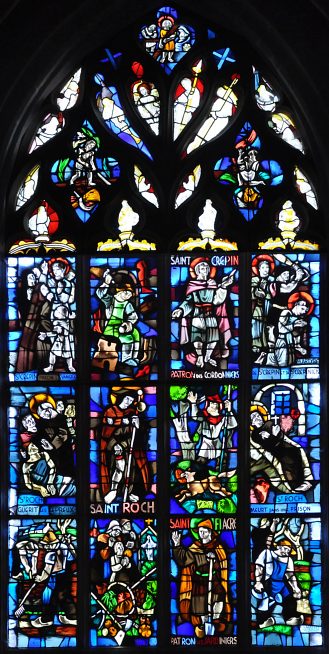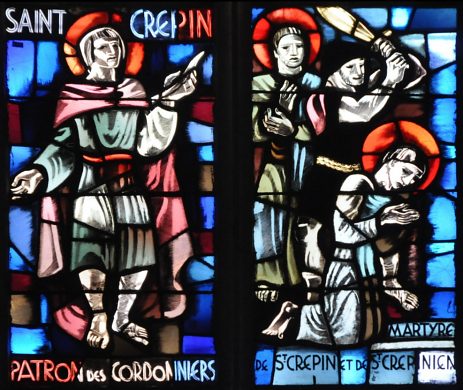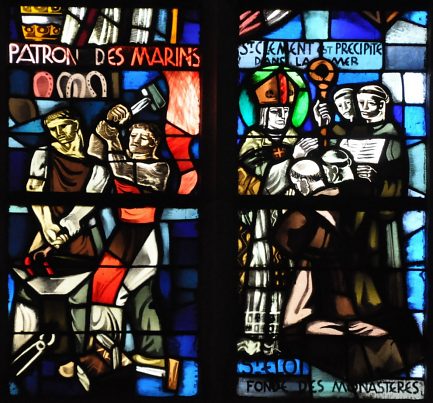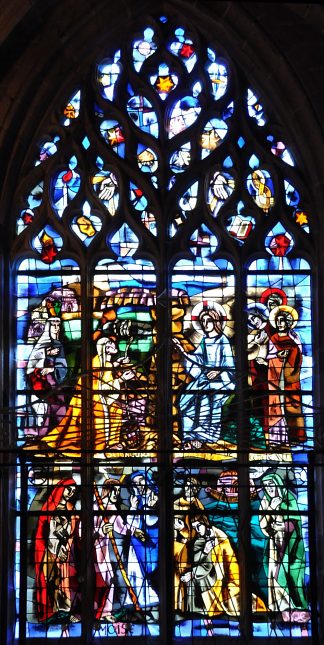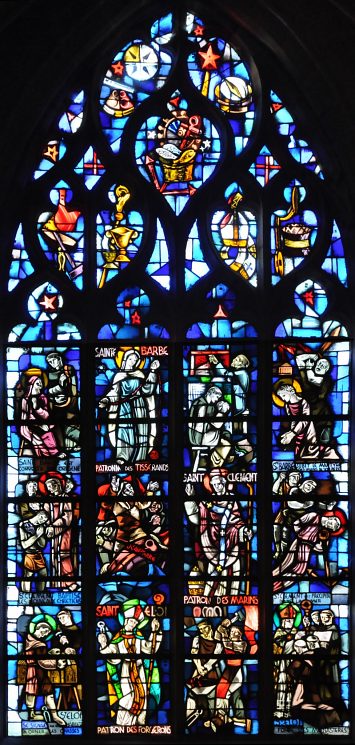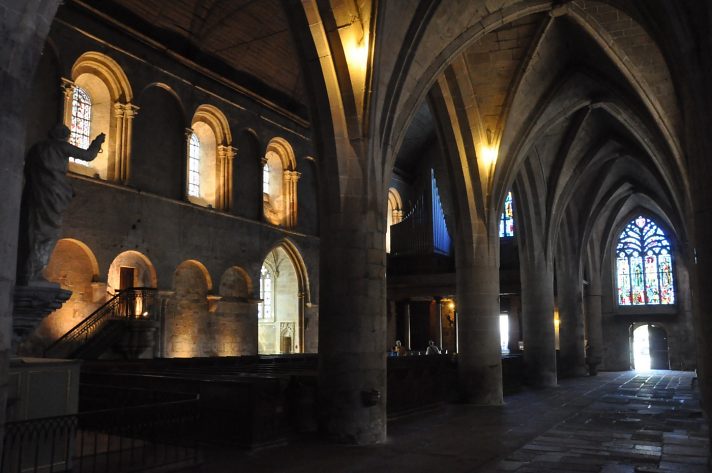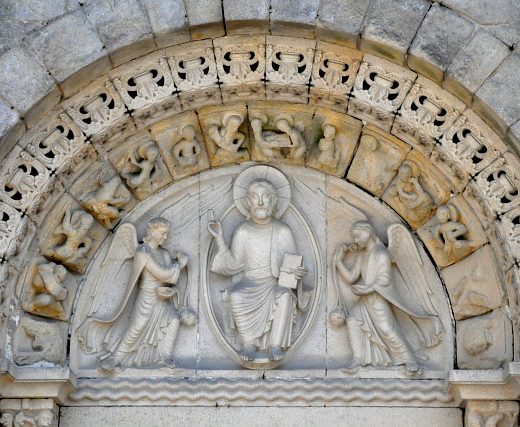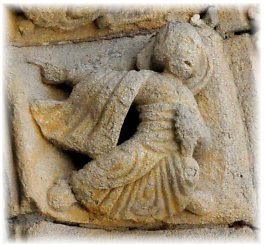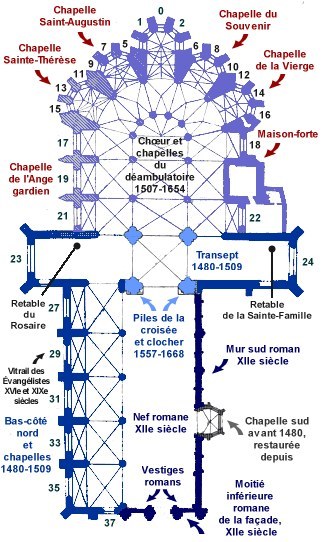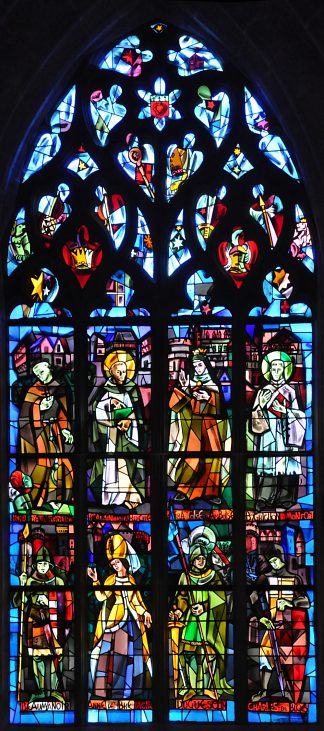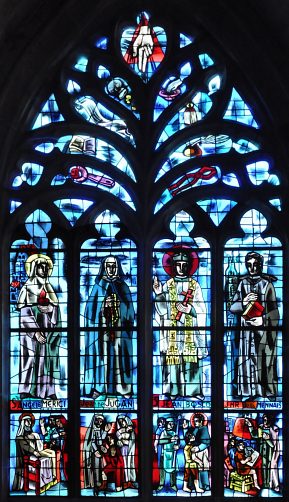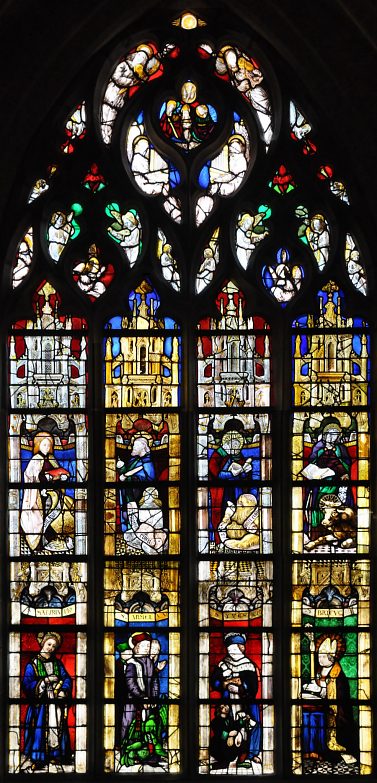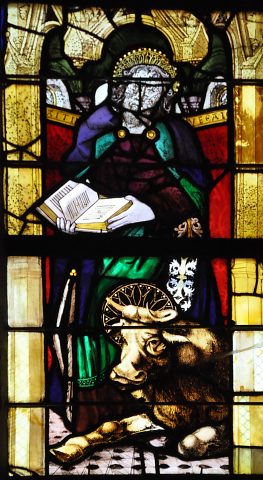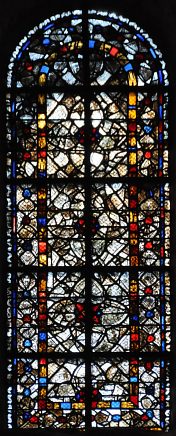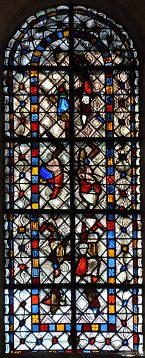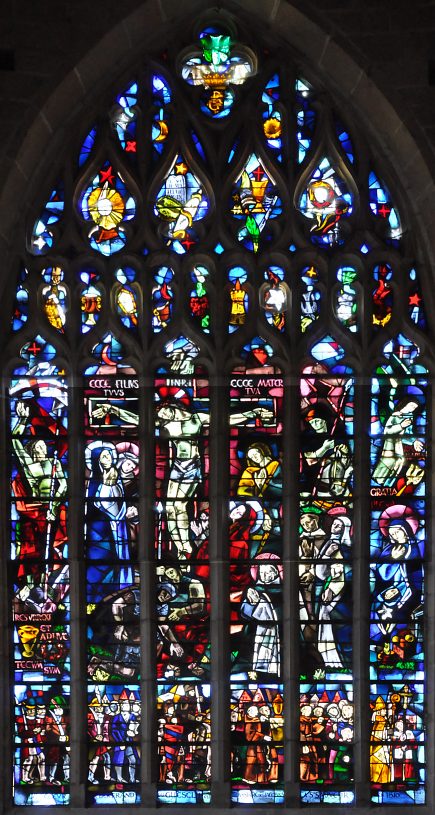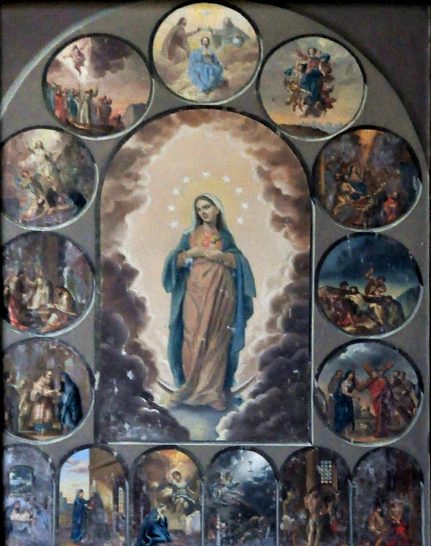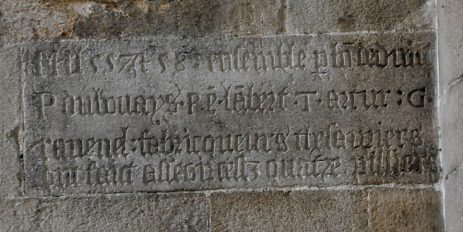|
|
 |
 |
Des deux églises de Dinan,
la basilique Saint-Sauveur est la plus vaste, la plus riche en ornements,
et pour partie la plus ancienne : la moitié
inférieure de la façade ouest est datée
du XIIe siècle, de style roman ; roman également l'élégant
mur méridional
de la nef que des circonstances,
jugées malheureuses à l'époque, ont transmis
jusqu'à nous.
On sait qu'une église romane a été édifiée
au début du XIIe siècle à l'emplacement précis
de l'actuel Saint-Sauveur. La tradition en attribue la construction
à un vœu de Rivallon le Roux, seigneur de Dinan,
à son retour de la première croisade. En conséquence,
il pourrait exister une influence byzantine dans la partie
romane de la façade (voir l'encadré).
Les historiens n'ont aucune certitude. Cette église romane
devait déjà être de bonne taille : une nef sans
bas-côté, avec un toit charpenté, un chœur
et des chapelles rayonnantes.
À partir de 1480, l'église fut transformée
en un édifice gothique plus vaste : nef
avec bas-côtés bordés de chapelles ; long transept
avec clocher ; chœur
à cinq chapelles rayonnantes. La paroisse de Saint-Sauveur
était riche au sein d'une ville prospère. Dinan
va, de plus, éviter les dommages lors de la guerre d'Indépendance
(1487-1491) en ouvrant ses portes, sans résister, à
l'armée de Charles VIII. Les travaux du gothique flamboyant
s'enchaînèrent alors dans un ordre
incertain : coté
nord de la nef ; façade
; puis, de 1507 à 1545, transept,
chœur,
clocher et
chapelles
rayonnantes.
En 1547, le clocher s'écroule, interrompant l'ordre prévu
des travaux. Conséquence indirecte ou pas : le mur
sud roman de la nef va subsister jusqu'à nos jours -
à la plus grande joie des amateurs d'art roman. Pendant les
guerres de Religion, l'église est saccagée, la plupart
des vitraux sont détruits. Lors de la Révolution,
l'église devient temple de la Raison, puis grange. Elle est
rendue au culte à la suite du Concordat.
En 1835, Prosper Mérimée, inspecteur général
des Monuments historiques, passe à Dinan
et inscrit l'église dans sa liste des monuments remarquables
de Bretagne (voir des extraits de son rapport plus
bas). L'édifice est restauré sous le Second Empire,
un nouveau tympan
vient orner la façade
occidentale. Saint-Sauveur a été classée
Monument historique en 1862 ; elle est proclamée basilique
en 1954.
Avec ses douze autels et ses retables, l'église Saint-Sauveur
possède beaucoup d'ornements, que ce soit à l'extérieur,
dans les chapelles du bas-côté nord ou dans les chapelles
rayonnantes du chevet. Ce dernier abrite des sculptures de style
gothique flamboyant. Et dans d'autres sculptures se lit le passage,
dans la première moitié du XVIe siècle, du
flamboyant au style Renaissance (clés
de voûte et crédences monumentales comme celle
de la chapelle rayonnante Sainte-Thérèse).
Enfin, une urne
rappelant le souvenir de Du Guesclin est visible dans le bras nord
du transept.
Vitraux anciens dans le bas-côté nord : la baie
29, dite des Évangélistes, possède une
rangée de panneaux datés du XVIe siècle et
restaurés au XIXe. Tous les autres vitraux historiés,
donnés dans leur intégralité ici, sont des
créations de l'atelier Louis Barillet, réalisées
autour des années 1940.
Cette première page présente l'extérieur de
la basilique, la nef
et le transept
; la page 2, le chœur,
les chapelles
des travées droites du déambulatoire et les chapelles
du rond-point.
|
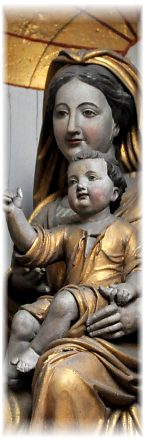 |

Vue d'ensemble de la basilique Saint-Sauveur.
Les deux chapelles Sainte-Barbe
et Saint-Éloi (que l'on voit de face) sont accolées
contre des piles de la croisée à plan barlong,
ce qui réduit fortement le passage de la nef vers le chœur
et produit un effet visuel assez malheureux. |
| ARCHITECTURE EXTÉRIEURE
DE LA BASILIQUE |
|

La basilique Saint-Sauveur vue depuis la Rance au XIXe siècle.
«Le Port de Dinan» de George Clarkson Stanfield (1828-1878).
Huile sur toile de 1871, musée
du château de Dinan. |

La nef et le clocher de la basilique vus depuis l'ouest.
La flèche bleue indique l'arcade creusée primitivement
dans le bras du transept pour bâtir un bas-côté
au sud à la place du mur roman. |

La basilique Saint-Sauveur et son chevet
en restauration en 2013.
|
|

Le chevet gothique de la basilique (début du XVIe siècle). |
|
Architecture
extérieure (1/4). Cette architecture
possède un aspect gothique et roman. À
l'ouest, la partie inférieure de façade,
datée du XIIe siècle, est romane. Elle
est présentée dans un encadré plus
bas. Est roman également toute la longère
sud de la nef. Quant à l'aspect gothique,
il transparaît dans l'élévation
nord de la nef, bâtie à partir de 1480,
et surtout dans le chevet, construit à partir
des années 1500.
Rappelons que si le mur sud est resté roman,
c'est parce que son remplacement, comme au nord, par
un mur gothique avec bas-côté (bordé
de chapelles?) a été abandonné
lors des travaux des XVe et XVIe siècles. La
preuve que ces travaux étaient prévus
est donnée par la présence d'une arcade
dans le bras sud-ouest du transept, visible à
l'extérieur (flèche dans la photo ci-contre)
et à l'intérieur (photo plus
bas).
La photo ci-dessus montre la partie basse du chevet,
élevé sur un ancien chevet roman. Correspondant
à cinq chapelles rayonnantes, elle offre une
forêt de contreforts striés de larmiers
et terminés par des épis ou des pinacles
arrondis. Les toits en pyramide sont, eux aussi, surmontés
d'un épi. Globalement, de bas en haut du chevet
et du sud vers le nord, le style Renaissance prend l'avantage
sur le style gothique. Dans son étude pour le
Congrès archéologique de 2015,
l'historienne Michèle Boccard écrit :
«(...) si des baies des chapelles rayonnantes
sud sont encore ornées de choux et de crochets
flamboyants, celles situées au nord voient apparaître
de nouveaux motifs (candélabres, visages, grappes
de fruits) d'une plus grande platitude, témoignant
de l'apparition du vocabulaire de la Renaissance sur
le chantier.» C'est la marque d'un changement
dans la direction du chantier, ajoute-t-elle, (un chantier
qui aura pris plusieurs décennies), mais pas
forcément la preuve d'une interruption des travaux
(qu'une nouvelle équipe aurait poursuivis plus
tard).
On remarque aussi que la base des toitures des chapelles
s'accompagne d'un garde-corps tantôt aveugle,
tantôt ajouré. Dans son aspect général,
le chevet de Saint-Sauveur est moins dense que celui
de
Saint-Malo. Cette sobriété est illustrée
dans la tourelle d'escalier menant aux combles (photo
plus
bas) et dont l'armortissement sommital est étrangement
surchargé d'ornements.
Il faut s'arrêter à présent sur
le mur roman méridional de la nef, en
photo ci-dessous. Avec la façade, c'est, au niveau
artistique, la pièce maîtresse de l'architecture
extérieure de la basilique. D'un aspect très
élégant, il présente six travées
et deux niveaux. Le niveau du bas est une suite de doubles
arcatures aveugles ; celui du haut, une succession «de
trois niches de section courbe dont les deux extrêmes
sont aveugles et celle du milieu percée d'une
fenêtre», écrit Louise-Marie Tillet
dans Bretagne romane (La Pierre-Qui-Vire, 1982)
où elle ne fait d'ailleurs que copier-coller
la description de René Couffon, en 1949, lors
du Congrès archéologique... Les
travées sont séparées par des contreforts-colonnes
surmontés d'un chapiteau en demi-cercle sculpté
d'animaux. Exception faite pour la troisième
travée qui est encadrée par des pilastres
à chapiteaux quadrangulaires eux aussi sculptés.
Un cordon fin et peu saillant sépare nettement
les deux niveaux, tandis qu'une puissante corniche à
modillons longe le sommet. Enthousiasmée par
l'élégance de ce mur et par cette série
d'arcs triples qui surmonte la série d'arcs doubles,
Florence Surel écrit en 1966 dans le Dictionnaire
des églises de France (Robert Laffont) :
«L'effet obtenu est saisissant ; la solution donnée
aux grandes surfaces de mur sans ouvertures est sans
équivalent en Bretagne et sa réussite
est totale.» ---»» Suite 2/4
|
|
|
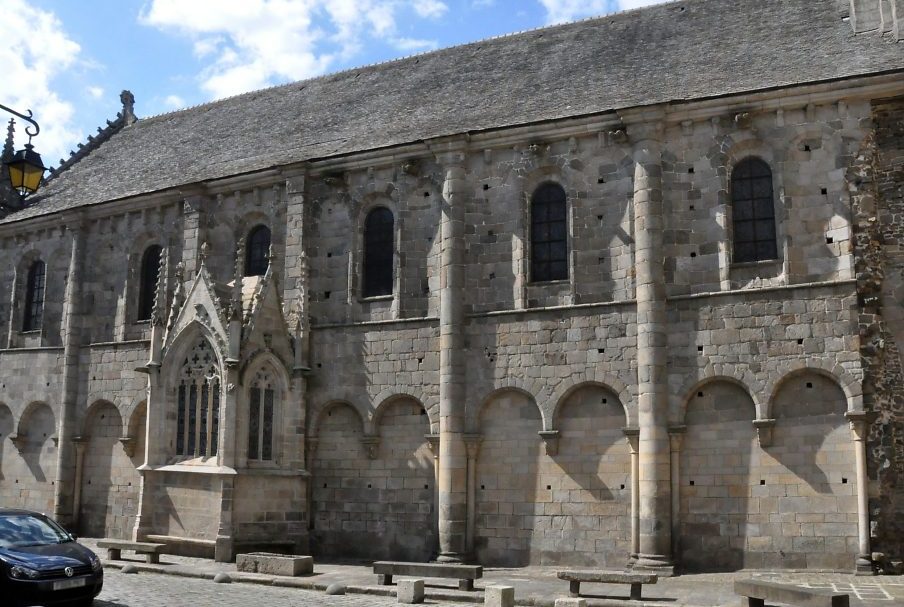
Avec la moitié inférieure de la façade, le côté
sud, de type roman, est la partie la plus ancienne de la basilique.
Cette longère romane, à six travées et deux niveaux,
est particulièrement harmonieuse. |
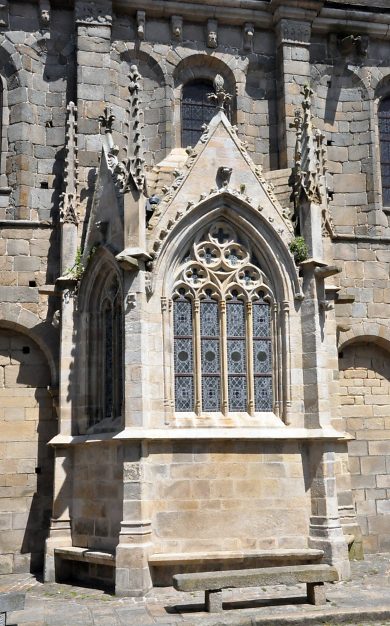
La chapelle se tient dans la troisième travée de la
longère sud. |

Modillons romans accolés à la corniche qui surplombe
la longère sud. |
|
Architecture
extérieure (2/4) : la chapelle sud.
---»» Dans la photo au-dessus,
on voit qu'à la troisième travée
est accolée, un peu comme un élément
rapporté, une petite chapelle qui a intrigué
les archéologues. Lors du Congrès archéologique
de 1949, René Couffon la signale en quelques
mots : cette travée «a été
remplacée au XVe siècle par une arcade
gothique donnant accès à une chapelle.»
Dans Bretagne gothique (Picard, 2010), Philippe
Bonnet et Jean-Jacques Rioult la mentionnent un peu
plus longuement : «[c'est] une construction parfaite
dans ses proportions et sa modénature, que ses
pignons à gâbles aigus, semblables à
ceux des chapelles rayonnantes du chœur de Saint-Malo,
situent autour de 1500.» Et ils concluent : «L'installation
de cette chapelle privée corrobore en fait l'abandon
du projet initial de collatéral sud.» Ce
qui signifie, pour les deux historiens, que la chapelle
a été bâtie une fois décidé
l'abandon du mur gothique sud, une décision que
l'année 1500 citée plus haut situerait
donc à la fin du XVe siècle. Précisons
tout de suite qu'aucun document ancien n'indique l'année
d'abandon de ce projet.
Lors du Congrès archéologique de
2015, Michèle Boccard s'empare de ce palpitant
problème et y consacre quarante lignes !
Notons en passant qu'il n'est pas rare qu'un bâtiment
médiéval place les historiens-archéologues
devant une énigme : quel est l'ordre de succession
des parties construites ? Ici, trois possibilités
se présentent : 1) la chapelle date d'avant les
travaux du gothique flambloyant ; 2) elle date de l'époque
des travaux et a été bâtie avant
l'abandon du mur sud ; 3) elle a été bâtie
après l'abandon du mur sud. La deuxième
possiblité doit être rejetée. Comme
le souligne Michèle Boccard, on n'imagine pas
la fabrique de Saint-Sauveur autoriser la construction
de cette chapelle sachant que le mur roman va disparaître
au profit d'un collatéral gothique bordé,
lui-même, de chapelles, à l'image du côté
nord. Il reste donc deux cas possibles, résumés
en une question : la chapelle a-t-elle été
construite avant 1480 (début des travaux du gothique)
ou après l'abandon de la construction du mur
sud gothique ? Et en complément : vers quelle
année cet abandon se situe-t-il ? Une énigme
passionnante. La vue de cette chapelle, tout éclatante
de blancheur dans la photo, et fortement restaurée,
fait pencher pour la seconde solution. Et pourtant !
Suivons Michèle Boccard. L'historienne observe
d'abord le réseau à trilobes et quadrilobes
des trois baies de la chapelle et les rapproche de ce
qu'on trouve à Dol
au XIIIe siècle et surtout à Tréguier
au XIVe. D'où un premier indice : la chapelle
daterait d'avant le quinzième siècle ou
du début. Ensuite, l'examen de l'architecture
intérieure de la chapelle et le profil de ses
ogives (voir la vue intérieure plus
bas) conduisent à rejeter la possibilité
d'une construction après l'abandon du collatéral
sud. En effet, le profil des moulures et des chapiteaux
est bien distinct de ce qui a été créé
dans le bas-côté nord. Il ne s'agit donc
pas de la même époque. ---»»
Suite 3/4
|
|
|

Contrairement aux autres, la TROISIÈME TRAVÉE du mur
sud est encadrée par deux pilastres surmontés de chapiteaux
quadrangulaires.
On y voit, à gauche, des animaux fantastiques ; à droite,
une suite d'arcades en plein cintre. |
|
Architecture
extérieure (3/4) : la chapelle sud. ---»»
Enfin, Michèle Boccard attire l'attention sur un autre
point, négligé jusque-là : si les travées
sont délimitées par des demi-colonnes, la troisième
travée (où se situe la chapelle) l'est, quant
à elle, par des pilastres. Et les chapiteaux qui les
coiffent sont quadrangulaires, contrairement à tous
les autres. Pilastres et chapiteaux «sont purement romans
et ne paraissent pas avoir été remployés»,
écrit l'historienne. Voir la photo plus
bas. Lors de la construction de l'édifice roman,
cette travée tenait donc un rôle particulier.
Recevait-elle un portail ? Ou déjà une
petite chapelle ? La seconde solution semble l'emporter
car on trouve, dans la chapelle, la trace de multiples restaurations.
De plus, dans sa monographie Dinan, mille ans d'histoire
paru en 1958, Mathurin-Eugène Monier écrit que
c'était la chapelle funéraire d'Henry Lefeuvre,
«bourgeois de Dinan» et qu'elle remontait à
la fin du XIVe siècle ou au début du XVe. Michèle
Boccard, qui donne cette information en note, signale que
l'auteur, malheureusement, ne cite aucune source.

Quel a été l'ordre de succession des travaux ?
L'étude minutieuse du bâti, l'observation des
maçonneries, les arguments développés
dans son article pour le Congrès archéologique
de 2015, le tout renforcé d'une bonne dose de logique,
conduisent Michèle Boccard à la proposition
suivante : construction de la petite chapelle
sud bien avant 1480 ; construction du bas-côté
nord à partir de 1480, réédification
de la façade
; construction du chœur
à partir de 1507 ; chapelles
rayonnantes et voûtes
du déambulatoire, de 1514 à 1545 ; puis,
élévation du transept,
de la tour et du clocher
(nef et chœur sont là pour contrebuter les poussées)
; enfin, dernière étape prévue, le bas-côté
sud de la nef.
Mais le clocher s'écroule en 1547, obligeant à
fermer la nef par une clôture. Le carré du transept
est reconstruit dix ans après, avec des fonds qui n'étaient
évidemment pas destinés à cette tâche.
Les guerres de Religion qui embrasent la seconde moitié
du XVIe siècle et saccagent l'église retardent
les travaux. Saint-Sauveur va héberger des réfugiés
et l'on doit couvrir provisoirement le chœur et le clocher.
La reconstruction de la tour ne commence qu'en 1605 et se
prolonge jusqu'en 1654. La charpente de la flèche est
achevée en 1667, tandis que celle du chœur avait
été posée dés 1646. En 1653, la
clôture qui séparait le chœur et la nef
est supprimée.
Dans cette succession proposée, l'élévation
du mur sud gothique est placée à la fin. Pourquoi
ne pas l'insérer juste après l'élévation
du mur nord comme la logique pourrait le faire penser ? Pour
Michèle Boccard, ce choix curieux pourrait s'expliquer
justement par la présence de la chapelle sud dont la
destruction ou le déplacement aurait été
retardé au maximum...
Ajoutons qu'au XVIIIe siècle, la foudre frappa le clocher
à plusieurs reprises. Et encore une fois en 1800, avec
un incendie qui l'endommagea sévèrement. Toute
la partie haute du clocher
fut refaite au début du XIXe.
Le manque de sources pose toujours des problèmes aux
archéologues et aux historiens, surtout quand il s'agit
de classer dans le bon ordre les travaux de construction et
de réédification d'un édifice religieux.
Un autre cas est proposé dans ce site avec l'église
Saint-Jacques
de Reims.
---»» Suite 4/4
|
|

La tourelle d'escalier menant aux combles est embellie d'un amortissement
gothique.
À noter, sur la droite, une originale colonnette torsadée.
|

Façade occidentale de la basilique. La partie basse,
romane, date du XIIe siècle. |
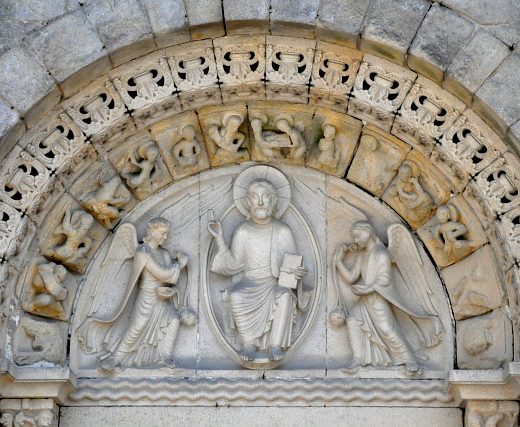
Le Christ servi par deux anges : ce tympan moderne date du Second
Empire. |
| DEUX VIEILLARDS
DE L'APOCALYPSE (XIIe siècle) |
|
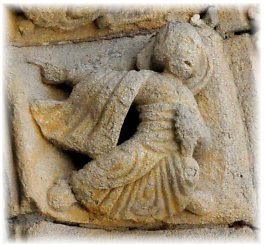 |
 |
|
|
Architecture
extérieure (4/4) : la façade romane.
Seule la moitié inférieure de la façade
occidentale est romane, datée du XIIe siècle.
Dans Bretagne gothique (Picard, 2010), Philippe Bonnet
et Jean- Jacques Rioult voient, dans cette façade hybride,
la conséquence directe de l'abandon du bas-côté
gothique, au sud de la nef, et du maintien du mur roman. Le
bas-côté nord et ses chapelles, élevés
à la fin du XVe siècle, diminuent la luminosité.
Sans l'équivalent au sud, il a fallu, selon nos deux
historiens, accroître la source de lumière venant
de l'ouest. D'où la réédification de
la partie supérieure de la façade avec mise
en place d'une grande baie à six lancettes.
Cette baie recevait-elle du verre blanc à l'origine ?
Ce choix de verre paraîtrait logique car, quelle que
soit sa taille, une baie dont le vitrail est couvert de pigments
colorés, n'éclaire plus grand-chose... On pourra
lire à ce sujet le problème de la forte pénombre
qui pénalise la grande église Saint-Vincent-de-Paul
à Paris (9e arr.).
Un doute demeure sur l'époque de cette réédification.
Si l'on rapproche les raisons avancées par Philippe
Bonnet et Jean-Jacques Rioult (réédification
car abandon du mur gothique au sud) de l'ordre
de succession des travaux proposé par Michèle
Boccard (Congrès archéologique, 2015),
il faut privilégier la seconde moitié du XVIe
siècle. De son côté, l'historienne, qui
n'aborde pas, dans son étude de 2015, le problème
de la luminosité de la nef, écrit que «la
partie supérieure de la façade ouest a été
entièrement modifiée à la fin du XVe
siècle». Cette datation, rattachée à
l'édification du mur nord, paraît plus réaliste.
Restons sur la luminosité. Selon l'article de Bretagne
gothique, c'est aussi pour l'améliorer que le bas-côté
nord se termine, à l'ouest, par une large baie à
quatre lancettes (photo donnée ci-contre). L'idée
est recevable. Remarquons que le réseau de cette baie,
à la fois original et rare, s'élève en
éventail comme des feuilles de palme. Michèle
Boccard mentionne que ce motif se retrouve à l'abside
de l'église Notre-Dame de Guingamp dès 1484.
Le Second Empire réalisa une restauration de la partie
romane de Saint-Sauveur : nouveau tympan
sculpté représentant le Christ servi par deux
anges ; voussures refaites ainsi que bon nombre de chapiteaux
et de bases de colonnes.
Abstraction faite de ces restaurations, la partie
romane de la façade reçoit trois arcades
en plein cintre de taille égale. Au nord et au sud,
l'archivolte est nue, de même que le tympan. La multiplication
des colonnes à chapiteaux donne un aspect très
vivant à cet ensemble. Le cintre principal est orné,
à droite et à gauche, de deux belles rondes-bosses
: le bœuf
(ailé) de saint Luc et le lion (ailé) de saint
Marc.
L'aspect général de la façade romane
et de la longère sud «ont fait généralement
attribuer l'édifice primitif de Saint-Sauveur à
un architecte poitevin», écrit René Couffin
en 1949 pour le Congrès archéologique.
Il est à noter que les quatre statues (des Évangélistes?),
dans les arcades latérales, reposent sur des lions.
La présence de ces sculptures en haut-relief, ajoutée
aux dais qui coiffent les statues ou encore aux motifs de
la seconde voussure de l'archivolte centrale, ont fait croire,
écrit Michèle Boccard, à une influence
orientale, en l'occurrence byzantine. D'où l'hypothèse
d'une fondation de l'église romane au retour de la
première croisade, peut-être vers 1120.
En 1982, dans Bretagne romane (La Pierre-Qui-Vire),
Louise-Marie Tillet, du Centre International d'Études
Romanes, s'exprimait déjà, à ce sujet,
au conditionnel : «Si la tradition, qui fait remonter
la fondation de Saint-Sauveur à Riwallon [seigneur
de Dinan] à son retour de la croisade, écrit-elle,
était confirmée, on pourrait admettre que cette
église ait été édifiée,
sinon par un architecte venu d'Orient, du moins à partir
de croquis rapportés par Riwallon lui-même ou
par quelqu'un de son entourage, comme le suggèrent
plusieurs auteurs.»
En 2015, Michèle Boccard souligne que l'idée
d'une influence orientale a été relancée
par René Couffon en 1949 dans son étude sur
Saint-Sauveur lors du Congrès archéologique.
En fait, dans cette étude, René Couffon fait
mention de l'un de ses anciens écrits de 1938 (où
il analyse l'influence orientale en Bretagne dans le cadre
des pèlerinages des Bretons à Rome du VIe au
XIIIe siècle) et donne la paternité de cette
idée d'influence orientale dans la façade de
la basilique à l'architecte et historien de l'art Victor
Ruprich-Robert (1820-1887). Mais, à lire René
Couffon, Ruprich-Robert ne fait que suggérer une alternative
: soit Saint-Sauveur a été édifiée
par un architecte venu d'Orient, soit «plus vraisemblablement,
d'après des croquis rapportés d'Orient, peut-être
même par Riwallon de Dinan ou par son entourage»
[Couffon]. Bref, tout le monde se contente de suppositions.
Quoi qu'il en soit, Michèle Boccard s'en tient, pour
l'essentiel, au cadre français. La façade, telle
qu'elle la conçoit au complet, rejoint les styles pratiqués
communément en Poitou et en Saintonge vers le milieu
du XIIe siècle. On peut la rapprocher notamment de
celles de Notre-Dame-la-Grande
à Poitiers,
de Saint-Nicolas à Civray et de Saint-Pierre à
Aulnay. «La conception architecturale de l'église
romane, écrit l'historienne en 2015, doit sans doute
plus à la présence d'artisans saintongeais ou
poitevins à Dinan
qu'à celle d'un hypothétique maître d'œuvre
venu de Byzance ou de Terre Sainte.»
En fait, l'iconographie de la partie romane de la façade
suit tout simplement la tradition de l'époque : vieillards
de l'Apocalypse ; travaux des mois ; Adoration des mages
; symboles des Évangélistes, etc. Néanmoins,
concède Michèle Boccard, une influence orientale
indirecte est admissible par le biais de motifs décoratifs
: ceux-ci pouvaient aisément circuler via des tissus
ou des carnets de modèles. Ce qui rejoint l'idée
des croquis véhiculés par un proche de Riwallon,
telle qu'elle est suggérée par Louise-Marie
Tillet et Victor Ruprich-Robert.
Sources : 1) Congrès
archéologique, 1949, article de René Couffon
; 2) Congrès archéologique, 2015, article
de Michèle Boccard ; 3) Bretagne gothique de
Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult, 2010 ; 4) Bretagne
romane, La Pierre-Qui-Vire, 1982.
|
|

Le premier niveau de la façade occidentale de la basilique
date de l'époque romane (XIIe siècle).
La présence de lions sous les pieds des statues a fait penser
à une possible influence orientale dans l'élaboration
de cette façade. |

Archivolte romane du portail central, détail.
On reconnaît les vieillards de l'Apocalypse. |

Chapiteaux romans (en partie refaits au XIXe siècle)
sur la façade occidentale. |

Chapiteau roman : un monstre
dévorant un homme. |

Chapiteau roman : le châtiment des vices. |
|
|
Mérimée
et la façade romane de Saint-Sauveur.
Dans ses Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France
(1835), Mérimée écrit à
propos de la façade : «Malgré la
mauvaise qualité des matériaux, la façade
de l'ancienne cathédrale de Dinant [sic], Saint-Sauveur,
couverte de bas-reliefs, produit, à distance,
un effet assez imposant, mais qui diminue à mesure
que l'on s'approche. Cette façade est romane
et je la crois de la fin du douzième siècle.
Il faut en excepter un fronton, maladroitement ajouté
au-dessus du portail, et percé d'une grande fenêtre
flamboyante. Le portail et le mur méridional
de la nef, voilà tout ce qui reste de la construction
primitive. Le reste de l'église est du quinzième
siècle, d'un style mesquin et sans grâce.»
Il poursuit plus loin : «On doit remarquer comme
un fait assez rare dans l'époque romane, les
dais au-dessus des saints. Sous le rapport de la composition,
deux de ces dais présentent le motif ordinaire
des dais gothiques, une chapelle plus ou moins ornée
suspendue au-dessus d'une statue. Les deux autres ne
sont que des petites pyramides avec des bas-reliefs
sur leurs faces.»
Source : Notes d'un
voyage dans l'Ouest de la France par Prosper Mérimée,
Paris, Librairie de Fournier, 1836.
|
|

Chapiteaux romans sur la façade occidentale. |
|

Ornementation romane
dans l'archivolte du portail central, détail. |
|
Le
granit en Bretagne. En 1835, lors de son
passage à Dinan,
Prosper Mérimée, inspecteur général
des Monuments historiques, se montrait assez négatif
sur cette pierre. Il écrivait : «L'espèce
de granit employée dans toutes les constructions
est, par sa nature, impropre à recevoir une ornementation
soignée. C'est une pâte peu compacte, renfermant
un sable très dur ; le ciseau l'égrène
au lieu de la couper.»
Dans sa description de la façade de Saint-Sauveur,
Mérimée ne se méprend pas sur l'origine
romane des sculptures de granit malgré une érosion
qui pourrait tromper : «Si l'on considère
de plus près ces colonnes torses, écrit-il,
ces chapiteaux historiés, ces figurines répandues
avec profusion, il est impossible de ne pas reconnaître
le style roman fleuri dans son entier développement.
Si l'architecte eût eu d'autres matériaux
à sa disposition, sans doute il eût mieux
fait, et le fini du travail eût ôté
à son œuvre ce caractère de rudesse
que l'on prend d'abord pour un indice d'antiquité.»
En 1931, dans l'Art breton, l'historien Henri
Waquet prend la défense des artisans de la pierre
qui ne changent pas souvent de style : «Qu'on
ne se presse pas de crier à l'ignorance ni même
à la routine ; la nature si rétive du
granit ne permettait pas aux ouvriers [bretons] de passer
aisément d'une mode à une autre ; volontiers
ils s'en tenaient à ce qu'ils avaient toujours
vu faire et qui, très souvent, leur plaisait.»
La fameuse règle du retard de cent ans qui frapperait
l'art breton n'est pour Henri Waquet qu'un leurre. Dans
ce prétendu retard, écrit-il, «la
part de la volonté ou, si l'on veut, du génie
personnel est très grande : manifestation plastique
d'un vieil esprit d'indépendance ; la Bretagne
n'est pas "snob".»
Sources : 1) Notes d'un
voyage dans l'Ouest de la France par Prosper Mérimée,
Paris, Librairie de Fournier, 1836 ; 2) L'Art breton
d'Henri Waquet, éd. Arthaud, 1931.
|
|
|

Le portail sud de la façade occidentale.
La présence des lions, sous les pieds des statues, a fait penser
à une influence orientale. |

Chapiteau roman : un homme tenu par deux démons. |

Chapiteau roman : le châtiment des vices. |

Le bœuf de saint Luc
dans un écoinçon de la façade.
L'autre écoinçon accueille le lion de Marc.
Art roman, XIIe siècle. |

Chapiteau roman : le châtiment des vices. |
|
|

Partie haute du portail nord de la façade. |
| LA NEF DE LA BASILIQUE
SAINT-SAUVEUR - LE CÔTÉ NORD GOTHIQUE |
|

L'élévation nord de la nef, de style gothique, date
du début des années 1480. |
|
Architecture
intérieure : le mur gothique nord et les chapelles.
C'est par le nord de la nef que démarre le chantier
de l'époque flamboyante (début des années
1480). Avec ses dix mètres de large, l'église
est trop petite. Le mur nord roman, dont on ignore l'aspect,
est donc abattu pour être remplacé par un bas-côté
voûté d'ogives (alors que la nef est lambrissée),
bordé de chapelles latérales peu profondes.
Des deux côtés du collatéral, les grandes
arcades en tiers-point retombent en pénétration
dans des piles circulaires qui n'ont ni base ni socle. Les
grandes baies à quatre lancettes et à réseau
flamboyant sont seules à éclairer la nef depuis
le nord.
Le profil à deux rouleaux des arcades est exactement
semblable à celui des arcades du chœur de Saint-Malo
dont le chantier a démarré en 1489.
Enfin, l'historienne Michèle Boccard note la présence,
dans une travée du bas-côté et dans la
chapelle attenante, d'une clé de voûte portant
les armes de Jean Lespervier, évêque de Saint-Malo
de 1450 à 1486, date de sa mort. Elle en déduit
logiquement que le chantier de Saint-Sauveur a précédé
la reconstruction du chœur de Saint-Malo
et qu'il lui a servi de modèle. Source : Congrès
archéologique de France, tenu dans les Côtes-d'Armor
en 2015, article sur Saint-Sauveur par Michèle Boccard.
|
|
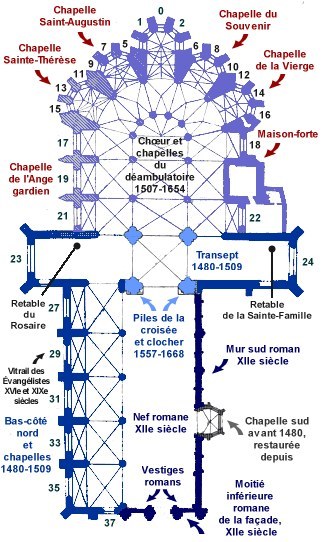
PLAN de la basilique.
Les numéros sont ceux des baies avec leurs vitraux. |
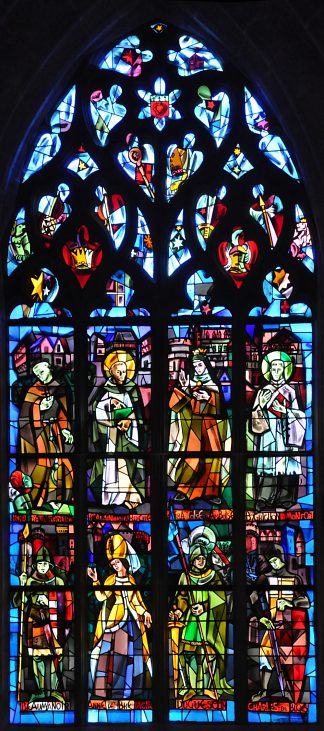
Baie 33 : Vitrail des personnages historiques bretons. |
|

Suite de chapelles latérales dans le bas-côté
nord et voûte d'ogives du collatéral. |

Saint Roch et son chien
Tableau du XVIIe siècle.
Chapelle latérale nord Saint-Roch. |

«Saint Mathurin», tableau d'un peintre anonyme
dans la chapelle Saint-Mathurin. |
|
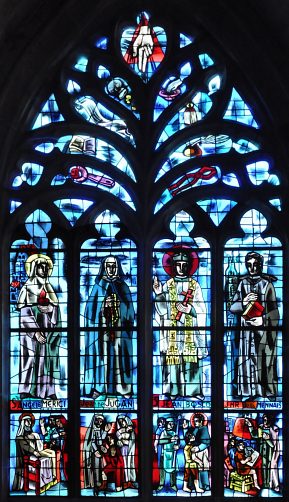
Baie 37 : Vitrail des Quatre Saints Bretons.
Première moitié du XXe siècle. |

Cuve baptismale romane en pierre, XIIe siècle.
Elle porte quatre cariatides aux robes plissées.
Les têtes ont malheureusement disparu.
Certaines sources présentent cette cuve comme un
bénétier. |
|
|

Suite de chapelles dans le bas-côté nord.
Toutes les voûtes sont ogivales.
Les retables remontent en général au XVIIIe siècle. |

Baie 33 : Vitrail des personnages
historiques bretons.
Détail : Anne de Bretagne. |
|
Baie 31 ---»»»
Vitrail des trois Saints
Œuvre signée :
L. Barillet
J. Le Chevallier
Th. Hanssen.
Atelier Louis Barillet, vers 1940.
|
|
|
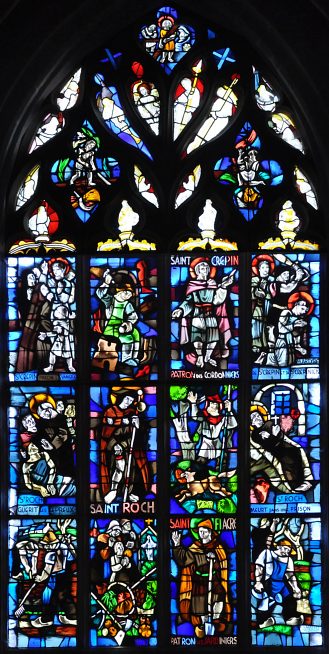 |
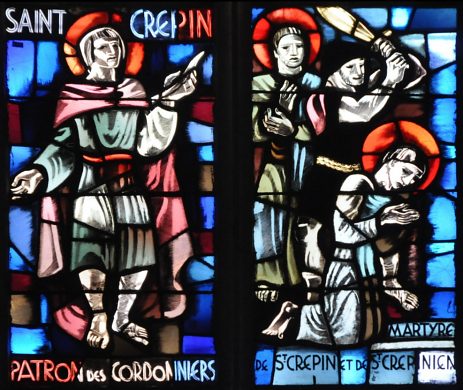
Baie 27, détail : Le Martyre de Crépin et Crétinien. |
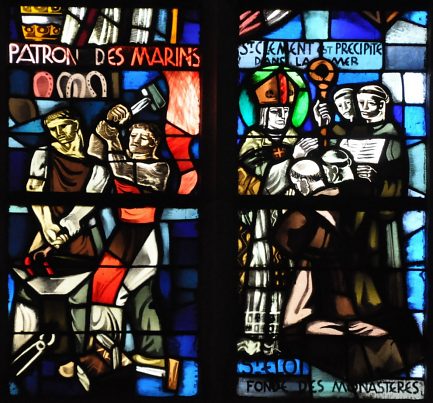
Baie 31, détail : Saint Clément et saint Éloi. |
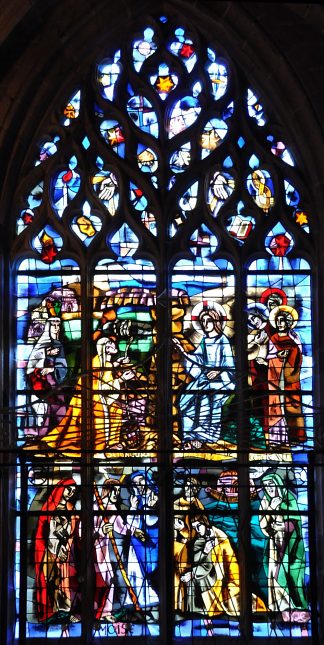
|

La chapelle Saint-Roch dans le bas-côté nord. |

Baie 33, détail : Du Guesclin. |
|
«««--- Baie
35 : Vitrail du baptistère (deux scènes
avec Jésus et Moïse).
|
|
|

«La Vierge et l'Enfant»
Tableau anonyme dans la chapelle Saint-Clément. |
|
Baie
29 (1/2).
Située dans le bas-côté
nord, elle reçoit le seul vitrail de la basilique
qui compte d'importants fragments d'époque Renaissance.
La présence de hauts dais dans le registre supérieur
(photo ci-contre à droite) montre aisément
que le vitrail est du XVe siècle, en l'occurrence
les années 1480-1490.
La totalité du registre inférieur a été
refaite au XIXe siècle (1853?) d'après
les modèles donnés par l'architecte et
dessinateur Pierre Hawke. On trouve ainsi de gauche
à droite : saint Mathurin, saint Armel, saint
Yves et saint Brieuc. Saint Armel est accompagné
du dragon qui, selon la légende, hantait la forêt
du Theil-de-Bretagne et qui périt en se précipitant,
sur l'ordre du saint, dans les eaux de la Seiche.
Le registre supérieur affiche les quatre évangélistes,
mais les panneaux ont subi des restaurations. De gauche
à droite : saint Jean dont la tête a été
refaite ; saint Matthieu (assez bien conservé,
mais le dais est moderne) ; saint Marc lisant avec des
besicles
et dont le lion est moderne ; enfin saint Luc avec un
panneau inférieur refait au XIXe siècle.
---»» Suite 2/2
|
|

Baie 29, détail : saint Jean l'Évangéliste
et son aigle.
Vers 1480-1490.
La tête a été refaite au XIXe siècle. |

Baie 29, détail : saint Matthieu et l'Ange
Vers 1480-1490.
Panneaux assez bien conservés. |
|
|
Baie
29 (2/2). ---»»
Les anges du tympan sont en partie refaits, notamment
les têtes. Le soufflet central accueille un Couronnement
de la Vierge, donné plus bas, qui est très
restauré.
Le Corpus Vitrearum consacré aux vitraux
de Bretagne écrit que le vitrail a été
déposé en 1942 parce qu'un terrain d'aviation
(susceptible d'être bombardé) se trouvait
à proximité. Sans plus d'information,
le Corpus précise que la mesure a été
«salutaire».
Source : «Les vitraux
de Bretagne», Corpus Vitrearum, Presses
universitaires de Rennes, 2005.
|
|

Baie 29, détail du tympan : le Couronnement de
la Vierge.
Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |

Baie 29, détail : saint Marc et ses besicles
Vers 1480-1490. |
|
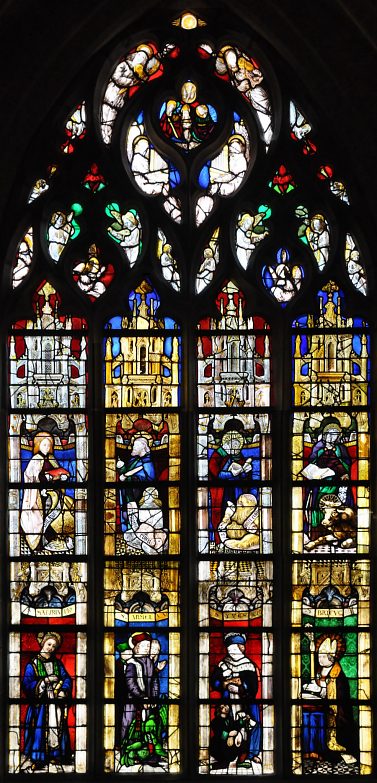
Baie 29 : Les Évangélistes
Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |

Baie 29, détail du tympan :
un ange musicien
Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |
 |
|

Baie 29, détail : saint Marc et son lion
Vers 1480-1490 et XIXe siècle.
«««---
Baie 29, détail : saint Armel
XIXe siècle.

Le saint est accompagné du dragon
qui hantait la forêt du Theil-de-Bretagne
et qui se précipita, sur l'ordre du saint,
dans les eaux de la Seiche.
(Bernard Rio, Le Livre des Saints Bretons). |
|
|
Les
besicles de saint Marc. Il est rare de voir
des lunettes sur le nez d'un personnage peint dans un
vitrail de l'époque Renaissance. C'est le cas
ici de saint Marc dans la verrière des Évangélistes,
une verrière dont les éléments
les plus anciens sont datés des années
1480-1490. Le saint y apparaît absorbé
dans sa lecture. Le Corpus Vitrearum consacré
aux vitraux de Bretagne souligne, comme on peut le constater
à gauche, que la tête de saint Marc (non
restaurée) est barrée de plombs de casse
et qu'elle est très corrodée.
Ce site propose d'autres vitraux Renaissance intégrant
des personnages avec des besicles. C'est le cas dans
deux Dormitions : église Notre-Dame
à Villeneuve-sur-Yonne et église Notre-Dame
à Alençon. D'autre part, saint Materne
est peint avec des besicles à la main dans un
vitrail, daté de 1510, de la grande église
Saint-Nicolas
à Saint-Nicolas-de-Port.
|
|
|
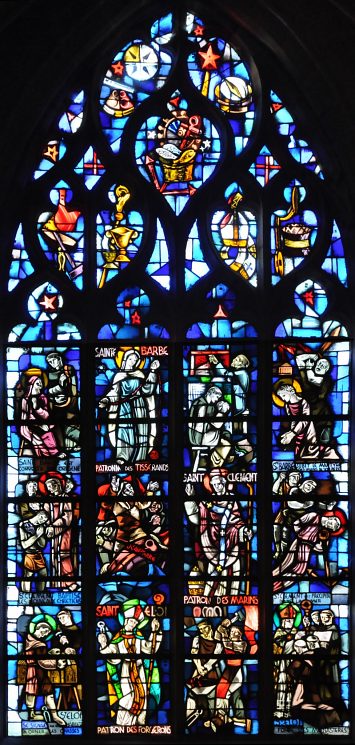
Baie 27 : Vitrail des Artisans.
Atelier Louis Barillet,
Années 1940. |
|
Mérimée
en Bretagne (1/3).
En 1830, l'État français crée
la Commission des monuments historiques, un peu pour
emboîter le pas aux sociétés et
commissions lancées en Normandie, sur un plan
privé, par le très actif Arcisse de Caumont
(1801-1873). Ludovic Vitet est le premier inspecteur
général de cette Commission rattachée
au Ministère de l'Intérieur, remplacé
à ce poste dès 1834 par Prosper Mérimée
(1803-1870), Vitet en devenant le président.
Le nouvel inspecteur, qui aime bien voyager contrairement
à son prédécesseur, parcourt l'Ouest
de la France dès 1835. Sa priorité est
la Bretagne. Il justifie son choix dans son rapport
final : la Bretagne, écrit-il, est une province
où l'on s'est trop longtemps focalisé
sur les pierres celtiques ou druidiques
[les menhirs] en négligeant les monuments médiévaux.
Mérimée part de Chartres,
va au Mans et rentre en Bretagne par Vitré.
Il parcourt ensuite toute la côte et termine à
Nantes. Enfin, il revient à Paris en faisant
un crochet rapide par l'Anjou et le Poitou. Dans son
périple, l'écrivain privilégie
les villes et les édifices qui lui paraissent
les plus importants.
En 1838, il adresse son rapport au ministre de l'Intérieur
avec une liste de monuments dont la sauvegarde lui semble
prioritaire. Plus de la moitié de ces monuments
sont des édifices religieux du Moyen Âge.
Il ne faut pas croire que Mérimée était
engoncé dans une foi chrétienne qui l'aurait
porté aveuglément vers les églises
et les abbayes : l'auteur de Carmen était athée
et ne voyait dans une église, selon son propre
aveu, que de l'architecture et de l'art ! Le contexte
était simple : l'État lui avait confié
une mission qui lui paraissait indispensable et il l'accomplissait
avec sérieux.
---»» Suite 2/3
ci-dessous.
|
|
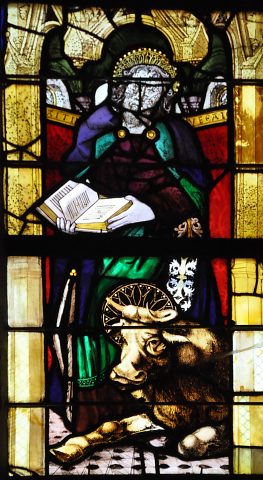
Baie 29, détail : saint Luc et son taureau.
Vers 1480-1490 et XIXe siècle. |
|
Mérimée
en Bretagne (2/3).
---»» Quand il visita les Côtes-du-Nord,
Mérimée bénéficia de l'aide
d'un érudit local réputé, le juge
Habasque, qui accompagna l'écrivain «dans
les environs de la ville» [il doit s'agir de Saint-Brieuc].
Cette aide fut-elle utile? Probablement pas car cet
érudit se montre très négatif sur
les monuments de son département et sur... l'apathie
de sa population.
Qu'on en juge. Dans l'enquête nationale lancée
en 1837 par le ministère de l'Intérieur
auprès des préfets pour connaître
- selon leur opinion - les monuments historiques de
leur département, le préfet des Côtes-du-Nord
eut l'occasion de contacter le juge Habasque. Citons
la réponse du magistrat telle qu'elle est rapportée
par Manuelle Aquilina dans les Annales de Bretagne
et des Pays de l'Ouest, année 2007 : «Le
département des Côtes-du-Nord, écrit
le juge, ne possède que bien peu de monuments
historiques. À part quelques abbayes [...] les
ruines de quelques maisons fortes [...] je ne vois guère
de monuments historiques dans le département,
autre que la chapelle des Beaumanoir à Dinan,
le monument de Lanleff et le château de Tonquédec
qui méritent quelque attention.» En fait,
Lanleff était déjà «protégé»
et les autres étaient entre les mains de particuliers
si bien, comme le confesse Habasque, que la bonne volonté
du ministre, dans les Côtes-du-Nord, serait quasiment
sans effet... Il ne faut pas voir là de l'indifférence
envers l'enquête ministérielle. Le juge
Habasque, membre de plusieurs sociétés
savantes, a en effet déjà publié
un ouvrage sur le littoral des Côtes-du-Nord.
C'est un passionné... désabusé.
Un fataliste, écrit Manuelle Aquilina. ---»»
Suite 3/3
ci-dessous.
|
|
|
|
Mérimée
en Bretagne (3/3).
---»» En 1835 déjà, consulté
pour la création d'une société de conservation
du patrimoine de la Bretagne, il avait répondu au préfet
(texte toujours cité par Manuelle Aquilina) : «On
est très apathique dans les Côtes-du-Nord, peu
soucieux de se livrer aux travaux de l'intelligence [...]
On regarde donc comme peu digne d'attention une société
archéologique qui ne présentera d'autre avantage
que de concourir avec l'administration à défendre
de vieux monuments dont on se rit.» Un beau pessimisme
!
Le problème ne doit pas être pris à la
légère. L'État français attendait
de ses préfets une information fiable, indispensable,
appuyée par une réelle impulsion locale. Les
principes de la sauvegarde du patrimoine prenaient vie : le
ministère voulait sélectionner des sites, contacter
les mairies et proposer une aide financière pour les
restaurations. Il fallait s'activer face à la Société
Française d'Archéologie créée
par Arcisse de Caumont en 1834... Mais que faire devant une
pareille apathie ? On mesure dès lors l'étendue
de la tâche qui attend l'inspecteur général
Prosper Mérimée au cours de son périple
à travers la France dans la décennie 1840.
Un bon exemple de barrière locale qu'il devra surmonter
est donné, lors de son déplacement à
Saintes
en 1844, par le problème de la sauvegarde de l'arc
de Germanicus.
Source : Annales de Bretagne
et des Pays de l'Ouest, juin
2007, article de Manuelle Aquilina : «Une question d'art
et de sentiment», Les préfets face au patrimoine
des départements en 1837.
|
|
|

Baie 27 : Vitrail des Artisans, détail. |
| LA NEF DE LA BASILIQUE
SAINT-SAUVEUR - PARTIE INTÉRIEURE ROMANE DE LA FAÇADE
OCCIDENTALE |
|

L'élévation sud de la nef vue depuis le dessous de la
tribune d'orgue. |

Art roman : deux dromadaires aux têtes affrontées (XIIe
siècle). |
|
|

Art roman : Sculptures de femmes sous un entablement. |
 |
|
| LA NEF DE LA BASILIQUE
SAINT-SAUVEUR - LE MUR MÉRIDIONAL ROMAN |
|

Le bas-côté sud de la nef remonte à l'époque
romane (XIIe siècle). |
|
Architecture
intérieure : le mur méridional roman.
Ce mur est l'une des richesses de la basilique.
On ignore la raison qui a conduit à sa non-destruction
au XVe siècle ou au début du XVIe, mais
on sait, par la présence d'une arcade dans le
bras sud du transept, qu'il était prévu
de le démolir (voir la flèche plus
bas pour le côté intérieur et
une autre plus
haut pour le côté extérieur).
Un collatéral bordé de chapelles, comme
au nord, l'aurait vraisemblablement remplacé.
Deux choses se remarquent d'emblée. C'est d'abord
l'épaisseur de ce mur, très visible au-niveau
des fenêtres, une épaisseur que l'on qualifiera
de «moyenne» pour un mur roman : il doit
assurer le soutien d'une voûte en berceau lambrissée
qui n'exerce pas autant de pression sur les murs qu'un
toit de pierre. C'est ensuite la petitesse des fenêtres
- typiquement romanes - qui ne suffit pas à éclairer
un lieu aussi vaste. Si l'on retirait les lumières
artificielles, le côté sud de la nef serait
plongé dans une pénombre totale, un peu
comme l'intérieur de l'église
romane de Talant, au nord de Dijon.
Une photo
plus bas donne une idée de la luminosité
générale de la nef de Saint-Sauveur.
Au niveau architectural, le mur se présente en
deux registres horizontaux séparés par
un cordon torique : en bas, une suite d'arcatures aveugles
doubles, assez sobre, relevée, en son centre,
d'une chaire à prêcher en pierre ; en haut,
une suite d'arcatures très élégantes
alternativement aveugles et ajourées. Les archivoltes
des baies comportent deux rouleaux tandis que les arcatures
aveugles n'en ont qu'un seul.
Source : Bretagne romane,
Zodiaque, La Pierre-qui-Vire, 1982.
|
|

Statue de sainte Barbe
Autel Sainte-Barbe dans la nef. |

Statue de saint Éloi
Autel Saint-Éloi dans la nef. |

«Saint Éloi en évêque»
Tableau peint par Loyer en 1817
Autel Saint-Éloi. |
|
|
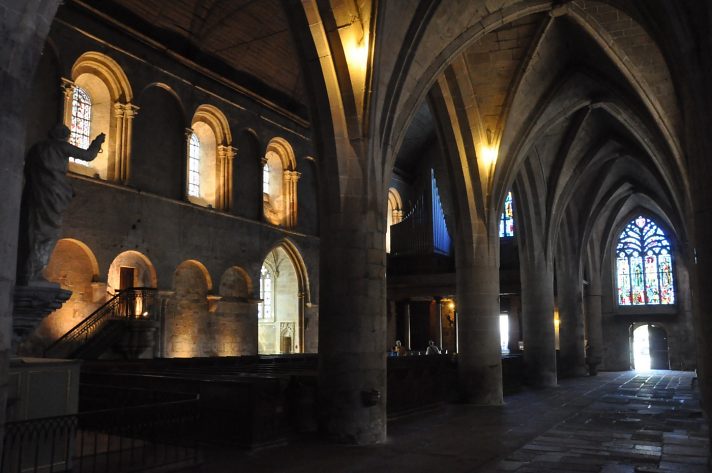
Le mur roman au sud et le bas-côté gothique, voûté
d'ogives, au nord. |

Saint Pierre par Casini.
Casini est un sculpteur de Dinan.
Autel Sainte-Barbe. |
| LE TRANSEPT DE
LA BASILIQUE SAINT-SAUVEUR, SES RETABLES ET SES VERRIÈRES |
|
 |

Saint Fiacre, XIXe siècle
dans le transept.
«««-- Le bas-côté nord et
l'entrée dans le déambulatoire. |
|
Le
transept, sa voûte, ses retables et ses verrières.
La croisée est délimitée
par quatre fortes piles reconstruites après l'effondrement
de la tour en 1547 (voir plus
bas). Celles qui jouxtent la nef sont à plan
barlong pour abriter les chapelles Sainte-Barbe
et Saint-Éloi. Sur la photo de droite, on voit
que les doubleaux, sous le clocher, sont bandés
en pénétration directe et que les branches
d'ogives de la voûte en bois aboutissent à
une lunette.
Dans l'ouvrage Bretagne gothique, Philippe Bonnet
et Jean-Jacques Rioult apportent, en 2010, une information
technique sur ce transept : «Il n'est pas voûté,
écrivent-ils, [ce qui n'est pas exact pour la
croisée] mais simplement couvert d'une puissante
charpente lambrissée dont les entraits sont assemblés
dans un corps de sablières et d'entretoises moulurées
qui forme plan d'enrayure au sommet des murs gouttereaux.
Cette charpente, résolument gothique malgré
sa date d'exécution tardive de 1646, a permis
d'évider au maximum les murs pignons et d'y percer
de larges et hautes baies qui diffusent la lumière
en direction de la croisée.»
Un des points intéressants du transept est l'existence
d'une grande arcade dans le bras sud : il était
bel et bien prévu de remplacer le mur sud roman
par un bas-côté gothique comme au nord,
et le percement avait déjà été
fait (flèche bleue). Sans doute murée
dans un premier temps par des moellons, cette arcade
est restée en l'état quand le projet de
bas-côté a été abandonné.
Le transept abrite deux grands retables (Rosaire
et Sainte-Famille)
ainsi que deux larges verrières à six
lancettes. On y voit deux créations de l'atelier
Barillet dans les années 1940 : la Crucifixion
(donnée ci-dessous) et la Victoire
de Constantin en 312 contre Maxence.
La photo ci-dessus montre un important décalage
entre le bas-côté nord et le déambulatoire
puisqu'une partie non négligeable du retable
du Rosaire se trouve dans le prolongement du bas-côté.
Bref, les deux couloirs ne sont pas alignés.
Il ne faut y voir aucune aberration dans le plan. Sans
doute est-ce là la conséquence d'une décision
de la fabrique de Saint-Sauveur qui voulait un bas-côté
assez large. Et les architectes du XVe siècle
ont dû se résoudre à ce décalage.
Sources : 1) Bretagne
gothique de Philippe Bonnet et Jean-Jacques Rioult,
éditions Picard, 2010 ; Congrès archéologique
de France tenu à Saint-Brieuc en 1949, article
sur l'église Saint-Sauveur de René Couffon.
|
|
|

Le transept vu depuis le croisillon sud.
Ce croisillon porte la trace d'un percement (flèche bleue)
réalisé pour
construire un bas-côté gothique sur le côté
sud de Saint-Sauveur. |

Baie 23 : la Crucifixion, détail. |
|
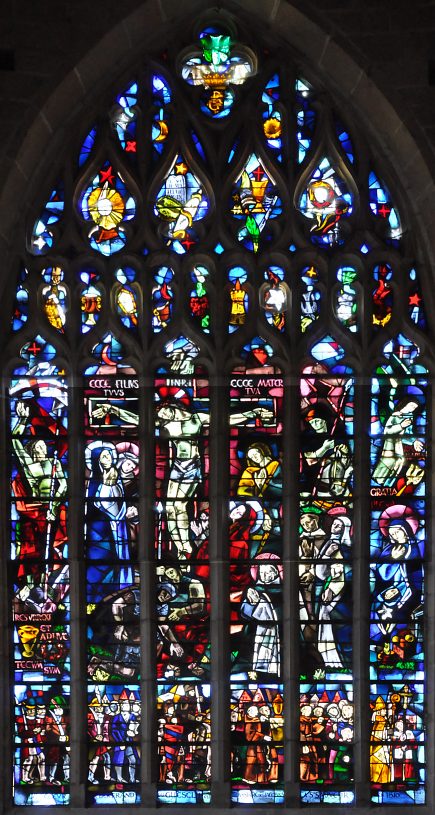
Baie 23 : la Crucifixion.
Vitrail signé : L. Barillet, J. Le Chevallier, Th. Hanssen.
Atelier Louis Barillet, 1940. |

Le retable du Rosaire dans le croisillon nord du transept.
L'urne contenant le cœur de Du Guesclin se trouve sur la
colonne quadrangulaire à gauche. |
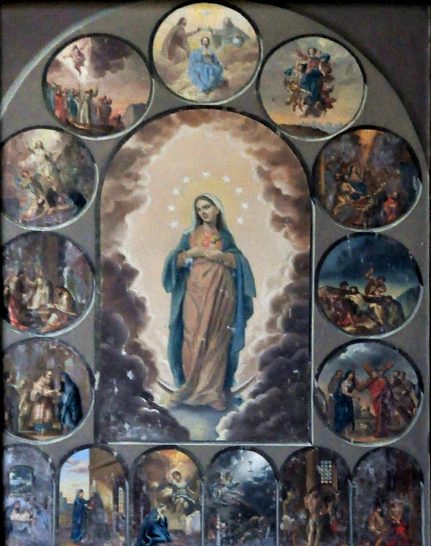
Tableau de la Vierge et de ses mystères dans le retable
du Rosaire. |
|

Statue de saint Gilles
XVIIIe siècle
Transept. |

«L'archange saint Michel terrassant le démon»
Copie, datée de 1847, d'un tableau de Raphaël.
Croisillon sud du transept. |
|
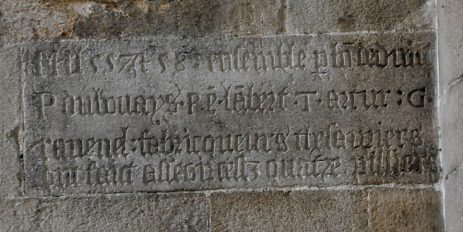
Inscription qui relate la construction des quatre piliers de
la croisée
après l'effondrement de la tour en 1547. |
|
Inscription
dans la croisée. La tour de la croisée
s'effondre le 22 octobre 1547. La cause exacte n'est
pas connue. Dans son article pour le Congrès
archéologique de 2015, l'historienne Michèle
Boccard rappelle qu'en 1547 une partie de l'ancien chœur
roman était encore debout. Est-ce la démolition
de ces anciens éléments (pour achever
le nouveau chœur gothique) qui a provoqué
la chute de la tour ? Aucun document connu ne permet
de répondre. Toujours est-il qu'il fallut consacrer
des ressources pour rebâtir la croisée.
Cette tâche urgente fut achevée dix ans
plus tard. C'est ce que montre l'inscription ci-dessus
:

Mil 557 & 58, ensemble Phi. Deduit,
P. Dubouays, Re. Tabert, T. Artur,
G. Ravenel, Fabriqueurs thésauriers
ont fait asseoir ceslz quatre piliers.

Les fonds consacrés à la reconstruction
de la croisée ont-ils alors manqué pour
remplacer le mur sud roman de la nef par un mur gothique ?
C'est une hypothèse que, là encore, aucun
document ne vient confirmer.
Source : Congrès
archéologique de France, Côtes-d'Armor,
2015, article sur la basilique Saint-Sauveur par Michèle
Boccard.
|
|

La Vierge à l'Enfant (XVIIe siècle)
Retable du Rosaire. |
|
Retable
du Rosaire. D'après une inscription
dans la basilique, il est daté du XVIIIe
siècle. Il est construit sur le thème
du Rosaire donné par la Vierge à
saint Dominique et sainte Catherine de Sienne.
Les statues, qui sont vraisemblablement en bois
peint, sont d'un artiste inconnu. Au deuxième
niveau se trouve un tableau
rassemblant, autour de la Vierge, dans quinze
médaillons, les mystères joyeux,
douloureux et glorieux.
|
|
 |
|

Saint Dominique
Retable du Rosaire. |

Sainte Catherine de Sienne
Retable du Rosaire. |
«««---
Baie 23. La Crucifixion, détail :
La Vierge et une sainte femme. |
|
|
|
Prosper
Mérimée et Du Guesclin à Dinan.
Dans ses Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France,
voyage réalisé en 1835, Mérimée
écrit : «Dans le transsept [sic] nord se
trouve un petit monument d'un goût détestable,
restauré récemment, comme il paraîtrait.
C'est là, dit-on, qu'est renfermé le cœur
de Bertrand du Guesclin. Son nom, que la postérité
a défiguré, comme tous ceux qui sont célébrés
dans une langue étrangère, est écrit
Guéaclin dans l'inscription de Dinant
[sic]. Dans la charte de Rennes, D. Henri le nomme don
Beltran de Claquin. Ailleurs on trouve Glasquin,
Glayaquin. D'après Froissart, qui lui
fait une généalogie tout à fait
héroïque, Glayaquin serait la meilleure
orthographe. Le brave connétable ne savait pas
probablement signer, et de son temps même il semble
qu'on ait estropié son nom de vingt manières
différentes. Du Guesclin, la moins probable de
toutes, à prévalu.»
Source : Notes d'un
voyage dans l'Ouest de la France par Prosper Mérimée,
Paris, Librairie de Fournier, 1836.
|
|
|

Baie 23, détail : Transfert du cœur de Bertrand
Du Guesclin des Jacobins à Saint-Sauveur en 1816.
Vitrail signé : L. Barillet, J. Le Chevallier, Th. Hanssen.
Atelier Louis Barillet, 1940. |

Retable de la Sainte-Famille et son autel datés de 1811.
Croisillon sud du transept. |

La Vierge et l'Enfant.
XVIIe siècle ou XVIIIe siècle.
Retable de la Sainte-Famille. |

Sainte Anne instruisant la Vierge.
XVIIe siècle ou XVIIIe siècle.
Retable de la Sainte-Famille. |
|
Retable
de la Sainte Famille. Cette œuvre occupe
une bonne partie du croisillon sud du transept. L'autel
est daté de 1811 et les statues de la Vierge
à l'Enfant, de Joseph et de sainte Anne instruisant
sa fille Marie remontent, d'après certaines sources,
au XVIIe siècle. La peinture centrale illustre
Jésus au jardin des Oliviers. Point intéressant
: il n'est pas fréquent de voir une Vierge aussi
joufflue.
|
|
|

Baie 24 : La Victoire de Constantin au pont Milvius en 312.
Vitrail signé : L. Barillet, J. Le Chevallier, Th. Hanssen.
Atelier Louis Barillet, vers 1940. |

Pile nord-ouest de la croisée.
Cette pile, qui date de la reconstruction de la croisée
(années 1550), est la plus massive de la basilique. |

Baie 24, détail :
Dinanais devant l'église Saint-Sauveur.
Atelier Louis Barillet, vers 1940. |

«Du Guesclin sur son lit de mort»
Tableau d'Antoine Rivoulon (1810-1864)
Exécutée en 1838, cette peinture a été
offerte à la paroisse par le roi Louis-Philippe. |
|

Baie 24, détail : procession des Dinanais devant un
arrière-plan de basiliques.
On reconnaît de gauche à droite : Saint-Sauveur à
Dinan, Notre-Dame à Lourdes, le Mont-Saint-Michel, Saint-Pierre
de Rome. |
 |
|
Documentation
: Congrès archéologique de France tenu à Saint-Brieuc
en 1949, article sur la basilique Saint-Sauveur par René Couffon
+ Congrès archéologique de France, Côtes-d'Armor,
2015, article sur la basilique Saint-Sauveur par Michèle Boccard
+ «Bretagne gothique» de Philippe Bonnet et Jean-Jacques
Rioult, éditions Picard, 2010
+ «Les vitraux de Bretagne», Corpus Vitrearum,
Presses universitaires de Rennes, 2005
+ «Bretagne romane», Zodiaque, La Pierre-qui-Vire, 1982
+ «Patrimone religieux de Bretagne», édition Le
Télégramme, 2006
«Cathédrales et basiliques de Bretagne», éditions
ereme, 2009
+ «Dinan» de Gérard Malherbe, éditions JOS
Le Doaré, 1976
+ «Dinan» de Peter Meazey, édition Comunicom, collection
«L'Histoire en Héritage», 2002
+ «Notes d'un voyage dans l'Ouest de la France», Prosper
Mérimée, 1836
+ «L'Art breton» d'Henri Waquet, éditions Arthaud,
1931
+ Note sur la basilique disponible à l'entrée de l'édifice
+ Dictionnaire des églises de France, éditions Robert
Laffont, 1966. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|