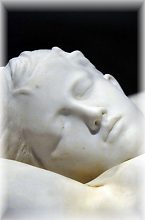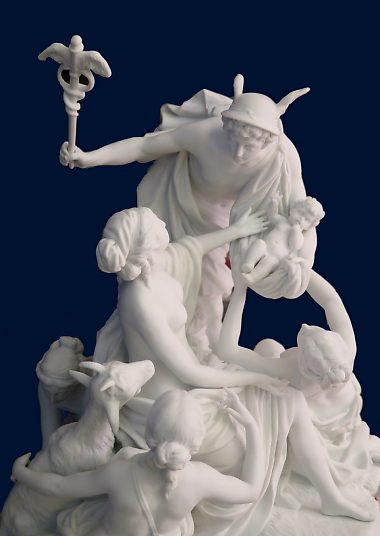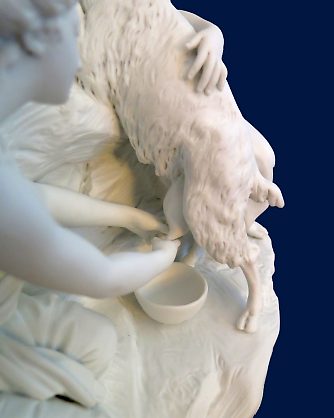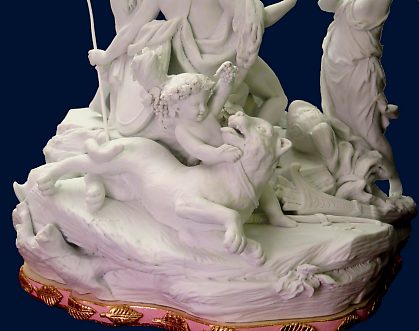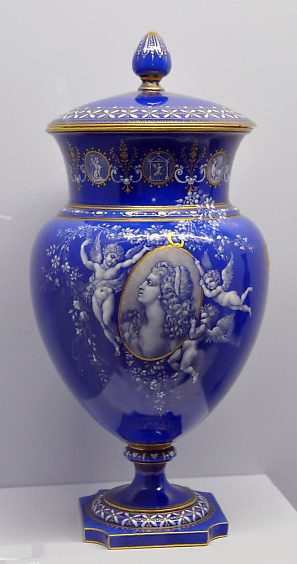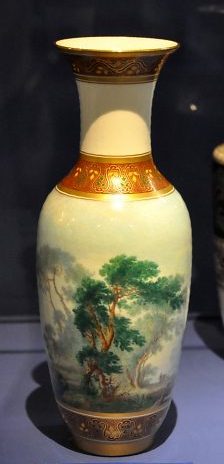|
|
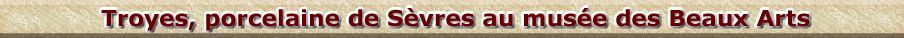 |
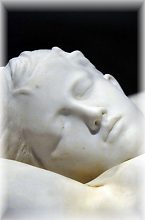 |
La Cité
de la Céramique à Sèvres
possède dans ses réserves des milliers d'objets de
porcelaine (vases, biscuits, vaisselle de table, etc.) qu'elle sort
de temps en temps pour des expositions temporaires, notamment dans
les musées de province. Cette page offre quelques photographies
réalisées lors d'une exposition sur les vases et les
biscuits de Sèvres
du XIXe et du XXe siècle au musée des Beaux Arts de
Troyes.
On y trouvera avec intérêt les modèles créés
durant la période 1773-1800 par Louis-Simon
Boizot, alors directeur de l'atelier de sculpture de la Manufacture
Royale, et traduits en biscuits de porcelaine.
L'univers des vases
de Sèvres est marqué par l'évolution des
formes. Les premiers vases de la Manufacture vont bien sûr
de pair avec l'année de sa naissance (1756), mais les formes
n'ont cessé de varier jusqu'à l'époque actuelle
en passant par l'Art
nouveau des années 1880 et l'Art Déco des années
1920. En boule, en fuseau, en vasque, en cylindre, la liste est
longue. Si l'on y ajoute les différents modes d'ornementation
(jusqu'au procédé en relief dit pâte sur pâte
- voir le vase de l'Âge
d'or), on aboutit à des créations qui sont le
fruit des progrès techniques et des découvertes chimiques.
Chaque époque a connu ses créateurs (citons Boizot
pour le XVIIIe siècle et Carrier-Belleuse pour le XIXe).
Ces hommes furent souvent mandatés pour créer des
formes nouvelles que la direction de la Manufacture pensait mieux
adaptées au goût du marché. Même si elle
demeurait un service de l'État, la Manufacture Royale, Impériale
ou Nationale se devait de renouveler sa gamme pour susciter l'intérêt
des cours européennes et attirer un public de connaisseurs.
|
 |

La salle d'exposition des porcelaines de Sèvres.
Salle annexe du musée des Beaux Arts de Troyes. |
| LES BISCUITS DE
PORCELAINE |
|
|
Louis-Simon
Boizot (1743-1809). Cet artiste très
éclectique a marqué l'histoire du biscuit
à la Manufacture
de Sèvres. Nommé directeur de l'atelier
de sculpture en 1773, Boizot va, pour les biscuits,
créer des modèles de différente
complexité : bustes, modèles à
deux personnages, groupes à multi-personnages.
Ces groupes, dont plusieurs sont donnés dans
cette page, frappent tous par leur équilibre
très harmonieux et la juste disposition des masses.
Bien sûr, on les admire en les regardant de face,
mais la partie arrière ne doit pas être
oubliée car elle recèle toujours un détail
pertinent. Ainsi, dans La
Fête des bonnes gens et Le
Couronnement de la rosière (donné
de face ci-contre), on y trouve un jeune homme qui tient
un panneau où est gravée une inscription
enrichissant la scène. Dans La
Naissance de Bacchus, c'est une nymphe qui trait
une chèvre ; dans Le
Triomphe de Bacchus, c'est un angelot qui joue avec
un lion. Boizot quittera son poste de directeur en 1800
(à la suite d'une drastique compression de personnel...),
mais continuera à créer des modèles
pour la Manufacture.
Par manque de documents formels, l'attribution à
Boizot de certains des groupes multi-personnages n'est
pas une certitude absolue. Mais l'étude du style
et de la composition suffit en général
à lever les doutes. Les historiens d'art se réfèrent
notamment aux visages des personnages. Même petits,
les visages de Boizot sont toujours très travaillés
et expressifs.
Les compositions à plusieurs personnages ne sont
pas nombreuses. Leur réalisation, d'une délicatesse
extrême, exigeait en effet un travail considérable.
Les thèmes traités par l'artiste relèvent
toujours de la mythologie antique ou de la tradition
populaire. On trouvera ainsi dans cette page : La
Naissance de Bacchus, Le
Triomphe de Bacchus, La
Beauté couronnée par les Grâces,
Minerve
protégeant l'Étude et foudroyant la Paresse,
mais aussi Le Couronnement de la Rosière et La
Fête des Bonnes gens). Boizot n'a quasiment
créé aucun biscuit d'ordre religieux.
Cette absence s'explique par son statut de franc-maçon.
Nous savons qu'il est entré en 1777 au Grand
Orient de France où il fréquenta la loge
de Saint-Jean d'Écosse et celle du Souverain
Chapitre. Même si son nom disparait des documents
maçonniques dès 1779, son adhésion
à la franc-maçonnerie n'en est pas moins
révélatrice de son état d'esprit.
Il est généralement connu qu'Élisabeth
Vigée Lebrun fut le peintre attitré de
la reine Marie-Antoinette. On sait moins que Louis-Simon
Boizot fut le sculpteur attitré de la souveraine.
Il réalisa pour elle plusieurs bustes au fil
des ans, traduits en biscuit par la Manufacture Royale
de Sèvres.
Pour l'histoire de l'art, Boizot reste un témoin
incontournable du style Louis XVI, un style qui alliait
la grâce avec une certaine forme de rigueur. Son
rôle de directeur et de créateur à
Sèvres intervint à une époque marquée
par l'irruption du style néo-classique qui portait
en lui le retour à l'inspiration antique. Boizot
sut en tirer profit.
La page de la préfecture de Versailles
présente un autre biscuit de Boizot, l'Alliance,
créé en 1773 en commémoration du
mariage du comte d'Artois. La page du musée de
la Manufacture
de Sèvres contient un biscuit plus impressionnant
encore : Le
Parnasse réalisé par Boizot en 1778-1779
à la suite de la commande d'un service de table
passée par l'impératrice Catherine II
de Russie.
Ajoutons pour terminer que les amateurs d'art peuvent
commander à la Cité de la Céramique
de Sèvres la plupart des groupes de Boizot montrés
dans cette page.
Source : «Louis-Simon
Boizot», Somogy, édition d'Art, 2001.
|
|

«Le Couronnement de la Rosière», partie arrière.
D'après un modèle créé en 1776 par
Louis-Simon Boizot.
Biscuit réalisé en 1892. |
|
| BISCUIT
DE PORCELAINE : LE COURONNEMENT DE LA ROSIÈRE |
|

«Le Couronnement de la Rosière»
D'après un modèle créé en 1776 par
Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé en 1892. |
|
Le
Couronnement de la Rosière.
Ce couronnement était une vieille coutume populaire
célébrée chaque année, le
8 juin, jour de la saint Médard. Elle a été
remise à la mode en France vers la fin du XVIIIe
siècle. «Une jeune fille vertueuse était
choisie par le conseil de la ville pour sa conduite
exemplaire et recevait une couronne de roses blanches,
symbole de sa vertu», lit-on sur la fiche de présentation
du musée.
L'hagiographie attribue à saint Médard la création de la Rosière. Évêque de Noyon au VIe siècle et contemporain de la reine Radegonde, ce fils de paysans aisés fut, selon la légende, seigneur de Salency, village de l'Oise où il était né et où l'on situe le couronnement de la première rosière.
La légende ajoute que celle-ci n'était autre que la propre sœur de saint Médard.
Le renouveau de cette cérémonie, vers 1764, se produisit à Salency. Il illustre la puissance du mouvement moralisateur qui se répandait
alors dans la société française.
Les beaux esprits vantaient les vertus d'une vie simple
baignant dans les bons sentiments. Rousseau et Diderot
développèrent ce thème en littérature
; Greuze fit de même en peinture. Et la manufacture de Sèvres créa ses biscuits.
La scène s'en empara aussi : l'auteur de théâtre Charles-Simon
Favart créa un opéra-comique intitulé
La Rosière de Salency qui fut représenté
à Fontainebleau en 1769, puis à la Comédie
italienne. André Gétry reprendra la pièce
en 1774.
Source : panneau affiché
dans le musée.
|
|
Le biscuit du Couronnement
de la Rosière peut être couplé avec
un autre biscuit donné plus bas : La
Fête des bonnes gens. En effet, dans Le Couronnement
de la Rosière, le panneau ovale brandi par un
jeune homme sur le côté affiche l'inscription
«La Vertu récompensée, 1788».
Dans La
Fête des bonnes gens, un panneau ovale semblable,
tenu à l'arrière, relie le couronnement
du Bon vieillard à la cérémonie
du couronnement de la rosière. On y lit en effet
: «Sagesse et vertu ont ici le même prix
qu'à Salency». Voir la photo en gros plan
plus
bas.
|
|
«««---
Le Couronnement de la Rosière.
À l'arrière du biscuit créé par Louis-Simon Boizot, une
jeune fille pleure en s'essuyant les yeux. Est-ce l'image
d'un espoir déçu? À gauche, un
jeune homme tient un panneau ovale où est écrit
: «La Vertu récompensée, 1788».
Voir ce même thème dans un vitrail de l'église
du Cœur-Immaculée
de Marie à Suresnes (Hauts-de-Seine). Voir aussi l'église Saint-Médard à Paris et la toile de Louis Dupré. |
|
|
| BISCUIT DE PORCELAINE
: LA BEAUTÉ COURONNÉE PAR LES GRÂCES |
|

«La Beauté couronnée par les Grâces»
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1776.
Musée
de la Cité de la Céramique à Sèvres.
|

«La Beauté couronnée par les Grâces»,
détail.
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1776. |
|
La
Beauté couronnée par les Grâces.
Sans aucune certitude, ce groupe de six personnages,
daté de 1776, est attribué à Louis-Simon
Boizot. L'élégance de la composition,
le thème mythologique et les visages très
travaillés font pencher les historiens d'art
et les spécialistes des biscuits de Sèvres
vers ce choix.
La déesse Vénus, assise dans un fauteuil,
désigne une jeune fille qui s'apprête à
recevoir une couronne de roses des mains des trois Grâces.
Les Grâces romaines (ou les Charités chez
les Grecs) étaient les filles de Zeus et de l'océan
Eurynomé. Érigées en divinités
de la Beauté, on y trouvait Euphrosyne pour le
plaisir, Thalie pour l'abondance et Aglaia pour la beauté.
La tradition les représente comme trois sœurs,
nues et se tenant par les épaules. Elles faisaient
partie du cortège d'Aphrodite ou de Dionysos.
Ce groupe était la partie centrale d'un surtout
de table de trois pièces créé pour
Versailles.
On y trouvait aussi L'Offrande à l'Amour
et L'Offrande à l'Hymen.
Source : note de la Cité
de la Céramique à Sèvres.
|
|
|
| BISCUIT DE PORCELAINE
: MINERVE PROTÉGEANT L'ÉTUDE ET FOUDROYANT LA
PARESSE |
|

«Minerve protégeant l'Étude et foudroyant la Paresse»,
partie arrière.
D'après un modèle de Louis-Simon Boizot créé
en 1787. Biscuit réalisé en 1892. |

«Minerve protégeant l'Étude et foudroyant la Paresse»
D'après un modèle de Louis-Simon Boizot créé
en 1787. Biscuit réalisé en 1892.
Minerve tient une lance (disparue) pour foudroyer la Paresse qui se
morfond,
appuyée à la petite tour cannelée. |
| BISCUIT DE PORCELAINE
: LA PÊCHE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

«La Pêche», partie arrière.
D'après un modèle créé par Etienne-Maurice
Falconnet en 1758.
Biscuit réalisé en 1890. |

«La Pêche»
D'après un modèle créé par Etienne-Maurice
Falconnet en 1758.
Biscuit réalisé en 1890. |

«Le Hautbois ou le Concert de hautbois espagnol»
D'après le modèle de François-Joseph Furet (1729-1807)
créé en 1772 pour le service de table du roi Louis XV.
Biscuit réalisé en 1875.
|
| BISCUIT
DE PORCELAINE : LA FÊTE DES BONNES GENS |
|

«La Fête des bonnes gens« ou «Le Bon
Vieillard»
Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé
à la fin du XIXe siècle.
Musée
de la Cité de la Céramique à Sèvres. |
|

«La Fête des bonnes gens» ou «Le Bon vieillard»,
partie supérieure.
On lit sur le panneau ovale : «SAGESSE ET VERTU ONT ICI LE MEME
PRIX QUA SALENCY»
Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé
à la fin du XIXe siècle.
En médaillon : «LA VERTU RÉCOMPENSÉE, 1788»
dans le Couronnement de la Rosière.
Musée
de la Cité de la Céramique à Sèvres.
|

«La Fête des bonnes gens», partie arrière.
Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé
à la fin du XIXe siècle. |

«Le Couronnement de la Rosière», partie arrière
Modèle de Louis-Simon Boizot. Biscuit réalisé
en 1892. |
| BISCUIT DE PORCELAINE
: LA NAISSANCE DE BACCHUS |
|

«La Naissance de Bacchus»
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783. Hors
exposition.
|
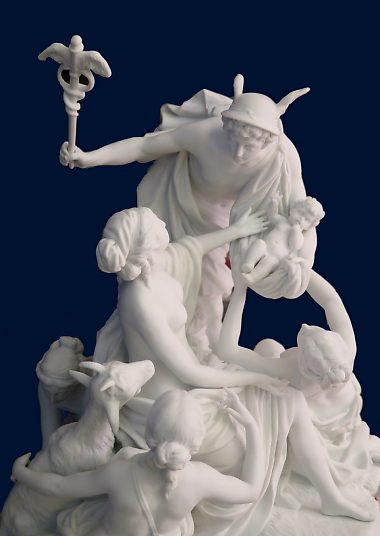
«La Naissance de Bacchus», détail.
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783.
Mercure confie Bacchus bébé à trois nymphes vivant
sur le Mont Nysa. |

«La Naissance de Bacchus», partie arrière.
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783.
|
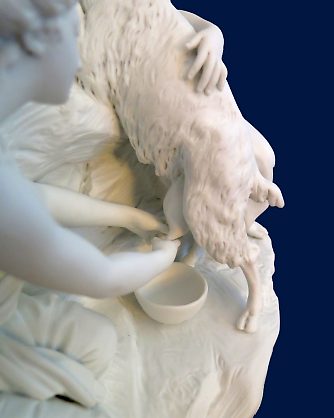
«La Naissance de Bacchus», détail de la partie
arrière.
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot, 1783.
Cette partie du biscuit rappelle que, pour l'ôter à la
fureur d'Héra,
Mercure transforma le bébé, fils de Zeus, en chevreau
(ou en cerf). |
| BISCUIT DE PORCELAINE
: LE TRIOMPHE DE BACCHUS |
|

«Le Triomphe de Bacchus», 1773.
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot et inspiré
d'un tableau d'Hugues de Taraval (1729-1785).
Hors exposition.
Au premier plan, tambourin, masque, sistre, cimbales, flûte
et amphore rappellent les bacchanales. ---»» |
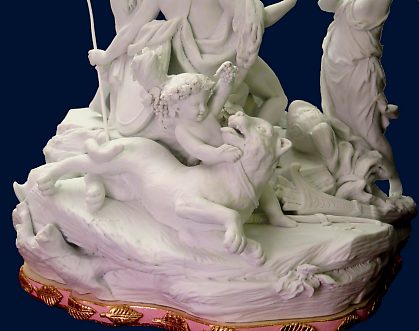
«Le Triomphe de Bacchus», partie arrière.
Modèle attribué à Louis-Simon Boizot et
inspiré d'un tableau d'Hugues de Taraval. |
 |
|
| BISCUIT DE PORCELAINE
: LE REPOS |
|

«Le Repos»»
D'après la sculpture d'Alfred Boucher (1850-1934) créée
en 1890. Biscuit réalisé en 1893. |

«Le Repos»», détail.
|
|
Le Repos.
Ce biscuit de porcelaine a été créé
d'après une sculpture de l'artiste nogentais Alfred
Boucher (1850-1934). L'aspect charnel de l'œuvre
saute aux yeux, mais Alfred Boucher était un habitué
du genre. La page consacrée au musée Paul
Dubois-Alfred Boucher à Nogent-sur-Seine
expose une œuvre, elle aussi très charnelle, L'Hirondelle
blessée, qui eut d'ailleurs à l'époque
beaucoup de succès.
La note de présentation affichée dans l'exposition
nous apprend que cette jeune fille abandonnée au repos
sur son lit de style Louis XVI (on dirait plus avantageusement
qu'elle se prélasse) s'inscrit bien dans l'esprit de
la IIIe République. Cette pose langoureuse prend la
suite de la gestuelle proposée par la tradition néo-classique
telle qu'elle transparaît dans la Pauline Borghèse
de Canova.
Pour réaliser ce biscuit, la note du musée révèle
que la Manufacture de Sèvres a dû créer
au moins vingt-et-un moules, «ce qui en faisait un article
très coûteux, son prix d'alors étant de
800 francs or». Certains modèles de Boizot, aux
multiples personnages, en demandent plusieurs dizaines...
«Il s'agit d'une pièce exceptionnelle dont la
qualité plastique est merveilleusement servie par le
velouté de la porcelaine.», lit-on encore dans
la note.
Source : panneau affiché
dans le musée.
|
|

«Le Repos»»
D'après la sculpture d'Alfred Boucher (1850-1934) créée
en 1890. Biscuit réalisé en 1893. |
|
|

Vitrine de vases de Sèvres. |

Trois vases de Sèvres de type Godron.
La technique du décor flammé qui orne ces vases a été
maîtrisée
par la Manufacture de Sèvres dans les années 1880-1890. |

Trois vases de Sèvres. Au centre : vase étrusque.
La forme du vase étrusque a été créée
par Albert Ernest Carrier-Belleuse en 1881.
Le décor du vase est attribué à Henri Labrouste. |
|
|
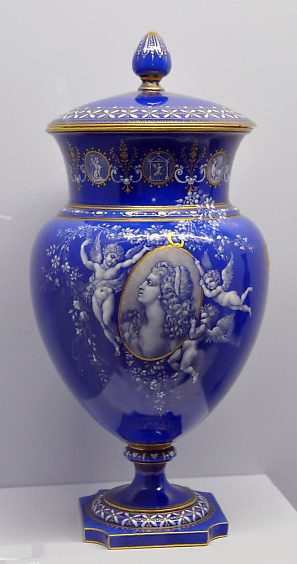
Vase de Nola II.
Forme créée par Albert Ernest Carrier-Belleuse
(1824-1887).
Décor de Jean-Charles Derichweiler. |

Vase «E» décoré de putti. Réalisation
de 1877.
Forme créée à la Manufacture de Sèvres
en 1780
par un styliste resté anonyme.
Vers 1780, une série de formes de vase a été
créée
par des inventeurs anonymes. Cette série est référencée
de manière alphabétique (vases «A»,
«B», «C», etc.). |
«««---
Vase de Lesbos (d'inspiration antiquisante).
Porcelaine de pâte tendre.
Forme créée en 1849 par Jules Dieterle
(actif à Sèvres de 1840 à 1855).
Décor d'Eugène Cabau. |
|
|

Vase de Lesbos, détail de l'ornementation. |

Vase Voltaire.
Porcelaine nouvelle. Forme à côtes.
Vase réalisé en 1893. |
|
Félix
Aubert (1866-1953). Après l'Art nouveau,
style créé par l'École
de Nancy dans les années 1880, l'Art déco
fit irruption dans les années 1920. La Manufacture
de Sèvres suivit cette évolution artistique
en renouvelant son style, en imaginant des formes de
vases plus raides, plus géométriques.
La gamme de ses vases, toujours plus nombreuse, se diversifia
Félix Aubert, qui travailla à la Manufacture
de 1920 à 1924 en tant qu'artiste-décorateur,
créa une série de vases numérotés.
Tous ces vases sont obtenus par la technique du coulage
dans un moule.
La note de l'exposition sur Félix Aubert rappelle
que, jusqu'en 1923, les formes de vase recevaient des
noms de villes, puis de fleuves. À partir de
1923, on donna aux vases le nom du créateur de
leur forme. Félix Aubert fut ainsi le premier
à attacher son nom à des vases.
Source : panneau affiché
dans le musée.
|
|
|
|

Figures féminines dans leur vitrine.
Création de Claude-Édouard Forgeot en 1862. |
|
Figures
féminines. Ces figures, en porcelaine
dure émaillée, ont été créées
par Claude-Édouard Forgeot en 1862. Elles faisaient
partie d'un surtout de table nommé Surtout
aux figures qui fut présenté à
l'Exposition universelle de 1867. Le surtout comprenait
cinq figures féminines, chacune avec son vêtement
et ses coloris propres. Elles portaient toutes un objet
pour décorer la table.
Ainsi la figure féminine porte-étagère
tenait un plateau de bronze doré, décoré
de putti ailés. La figure féminine porte-lumière
tenait, au-dessus de sa tête, un candélabre
arrondi orné de feuillages.
Source : panneau affiché
dans le musée.
|
|
|

Figure féminine porte-lumière. |

La salle d'exposition. |
Documentation : panneaux affichés dans
l'exposition
+ «Louis-Simon Boizot», Somogy, édition d'Art,
2001. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|